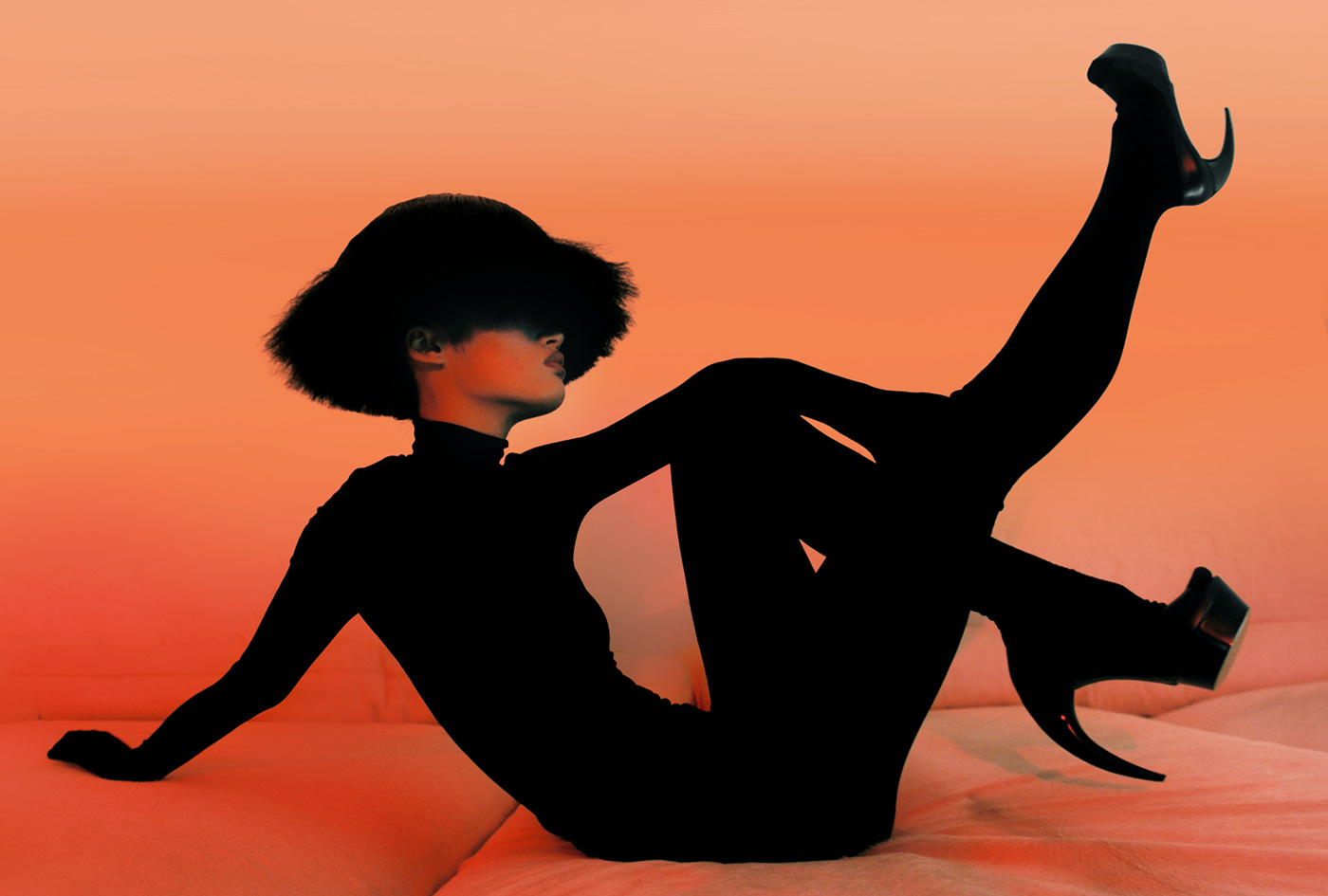Collections Automne 2024
Syra Schenk
Undercover
Combien de marques proclamaient au cours de la dernière décennie dessiner pour la femme moderne et sa vie quotidienne, affirmant qu’elles produisent des vêtements confortables et portables; et dont les vêtements manquent de bon sens et de fonctionnalité, et ne sont souvent pas seyants. Jun Takahashi n’a pas cessé d’étonner sur les 25 dernières années. Peu savent allier couture et streetwear comme lui, sans laisser un arrière-goût gimmick et aigre. Son sens de l’observation, de l’expérimentation et de la créativité sont un enrichissement pour l’univers de la mode, qui semble parfois trop se concentrer sur la commercialité d’un produit, en oubliant que les podiums sont là pour nous faire voyager dans l’univers du créateur. Pour l’automne-hiver 2024, Jun a certainement embarqué son audience, le temps d’une journée dans la vie d’une quadra – mère, célibataire, avocate, tel que Wim Wenders la relate. Et l’audience est captivée, touchée, hypnotisée par la voix douce et monotone, les pas lents et étouffés des mannequins, au long de la journée de cette mère. Wim et Jun ont réellement regardé les femmes. Les ont observées. Des premiers pas à l’aube, préparant le petit-déjeuner de son enfant, sur le trajet vers son bureau, au déjeuner répétitif et solitaire, jusqu’à la sortie d’école… Les silhouettes de chaque mannequin, ponctuées par les paragraphes récités, semblent parfaitement adaptées à l’instant narré. Élégantes, suivant néanmoins leurs mouvements avec aise. Notre héroïne porte son sac en bandoulière – car c’est plus pratique – et emporte toujours un cabas. Ici, puisque nous sommes dans le monde d’Undercover, la baguette a son propre sac en organza, tout comme le sac de pressing à la fin de la journée ou le sac de quincaillerie, qui accompagne une tenue scintillante. Comme toujours, les superpositions de matières familières de Jun, tout comme son mélange éclectique de matières nobles et démocratiques. Chaque look a son élément de surprise, fidèle à la marque, ici une bande de satin se dévoile derrière la grosse maille, là de lourds bijoux dorés ornent une silhouette autrement modeste. Récemment, un homme – blanc, la 60aine – me fit remarquer avec regret que les femmes ne portent plus de stilettos. Les vies d’aujourd’hui ne laissent pas place aux talons aiguilles – les femmes courent de chez elles aux écoles de leurs enfants, au métro, au travail, au diner en ville – et ceci en boucle. Peu de femmes ont le luxe de flâner en stilettos avec tout le temps du monde. Ainsi, la mère de Undercover porte des baskets. Et par moments, un talon très rouge, avec une bouche très rouge. Car la vie d’une avocate mère célibataire c’est aussi ça, un instant de séduction. Avec la pointe de dérision qu’Undercover ne manque jamais nous apporter: une fois la narration de la journée terminée et la voix de Wim éteinte, les looks les plus spectaculaires passent, tels des personnages de rêves, une explosion de couches satinées, dorures, organza. Tout n’est pas ce qu’il semble être.

Undercover
Fall 2024
Gauchère
Marie-Christine Statz est certainement connue pour ses vestes empruntées au vestiaire masculin, et ses boutiques ont souvent souhaité des looks plus féminins. Cette saison, la designer allemande basée à Paris a envoyé défiler des silhouettes étonnamment sensuelles. Ses vestes et manteaux signatures, toujours dans de tissus somptueux et confortables, étaient cette fois-ci superposés à des bodys laissant entrevoir des jambes interminables ou des jupes en gazar. Les pantalons en cuir, parfaitement ajustés, taille haute, portés avec un haut à capuche en jersey tel une seconde peau, glorifieraient toute morphologie. Les épaules ou les dos nus dévoilent un peu de peau, sans toutefois trop révéler. Les cols roulés, toujours part de l’armure confortable qu’elle a créée, sont un trompe-l’œil : le tricot est pris dans une couche d’organza. On parle beaucoup de luxe discret en ce moment, et Gauchère n’a rien de gauche à ce sujet : Statz maitrise ses matières et sait rendre des looks classiques résolument modernes et désirables.
Loewe
Jonathan Anderson est un créateur cérébral. Lorsqu’il se met un thème en tête, il le traite sous toutes les coutures, l’exploite, le détourne et le retourne. Pour la collection FW24, il parle de sa fascination pour la désuétude de la noblesse, leurs maisons de campagne aux signifiants reconnaissables entre pairs. Les imprimés floraux à première vue un peu mièvres, que l’on retrouve en tapisserie, rideaux, couverture de lit et canapés, sont ici des robes longues, d’une coupe minimaliste, cintrées à la taille avec une large boucle, tel un rideau pris dans une embrasse. Les imprimés animaliers – carlins et faisans – sont appliqués en broderie perlée, dans un travail d’une précision remarquable. Le queue de pie est over-size, cyniquement porté sur un sarouel bouffant, à imprimé végétal, qui semble se gonfler à chaque pas, ou sur un pantalon d’homme à fines rayures brodées de perles. Les manteaux en feutre de laine, à double patte de boutonnage, en apparence conventionnels, sont ornés d’un col effet fourrure – or la fourrure est ciselé dans du bois laqué. Un imprimé surréaliste orne une tenue minimaliste, ou le col blanc immaculé se transforme en fourrure ou cuir d’autruche plus on descend vers les chevilles. Le tartan ne manque pas à l’appel bien évidemment, ici il est partiellement flouté sur une robe longue, là il semble griffonné au stylo – Anderson expérimente souvent à détourner des motifs traditionnels en les traitants de manière inhabituelle, il y a deux saisons il avait créé un trompe l’oeil de tenues pixelisées. La cerise sur le gateau, ou la plume sur le chapeau de chasse, est sans aucun doute le pull en maille grise, un mouton de poussière qui enveloppe la jeune femme au pantalon marron de gentleman. Et on voudrait lui emprunter sur le champ ! Parsemé dans cette extravaganza créative, les pièces commerciales dont J.W. Anderson a le talent – un blouson en fausse fourrure aux proportions parfaites, le traditionnel bomber d’aviateur dans un cuir souple dont Loewe a le secret, les petites tenues pyjama en cotton, les pantalons très larges dans des matières fluides. Seule la veste de chasse en ciré semble manquer dans ce riche tableau de campagne surannée. Merci Jonathan pour ce cour magistral de mode onirique mais désirable.

Loewe
Fall 2024
Mugler
Thierry Mugler lui-même était un showman. Il est sans aucun doute le créateur qui a introduit le spectacle à la mode : ses présentations de la fin des années 80 et du début des années 90 restent gravées dans notre mémoire – il louait des salles de concert entières, faisait apparaitre des nymphes des cieux, son emblématique défilé Hiver Buick envoyait les mannequins vêtues de pièces automobiles sur le podium, et nous nous rappelons tous du grandiose spectacle pour son 20e anniversaire, mettant en vedette l’armure que Zendaya a récemment portée. Nous sommes certainement resté un peu sur notre faim de ce côté de Mugler, les dernières années. Cadwallader n’a pas déçu cette saison : son spectacle a commencé comme une version classique de défilé, deux filles marchant droit devant un rideau gigantesque. Ce dernier se trouve soudainement aspiré dans le néant, pour révéler une autre scène avec une dramatique Kirsten McMenamy, vêtue dans un incroyable ensemble en cuir à boucles. Cadwallader a complètement pris son public de court, envoyant défiler les mannequins les plus emblématiques des années 90 – Eva Herzigova, Ester Canadas, Farida Khelfa, d’un acte à l’autre sur scène. Les robes étaient très Mugler – scandaleuses, sexy, renversantes. Ses subtils hommages à certaines robes iconiques du maître lui-même – le jeu avec le col de smoking sur plusieurs pièces, drapant ici une épaule ou façonnant par là un bustier, ont été enrichis de la vision de Casey. Les peintures audacieuses d’Amber Wellmann, traduites en impressions sur velours et soie, sont le coup de foudre qui traverse la collection par ailleurs sombre. Cadwallader a également sculpté sa propre armure : deux robes en jersey, renforcées avec des structures chromées aux hanches et aux épaules, qui rendaient les mannequins résolument fières et cool. La petite incursion dans le prêt-à-porter masculin était peut-être superflue dans ce spectacle par ailleurs extra-ordinaire.
Duran Lantink
Le designer hollandais a fait irruption sur la scène en tant que finaliste du prix LVMH en 2019, avec ses volumes extrêmes. Emprunté dans une certaine mesure à l’école japonaise – Rei – sa manière de bomber le corps est cette fois rendu de manière plus sensuelle. Ses matières sont dénaturées de leurs proportions intrinsèques – ici, une maille écossaise classique est rembourrée et enroulée autour du corps, une parka prend des proportions Klaus Nomi et un blouson à capuche déperlant devient un body (ou serait-ce une tenue de super-héros ?). Il semble avoir murrit cette saison – son esthétique signature est déclinée de manière plus portable, tout en préservant ce look si fort: les épaules du premier look en maille rouge sont dignes de Montana, mais garantissent une confiance en soi glorifiée, une doudoune devient un pullover très convaincant, et les vestes en mailles servent certainement d’excellentes pièces à superposition. Bien que la collection soit nommée Duran-Ski, difficile de faire confiance à autre chose que les grosses pièces pour la saison, mais le jeu de cuissardes ou chaussettes mi-cuisses, associées à des shorts ou mini-jupes, donnent une alternative rafraichissante au pantalon. Et son dernier look, une robe noir de tapis rouge, bustier avec capitonnage signature – économiserait certainement un aller-retour à Rio pour des implants. L’approche durable de Duran Lantink veut qu’une partie de la collection est sourcée de deadstocks ou de vintage – bien que le processus soit louable, il reste à voir s’il peut être déployé à long-terme dans une industrie à forte croissance d’une saison à l’autre.

Duran Lantink
Fall 2024
Marlastar
(Marie Adam-Leenaerdt)
La jeune designer belge en est à sa troisième saison et a réussi ce que peu ont su réaliser : rassembler une équipe solide autour d’elle, avec Etienne Russo (Villa Eugénie) produisant ses spectacles, Lucien Pagès gérant les relations presse, et Rae Boxer au styling (Mastermind Magazine). Ses vêtements intrigants, mais parfaitement portables ont convaincu ces vétérans de l’industrie. Les racines belges de Adam-Leenaerdt et son expérience à La Cambre sont visibles dans son travail, où rien n’est vraiment ce qu’il semble être. La collection FW24 tourne autour de la jupe, la jupe, la jupe. Tout est une jupe ici, cintré et puis évasé. La jupe est une cape, une robe, une robe de soirée, un trench. Les signifiants des power girls des années 80, épaules carrées, pied-de-poule et tartan, sont exagérés et glissent des épaules surdimensionnées. Les jupes – les vraies – sont déconcertantes – vois-je un drapé, ou serait-ce une poche…? Le tricot drapé, ici une cape, là une robe à capuche, est aussi invitant que les vestes matelassées surdimensionnées avec encore une fois un col cintré et une ligne A. Marie Adam-Leenaerdt ne prend pas la mode trop au sérieux, ce serait trop parisien, comme elle l’a déclaré lors de sa première collection. Elle cherche à garder son travail amusant, ludique et portable, et jusqu’à présent, elle tire dans le mille.
Rêverie par
Caroline Hu
Caroline Hu était une des finalistes du prix LVMH en 2019, attirant ainsi l’attention internationale. Sa collection FW24 a été présentée dans un hôtel particulier du 7e arrondissement, dans une atmosphère presque lugubre – sombre et brumeuse. Les onze robes présentées semblaient toutes sorties d’un conte, peut-être féerique, peut-être morose… Elles montrent certainement un niveau incroyable d’artisanat et de créativité presque couture. Ses poupées punk avaient chacune une silhouette très distincte, déambulant lors la présentation devant le public, regardant dans le vide ou défiant les regards des spectateurs. En ses propres mots, Caroline a été marquée par son père, un peintre, et son sens de l’expression émotionnelle. Ses vêtements sont sa façon à elle de traduire son univers émotionnel. Son kaléidoscope est ludique, coloré et complexe. On cherche à scruter la robe pour comprendre chaque pli, chaque broderie, chaque couche. Elle drape et fronce le tulle, un matériau signature ; créant une silhouette éthérée, qui semble parfaitement à l’aise dans cette salle de bal opulente mais délabrée. Caroline voit cette collection comme une étude de la distance et de l’espace entre les gens, et observe que la distance perçue et la distance physique peuvent par moment être perçues très différemment. Pour soutenir son propos, elle a créé une silhouette semblable à une armure, avec des basques rembourrées à motif floral, telle une Infante espagnole, maintenant tout le monde à une distance physique imposée; Caroline emporte certainement les femmes qui la porte dans son propre espace narratif, et nous suivrions volontiers.
Texte de Syra Schenk

Préservation passive
Fidèle à sa réputation, la Maison Paco Rabanne continue de repousser les limites des matériaux qu’elle emploie. Avec une approche quasi fétichiste, la dernière collection, ici mise en images par Luna Comte, se décline en vinyles et mailles métalliques, pour une sensualité réincarnée.
C.Q.F.D. (encore)
du sexe
Luca Marchetti
Les définitions du mot « sexe » données par les dictionnaires courants commencent généralement par des phrases telles que « La conformation particulière qui distingue l’homme de la femme en leur assignant un rôle. » Il y a de quoi se demander si les compilateurs de ces entrées savent vraiment de quoi on parle… Heureusement, il suffit de lancer une recherche d’images sur n’importe quel navigateur, pour constater à quel point les représentations visuelles de ce terme sont variées, surprenantes et visiblement indénombrables.
Cet écart se produit parce qu’il n’y a jamais de correspondance directe entre les « concepts » et leur imaginaire. Ce dernier est infiniment plus fluide et multiforme, il se dilate, se comprime et change perpétuellement suivant la sensibilité des individus, selon le moment historique et en fonction de la culture spécifique à chaque société. L’imaginaire contemporain du sexe sera donc déterminé par ce que nous avons hérité du passé et par des expériences encore en train de se faire, étroitement liées à ce qui se passe dans notre présent.
L’attention que le sens commun donne aujourd’hui à la singularité des individus, à la sensibilité des minorités ethniques, culturelles ou de genre, en plus de l’importance accordée au corps, à la perception sensorielle et à l’affect en général, met en lumière des aspects de la sexualité traditionnellement relégués dans l’ombre de « l’exception » ou de la « banalité », parce qu’elles ont été considérées en dessous de ce seuil minimum d’intensité sans lequel il ne peut y avoir ni excitation ni plaisir. Le psychiatre Gaëtan Gatian de Clérambault en parlait déjà dans son ouvrage La Passion érotique des étoffes chez la femme de 1908, où il décrit le lien orgasmique que certaines de ses patientes entretiennent avec certains tissus, comme le velours. Au début du XXe siècle un tel phénomène était considéré comme une « déviance » voire une « pathologie ». En revanche, il est plus surprenant de constater qu’à l’ère Tinder ou Grindr, où on imaginerait un débridement sexuel extrême et sans limites, des communautés entières d’individus s’identifient en tant qu’adeptes du yiff (le contact intime avec la fourrure animale), woolies (fétichistes de la laine) et s’épanouissent par l’abstinence programmée ou par d’autres stimulations charnelles habituellement considérées comme non érogènes.
Parmi les multiples raisons (certaines bien mystérieuses) à l’origine de ces évolutions dans l’imaginaire sexuel de notre temps, l’attention que la culture contemporaine porte aux questions de transition de genre et d’identité ne doit pas être sous-estimée. À travers les témoignages, les écrits et les expériences de ceux qui sont ou ont été en transition, on rencontre souvent une sexualité poly-perceptive, pas strictement génitale, dans laquelle le corps est ressenti comme «un champ de bataille» – selon les mots du romancier amérindien canadien trans et queer Billy-Ray Belcourt (A History of My Brief Body, (2021) – dont chaque partie doit être réinventée, explorée, et peut être érotisée. De même, l’artiste musicale trans Arca milite pour un nouvel érotisme où tout est exploration sensuelle, bien au-delà du bon vieux coït.
Tout cela existait bien sûr avant même les années 2000, mais il est probable que la sensibilité collective ne soit pas encore suffisamment mûre pour inclure de telles pratiques dans l’imaginaire commun du sexe.
C’est ce que note, également, le philosophe et journaliste trans français Paul Preciado, étonné qu’il ait fallu attendre 2020 pour que l’autobiographie de John Giorno (Great Demon Kings, A memoir of poet, sex, art, death, and lighting, McMillian, 2020) révèle au grand public les expériences sexuelles du poète-star américain avec de célèbres artistes des années 1970 et 1980, tels qu’Andy Warhol ou Jasper Johns, fanatiques du sexe avec les pieds, les tétons ou la bouche…
Ce qui par le passé aurait pu nous apparaître comme de simples ragots ou des « confessions scabreuses » est considéré maintenant comme un aspect de l’expérience sexuelle tout à fait encouragé par nombre d’experts, sociologues, psychologues et philosophes du bien-être, comme Alexandre Lacroix (Apprenons à faire l’amour, Allary Éditions, 2022).

Boutique Balenciaga, Mount Street, Londres, 2022. ©Balenciaga
Le philosophe décrit une relation sexuelle exempte de clichés sociaux et culturels, une expérience bien plus vaste que la banale pénétration. Entre deux (ou plusieurs) partenaires, celle-ci pourrait même ne jamais exister, si le moment sexuel est capable de solliciter tous les sens et de créer de la beauté sous d’innombrables autres formes de partage.
On doit à un autre philosophe, l’italien Mario Perniola, l’anoblissement des relations charnelles entre nos corps animés et d’autres inanimés, tels que les machines, les objets et les vêtements. Dans sa conception visionnaire du sexe, c’est la contiguïté entre le corps et son environnement qui se trouve au cœur même du principe du plaisir charnel, jusqu’à imaginer le monde tel un « vêtement ressentant » dont on s’habille et sur lequel on se frotte pour en tirer de la jouissance. C’est certainement à ce « sex-appeal de l’inorganique » – comme Walter Benjamin définissait au début du XXe siècle la sensorialité typiquede la mode – que Demna Gvasalia a pensé lorsqu’il a imaginé le design d’intérieur de la boutique Balenciaga de Mount Street à Londres. Cet espace aux formes utérines, entièrement tapissé de fausse fourrure rose, a été conçu pour que le visiteur soit en fusion sensuelle avec le contexte et s’empreigne de l’essence mêmedu produit que la boutique entend promouvoir : le Cagole Bag (dont le seul nom suffirait à évoquer une sexualité polymorphe et pas si conventionnelle).
En poussant plus loin la réflexion de Perniola, encore un philosophe italien, Emanuele Coccia suggère qu’il existe une relation profonde, existentielle entre notre espace et notre plaisir charnel. Il remarque que la relation que de nombreux humains « écologiquement éveillés » entretiennent avec une Terre « en danger », a une intensité comparable au sentiment érotique. Mais loin d’être une déviance, ou une pathologie, il la qualifie de nécessité. D’après ce penseur du monde vivant, ce ne sera pas l’écologie militante qui transformera le genre humain en une forme de vie durable, mais son appétit charnel du monde qui le poussera à le préserver pour continuer à assouvir sa soif de plaisir. Et l’on parle déjà de sextainability…
Texte de Luca Marchetti
Quand les talons
pour hommes
s’ensanglantent
Antoine Bucher
Si aujourd’hui un homme en perruque, talons et maquillage a de grandes chances d’appartenir à un programme télévisé de RuPaul, au XVIIe et XVIIIe siècles, ce type de description correspond facilement à un membre masculin de l’aristocratie européenne.
Au XVIIe siècle, les nobles prennent notamment de la hauteur grâce à leurs chaussures et c’est d’abord aux pieds des hommes que les talons hauts s’installent dans les cours royales. La fréquentation diplomatique des ambassadeurs de Perse au début du XVIIe siècle cultive la curiosité pour ce qu’on appelle alors l’Orient et la mode des souliers à talons gagne progressivement les courtisans inspirés par ceux des cavaliers perses qui leur permettent de caler les pieds dans les étriers. Alors que sous Louis XIV, les représentations de mode masculine abondent avec le développement de la gravure de mode sous l’impulsion notamment des éditeurs d’estampes Jean Dieu de Saint-Jean et la famille Bonnart, de nombreuses eaux-fortes représentant les tenues en vogue n’oublient pas de représenter ces souliers qui rajoutent de la hauteur aux grands du monde sur les centaines d’images qui sortent des presses de la rue Saint-Jacques, haut lieu de l’estampe française (cf. illustration). Si ces gravures de mode imposent à partir de 1670 un format vertical standardisé présentant un personnage en pied dont la parure est détaillée avec soin, mais au visage indifférencié, la paternité des tendances de mode peut être attribuée à certains personnages de la cour. Ainsi, le duc d’Orléans, le frère du roi, qu’on appelle alors Monsieur est croqué par Saint-Simon dans ses Mémoires en 1701 comme un amateur portant à ses pieds les modèles de talons les plus importants : « C’était un petit homme ventru, monté sur des échasses tant ses souliers étaient hauts, toujours paré comme une femme, plein de bagues, de bracelets et de pierreries partout, avec une longue perruque tout étalée devant, noire et poudrée et des rubans partout où il pouvait mettre, plein de sortes de parfums, et, en toutes choses, la propreté même. »
Monsieur, alors l’un des personnages les plus important du royaume, mais aussi un expert en débauche, ajoute une touche de couleur aux talons de l’aristocratie. Lors d’une nuit de fête de 1662, le frère du roi finit avec son entourage sa soirée dans l’anonymat des tavernes du cœur de Paris et traverse notamment le quartier de la Grande Boucherie près du Châtelet. Le sang des animaux colore les talons du fêtard et le roi s’en inspire en commandant à son cordonnier des talons rouges. Ils deviennent alors une mode à Versailles puis à la cour d’Angleterre par l’entremise du cousin de Louis XIV, le roi Charles II. Un rare exemplaire d’une version habillée d’une estampe des années 1690 représentant le souverain français met l’accent sur cette nouvelle tendance. Publiée par l’éditeur Antoine Trouvain, la gravure finement découpée comporte des parties ajourées habillées de morceaux de textile. Ce type d’objet réservé aux collectionneurs les plus fortunés de la fin du XVIIe siècle voit ici les talons royaux laisser apparaître un morceau de tissu rouge. Ce montage réalisé dans ce cas à l’époque diffère de la version originale de l’eau-forte qui ne différencie pas le talon et le corps de la chaussure. Pour les clients de ce type d’œuvres, plus chères encore que les versions rehaussées en couleurs à la main, il semble alors important de mettre l’accent sur les pieds du roi. Quelques années plus tard, le peintre Hyacinthe Rigaud ne manque pas de souligner de rouge les talons du roi dans son magistral portrait de Louis XIV en costume du sacre qu’il réalise en 1702. La tendance dure et ouvre la voie à l’utilisation aux XVIIIe et XIXe siècles de l’expression « les talons rouges » pour décrire les nobles et notamment les courtisans. Le Dictionnaire Universel de 1896 décrit un talon rouge comme « un homme de la cour qui avait des talons rouges à ses souliers ce qui était une marque d’élégance et de distinction », mais la synecdoque sous-entend également de grandes manières et une affectation certaine, à l’image des plus importants courtisans du royaume. En 2019, le Metropolitan Museum associe d’ailleurs Monsieur, l’inventeur de ces talons colorés, au développement du « camp » lors de l’exposition Camp Notes. La mode des semelles rouges couplées à des talons aiguilles est, elle, une histoire d’un autre genre…

Jean dieu de Saint-Jean, Homme de Qualité en Surtout, 1683. Librairie Diktats
La voyageuse
contemplant
une mer de nuages
Simone Rocha
La collection Printemps 2022 de Simone Rocha a conduit le public dans l’église médiévale de St Bartholomew-the-Great à Londres dont l’atmosphère lugubre et sinistre, mais également sublime et sacrée, offrait une ambiance parfaite pour les silhouettes de la créatrice. Pendant que les mannequins défilaient sur le podium, le spectateur avait l’impression d’assister à un baptême allégorique, les vêtements évoquant les tenues revêtues pour une cérémonie chrétienne qui semble devenir, d’une certaine manière, troublante et poignante. En jouant avec la thématique de l’enfance, de la naissance, mais aussi de la maternité, Simone Rocha parvient à célébrer le corps féminin dans l’expérience de l’accouchement et de l’adaptation au rôle de mère. Nous avons rencontré la créatrice pour parler de ses inspirations pour la collection et de sa méthodologie de travail.
Lorsqu’on lui a demandé s’il existait un lien entre ses expériences personnelles et ses créations – au moment de la présentation de la collection, elle venait d’avoir son second enfant – Simone Rocha a répondu :
« Je trouve difficile de concilier les deux, donc je suppose que ma situation authentique de maternité s’est naturellement infiltrée dans mon travail. »
Cette « infiltration naturelle » n’est donc pas simplement une inspiration fugace, mais doit être considérée davantage comme une évolution organique de la vie de la créatrice et de son approche des créations.
Le printemps 2022 marque en effet le 10e anniversaire de sa première collection griffée Simone Rocha. Tout au long de la décennie, elle est parvenue à développer certaines caractéristiques clés qui sont restées des constantes dans chaque collection. Parmi les détails qui définissent l’identité de la marque on retrouve l’exagération des dimensions de certains éléments tels que les cols et les manches, l’utilisation impulsive de volumes démesurés sur des silhouettes classiques et enfantines et celle de symboles irlandais et catholiques comme ornements. Après avoir obtenu une licence en mode au National College of Art and Design de Dublin, Simone a suivi le Master de mode du Central Saint Martin’s College de Londres, dont elle est sortie diplômée en 2010. C’est là qu’elle a pu travailler sur différents textiles et découvrir les possibilités qu’ils offrent pour créer un vêtement :
« Je me suis toujours intéressée aux silhouettes et aux volumes, j’ai toujours aimé les déplacer, jouer avec les proportions, exagérer les détails et travailler avec les tissus dans les mains. Il faut être mis au défi et bousculé, l’expérimentation est donc cruciale. Mais les créations en elles-mêmes résultent toujours de la collaboration avec mon équipe et nous avons maintenant une signature qui résonne dans chaque collection. »
Le jeu avec les possibilités offertes par le studio de mode fait partie de l’ADN de la créatrice. En effet, son père, John Rocha, est un créateur installé à Dublin qui travaille dans l’industrie de la mode depuis les années 1980. En grandissant, elle a baigné dans le design de mode en accompagnant son père au studio et en l’aidant à développer ses collections. Sa mère, Odette, travaille également aux côtés de son mari depuis ses débuts à Dublin et accompagne aujourd’hui Simone dans ses prises de décisions pour sa marque solo. Rocha reconnaît cette dynamique quand elle affirme :
« La plus grande chance que j’ai eue en grandissant dans un environnement aussi créatif, c’est que ma créativité n’a jamais été remise en question, elle a toujours été acceptée. »
Par conséquent, sa famille et ses racines irlandaises ont toujours joué un rôle central dans sa vie de créatrice, d’abord avec ses parents à Dublin, puis aujourd’hui avec la famille qu’elle a fondée à Londres. D’une certaine manière, ses collections sont un moyen de réinterpréter et d’analyser ses expériences personnelles, par exemple la maternité lors du défilé du printemps 2022. Il est difficile de concilier ces deux activités, et elles se déroulent donc, biologiquement, en parallèle. À ce sujet, Simone ajoute :
« Avec chaque collection, je peux mettre le doigt sur ma vie, le contexte et les événements à ce moment précis. Mes collections naissent d’abord de mes émotions et, avec elles, j’explore de nouvelles idées, des récits multiples et des sensations diverses. »
Ces sensations ne doivent pas nécessairement être toujours brillantes et éblouissantes. Ce qui ressort de l’expérience dans la collection est souvent un fil conducteur, en partie sombre, troublant :
« Je pense qu’il y a toujours un contraste, et un élément sous-jacent. »
La maternité, par exemple, apporte aussi avec elle le dérèglement du sommeil, l’insomnie, et est indissociable du corps qui a dû se transformer, presque se disloquer, pour accueillir un autre être humain. Les vêtements de Simone Rocha parviennent à célébrer avec brio cette transformation primitive et nécessaire dans laquelle de nombreuses femmes peuvent se retrouver. En ce sens, sa vision de la féminité est précise. Il était donc presque naturel de lui demander si, après une décennie, elle pourrait transposer cette vision en parfum. La créatrice pense qu’un éventuel parfum Simone Rocha sentirait « le bois brûlé et la tubéreuse. »
Sa vision personnelle s’inscrit également dans le contexte plus large de ses collections. Le cinéma, par exemple, joue un rôle important dans leur élaboration. Pour la collection Automne-Hiver 2020, par exemple, Simone a travaillé en collaboration avec le réalisateur Hugh Mulhern. Elle a utilisé le support du clip pour contextualiser davantage les silhouettes en se concentrant sur les mouvements, les effets textiles et des détails particuliers.

« J’adore travailler avec les réalisateurs de films, surtout lorsqu’ils sont comme Hugh et qu’ils ont une vision personnelle si forte. J’aime amener mes pièces dans un nouveau monde. Un peu comme lorsque j’ai fait un film avec Petra Collins et que mon travail est presque devenu un personnage du récit. »
Les réalisateurs sont capables de ré-imaginer ses vêtements et de les recontextualiser, en analogie ou en contraste avec l’idée originale. L’ensemble du processus devient un échange fertile entre les deux créateurs.
D’une manière générale, les films que Simone a cités comme sources d’inspiration alternatives sont en adéquation avec sa personnalité. En tête de liste, le grand classique Chambre avec vue, de James Ivory, un drame romantique complexe qui se déroule à Florence au début du XXe siècle. Vient ensuite In the Mood for Love de Wong Kar-Wai, une histoire d’amour située dans les années 1960 à Hong Kong, d’où le père de Simone est originaire. Elle ajoute ensuite deux films dans lesquels on peut voir des symboles internationaux du cinéma irlandais : Le Cheval venu de la mer et The Field. Plus tard, son intérêt se portera vers Londres, avec Les Chaussons rouges, une histoire d’amour tragique racontant les péripéties d’une ballerine dans les années 1940. Enfin, elle ajoute à sa liste Fish Tank, un film de la réalisatrice britannique Andrea Arnold, l’histoire de l’enfance troublée d’une jeune fille tiraillée entre famille et amants.
On est également surpris de constater que lorsqu’on lui demande si sa dernière collection – automne 2022 – pourrait être traduite en film, elle choisit précisément Andrea Arnold comme scénariste pour adapter ses vêtements en récit cinématographique. Une collaboration entièrement féminine pour repenser dans un contexte plus large les femmes Simone Rocha, personnages principaux de son récit. Elle précise qu’elle y verrait une adaptation de la légende irlandaise des Enfants de Lir. Ce mythe, qui a inspiré Le Lac des cygnes, raconte l’histoire de quatre frères et sœurs condamnés par leur belle-mère, jalouse de l’amour et de l’attention que leur accorde leur père, à passer 900 ans sous la forme de cygnes. Ainsi transformés, les enfants ne parviennent à conserver leur voix humaine que pour chanter des mélopées susceptibles d’attirer l’attention de leur père qui découvrirait enfin la vérité sur sa nouvelle épouse. Le charme n’est rompu que lorsqu’il entend sonner une cloche, la première cloche chrétienne à sonner en Irlande. À partir de là, ils peuvent mourir sous leur apparence humaine tandis que leur mémoire sera conservée grâce à ce mythe. Quand on écoute cette histoire ancienne, on remarque bien sûr la métaphore entre les élégantes créatures blanches des quatre cygnes, fascinantes à première vue mais au destin tragique,
TEXTE D'ILARIA TRAME
Baby Rock
and Doll
Nicolas di FeliceCaroline PoggiJonathan Vinel
Après de nombreuses années à travailler dans l’équipe du designer Nicolas Ghesquière, et un rapide passage dans le Dior de Raf Simons, Nicolas di Felice a tout récemment été nommé directeur artistique de la maison française Courrèges. Enfance dans un petit village belge, non loin de néons de maisons closes, puis études à la Cambre à Bruxelles, qu’il ne termine pas pour rejoindre Paris, et Balenciaga.
Jonathan Vinel et Caroline Poggi font des films, le plus souvent ensemble, parfois séparément. L’un est né dans une banlieue proche de Toulouse, l’autre dans une des grandes villes de Corse. On peut notamment citer Bébé Colère, court-métrage sorti en 2020, commandé par la Fondation Prada ; Martin Pleure, réalisé intégralement sur le jeu vidéo Grand Theft Auto V, ou encore à leur premier long-métrage Jessica Forever.
Décrire les travaux des uns comme des autres en quelques mots serait réducteur, tant les mondes qu’ils proposent sont denses. Leur échange, une fin d’après-midi, en face du parc des Buttes-Chaumont, dessine les contours de leurs univers.
Nicolas di Felice
Je suis encore en train de prendre le rythme chez Courrèges. J’ai commencé il y a un an et demi. C’est la première fois que j’ai ce rôle de directeur artistique. J’ai tendance à être assez control freak : le rapport que j’ai aux vêtements est extrêmement précis. Je pense que jusqu’à présent, je donnais des directions très précises à mon équipe. Pour la collection qui défile en mars, je me suis forcé à lancer un genre de brief, et ne faire qu’un seul dessin. Je suis parti une semaine, et puis j’ai vu ce que mon équipe proposait. C’était très enthousiasmant de voir ce qu’ils comprenaient. Un certain nombre de pièces sont des propositions, des dialogues avec certains des stylistes – j’apprends à travailler avec cette nouvelle équipe.
Caroline Poggi
Après avoir travaillé avec Prada sur notre court-métrage Bébé Colère, Jonathan et moi avions pu assister au développement d’une collection : elle n’était prête que deux ou trois jours avant le défilé.
Jonathan Vinel
C’est tellement différent du cinéma, cette temporalité.
Caroline Poggi
En tout cas, c’est différent de notre façon de faire du cinéma. On est dans quelque chose de très préparé. Nos envies de scènes demandent beaucoup d’acteurs, de la lumière… On ne peut pas arriver et dire : on verra sur le moment. En assistant à ça, je ne comprenais pas.
Nicolas di Felice
Je connais vraiment ce genre de choses… Quand j’ai commencé chez Balenciaga en 2008, c’était encore très petit. Dans les vieilles collections, les vêtements sont parfaits – aussi parfaits que ce dont ils avaient l’air. On croirait qu’ils sont photoshoppés, mais non. On avait une équipe pour le défilé, et puis une équipe pour la pré-collection. Des stylistes travaillaient six mois sur cinq pièces. On les refaisait, encore et encore, jusqu’à ce qu’elles soient parfaites. Si la surpiqûre était un peu trop large, on recommençait tout le vêtement. De nos jours, on peut lancer un vêtement en patchwork de cuirs colorés cinq jours avant un défilé, alors qu’on n’avait pas commandé ces matières encore trois mois avant. Il faut alors, en un temps record, trouver le motif du patchwork, les cuirs, il faut lancer la pièce, la faire fabriquer… C’est un peu fou.
Revue
Vous pensez que les méthodes de travail ont changé entre 2008 et aujourd’hui ? Ou c’est quelque chose d’autre ?
Nicolas di Felice
Je pense que c’est une question de moyens… Aussi, je ne trouve pas ça confortable de faire les choses dans la précipitation. Même si j’ai déjà fait un certain nombre de choses, je me sens – peut-être comme Caroline et Jonathan – toujours en construction. On a envie d’être fier de ce qu’on fait, d’être sûr.
Caroline Poggi
Il y a un temps qu’on est obligé d’avoir, de mûrissement, pour laisser les idées grandir, avoir du relief. Même quand on cherche des pages d’illustration, que l’on pense à la façon dont on va les montrer à des gens, on pèse quelle image arrive en premier, en deuxième…
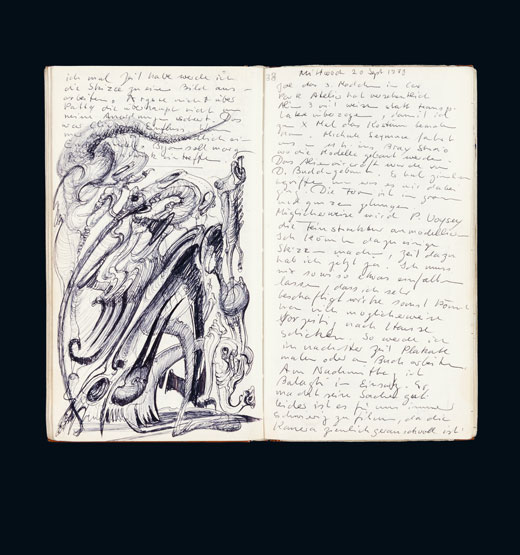

Extrait du livre d’H.R. Giger, Alien Diaries / Alien Tagebücher, Edition Patrick Frey, 2013 (première édition). Avec l’aimable autorisation des éditions Patrick Frey.
Tout ça a un équilibre, que tu ne peux pas trouver en deux jours. C’est dur d’arriver à quelque chose qui a du relief, une profondeur, une histoire, quand tu es dans la pression. Tu as tendance à marcher plus à l’instinct – même si ça peut être bien.
Nicolas di Felice
Ça peut être beau aussi… Une pièce à laquelle tu n’avais pas pensé, une scène que tu n’avais pas voulue…
Caroline Poggi
Je pense qu’il faut les deux. On peut garder cette notion d’instinct sur un temps plus long. C’est quand tu retravailles trop quelque chose que tu perds le désir.
Jonathan Vinel
Nicolas, est-ce que tu as une histoire de marque à respecter, ou est-ce que tu es totalement libre ? Est-ce que tu peux tout changer ?
Nicolas di Felice
J’ai hérité de la maison dans l’état dans lequel elle était, il y a un an et demi. Je n’ai eu aucune exigence de qui que ce soit. La famille Pinault, à qui Courrèges appartient, ne savait pas ce que j’allais présenter : je n’ai fait aucun dossier d’images, de croquis… J’ai été engagé sur une lettre, où je racontais ma vie. Ils ont parié sur moi, ne sachant absolument pas ce que j’allais faire. Je n’ai jamais rêvé d’avoir ma marque, avec mon nom. Ce qui me plaisait dans le projet, c’est de faire revivre une maison que j’affectionne beaucoup, et qui m’a toujours inspiré.
Jonathan Vinel
Mais qui a aussi un héritage.Nicolas di Felice C’est pour ça que, dès le début, j’ai voulu que l’on fasse des rééditions. Personne au marketing ne m’a rien demandé.
Quand j’ai repris la maison, il me semblait primordial de réfléchir à ce que je voulais proposer, et produire. On parle tout le temps d’écologie... Je voulais réfléchir à ce qui allait être produit, pour ne pas gaspiller. Formellement, mais aussi dans mes idées. Faire un hommage à la maison, ne pas arriver en détruisant tout à grands coups de massue. De manière générale, je n’aime pas trop ce genre d’entrée.
Je trouvais cette marque super belle, comme un petit symbole de quelque chose que je ne retrouvais plus autour de moi. Même le fait que ce soient des vêtements très géométriques, des à-plats de couleurs, des matières absorbantes, très nettes… Dans le flot d’images que je voyais, les images de Courrèges : tout à coup, juste une forme colorée. C’était une respiration très inspirante pour moi, que j’avais envie d’honorer.
Jonathan Vinel
Je me dis que parfois tu dois avoir des idées qui te plaisent, qui te semblent justes, mais qui ne le sont pas par rapport à Courrèges…
Nicolas di Felice
Oui, bien sûr… Mais ça ne me brise jamais le cœur de faire un choix.
Jonathan Vinel
Où vont tous ces trucs que tu ne peux pas faire ?
Nicolas di Felice
Je les transforme pour que ce soit Courrèges, je ne laisse pas tomber l’idée.
Caroline Poggi
Ç’a à voir avec la réception de ton travail : comment ça va être reçu, qui regarde… Comment tu montres un film, c’est pareil.
Jonathan Vinel
Quand on a une commande, on se positionne toujours par rapport à comment ça va être perçu, et comment on dialogue avec ça. Quand tu arrives dans une maison qui a une certaine histoire, j’ai l’impression qu’il y a forcément cette question de comment tu vas te positionner par rapport à elle : parfois, le fait que ça ne corresponde pas à la maison, ça peut aussi créer d’autres envies…
Nicolas di Felice
Les idées rentrent toutes, d’une manière ou d’une autre. Même si c’est seulement du point de vue de l’idée, ce que racontait la pièce… On lui fera raconter la même chose, mais différemment. Il y a ce truc d’opposés qui se rencontrent. Mes inspirations ne sont pas du tout des petites dames des années soixante : je suis inspiré par des choses qui sont sans doute similaires aux vôtres. C’est comme si ça passait très naturellement par un filtre, et que je les remélangeais.
Jonathan Vinel
À chaque collection, tu as une idée un peu globale ou tu la trouves au fur et à mesure ?
Nicolas di Felice
Je me dis tout en une seconde. La musique, le défilé, le lieu, le style… Ça vient comme un flash. Je vois les choses très vite. Le reste du temps, c’est pour tout traduire.
Jonathan Vinel
Pour moi, j’ai l’impression que c’est l’inverse. Au début, c’est plein de petites envies ; et il faut travailler pour qu’elles sortent de quelque chose de purement fétichiste, qui ne veuille pas dire grand-chose… Trouver l’histoire de ces envies en les montant ensemble.
Caroline Poggi
Il y a des images dont tu sais au fond de toi que ce sont des premières images.
Jonathan Vinel
Le totem, un peu.
Caroline Poggi
Ce ne sont pas forcément des images qui restent, au final. Mais c’est l’origine, le battement de cœur… Si tu as l’impression de te perdre, tu reviens à cette image et bon, c’est bon, tu peux repartir. Après, forcément, tu creuses, tu donnes des formes, du relief… Ça part de quelque chose d’intuitif, qui le devient de moins en moins. Tu es obligé de formuler tes idées en permanence, encore plus en étant deux : on passe notre temps à parler, à verbaliser. Petit à petit, il y a des codes, des genres, des ambiances, des sons, des musiques qui viennent héberger ces images initiales.
Nicolas di Felice
Quand je m’emballe dans les belles surprises que je rencontre dans le processus, j’essaie de me rappeler, me remettre dans ces images du début. Ou bien, quand on n’a pas le lieu que l’on veut pour faire un défilé, il s’agit quand même de trouver la manière de raconter l’histoire que l’on avait en tête. Heureusement, il y a une évolution au cours du processus : tout ce qui en fait partie est intéressant, même parfois certains incidents.
Jonathan Vinel
Est-ce que tu te racontes une histoire quand tu crées une collection ? Ou bien est-ce que ce sont des choses visuelles, sensorielles ?
Nicolas di Felice
Je ne me raconte que des histoires. À la Cambre, c’était assez troublant, parce qu’ils tenaient quand même à l’art en général. Tu découvres des artistes, des expositions qui résonnent un peu en toi. Mais j’avais du mal à venir avec des documents d’inspiration. Caroline, je t’avais entendu parler de votre court métrage After School Knife Fight, et je me reconnais dans cette idée de tenter de représenter un sentiment – c’est la fin de l’adolescence, ce film. Je n’étais inspiré que par ce genre de choses. Une fille que j’avais croisée à un festival de musique, qui dansait devant un mur de speakers… Mais va trouver cette image !
Caroline Poggi
Et même si tu en avais une image, elle ne représenterait pas le moment.
Nicolas di Felice
Pas vraiment.
Caroline Poggi
C’est un état.
Nicolas di Felice
Ce sont des moments, des sentiments, des rencontres. Après, heureusement, à trente-huit ans, j’ai eu la chance de trouver des artistes…
La première fois que j’ai vu des photos de John Divola, je me suis dit mais c’est exactement tout ce que j’aime. J’avais l’impression de comprendre totalement ce qu’il faisait, mais aussi d’être compris. Il y a aussi des photos de Mapplethorpe...
Maintenant, je peux faire des moodboards, mais pendant mes années d’école c’était problématique… Jonathan, Caroline, est-ce que vous fonctionnez avec des moodboards ?
Caroline Poggi
Je n’aime pas ce mot.
Nicolas di Felice
C’est vrai, moi non plus
Caroline Poggi
Mais je vois évidemment ce que tu veux dire. Moi aussi je dis comme ça, parce que c’est difficile d’appeler ça autrement. Et puis, nous en faisons.
Jonathan Vinel
Énormément. Le problème, c’est que souvent, dans les images, je cherche à montrer le sentiment qu’elles m’évoquent. Quand tu les montres, les gens vont voir des formes, des couleurs… Alors que c’est quelque chose d’intime qui te rattache à cette image. Souvent, ce n’est pas dans l’image elle-même.
Caroline Poggi
On a beaucoup de retours, en commission – alors que moi j’adorais nos moodboards, que j’étais contente de l’effet que ça produisait sur moi, que ça me donnait envie de faire le film – « C’est dommage, car les images ne correspondent pas trop à l’imaginaire qu’on s’en fait. » Et c’est vrai que ce n’est pas collé, ce n’est pas illustratif. C’est un état, quelque chose d’un peu plus large. C’est tellement dur à transmettre.
Jonathan Vinel
C’est déjà du montage. Les images ne sont pas là pour aiguiller une fabrication précise, mais pour donner un sentiment global de ce que l’on veut dans le film – de l’ordre de la sensation. C’est dur à capter. Souvent, les gens s’arrêtent précisément à ce que l’on voit dans l’image.
Caroline Poggi
« Mais il n’y avait pas cette scène dans le moodboard ? »
Jonathan Vinel
Parfois, on n’en fait pas, comme ça chacun projette ce qu’il veut.
Caroline Poggi
C’est dur de trouver la balance, surtout lorsque l’on fait un travail qui n’est pas naturaliste : arriver à transmettre l’atmosphère, l’univers, de tes plans, de tes scènes. Le problème c’est que ceux à qui s’adressent nos moodboards, qui souvent doivent financer le film, en voient tellement que c’est difficile de leur demander de faire un effort. Il faut que les choses soient simples, faciles à prendre.

Image extraite du livre d’H.R. Giger, Alien Diaries / Alien Tagebücher, Edition Patrick Frey, 2013 (première édition).
Avec l’aimable autorisation des éditions Patrick Frey.
Nicolas di Felice
Je vois très bien. Ce qui motive une collection, c’est souvent quelque chose que j’aurais du mal à exprimer par une image. Quand je fais les premiers briefs de collection, je parle à mon équipe, je leur raconte des histoires. J’ai l’impression – et c’est ce que je ressens aussi dans votre travail – que mes projets demandent beaucoup d’énergie, donc j’ai besoin d’être motivé par quelque chose qui me touche.
Jonathan Vinel
S’il n’y a pas déjà une image qui résume parfaitement, c’est peut-être là aussi que ça vaut le coup de le faire.
Caroline Poggi
Ce qui est difficile pour moi, c’est que je suis la dernière spectatrice de mes films. Je fais un film que j’aimerais voir au cinéma, que j’aime profondément, mais je suis tellement dans le process que je suis incapable de le voir. Jessica Forever, sorti en 2018, on l’a seulement revu dernièrement – quatre ans plus tard. Et encore, on le voit avec du recul – c’est notre film. Je trouve ça quand même fou comme métier.
Nicolas di Felice
Ce sont des films que vous faites avant tout pour vous ?
Caroline Poggi
Non, je les fais pour partager quelque chose que je n’arrive pas à retransmettre autrement.
Jonathan Vinel
Je les fais quand même pour moi, à la base. Quand j’ai commencé, c’était dans l’idée de m’amuser. Il y avait quelque chose de puéril à se dire cette image, avec cette musique, je n’ai jamais vu, j’ai envie de voir ce que ça fait. C’était de l’ordre du test : se dire que quelque chose n’a pas l’air possible, le faire, en être content, et voilà, c’est ça le film. J’ai toujours gardé ce rapport instinctif, de désir, de joie. Au début, j’arrive à les revoir ; mais après, avec toutes les critiques… Tout abîme ton film. Quand j’en fabrique un nouveau, je n’arrive plus à voir celui d’avant.
Nicolas di Felice
Tu as peut-être aussi des regrets, liés aux compromis nécessaires sur le tournage…
Jonathan Vinel
Oui. Parfois je me dis : comment j’ai pu faire ça ? J’ai envie de me couper la tête. Mais je suis toujours content de l’énergie dans laquelle on a travaillé. On a l’impression, quand même, d’être allé au bout de l’idée de ce qu’on voulait raconter.
Caroline Poggi
Mais alors toi, Nicolas, c’est quoi qui t’a fait commencer ? Tu savais que tu voulais faire des vêtements ?
Nicolas di Felice
Je n’étais pas prédestiné à faire ça. J’ai fait des études générales, les jésuites… Vient le moment où tu as 17 ans, et il faut choisir ce que tu fais. J’ai dit : la mode. On me demande tout le temps quels sont mes premiers souvenirs de mode. Je viens de la Belgique profonde, il n’y avait pas vraiment de magazines de mode. Mes parents n’achetaient pas Vogue. J’ai compris ce qu’était la mode par la musique, les clips : pouvoir être qui tu veux par le vêtement, la coiffure… Construire une image. Ensuite, quand j’ai découvert ce que c’était, j’ai vite été happé par le côté manuel de la chose. J’adore fabriquer des vêtements. Je prenais beaucoup de temps, à la Cambre, pour faire les vêtements.
Jonathan Vinel
Tu faisais tes vêtements, jeune ?
Nicolas di Felice
Dès que je suis arrivé à Bruxelles, oui. Je customisais tout.
Jonathan Vinel
Mais plus jeune ?
Nicolas di Felice
Non, je n’avais pas de machine à coudre. Mais je me déguisais tout le temps. Mes parents n’ont qu’une seule photo de moi habillé comme ils m’avaient habillé le matin. Sinon, il n’y a que des photos de moi déguisé.
Caroline Poggi
Moi aussi j’avais la malle aux déguisements, que je sortais le weekend. C’était un panier à linge blanc. On avait une petite caméra. Avec mes copines, on la posait, en mettant le petit écran devant nous pour voir le retour, et on se déguisait, on racontait des histoires.
Nicolas di Felice
Tu faisais déjà des films… Toi, Jonathan, tu faisais aussi des images, petit ?
Jonathan Vinel
Non, j’ai commencé assez tard. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire. J’aimais bien les films, mais je n’en regardais pas trop quand j’étais petit. À un moment, j’avais un pote qui voulait faire des films : j’étais chaud, j’ai acheté une caméra. J’y ai pris goût en faisant. C’est comme ça aussi que j’ai pris goût au montage : essayer de fabriquer des films en chopant des images sur Internet, et en voyant ce que ça racontait en les mettant ensemble. J’aurais voulu faire un BTS montage, mais je n’ai pas été pris. Alors je suis allé à la fac de cinéma. J’avais le sentiment d’être en retard, d’avoir zoné. J’avais redoublé ma seconde, puis j’avais arrêté un IUT qui me soûlait, donc je travaillais à l’usine à côté… Je me disais que si je choisissais le cinéma, il fallait que je travaille dur, que je me lance. C’est pour ça qu’on a commencé tôt à faire des films, même en étant à l’école. C’est quelque chose que j’ai vraiment appris. Je n’étais pas prédestiné à ça. Je pense aussi qu’on m’a montré les bons films aux bons moments, qui m’ont fait des chocs assez forts.
Nicolas di Felice
Quels films ?
Jonathan Vinel
Le premier c’était Elephant de Gus van Sant, que mon oncle m’avait emmené voir. J’ai pris un énorme kick. Deux mois après, j’ai vu Mulholland Drive de David Lynch. Ces deux films ont été très fondateurs : je me suis dit que c’était ce que je voulais faire. C’était aussi lié à la musique. À la base, j’étais bassiste dans un groupe de métal, et je voulais faire ça. Mon premier choc esthétique, c’était Slipknot et Korn. Caroline et moi, on parlait récemment du micro du chanteur de Korn, qui a été fait par HR Giger, celui qui a créé la créature et le vaisseau dans Alien.
Nicolas di Felice
Cette idée de musique est toujours importante dans vos films : vos choix de soundtrack…
Caroline Poggi
On travaille tout le temps avec la musique.
Jonathan Vinel
C’est même sans doute une des choses qui nous a donné envie de faire des films…
Caroline Poggi
… écouter certaines musiques au cinéma.
Jonathan Vinel
Ce sont des musiques liées à un univers, un sentiment.
Il y a ce truc ado, emo : je ne suis pas bien dans ce monde-là. On choisit des musiques agressives, un peu extrêmes. Des musiques qui essaient de tout casser.
After School Knife Fight, c’est le film qui en parle le plus. Pourtant, c’est le plus doux qu’on ait fait. On était en train d’essayer d’avoir les financements de Jessica Forever, un film avec beaucoup d’armes, qui traite de la violence. On a aussi fait Martin Pleure en attendant, celui qui a été fait dans Grand Theft Auto.
Nicolas di Felice
Habituellement, les jeux vidéo ne me touchent pas du tout esthétiquement. J’aime y jouer, mais en terme d’esthétique, j’aime plutôt les choses avec du grain, délavées, les VHS… Quand c’est trop en HD, ça me tend. Pourtant, je trouve que Martin Pleure est très beau. C’est ce contraste entre ce truc complètement froid de la super technologie, et Martin qui dit des choses touchantes.
Jonathan Vinel
C’est un film qui s’est fait très simplement, qui n’était pas écrit. Ce n’est même pas en le faisant que c’est devenu un film. Ça le devient parce que, à force, tu en as envie. Sur le moment, on ne savait pas.
Caroline Poggi
Tu attendais, on attendait, tu me disais : je ne sais pas ce que je vais faire, donc je vais filmer GTA, faire un avatar… De fil en aiguille, tu as écrit un texte. Comme Bébé Colère, notre dernier film : il y a eu les images, l’idée du Bébé, puis la commande de la fondation Prada. On a inclu le film dans leur commande.
Jonathan Vinel
Pendant le confinement, Prada est venu nous voir. Nous avions déjà commencé le film, mais leur commande y correspondait.
Caroline Poggi
Le début de l’idée de ce film, c’est de partir exclusivement d’images d’archives. Nous nous sommes dit que ces archives, nous les avions déjà – sauf que c’était nous qui les avions tournées. On est arrivés avec des images de la Corse, de Toulouse… Et après on a créé le Bébé, qui est un peu une archive aussi : c’est un asset qu’on a acheté, pimpé et animé.
Jonathan Vinel
Il existait déjà.
Caroline Poggi
Et c’était chouette que le film se retrouve sur YouTube. Il parlait avec le moment, avec les un an et demi que l’on venait de vivre, enfermés chez nous à se demander à quoi bon, et il y avait ce bébé qui se demandait exactement la même chose.
Revue
Et vous Nicolas, comment avez-vous envisagé ce moment des confinements, et notamment la production de défilé sous forme de vidéos ?
Nicolas di Felice
Une vidéo d’un défilé de mode, je trouve ça très compliqué. Le premier film, on l’a tourné en une seule prise, comme un vrai défilé. Et c’était diffusé une heure et demie après. J’ai l’impression que cette énergie se voit. Il manquait juste le public.
Jonathan Vinel
Même si un projet ne se passe pas exactement comme on aurait pu l’espérer, on garde toujours des choses des idées que l’on a eues.
Nicolas di Felice
J’ai l’impression que toutes les discussions que l’on a, les rêves que l’on s’échange, même si ça ne se fait pas, ça laisse toujours quelque chose que l’on peut ressortir le lendemain. Les grosses looses aussi, d’ailleurs.
Caroline Poggi
Il y a des personnages que l’on fait sauter de projet en projet. On se dit toujours : la prochaine fois, ce sera la bonne !
Nicolas di Felice
J’ai une robe, aussi, qui est là depuis le premier défilé. Et qui a un peu changé, mais finalement je l’ai trop changée… J’ai revu sa première version, et je me suis rendu compte qu’il fallait que je m’en rapproche à nouveau. Je pense que ça va être son moment, là.
Jonathan Vinel
Pour chaque collection, tu repars de zéro ? Ou il y a des idées, des fils que tu tires de collection en collection ?
Nicolas di Felice
Je tire des fils non-stop. Je ne repartirai jamais de zéro.
C’est une histoire que j’écris petit à petit. Qui a commencé depuis que l’on m’a donné l’opportunité de parler en mon nom. Je pense que je fais ça pour que ça ait un sens pour moi. Tout ce que je fais a été une évolution.
Le premier défilé, c’était la boîte blanche. Puis, le suivant, on était uniquement dans la nature, mais le carré blanc était peint sur l’herbe. Et la dernière campagne, ce sont les mêmes personnes qui étaient dans le carré blanc, endormies dans le métro. Et ensuite, le défilé de mars arrive.
Jonathan Vinel
Ça se déploie, comme des échos.
Nicolas di Felice
J’essaie de laisser quelques surprises, mais la trame est écrite. Je ne peux pas recommencer à zéro. Je fais un métier où on ne sait jamais quand ça va se terminer, et j’en ai conscience. Si ça se termine demain, j’ai envie de regarder ce que j’ai fait, et me dire que j’ai écrit une histoire qui a un sens pour moi.
Caroline Poggi
Quand je vois que nous on travaille sur un scénario pendant quatre ans… Ça correspond à ce que tu dis. Tu pars avec tes totems, tes images de cœur, et puis tu les fais grandir. Mais tu grandis aussi avec…
Les coiffures
à l’échelle
Antoine Bucher
OU QUAND LES ARISTOCRATES AVAIENT
ENCORE TOUTE LEUR TÊTE ET BIEN PLUS
Au cours du dernier tiers du XVIIIe siècle, la coiffure féminine connaît une période d’extravagances capillaires durant laquelle la taille de la tête et des cheveux peut représenter près du tiers de la silhouette d’une élégante. La hauteur des créations conduit à les baptiser coiffures à l’échelle.
C’est au règne de Louis XVI que la vogue des coiffures hautes est généralement associée, mais il convient de noter l’existence de quelques précédents dans l’histoire de France. L’un d’eux, et sans doute le plus fameux est l’apparition de la Fontange. Décoiffée au cours d’une partie de chasse en 1680, la duchesse de Fontanges invente sur le vif une coiffure verticale à partir de sa jarretière. Le roi approuve, le succès est au rendez-vous et la coiffure prend à la fois plus de hauteur et le nom de cette maîtresse de Louis XIV. La poussée de croissance est toutefois limitée dans le temps et le règne de Louis XV reste, pour sa part, mesuré quant à l’ornement de la tête des femmes. C’est sans compter sur la dernière favorite du roi… Madame du Barry arbore en effet une coiffure toute en hauteur agrémentée de dentelles, plumes et fleurs naturelles lors de sa présentation à la cour en 1769. À cette occasion, le coiffeur dissimule même dans les cheveux des fines bouteilles d’eau dans lesquelles trempent les tiges des fleurs.
Les années 1760, 1770 et 1780 sont alors marquées par la puissance grandissante des coiffeurs grâce au développement de structures verticales. Les images de coiffures se multiplient alors comme jamais auparavant. Le naturel n’est pas à la mode et les têtes se vêtent de compositions de plus en plus architecturées. Construites souvent avec un coussin nommé pouf, elles sont gonflées à l’aide de crin et de faux cheveux. Ces véritables pièces montées se parent de rubans, de dentelles, de perles, de fleurs, de pierres, et parfois même de petits personnages de cire, d’oiseaux empaillés ou de maquettes. Les références à l’antique mais surtout aux actualités deviennent le sujet de ces coiffures. Le dernier opéra, une pièce de théâtre, la vaccination du roi ou une victoire militaire se transforment en sculptures capillaires. L’une des plus célèbres de l’époque est la Belle Poule, créée en hommage à la victoire navale du navire français éponyme contre la flotte anglaise en 1778.

Coeffure au chien couchant, gravure d’une suite de 31 Coiffures, inspirées de la Gallerie des Modes et Costumes Français (Allemagne, circa 1780). Librairie Diktats.
Elle comporte au sommet du crâne une maquette de bateau. En cette période d’extravagances, les coiffeurs se revendiquent comme de véritables artistes et utilisent la gravure pour faire connaître leurs créations et asseoir leur autorité. Legros fait ainsi paraître un traité illustré, Davault des almanachs et Depain des estampes. Ce dernier publie trois suites d’eaux-fortes représentant des coiffures entre 1777 et 1790. La première, Au Beau Sexe se compose de douze planches présentant des créations qui n’ont rien à envier à celles que Léonard, le coiffeur de Marie-Antoinette réalise pour la reine de France. Wartell immortalise d’ailleurs en 1777 « l’Autrichienne » dans un portrait dédié à la Comtesse de Polignac. Les cheveux de l’élégante jeune femme sont coiffés pour former quatre boucles sur les côtés et surmontés au sommet de trois plumes qui surplombent des couronnes de fleurs et des rubans.
La correspondance entre Marie-Thérèse d’Autriche et Marie-Antoinette ne manque pas d’ailleurs d’évoquer les cheveux de la jeune souveraine. L’impératrice appelle alors sa fille à plus de sobriété dans ses coiffures dont elle condamne la taille et les ornements. Copiées dans les différentes cours, les coiffures hautes deviennent un sujet de caricature dans toute l’Europe. Les gravures exagèrent la hauteur des compositions et le caractère impraticable de ce type d’ornement. Malgré leur coût élevé, un encombrement non négligeable et des démangeaisons fréquentes dues à l’hygiène limitée et à l’utilisation de pommades pour fixer l’ensemble, les coiffures hautes restent à la mode jusqu’à la Révolution. Et même, un petit peu au-delà. Les coiffeurs tentent en effet de les adapter au goût révolutionnaire. Depain est ainsi l’un des rares à publier des gravures de mode au moment de la Révolution et les planches de sa troisième suite parue vers 1790 reproduisent des coiffures aux noms évocateurs : sans Redoute, à l’Espoir, aux Charmes de la Liberté, à la Nation. Portant encore la mention « avec privilège du roi », elles constituent de précieux témoignages des toutes premières années postrévolutionnaires. Trop associées avec l’aristocratie, les coiffures hautes ne survivent toutefois pas longtemps à la décapitation de la clientèle.

Bonnet au Levant, gravure d’une suite de 31 Coiffures, inspirées de la Gallerie des Modes et Costumes Français (Allemagne, circa 1780). Librairie Diktats.

La Belle Poule, gravure d’une suite de 31 Coiffures, inspirées de la Gallerie des Modes et Costumes Français (Allemagne, circa 1780). Librairie Diktats.
Psychedahlia
Richard Quinn
On pourrait présenter la mode de l’Anglais Richard Quinn en évoquant ses volumes extravagants et ses imprimés audacieux. Il ne faudrait pourtant pas oublier sa maîtrise du trompe-l’œil. En jouant sur un motif qui se répand de la tête aux pieds, il cisèle des silhouettes qui se révèlent dès lors qu’elles se mettent en mouvement. L’endroit devient envers, l’image se déploie et le volume s’anime. Un art de la métamorphose qui rappelle que les fleurs, signatures graphiques du créateur, peuvent être aussi romantiques que psychédéliques. Rencontre avec l’auteur de la plus excitante des hallucinations collectives.
Lorsque l’on demande à Richard Quinn s’il est en mesure d’expliquer ce que l’on perçoit comme une fascination pour le monde floral, tant il emploie ce motif à travers ses collections, la réponse sonne comme l’affirmation de son amour pour la mode : « Quand on observe ce qui a été fait dans le passé par les maisons de couture parisiennes, on retrouve toujours un imprimé floral. Vous pouvez l’utiliser de manière stricte ou alors avec beaucoup de douceur, et je trouve ça particulièrement intéressant. Tout dépend de l’intention que vous souhaitez insuffler. Je trouve que c’est une bonne base. » Assurément, le créateur a profité de ses études à la Central Saint Martins School pour explorer l’histoire de la mode et de la couture, des années 1950 à nos jours, de la femme-fleur célébrée par Christian Dior avec la silhouette New Look aux robes gladiateurs de Nicolas Ghesquière pour Balenciaga qui composent l’iconique collection printemps-été 2008. Né en 1990 à Londres, dans le quartier d’Eltham dans le sud-est de la ville, Richard est le plus jeune d’une fratrie de cinq enfants. Son parcours à Saint Martins fait rêver : diplômé en 2016, sa collection remporte le H&M Design Award, qui se concrétise par une aide financière et la commercialisation de plusieurs pièces disponibles dès l’automne 2017. On y retrouve déjà ce qui fait le style Richard Quinn : des imprimés floraux de la pointe des talons jusqu’au bout des doigts gantés pour un collage graphique et survitaminé. Quelques mois plus tard, il fait défiler sa première collection dans le calendrier officiel de Londres. Pour la seconde, dédiée à l’automne 2018, les mannequins traversent un décor fait de papier peint, clin d’œil aux origines de ces fameux motifs végétaux. On a beaucoup parlé de la présence de la Reine Elizabeth II dans le public, un événement en soi puisqu’elle assistait ainsi à son tout premier défilé. Mais au-delà de cet adoubement royal, les vingt-neuf looks présentés ont impressionné par leur maîtrise.
Les volumes, semblables à des carrés de soie surdimensionnés, s’enroulent autour des corps. Les imprimés sont comme désynchronisés et jouent la confrontation, faisant se rencontrer les époques et les styles. Les fleurs graphiques dessinées façon années 1970, les compositions végétales tout en arabesque, les pois blancs sur fond noir – de différentes tailles –, tout se superpose et se mélange. Une telle surenchère pourrait faire basculer ces silhouettes dans le costume, et pourtant, il n’en est rien.
Richard Quinn a le sens de l’équilibre. Sa mode est fantasque tout en étant crédible. De quoi convaincre Moncler de lui proposer de collaborer à la ligne Moncler Genius, succédant ainsi à ses camarades Craig Green ou JW Anderson.
Rares sont les jeunes designers à avoir impressionné avec leurs premières collections. Sortir du lot est déjà une épreuve. Pourtant, les difficultés s’intensifient dès lors que le studio doit grandir. Contrôler sa croissance sans trahir son identité, respecter un calendrier fait de logistiques industrielles, gérer une économie fragile… Plus rares encore sont ceux qui réussissent ce tour de force. Face à ce challenge, Richard Quinn a décidé d’investir dans son indépendance : « Tout est imprimé dans nos ateliers. Cela nous permet d’être réactifs et de tester directement les idées en ajustant les échelles et les couleurs. » Justement, lorsqu’on le questionne sur son processus créatif, il répond : « Il n’y a pas vraiment de règles, je mélange les approches. Parfois nous assemblons les éléments à la manière d’un collage, d’autres fois j’ajoute un nouvel élément sur une ancienne toile précédemment utilisée pour un essayage. Si nous travaillons sur un très gros volume, on va le draper sur le mannequin, ou alors, on va se servir d’essais qui se trouvent dans l’atelier. L’idée est de traduire les intentions rapidement à partir de ce que l’on a. Évidemment, faire des croquis est important, mais je pense que le fait de travailler concrètement le volume offre beaucoup plus. » Cette méthodologie permet au créateur d’étendre son univers tout en perfectionnant son langage.
Il suffit d’ailleurs de voir le court-métrage qu’il a proposé pour dévoiler son automne 2021 afin de constater l’évolution – mais aussi les ambitions – de Richard Quinn. On y suit les pérégrinations d’une héroïne évoluant parmi des hordes de chats et de chiens incarnés par des silhouettes humaines outrageusement moulées dans du latex noir, clin d’œil à la Catwoman de Tim Burton et à la culture BDSM. Celle-ci est choisie par les chats pour devenir leur nouvelle reine. Pour avoir une idée plus précise de l’ambiance, pensez à Fritz the Cat, le matou imaginé par Robert Crumb catapulté entre les songes d’Alice au pays des Merveilles et les pas de deux de Black Swan. Le film est un délire en technicolor qui bénéficie de chorégraphies signées Dane Bates, rappelant les extravagances des comédies musicales de l’âge d’or d’Hollywood.

Photographie de Thibaut Grevet
Mais surtout, tout cela suinte de sensualité, voire de sexualité. Il y a un paradoxe dans les récentes propositions du créateur. En habillant l’entièreté du corps, il occulte totalement la peau, et par extension la nudité, mais révèle totalement la silhouette. Le corps est anonyme mais devient un objet de fascination.
Il le confirme : « L’idée de cette collection était d’explorer cette hypersexualité de manière très frontale tout en gardant un regard artistique. Par exemple, on peut y voir Lily Cole qui tient deux chiens en laisse, chiens incarnés par deux mannequins. Je recherchais ce genre d’images très assumées, qui ne cherchent pas à s’excuser, tout en restant très belles. Une beauté sombre. » Le film regorge de références provenant de différences disciplines artistiques. Le cinéma, bien évidemment, avec des citations de cadrages empruntés à Pulp Fiction : « Dans le long-métrage de Tarantino, les personnages ouvrent une boîte et le spectateur découvre un angle de vue particulier que nous avons repris. La scène d’ouverture de notre film est aussi un pastiche de cinéma noir. Il y a plein d’éléments qui proviennent de choses que j’ai affectionnées quand j’étais enfant, comme le Charlie et la Chocolaterie de Mel Stuart. Chaque scène change de décor mais l’histoire se poursuit. Je voulais vraiment que ce projet soit l’occasion de mettre en place une narration autour des vêtements, et de ne pas se contenter de filmer des mannequins en train de défiler sur un podium. Chromatiquement, le film joue les contrastes en termes de couleurs, passant du rose au gris pour aller ensuite au rouge et se conclure dans le blanc et bleu. Tout est très graphique et assumé. Nous avons profité de la pandémie pour construire quelque chose d’ambitieux. »
Ce soin apporté aux décors se traduit par des objets tapissés des imprimés de la collection : du papier peint, des parapluies, un piano et même un taxi accueillent les fleurs du designer. Et cette profusion fonctionne ! Se pourrait-il que Richard Quinn envisage de diversifier ses activités en ajoutant la décoration d’intérieur à la mode ? « C’est tout à fait possible. L’un des objectifs de cette vidéo était de mettre en place un monde immersif. Tout ce qui est visible dans le court-métrage, nous l’avons imprimé nous-même. Nous réfléchissons à cette idée d’un univers à 360 degrés. Plus qu’à de la décoration intérieure, je pense à un lifestyle. »
Impossible de parler de Richard Quinn sans évoquer Leigh Bowery, éternelle référence de la scène londonienne de la fin des années 1980, performer aux looks spectaculaires. Le maquillage se faisait masque quand les cagoules ne cachaient pas son visage. Lui aussi était un adepte du vinyle et n’hésitait pas à jouer les caméléons en se camouflant, en imprimé pied de poule. Pour Bowery, le vêtement est essentiel. Questionnant le genre et la norme, il n’a cessé de brouiller les frontières entre masculin et féminin. Trois décennies plus tard, Richard Quinn propose une mode dans la continuité de cette vision hybridant sens de la fête, de la beauté et du politique. Récemment, il a introduit dans ses collections ses premières pièces masculines avec des propositions qui cultivent le même goût pour l’extravagance et assument leur part de féminité. Cette revendication pour un corps libre trouve de nombreux échos dans la culture pop contemporaine, plus spécifiquement dans le hip-hop. Parmi les adeptes de Quinn, on peut citer les superstars Megan Thee Stallion et Cardi B qui ont toutes les deux fait de l’hypersexualisation un argument féministe, ou encore Lil Nas X qui détourne quant à lui les codes de la virilité. L’industrie musicale raffole de cette mode spectacle et subversive. Et puisque l’on parle de musique, on fait remarquer à Richard Quinn que son film offre une playlist impeccable, allant d’Underworld à Strauss en passant par Sam Smith. Ce à quoi il répond : « C’est ce que nous écoutions à l’atelier pendant la création du projet. Le fait que ces titres soient entendus par toute l’équipe nous a tous mis dans le même mood, c’est très immersif comme manière de faire. La musique influence l’ambiance de la collection. » Voilà qui permettra peut-être d’avoir des indices sur ce que l’on pourra découvrir lors du prochain défilé : « En ce moment, nous écoutons beaucoup de musique underground allemande, de la house music, mais rien de vraiment connu, contrairement à la précédente collection. » Il faudra sans doute se préparer à une plongée dans les tréfonds des nuits berlinoises. Frissons d’excitation garantis.
Texte de Justin Morin
En rose et noir
Daniel Roseberry
Nommé à la direction artistique de Schiaparelli en 2019, l’américain Daniel Roseberry a réveillé la belle endormie en quelques collections. Fidèle au surréalisme de la Maison, ses créations conjuguent avec brio l’extravagance à un sens rigoureux de la coupe. Les bijoux sculpturaux complètent des silhouettes audacieuses, sans pour autant tomber dans l’excès. Si les images sont fortes, les vêtements le sont tout autant et se mettent au service d’une femme plurielle. Rencontre avec un créateur à l’univers enchanteur.
Justin Morin
Vous êtes diplômé du Fashion Institute of Technology de New York et avez passé votre enfance au Texas. Quel était alors votre relation avec l’art et la mode ?
Daniel Roseberry
J’ai grandi en étant obsédé par Disney. Pendant des années, j’ai souhaité travailler dans l’animation. Je me souviens avoir réalisé un projet entier et l’avoir envoyé à Glen Keane, l’un de mes animateurs préférés qui a notamment travaillé sur La Belle et la Bête, Pocahontas et bien d’autres. Grâce à ce dossier, ma famille et moi avons été invités à nous rendre aux studios Disney pour une visite privée !
Justin Morin
Quel âge aviez-vous ?
Daniel Roseberry
J’avais douze ans ! Je crois que j’avais treize ans quand j’ai commencé à dessiner de la mode. Je me souviens du mariage de mon frère ; lorsque j’ai vu la robe de mariage de ma belle-sœur, j’ai été si inspiré. Plus tard, à mes seize ans, ma mère m’a inscrit à un cours de dessin vivant. J’ai toujours été fasciné par l’anatomie. Depuis, dessiner a toujours été ma manière de faire passer mes idées.
Justin Morin
Par de nombreux aspects, votre travail est sculptural. Comment passez-vous de la planéité du dessin aux volumes de vos créations ?
Daniel Roseberry
J’ai commencé à mélanger mes dessins à des collages digitaux. J’en suis arrivé à inventer cette technique alors que je cherchais à faire mes croquis sur ordinateur. Mais en réalité, le dessin n’est qu’une manière de lancer le processus de création. À partir du moment où nous commençons à travailler physiquement avec mon équipe, tout peut changer.
Il y a dix ans, j’étais vraiment appliqué dans la réalisation de mes dessins, je cherchais à rendre au mieux les lignes et les silhouettes. Aujourd’hui, il s’agit plutôt de définir le volume global. Je trouve ça intéressant car le travail du flou est vraiment quelque chose qui se met en place lors des sessions de travail avec l’atelier. Le tailoring est quelque chose qui se traduit plus facilement par le dessin. Les deux approches se complètent.
Justin Morin
Comment approchez-vous la matérialité de vos créations ?
Daniel Roseberry
J’ai travaillé pendant onze ans aux côtés de Thom Browne. Nous étions très limités en termes de silhouettes, ce qui fait que créativement, les tissus étaient très importants. Presque chaque tissu, qu’il s’agisse d’un tweed ou d’un jacquard, provenait d’un nouveau développement. Ici, c’est l’opposé ! Je préfère avoir un choix limité de tissus que j’affectionne et ne pas avoir à y penser constamment. Il y a probablement une quinzaine d’étoffes sur lesquelles je reviens tout le temps. Mais j’aime les extrêmes ! Si c’est un taffetas, je veux qu’il soit le plus léger,le plus sec et craquant que l’on puisse trouver. Je crois que j’ai une sensibilité américaine par rapport aux tissus. Je ne fais jamais de nettoyage à sec. Je porte du denim presque quotidiennement. J’aime que la soie lavée soit aussi douce et confortable que du coton. Il n’y a pas de préciosité, on peut voyager avec ces vêtements, ils sont faciles à vivre. Pour moi, le luxe est de ne pas avoir à s’inquiéter de ce genre de chose.
Justin Morin
Parlons de l’essence de votre travail chez Schiaparelli. L’héritage de la maison est spectaculaire et pourtant, vous avez réussi à proposer votre propre interprétation. A-t-il été difficile de concilier cet imposant passé avec le futur que vous développez ?
Daniel Roseberry
Je crois que la réponse courte serait non ! Je n’ai jamais été obsédé par l’histoire de la maison. J’ai un immense respect pour elle, mais je veux aussi en être détaché. Il y a cet aller-retour constant entre cette envie de se sentir libre et la volonté d’être créatif pour soi, et je crois que c’est ce qu’Elsa Schiaparelli souhaiterait d’un directeur artistique aujourd’hui. En même temps, on ne peut pas échapper à la beauté de cette maison. Schiaparelli n’est pas une machine industrielle, ce n’est pas un poids lourd du luxe. Et je pense que cela correspond bien à la conception d’Elsa. Donc pour moi, c’est vraiment agréable de travailler dans ces conditions et de pouvoir créer ces vêtements.
Justin Morin
Certaines de vos créations transforment le corps, qu’il s’agisse d’effets de trompe-l’œil ou d’anatomie redessinée. Il y a un aspect performatif qui se dégage de votre proposition. Pour la collection couture du printemps 2021, vous avez notamment réalisé un très beau bustier en cuir qui révèle la structure du corps, jouant à la fois sur son aspect féminin et sa musculature, produisant un saisissant contraste. Est-ce que le genre a un rôle important dans votre démarche ?
Daniel Roseberry
Certainement. Je viens d’un milieu où le genre et la sexualité n’ont jamais été discutés pendant mon enfance et adolescence. Ces discussions n’ont jamais eu lieu.
Justin Morin
Vous venez d’une famille très religieuse n’est-ce pas ?
Daniel Roseberry
Tout à fait. Mais même chez Thom Browne, je n’avais pas la liberté de montrer le corps de la manière dont je le souhaitais. Je crois que c’est pour cela que j’ai aujourd’hui une vraie excitation à explorer ce territoire avec un regard presque enfantin, joyeux. Revoir nos idées et jugements à propos du corps. C’est ce que j’aime dans le travail d’Elsa Schiaparelli : ce qu’elle faisait n’était ni macabre ni lourd.
C’était curieux et léger, et j’adore cette approche. Je déteste le cynisme. Je cherche à m’amuser avec tous ces critères. Il s’agit moins de faire une déclaration politique que de poser des questions.
Justin Morin
Comment avez-vous développé cette collection ?
Daniel Roseberry
Nous l’avons réduite à cinq grandes idées, comme « silhouette colonne » ou « stretch couture » et travaillé l’abstraction. Mais à y bien réfléchir, j’ai travaillé dans une grande solitude. Je n’ai pas vraiment de vie sociale à Paris !
Justin Morin
À cause de la pandémie ou de la barrière de la langue française ?
Daniel Roseberry
C’est une combinaison vicieuse des deux ! Mais ça n’est pas une mauvaise chose. Ça m’a permis de me concentrer sur ce qu’est le langage de la marque. La couture a développé ce rapport fantasmé au réel où le baroque, les proportions, les broderies sont poussés au maximum.
Justin Morin
À ce propos, vous avez introduit le prêt-à-porter chez Schiaparelli. Était-ce votre idée ou un désir dicté par vos supérieurs ?
Daniel Roseberry
Dès le départ, c’était un but commun. Nous n’étions pas forcément d’accord sur ce à quoi il devait ressembler. Mais les retours sur la couture ont été si incroyablement positifs que j’ai envisagé le prêt-à-porter comme une réponse. Je ne voulais surtout pas qu’on le considère comme la petite sœur moins belle ! Il s’agissait de faire une ligne tout autant intense, mais de parler du réel plutôt que de l’imaginaire.
Justin Morin
Puisque nous parlons de l’imaginaire, je me demandais où vous puisez votre inspiration ?
Daniel Roseberry
Pour être honnête, je n’ai jamais été une personne qui se rend dans les galeries ou les musées pour trouver l’inspiration. Je ne fonctionne pas comme ça. Je ne suis pas non plus quelqu’un qui cherche dans le cinéma. Pour moi, tout se passe quand je m’assois et que je dessine en écoutant de la musique.
Justin Morin
Est-ce que vous êtes du genre à écouter le même album en boucle ou plutôt à découvrir de nouveaux musiciens ?
Daniel Roseberry
Je me fais des playlists ! C’est marrant parce que ces derniers temps, et c’est évidemment lié à la pandémie, je cherche le réconfort. Ça se traduit notamment par le fait d’écouter la musique avec laquelle j’ai grandi. Je roulais jusqu’à l’école en écoutant les Dixie Chicks – ce qui n’est vraiment pas une réponse cool ! Je regarde de nouveau la série Frasier ! Je recherche des choses réconfortantes…
Justin Morin
Mais donc, qu’est-ce qui vous inspire ?
Daniel Roseberry
Je suis vraiment inspiré par la relation qu’entretient un performer avec son public.
Justin Morin
Est-ce que vous parlez de performance musicale ou artistique ?
Daniel Roseberry
Tout type de performance. Je ressens vraiment cet échange d’énergie que je trouve fascinant. Lors de ma première présentation pour Schiaparelli, j’étais sur scène, en train de dessiner, alors que les mannequins défilaient autour de moi. J’étais très à l’aise dans cette position. Comme vous le disiez, il y a une dimension performative dans mon approche, et c’est ce que je trouve particulièrement motivant. J’aime que mes pièces soient des véhicules pour se mettre en scène, mais qu’elles portent aussi en elles une qualité « intime » qui fait qu’on peut se les approprier.
C.Q.F. D. de la performativité
(dans la mode)
Luca Marchetti
En commentant le défilé-performance réalisé avec l’artiste Anne Imhof pour la collection Burberry de l’été 2021, le directeur artistique de la marque, Riccardo Tisci, a qualifié la mode – et non seulement la sienne – d’espace d’émotion, de rêve, et l’a décrite comme un flux d’énergie vitale. Plus spécifiquement à l’événement qu’il venait de présenter, il a évoqué un energetic move voué à rendre accessible au public cette montée d’adrénaline qu’il ressent à chaque fois qu’il conçoit une collection.
Je suppose que bien d’autres créatrices et créateurs souscriraient sans trop d’objections à ces mêmes propos. La mode est pour le plus grand nombre un phénomène de mouvement, d’énergie, vecteur d’évolution autant en termes de temps (les tendances de style, par exemple) que d’espace (chaque culture développe un mode spécifique à son contexte). Ce sont presque des évidences, sans besoin de rappeler que le terme « mode » renvoie en soi à la dynamique et à la mutabilité des choses.
Ce qui surprend en revanche, c’est que la mode ait élaboré au fil du temps un langage corporel et des codes expressifs si figés, où la démarche rigide des mannequins, l’absence d’expression faciale et des postures réduites à un vocabulaire aussi limité qu’inéluctable, jouent le rôle de protagonistes.
Loin d’être un paradoxe, ces deux aspects représentent les deux faces de la même vision culturelle, bien occidentale et ancrée dans un temps précis : celui de la naissance de la mode moderne il y a bientôt deux siècles. D’un côté on y retrouve un imaginaire de la beauté et de la féminité fondé sur la distance, l’épure et le désir de l’inatteignable : la perfection– d’où le fait que sur les podiums et dans les magazines de mode, la réalité et la dimension « charnelle » de la vie aient longtemps été des tabous. De l’autre, on constate qu’en dehors des défilés et des représentations que les médias en donnent, la mode est un facteur-clé, très pragmatique et incarné, dans toutes nos performances quotidiennes. Non seulement les habits vivent en contact permanent avec nos corps, mais ils sont aussi en mesure de transformer profondément notre manière d’être dans le monde. C’est en très grande partie grâce à eux qu’on « performe » efficacement dans nos rôles sociaux et institutionnels
Le fait de porter une jupe ou un pantalon, une chemise à pattes ou col Mao, d’aller à l’école en crop-top ou avec un T-shirt à slogan, de se présenter à un rendez-vous en chemise cravate, d’élaborer un style décontracté ou formel quand on occupe une fonction publique… peut nous ouvrir des portes ou alors en fermer, voire carrément déclencher le débat social, si ce n’est pas le scandale. Cela est possible car la mode, comme la langue parlée, est en elle-même un phénomène performatif.
L’emploi de la performance artistique pour souligner la performativité de la mode n’est pas une invention de ces dernières années. Si le défilé peut déjà être considéré comme le « degré zéro » de la performance de mode, certains créateurs et créatrices de vêtements ont recherché des formats alternatifs à ses codes bien établis où tout élément de l’événement (la temporalité, l’espace choisi et son occupation, l’évolution des corps, jusqu’à la relation particulière établie avec le public) puisse être déclencheur de significations spécifiques.
Le phénomène a eu un premier moment de visibilité publique avec les défilés des années 60 qui ont considérablement rapproché la présentation des collections de vêtements de la culture du happening de plus en plus populaire dans le milieu artistique de l’époque. La musique, le choix de lieux et de corps atypiques par rapport à la tradition de la couture, ainsi qu’une direction artistique de plus en plus personnelle et singulière y tenaient une position de premier plan ; les vêtements faisant simplement partie de ce dispositif totalisant.
Mais ce sont les deux dernières décennies, avec Hussein Chalayan, Viktor & Rolf, Rick Owens, Kenzo, Thom Brown, Valentino, Iris Van Herpen ou encore Issey Miyake jusqu’à Fenty by Rihanna, qui nous ont offert la plus haute densité d’événements artistiques en guise de défilés.La mode a certes changé depuis l’époque de Courrèges et Paco Rabanne, mais c’est surtout la culture globale dans laquelle elle baigne qui a évolué radicalement. Les revendications de plus de réalisme, d’incarnation et une vision de la femme plus adhérente à la « vraie vie », loin donc de la « vie rêvée » popularisée par la mise en scène de la création et par la presse spécialisée des origines, sont devenues la doxa officielle dans le monde entier.
En phase avec ces attentes, la performance représente le remix idéal de vie et de rêve, d’objectivité et de projection artistique, de suggestions diverses et variées en termes d’attitudes corporelles, relations entre les corps, les genres et les identités, jusqu’à inscrire à chaque fois sa narration dans des lieux signifiants qui, loin d’être des simples décors prestigieux, donnent la clé de lecture de l’événement.


Burberry Spring/Summer 2021 – The Performance
Revenons à la performance d’Anne Imhof et de Riccardo Tisci pour Burberry. Elle a été explicitement présentée comme le résultat d’une appréciation réciproque, en traduisant avant tout autre chose l’esprit collaboratif et hybride devenu essentiel à la notion contemporaine de « créativité » dans la mode. Sa narration présente ensuite une foisonnante réorchestration en version pop arty de références cinématographiques (de Fellini à Kubrick jusqu’à Guadagnino), de l’esthétique rock (ce n’est jamais de trop, dans l’univers vestimentaire), de l’imaginaire de l’arène de jeu ou de combat et même des récits survivalistes en nature dont la Gen Z raffole actuellement. L’évidente incohérence de l’ensemble n’apparaît pas comme un effet du hasard, au contraire, elle reflète plutôt notre Zeitgeist où l’incohérence, le chaos sont la norme. Dans ce paysage socio-culturel, la performance permet à la mode de rester pertinente en accomplissant l’une de ses missions principales : enregistrer ce qui nous entoure et le mettre en récit pour le rendre acceptable.
On pourrait se demander pourquoi se donner autant de mal juste pour un fashion show ? La réponse nous est donnée par Miuccia Prada, lors de la présentation de la première collection conçue à quatre mains avec Raf Simons. Elle décrit le vêtement comme un outil pour naviguer dans la complexité du quotidien, rendu d’autant plus complexe aujourd’hui avec la pandémie de Covid 19. Pour elle, le vêtement a donc la capacité d’accompagner l’individu « en devenir » autant dans ses évolutions mondaines que dans ses transformations intimes.
En d’autres termes, si la mode nous assiste dans notre définition sociale, elle participe grandement à notre définition intérieure, grâce au dialogue permanent – souvent inconscient – qu’on entretient avec elle.
Elle exalte nos ressentis intimes, elle souligne nos perceptions corporelles et fonctionne comme une loupe de la personnalité. La performance, oui, mais la performance de soi.
Bodybuilding
Harikrishnan
Tout juste diplômé du London College of Fashion, le créateur Harikrishnan a bénéficié d’une belle exposition médiatique grâce à sa collection finale. Ses pantalons de latex, formes sculpturales et graphiques, dessinent une silhouette inhabituelle. Ce jeu de proportions, jouant d’exagération et d’art optique, questionne la notion de perception et de norme. Il est intéressant de savoir que le jeune homme de vingt-six ans, originaire de Kerala, région du sud de l’Inde, a pratiqué le bodybuilding. De l’anatomie corporelle et des muscles, Harikrishnan est passé au patronage et aux textiles. Loin de se résumer à ces fascinantes jambes reproportionnées, les propositions du designer développent un vestiaire masculin, puisant autant dans l’artisanat que dans le tailoring. Une proposition complète, riche et raisonnée, qui présage un développement réjouissant. Alyse Archer-Coite, spécialiste en design et en pédagogie, s’entretient avec celui qui se fait appeler Hari et évoque avec lui les coulisses de ses recherches.
ALYSE ARCHER-COITE
Comment avez-vous décidé d’étudier la mode au London College of Fashion ? Et quelle place a eu votre famille dans votre réflexion ?
HARIKRISHNAN
Je n’ai jamais voulu étudier ou faire un master ; ma partenaire s’est rendue à l’entretien d’admission au LCF, et je l’ai accompagnée. Heureusement, nous avons tousles deux étés acceptés. C’est ainsi que je suis arrivé au LCF. Ce n’était ni un rêve ni une étape planifiée de ma vie.
Vous avez partagé en ligne des images du processus de production de votre pantalon. Grâce à cette documentation, nous avons appris qu’il s’agit en fait d’un projet artisanal et familial.
HARIKRISHNAN
Ma famille possède une plantation de caoutchouc depuis sept ou huit ans. Avant de commencer mon parcours de designer, j’aidais mon père à collecter et à transformer le latex dans la plantation. Le traitement du caoutchouc est une belle métamorphose ; le latex liquide se transforme en feuilles. Ce procédé a été une source d’inspiration et cela m’est toujours resté en tête. Mais ce n’est pas pour cette raison que j’ai choisi le latex pour ma collection. Mes recherches à ce moment-là exigeaient un matériau capable de convenir à différentes tailles et à un mode de vie dynamique. Le latex s’est donc naturellement imposé puisqu’il m’est très familier.
L’aspect et la texture du pantalon nous attirent vraiment, mais je me demande quel effet il fait une fois porté, quelle est son odeur ? Pourriez-vous décrire la sensation que l’ont ressent quand on marche dans la rue en portant votre pantalon ?
HARIKRISHNAN
C’est comme si vous étiez suspendu dans l’air, comme une sorte de promenade dans les airs ! Et, oui, il sent le caoutchouc à l’intérieur. Malheureusement, je n’ai jamais eu le temps de l’essayer. Mais les mannequins qui l’ont porté m’ont parlé de cette sensation de légèreté. Même assis, vous avez l’impression de n’être assis sur rien. Ce dont je suis sûr, c’est que cela les a ravis, car ils se sont beaucoup amusés en coulisses.
Les pantalons créent une silhouette qui rompt complètement avec la représentation anatomique classique. Vous les avez également proposés avec des hauts structurés, des vestes par exemple. Mettez-vous les spectateurs au défi de repenser l’apparence des corps ?
HARIKRISHNAN
Oui, absolument ! C’était le but. La collection visait à changer notre perception de l’image du corps, comme si je donnais ma version de la réalité. Je crois au pouvoir de l’image. C’est une approche spéculative dans le contexte de la mode, destinée à critiquer les proportions et les représentations actuelles.
Vos pantalons en latex ont eu un impact énorme, mais vous avez également créé des gilets qui comprennent des éléments solides. Votre débardeur en perles de bois sculptées à la main est créé en collaboration avec des artisans de la région de Channapatna en Inde. Pouvez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet ? Dans quelle mesure était-il important de combler, en procédant avec respect, les fossés culturels et géographiques pour un public européen ?
HARIKRISHNAN
Ce projet dans la région de Channapatna a demandé plus de temps et d’efforts que toute autre étape de la création de la collection. Pour celui-ci, j’ai vécu dans le village pendant quarante-cinq jours en collaboration quotidienne avec les artisans pour développer des modèles et des tenues. C’était donc la partie la plus enrichissante de mon travail.

Photographe: Ray X Chung
Modèle: Joshua J Small
Le plus intéressant dans les projets communautaires, c’est la satisfaction que l’on ressent lorsque l’on fait participer des gens à son travail, et elle est inexplicable.J’y suis allé inspiré par la texture de la résine qu’ils utilisent, mais une fois que j’ai commencéà travailler là-bas, il ne s’agissait plus uniquement de cela ; j’ai vécu de nombreuses expériences et j’ai beaucoup appris, y compris sur le mode de vie des artisans et son impact sur le processus de conception.
Les Européens ne connaissent pas la communauté de Channapatna pour sa mode. Même en Inde, elle est célèbre pour la fabrication de jouets. C’est un artisanat qui a tenu un rôle essentiel dans chaque foyer en Inde, mais qui a malheureusement perdu sa pertinence après l’industrialisation de ce secteur. Je crois qu’en restant en phase avec les nouveaux marchés et le nouveau mode de vie, mon projet profite à la communauté. De plus, en le réinventant par le biais de la mode et de l’habillement, j’ai réussi à donner aux artisans un nouveau moyen de subsistance.
Nous avons vu d’autres designers émergents utiliser des matériaux inattendus dans leur travail. Des algues, des élastiques, des sacs de haricots et même du latex sous différentes formes. D’après vous, qu’est-ce qui alimente cet esprit d’aventure dans la mode ?
HARIKRISHNAN
Dans mon cas, c’est la volonté de mettre la mode en avant en tant que moyen de communication et d’explorer les autres possibilités avec le corps comme véhicule. Ce que je voulais faire au travers de mes créations, c’est susciter des dialogues et des réflexions. Beaucoup de jeunes stylistes sont frustrés par le système actuel de la mode où la créativité passe au second plan et où tout le reste est porté aux nues au nom de la vraie créativité. Malheureusement, aujourd’hui dans l’industrie le style prend une place plus importante au détriment de l’innovation matérielle.
Quel impact sur vos créations a eu la fabrication en Inde ?
HARIKRISHNAN
Avant de m’installer à Londres, j’ai travaillé en Inde pendant deux ans sous la direction de Suket Dhir, lauréat du prix international Woolmark, à New Delhi. Pendant cette période, j’ai pu travailler sur de nombreux projets de développement de textiles et de surfaces. Cette collaboration continue d’influencer une grande partie de mon processus de création. Cependant, le langage visuel ou l’esthétique de mon travail ne se limitent pas à l’Inde. Je veux qu’il soit universel.
De plus, la ville de New Delhi représente un aspect central de mon travail, car elle me fournit toutes les ressources nécessaires pour que mes idées deviennent réalité.
Que voyez-vous actuellement dans le monde (tandis que vous êtes confiné chez vous à cause de la Covid) qui vous frappe et vous impressionne ?
HARIKRISHNAN
Je ressens et je vois de la résilience. En ce moment, je conçois les vêtements depuis ma ville natale, ce que je n’aurais jamais cru possible. Au début, il était difficile de trouver et de tester certaines choses ici, dans cette petite ville. Certains matériaux n’étaient pas disponibles, mais après trois ou quatre semaines de travail acharné, je parviens à travailler depuis chez moi et j’ai réussi à réaliser quelques commandes commerciales par moi-même.
De ce point de vue, la pandémie m’a beaucoup aidé à développer ma confiance en moi. Mais je ne suis pas le seul sur lequel elle a eu un impact. Beaucoup de gens autour de moi réussissent à continuer après avoir été durement touchés.
Certains ne vous connaissent que par votre pantalon gonflable. Que voudriez-vous que le public sache sur vous ?
HARIKRISHNAN
Je poursuis des recherches sur les problèmes croissants de santé mentale et d’anxiété chez les étudiants en mode et les créateurs émergents. La mode est un de ces domaines où l’on crée beaucoup mais où l’on est le moins récompensé.
J’y crois parce que je ressens moi-même toutes les émotions imaginables, et que seul quelqu’un qui partage la même passion peut comprendre. Beaucoup d’étudiants et de designers émergents subissent une pression énorme, principalement en raison des risques (en termes financiers et en termes de délais) qu’ils prennent. En particulier dans cette période où les réseaux sociaux accélèrent les interactions, où certains d’entre nous ont du mal à rester fidèles à leur philosophie. Ma partenaire, qui est conférencière de mode, et moi-même, menons ensemble cette recherche depuis six mois. Si nous pouvions aider ou au moins écouter certaines de ces personnes, ou encore si nous pouvons initier un dialogue, je considère que nous aurons réussi.

Photographe: Ray X Chung
Modèle: Joshua J Small
entretien avec ALYSE ARCHER-COITE
C.Q.F.D. d’un certain regard, le gaze
Exactitudes
Depuis vingt ans Exactitudes (composé par Ari Versluis et Ellie Uyttenbroek) repère et catalogue des phénomènes de mode non-officielle, saisis dans les lieux d’agrégation sociale les plus disparates. Leur travail révèle et documente une accélération spectaculaire des mutations du rôle de l’apparence et du style au sein de la société.
Parallèlement à l’explosion dans la culture populaire contemporaine des formes narratives néo-cinématographiques – de la publicité aux séries télé, sans oublier les plateformes web telles que YouTube – l’image de soi a été érigée en medium multi-canal pour la représentation de l’individu, autant dans son contexte de vie que dans une myriade de contextes d’existence fictionnels – des environnements sociaux en réseau jusqu’aux jeux vidéo en ligne . Aujourd’hui, exister pose d’emblée la question du regard. Dans la dictature de l’image, le fait d’être en permanence regardé et de regarder nous transforme en media. Comme l’auteure Iris Brey le précise dans son analyse du regard à l’ère des écrans (Le Regard Féminin. Une Révolution à l’Écran, Paris, Éditions de l’Olivier, 2020), il s’agit ici d’une forme de regard bien particulier, que la langue anglaise traduit par gaze. Le gaze a la spécificité de communiquer une intentionnalité entre l’observateur et ce qu’il regarde, principalement déterminée par le « désir ». La mode est l’un des domaines de la culture où l’on peut observer le plus facilement comment le désir masculin – et donc le male gaze – a forgé une image idéale de la femme. Mais comme le montre la récente exposition Masculinities (Curateur Alona Pardo, Barbican, Londres, 20 février — 17 mai 2020), les faiseurs de style et, plus encore, l’œil des photographes ont aussi élaboré un idéal masculin, que le female gaze remet maintenant en question.
Luca Marchetti
Quel regard portez-vous sur l’évolution du street-style (pour autant qu’on puisse encore l’appeler street-style) au cours des deux dernières décennies ?
Ari Versluis
Les principaux changements ont accompagné les bouleversements culturels qu’ont connu les sociétés contemporaines, et la notion de style est passée d’une conception locale à une dimension mondiale. Quant à celle d’identité, nous avons pu observer un glissement progressif du modèle fondé sur la proximité ou l’appartenance à une tribu vers des processus de construction identitaire de plus en plus fluctuants, principalement sous l’impulsion de l’utilisation généralisée du web.
Luca Marchetti
En regardant votre travail, nous avons l’impression que ces comportements sociaux très particuliers, qui impliquent un style, peuvent être envisagés comme un double portrait. D’une part, en portant certains vêtements, nous offrons une certaine image de nous-mêmes. D’autre part, nous finissons presque toujours par faire des choix qui nous placent dans un cadre socioculturel assez spécifique, dans une sous-culture, un groupe professionnel ou même politique. Dans quelle mesure pensez-vous que vos modèles sont conscients de ce phénomène ?
Ari Versluis
Les gens sont tout à fait conscients de ce phénomène. Peut-être ne peuvent-ils pas le définir précisément, mais leurs comportements sont plus éloquents que les mots. Toutefois, gardez toujours à l’esprit que la plupart des gens ne sont pas vraiment libres de choisir la vie qu’ils veulent mener, en raison de revenus limités, de leur éducation religieuse, d’une formation insuffisante, de l’inégalité des sexes, etc. Le choix de son identité est un privilège offert à ceux qui disposent d’une éducation et de moyens économiques satisfaisants. En particulier à notre époque de politique identitaire, de néolibéralisme et de capitalisme de gangsters, où choix résolu et capacité à évoluer sont de véritables mantras des temps modernes, beaucoup ont le sentiment que les choses pourraient vraiment mal fonctionner et que le double portrait se craquèle.
Luca Marchetti
…cela soulève la question du « point de vue ». Le nôtre, bien sûr, mais aussi celui des autres. Pour que notre style soit compris – ou du moins qu’il ne soit pas mal interprété – nous devons prendre en compte, consciemment ou inconsciemment, les désirs, les goûts, les craintes, les centres d’intérêts… et plus généralement les capacités de décodage de ceux qui nous regardent. Cette question semble particulièrement importante dans le cas d’Exactitudes car vos photos paraissent en général « objectives » :sur un fond neutre, des portraits de 3/4 encadrés sont répétés à l’identique au point d’obtenir un catalogue de « looks », que l’on pourrait qualifier de volontairement impersonnels. Comment comprenez-vous la double fonction du « point de vue » dans le cas des codes vestimentaires ?
Ari Versluis
En fin de compte, Exactitudes est le fruit d’une observation minutieuse. Le produit d’un regard sans gêne sur les autres, destiné à comprendre leur look et leur attitude. Le style au sens large est considéré comme un langage sémiotique, dont le ton varie de la poésie à l’agressivité audacieuse. L’observation permet de découvrir des modèles socioculturels qui illustrent la manière dont les gens aiment à se distinguer en adoptant une certaine identité de groupe. Dans notre approche des modèles et dans le contexte du studio photo, notre regard est encore plus précis et nous zoomons sur l’histoire qu’ils racontent, révélant ainsi bien d’autres détails.
Cette rencontre mène à la production photographique, mais nous en apprend aussi beaucoup sur les participants grâce aux conversations que nous avons avec eux. Nous mettons également leur regard à profit lorsque nous leur montrons des photos d’autres participants du projet Exactitudes afin qu’ils contribuent avec nous à la création, en démystifiant l’idée de l’objectivité qui existerait indépendamment de l’appareil photo ou de notre regard. Ainsi, dans la phase finale d’assemblage d’une série, nous trouvons toujours l’occasion de vérifier et d’arranger à nouveau les détails…
Luca Marchetti
Il me semble que la notion de « regard » est devenue encore plus intrigante avec l’importance accrue que notre société accorde au partage d’images à distance, qu’il soit instantané (via les réseaux sociaux par exemple), ou différé (par exemple via la presse écrite). Aujourd’hui, toute personne vivant dans un contexte urbanisé sait inconsciemment qu’elle « crée une image » en étant simplement perceptible (par d’autres personnes ou par les caméras omniprésentes). Cette nouvelle « imagéabilité » –un concept qui, selon ses premiers théoriciens tels que Reyner Banham ou Kevin Andrew Lynch, constitue l’une des caractéristiques fondamentales de la culture pop – a-t-elle modifié le rapport des individus au style ces vingt dernières années ? Et comment ?
Ari Versluis De nos jours, quand on leurdemande si je peux les photographier beaucoup de gens répondent qu’ils sont d’accord« pour un selfie ». Cette délicieuse ambiguïté du vocabulaire est exemplaire : la nouvelle « imagéabilité » a radicalement changé la relation des individus au style. Tous ceux qui possèdent un smartphone peuvent en faire l’expérience. Surtout la génération TikTok qui exploite ces possibilités au maximum. Elle perçoit le style comme un vernis dans un quotidien où règne le performatif. C’est le résultat d’une culture de consommation très narcissique dans laquelle les jeunes comprennent très bien que tout ce qu’ils font devient un signifiant de ce qu’ils sont. Leurs actes et leurs acquisitions sont réalisés pour ce qu’ils signifient plutôt que pour ce qu’ils « sont ». C’est aussi simple que cela. C’est presque du racolage : « Je te force à me regarder. Tu me regardes, donc je suis important en cet instant T ». C’est un phénomène majeur, qui implique également que beaucoup de nos contemporains ont tendance à dire non aux réseaux sociaux, à la pression de leurs pairs, à la surveillance potentielle qu’ils exercent (qui, en effet, est une forme de pouvoir) et ne les prennent plus trop au sérieux.
La question d’identité sociale est donc plus actuelle que jamais : affiner la réalité est une nécessité permanente.
Luca Marchetti
À ce propos, en cette époque de débats passionnés sur le genre, le monde de la mode est fréquemment critiqué pour avoir façonné un imaginaire féminin au service du « regard masculin ». Avez-vous observé cette tendance dans l’imaginaire collectif du monde de la mode et si oui, en avez-vous tenu compte dans votre travail et de quelle manière ?
Ari Versluis
Le talon haut qui torture les femmes est la cravate qui étouffe les hommes. Les deux sexes étaient pris au piège d’un même jeu biaisé – barbant aujourd’hui – instauré par la vieille école. C’était peut-être vrai par le passé, mais aujourd’hui l’imaginaire collectif de la mode crée de la diversité et une réalité changeante, s’éloignant des idéaux binaires glamour. Les représentations anticonformistes des genres, l’hybridité culturelle, les collections mixtes et durables,les identifications propres à chacun – chaque fois qu’elles apparaissent comme une forme de néo-conservatisme – esquissent une évolution plus radicale de la société vers une nouvelle approche de la réalité…
Luca Marchetti
…c’est vrai, pour l’instant il s’agit plutôt de niches de style. Les grandes marques et les grands groupes de mode semblent en effet avoir du mal à se défaire des archétypes identitaires traditionnels. Cependant, ces injonctions socioculturelles produisent indéniablement l’inverse, que l’on peut comprendre comme une réaction au regard masculin et qui préfigurent un regard féminin. Cela s’observe dans les défilés de mode – des événements assez éphémères – et progressivement dans les représentations photographiques popularisées par de nombreux nouveaux titres de presse. La photographie étant aussi votre principale forme d’expression, diriez-vous que son interprétation du style est une sorte d’autofiction et de fiction collective ?
Ari Versluis
Je pense que oui. Les nouvelles générations de professionnels de l’image produisent des scénarios de style facilement accessibles. Leur public peut sans effort se projeter dans ces récits en images de nouvelles identités. À l’inverse, ils utilisent les mêmes outils et stratégies visuelles d’« auto-imagination » pour se présenter sur les réseaux sociaux et dans les contextes de vie sociale.



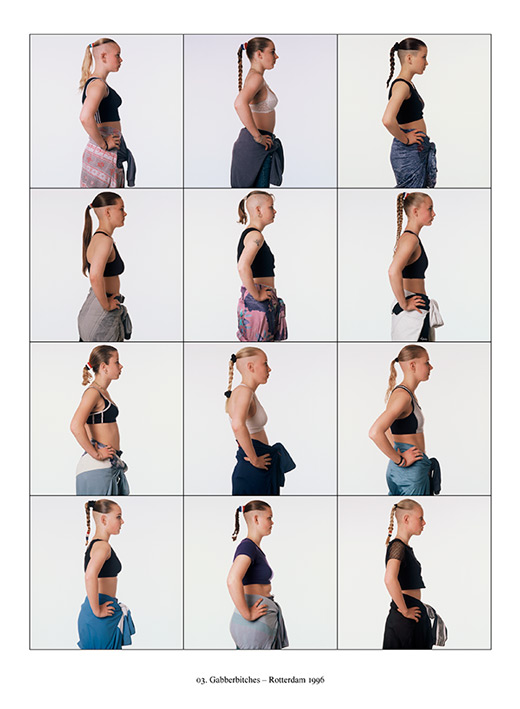
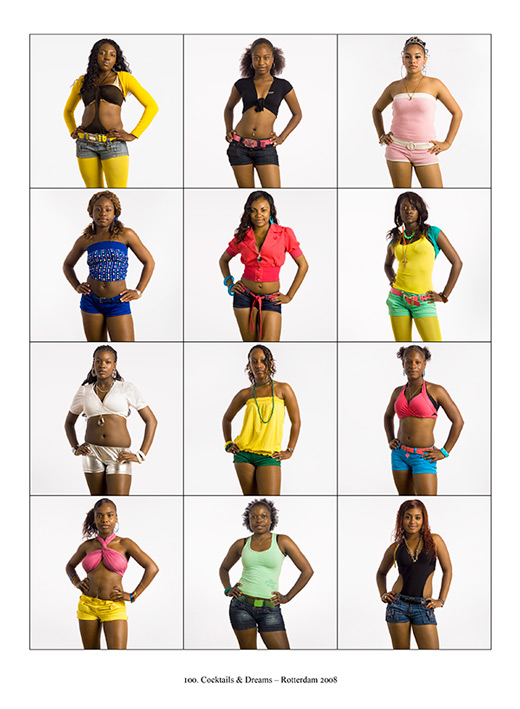

C.Q.F.D. de la culture urbaine
Christelle KocherLuca Marchetti
Il est plutôt commun de croire que si l’on vit dans une grande ville, « on est différent ». On s’habille différemment, on se comporte différemment, on sort différemment, on achète différemment car on a des goûts différents, peut-être parce que l’air qu’on respire dans l’urbis est différent aussi, comme le pensait déjà Marcel Duchamp. Il y a ici de quoi croire que dans la métropole, on pense différemment aussi. De cette idée, naît probablement la notion de « culture urbaine », laissant entendre qu’il existe une forme culturelle spécifique aux agglomérations métropolitaines. Si on écoute l’avis du psychologue et philosophe de l’art américain John Dewey, « la culture n’est pas le produit des efforts que les hommes déploient dans le vide ou juste pour eux-mêmes, mais celui de leur interaction prolongée et cumulative avec leur environnement. » Lorsque l’environnement en question est bien la métropole, le produit de nos interactions prolongées et cumulatives avec elle constituerait donc l’essence ce que l’on appelle « culture urbaine ».
Incontestablement, la mode en est devenue au fil du XXe siècle l’un de plus efficaces interprètes, probablement le seul en mesure de traduire l’intensité, l’esprit volontariste et visionnaire — pour ne pas dire utopique — qui la caractérise et que, dans le jargon de la mode, on aime appeler « le rêve ».
Apparemment, tous les principaux aspects susmentionnés pour qualifier la culture urbaine, se retrouvent dans l’identité de Koché, alors qu’avant de la créer, Christelle Kocher a officié pour des grandsnoms de la mode “officielle”, et qu’elle est actuellement la directrice artistique de Lemarié, maison d’art appartenant au groupe Chanel.
Luca Marchetti Qu’est-ce qui a motivé la naissance de Koché ?
Christelle Kocher À un moment donné de mon parcours, j’ai ressenti le besoin d’un projet moins élitiste — bien que je n’aime pas ce terme ! — plus démocratique et engagé, un dialogue entre quelque chose de très populaire et quelque chose d’extrêmement artisanal qui puisse mélanger culture, couture, streetwear et sportswear,tout en intégrant les extrêmes. Je souhaitais également que ce projet ne porte aucun jugement sur ces influences, mais plutôt qu’il reçoive la richesse des unes et des autres pour les faire cohabiter et avoir le meilleur de ces mondes. Ensuite, je crois que grâce à la mode on peut encore changer notre monde, à commencer par celui des individus, en s’adressant à une population extrêmement diversifiée en termes de morphologies, de choix culturels, de genre et d’identité…
Luca Marchetti L’idée de concilier des éléments apparemment inconciliables est également un aspect clé des cultures urbaines. Il fut un temps, dans les années 60, où le lieu privilégié de cette élaboration était la rue. La rue était devenue la scène d’affrontements générationnels, de la lutte entre les sexes et des manifestations pacifistes. Plus tard, la fabrique des codes expressifs des plus jeunes a poursuivi son chemin dans ce phénomène émergent qu’était la « boutique » — à commencer par le Bazaar de Mary Quant à Londres — devenue un lieu de vie à part entière. Et c’est dans l’espace nocturne et élitiste des night-clubs, tels le Studio 54 de New York ou le Palace de Paris, que la culture urbaine a établi son laboratoire de création identitaire pendant les années 80, en puisant de manière tout à fait transversale dans l’imaginaire de la musique pop, de la mode et des arts, de plus en plus populaires. En regardant tes collections et tes défilés, on a l’impression qu’à l’époque actuelle, un contexte urbain crucial pour l’invention du soi est le sport d’équipe, dont le foot est peut-être l’expression la plus puissante.

Koché FW19 Artbook
Images: FM_MM
Christelle Kocher Peut-être, oui. De mon côté, en tout cas, j’ai grandi en banlieue sans références culturelles officielles et dans une famille où personne n’avait fait d’études. Ce sont donc les amis, la musique et différentes activités qu’on partageait sur les terrains de foot ou de basket qui m’ont cadrée et nourrie. C’est aussi la passion que je ressentais dans ces lieux, qui m’a motivée à évoluer, à économiser et à obtenir des bourses pour, ensuite, faire des études et finalement faire le métier que je fais aujourd’hui.
Luca Marchetti Peut-on dire que le sport urbain est également une métaphore efficace du « collectif », du lien social et des valeurs qui les caractérisent, comme une certaine forme de croyance ?
Christelle Kocher Si j’ai choisi de travailler avec le PSG, c’est parce qu’il s’agit d’une marque qui représente aux yeux de tous un sport populaire suivi par un vaste mélange de classes sociales et de générations, ce qui implique la notion de diversité. Parallèlement, cette grande mixité est possible uniquement parce que le foot, et cette équipe en particulier, a le pouvoir émotionnel de rassembler des gens très éloignés au sein d’une même situation de partage et de communion. C’est particulièrement signifiant que cela se passe à une époque où l’on constate à quel point les institutions officielles fondées sur la croyance, comme la religion, tendent à perdre leur attrait. Malgré toutes les limites qu’on peut retrouver dans le domaine du foot, on trouve encore ici des fortes valeurs collectives.
À ce propos, la coupe du monde féminine de cette année m’a parue une vraie révolution. Pour la première fois, on a ressenti le besoin de faire évoluer le vocabulaire vestimentaire du foot, en concevant des produits spécifiquement pensés pour les femmes. Les joueuses ne portaient pas des vêtements initialement conçus pour des hommes et ensuite déclinés en taille S ou XS. Les maillots, les uniformes… ont tous été dessinés en prenant en compte des morphologies et des esthétiques spécifiques. Cet événement nous a réellement fait passer un « cap culturel », tout comme le mouvement #metoo qui l’a précédé et qui a tout changé. C’est la preuve que dans le contexte du sport et de la mode on peut encore faire passer des messages profonds, sans forcément être une porte-parole activiste et — une fois de plus — sans vouloir juger ou rechercher une vérité quelconque… en tout cas, je n’ai pas la volonté de le faire. En considérant ce qui est en train de se passer, j’ai du mal à penser que l’on puisse revenir en arrière, notamment à une vision de la femme assujettie à la culture masculine, ou à une notion d’émancipation féminine s’exprimant uniquement par des attributs masculins, au niveau de l’attitude, de la mode et de morphologiecorporelle.
Luca Marchetti Être émancipée signifiera tout simplement « être féminine » et cultiver sa féminité signifiera — culturellement parlant — cultiver sa diversité. Il me semble que cette révision profonde des codes initiée par les échanges et les pratiques caractéristiques du milieu urbain, s’accompagnent déjà aujourd’hui d’un puissant phénomène d’hybridation culturelle.

Christelle Kocher Certainement. D’autant plus que la série de t-shirts créée en collaboration avec le PSG a attiré l’attention de Beyoncé qui en a porté une version customisée. Aujourd’hui, Beyoncé a un statut d’emblème de l’hybridation culturelle, étant très active dans le débat sur les identités culturelles, étant une figure de proue du néo-féminisme, du mouvement body positive — et du mouvement #metoo — sans parler du mélange de genres artistiques qu’elle encourage sans cesse. Évidemment, elle est une figure qui contribue à l’évolution de la vision de la femme, tout comme elle participe à l’évolution générale des mentalités.
Luca Marchetti Depuis les années 50, le t-shirt a tenu un rôle de miroir dans la culture urbaine, une sorte d’écran qui en a enregistré les signes et les messages les plus révolutionnaires. Il a finalement fini par être adopté par la haute couture, afin d’en moderniser l’image dans la perception du plus jeune public. Par conséquent, il a aussi été un témoin crucial des hybridations culturelles qui ont vu la tradition et la modernité, voire la culture de mode officielle et la mode plus populaire, se rencontrer.
Christelle Kocher Le travail sur le t-shirt, m’a permis d’injecter de la modernité dans le métier de la couture, d’un point de vue esthétique, mais aussi en ce concerne les techniques de réalisation. Dans le contexte du défilé ce support dynamise la collection — dans la haute couture par exemple — lorsqu’il est alterné à des pièces plus importantes. Au niveau de la pièce seule, on peut apporter à un habit populaire — en soi banal — une valeur supplémentaire par un traitement semi-artisanal de la plume, par l’inclusion de la broderie ou par l’incrustation, tout en recherchant des techniques pour réaliser cela autrement afin que les coûts restent accessibles.
Luca Marchetti Ce processus a également généré un ‹ langage de mode › original et réellement contemporain, dans la mesure où un tel mélange hétéroclite de références aurait pu donner un mix-n-match volontairement provocateur et revendicatif — c’est le cas pour d’autres talents de mode actuels, comme dans le cas de Virgil Abloh. Les collections Koché, au contraire, intègrent leur profusion de références culturelles et sous-culturelles, un langage homogène qui se donne à voir comme une évidence, sans revendications, sans aspérités explicitement clivantes. C’est un matériau expressif qui traduit un point de vue singulier, en toute simplicité, sans effort.
Christelle Kocher Peut-être parce que les références auxquelles tu fais allusion ont été digérées à travers plusieurs phases de travail et par un processus de sophistication formel plutôt indifférent au scream loud et au super cool. Habituellement, je reste focalisée sur le choix des matériaux, sur la coupe et sur l’enchaînement fluide des références, jusqu’à obtenir quelquechose de véritablement effortless. Mon but n’est pas d’impressionner par les vêtements.
Luca Marchetti Ni par les mots, il me semble. Je pense au choix de communiquer le cadre esthétique — et au besoin, conceptuel — de chaque défilé, non pas par un communiqué de presse, mais par un fanzine. Peut-on dire qu’il y a ici, une volonté claire de ne pas faire appel à une prise de parole de type explicatif, mais plutôt de mettre en jeu des formes de communication visuelle, qui ne sont pas sans rappeler la communication virale et non officielle de la street culture métropolitaine ?

Christelle Kocher Oui, bien qu’il y ait dans chaque fanzine beaucoup de citations, car on y trouve des références à des auteurs, des poètes, des artistes ou à d’autres personnes qui m’inspirent profondément. Mais il ne s’agit pas ici de les citer dans une envie d’analyser, mais plutôt dans l’idée de donner une clé interprétative au défilé… en faisant ça, je laisse une grande marge d’interprétation à mon public.
Luca Marchetti La direction artistique du défilé spécial automne-hiver 2019 à Tokyo m’a semblé être un autre clin d’œil significatif à la culture urbaine. Non seulement pour l’emplacement — le quartier de Shibuya et le store Tsutaya qui fait face à l’un des carrefours les plus célèbres au monde — ou par le style hybride des pièces présentées, mais aussi pour le traitement musical. Tokyo est une ville extrêmement sonore, jusqu’à en devenir dérangeante parfois. La communication sonore dans les espaces publics devient en quelque sorte la BO de la ville… Le show en question, d’ailleurs, s’est ouvert avec le thème écrit par John Williams pour le film Rencontres du troisième type de Spielberg. Un choix bien ironique, car dans l’imaginaire européen le Japon est souvent vu comme un ovni culturel. Mais il est d’autant plus pertinent que Williams aussi est un musicien hybride, ayant construit sa carrière en jonglant entre culture officielle et culture populaire… à l’image de la mode Koché.
Christelle Kocher Indéniablement, la musique est pour moi un véritable accompagnement quotidien, un moyen de donner forme et de faire passer une émotion. Plus spécifiquement pour les collections, le travail sur la sélection musicale démarre plusieurs mois en amont. La musique aide à faire en sorte que le défilé amène quelque chose de singulier, sans être uniquement « dans l’air du temps ». Obtenir cela sans la musique ne serait pas possible dans l’espace des quelques minutes accordées à chaque show. Tout se déroule et doit se voir en carambolage. L’exemple idéal est le dernier morceau joué pendant ce défilé au Japon, une chanson populaire qui a été souvent écoutée et chantée en groupe juste après la catastrophe de Fukushima, comme une sorte de catharsis collective. Pendant ce moment final — malheureusement coupé dans la vidéo du défilé sur You Tube — une grande partie du public a commencé à chanter en synchro avec la musique, en se tenant par la main et à pleurer aussi. Cette empathie a été augmentée par le «casting sauvage » que nous avions réalisé, un mélange particulièrement inédit, voire bizarre, de personnes aux provenances très différentes, repérées dans le rues de Tokyo, entre mannequins, artistes, DJ, coiffeurs, maquilleurs. Ce à quoi on assiste n’est donc pas juste un défilé, il y a là une forme de vérité émotive qui se créesur place et dont la collection devient la trace.
Luca Marchetti Curieusement, bien que l’effet soit tout à fait différent, je retrouve quelque chose de semblable au niveau de l’image que Koché restitue de Paris, la « ville lumière » qui soudainement devient « ville urbaine », « ville pop ». Dans les vidéos tournées à Paris, pendant un moment, on perd de vue son chic traditionnel, son architecture monumentale, son aura de « ville couture » et de « ville culture »aussi : on la confond volontiers avec Londres ou New York, ce qui est un point de vue plutôt original dans le contexte de la mode.

Christelle Kocher Parce que je trouve que Paris a évolué. C’est une ville qui ne vit plus dans la « mythologie parisienne » que la tradition a cristallisé. Elle est de plus en plus une ville créative, influencée par les expressions et les énergies multiples d’une jeunesse qu’on peut voir très facilement, simplement en ouvrant les yeux sur la réalité urbaine de cette capitale tout à fait globalisée, certes, mais qui en même temps aime et sait faire les choses « à sa manière ». Paris partage et communique des valeurs qui lui sont spécifiques, mais elle est aussi riche de tout ce qui lui arrive de l’immigration et de ses échanges avec le reste de la planète. J’aime que dans tout cela, elle sache rester lucide sur son histoire, sur le fait qu’elle fasse partie de l’Europe avec tout ce que cela représente et sur le fait que l’Europe fasse partie du monde…
Wear Me Like Water
Steph WilsonSinead O'Dwyer
Réalisé par Steph Wilson pour la collection printemps-été 2020 de Sinead O’Dwyer, le film Wear Me Like Water célèbre le corps de la femme comme le centre d’un monde utopique.
Avec sa collection de diplôme au Royal College of Art, O’Dwyer a mis en place une esthétique non-normative en combinant des vêtements aux formes sculpturales avec des textiles délicats. En utilisant sa propre mère et ses amies comme muses, elle veut représenter celles qui ne sont d’habitude pas montrées en tant que corps féminin idéal. Son style et son esthétique ont encore évolué dans sa nouvelle collection, avec des moulages de silicone illustrant les nuances de chacun des corps sculptés : chaque courbe, chaque pli se donne à voir à travers la matière rigide et transparente.
La photographe Steph Wilson (REVUE 7) est captivée par ces vêtements de Sinead O’Dwyer et a choisi de transmettre par le biais d’un film le message qui sous-tend la collection : « Le travail de Sinead se concentre sur ce thème de « rentrer dans la peau de quelqu’un d’autre », en référence à ce problème des tailles de vêtements utilisées par l’industrie de la mode qui ne cessent d’avoir des effets négatifs sur la manière dont on se sent dans nos corps. J’avais le sentiment que cela devait être exprimé à travers de quelque chose de très beau. L’atmosphère générale le jour du tournage était merveilleuse, comme échappé d’un rêve : toutes ces femmes de toutes les tailles flottaient et riaient, pleines de joie. »
Wear Me Like Water est un film habité par ces questions qui traversent le travail d’O’Dwyer et Wilson depuis des années : la représentation de la féminité et le quotidien du corps à travers le regard d’une femme.
Depuis sa présentation pendant la Fashion Week de Londres en Septembre, Wear Me Like Water a gagné le prix SHOWstudio 2019 du meilleur film d’une marque de mode.
Texte par Philippa Nesbitt
Il y a des fleurs partout pour qui veut bien les voir
Kris Van AsscheBen Sledsens
Alors qu’il fait souffler sur Berluti un vent de modernité, Kris Van Assche, directeur artistique de la Maison depuis mars 2018, ne cesse de surprendre. Toujours aussi méticuleux dans l’art de la coupe, il se révèle fin coloriste et modernise le patrimoine de la marque. Pour Revue, il s’entretient avec Ben Sledsens, jeune peintre Belge dont le travail semble être aux antipodes de l’esthétique qu’il développe depuis plus d’une quinzaine d’années. Grandes toiles figuratives aux traits naïfs, les œuvres de Sledsens semblent être à contre-courant et hors du temps. Si le premier collectionne le second, les deux Anversois échangent pour la première fois et partagent leur amour commun pour les fleurs.
Kris Van Assche C’est étrange car nous ne nous sommes jamais rencontrés, mais j’ai une peinture représentant ta petite amie chez moi ! J’ai découvert ton travail par l’intermédiaire de la galerie Tim Van Laere car je suivais un autre de leur artiste, Rinus Van De Velde. Si je ne me trompe pas, c’est même Rinus qui a parlé de toi à Tim. Tu as étudié à l’Académie Royale d’Anvers n’est-ce pas ?
Ben Sledsens Tout à fait. Pendant ma scolarité, j’ai fait une exposition dans un petit espace indépendant de la ville. Rinus est tombé sur le flyer alors que le projet était fini. Il y avait dessus une image de mon travail. Il a fait une recherche sur Internet et a ensuite parlé de moi à Tim, qui est venu visiter mon atelier. La galerie m’a dit qu’elle envisageait de travailler avec moi et nous avons commencé notre collaboration une fois mon diplôme obtenu.
KVA Tu es rentré directement dans l’une des meilleures galeries de Belgique ! Quand as-tu terminé tes études ?
BS Il n’y a pas si longtemps, il y a quatre ou cinq ans.
KVA C’est sur Instagram que j’ai vu une de tes peintures. Elle représentait un garçon dans un magasin de fleurs. J’aurais vraiment aimé l’acquérir et j’étais très énervé contre la galerie car elle était déjà vendue. J’ai longtemps insisté, ils m’ont répondu : « Kris, elle a déjà été vendue, il n’y a pas de deuxième exemplaire ! » C’est la première de tes toiles que j’ai découverte.
Je pense que certaines personnes peuvent être surprises d’apprendre que j’apprécie ton travail. Venant de chez Dior et étant un « designer belge », une grande partie de mon travail s’est longtemps déclinée en noir avec des touches de blanc, et si vraiment il y avait besoin de couleurs, j’y ajoutais un peu de rouge. Une attitude très belge
Les premières œuvres qui m’ont attiré étaient aussi en noir et blanc. Je pense notamment aux photographies de Robert Mapplethorpe, plus précisément à ses fleurs. Mais je crois qu’il est important de se confronter à des choses qui sont différentes de son propre monde. Ce qui m’a immédiatement plu dans cette peinture avec ce garçon fleuriste, c’est que j’ai pensé que j’aurais pu être lui. J’ai toujours dit que si je n’étais pas devenu créateur de mode, je serai devenu fleuriste. La poésie et la narration un peu naïve qui se dégagent de cette toile m’ont tout de suite touché.
BS C’est une pièce importante également pour moi car je crois que c’est cette peinture qui a convaincu Tim de travailler avec moi. Quand il est venu visiter mon atelier et a vu cette toile, il m’a dit que j’étais prêt.
KVA Mais malheureusement je ne l’ai pas ! J’ai réussi à avoir cette œuvre qui s’intitule De Bloemenplukster. C’est bien ta petite amie qui y est représentée ?
BS Oui ! Et c’est aussi une autre de mes peintures favorites. J’aime beaucoup peindre la nature, particulièrement les fleurs, ce sont deux sujets que j’aime peindre. Et sur les deux toiles que l’on vient d’évoquer, on retrouve un jardinde fleurs et un magasin de fleurs.
KVA À quel rythme peins-tu?
BS Je travaille lentement mais beaucoup. J’aime être quotidiennement à l’atelier. Je passe généralement trois ou quatre semaines sur une toile, parfois plus longtemps. Je ne produis pas énormément, ce qui, d’une certaine manière, rend mon travail plus précieux.
KVA Je crois que tu connais un peu le milieu de la mode grâce à ta petite amie ?
BS Oui. Nous nous sommes rencontrés alors que j’étais encore à l’Académie. Elle y était également, dans le même département que toi d’ailleurs, puisqu’elle a étudié la mode. Je ne connaissais pas grand-chose à ce monde et c’est elle qui m’a initié. Son travail est assez proche du mien car elle est aussitrès intéressée par la nature. Elle a lancé sa propre marque qui s’appelle « Bernadette » et qui commence à rencontrer un joli succès.
KVA Est-ce que tu as déjà essayé de créer des imprimés, pour elle ou d’autres designers ?
BS J’ai essayé mais c’est un processus tellement différent, avec une technique bien précise. Je ne suis arrivé à rien. Je devrais m’y consacrer plus sérieusement… Peut-être dans le futur
KVA La nature a toujours été ton sujet de prédilection ?
BS C’est une bonne question ! J’ai toujours été intéressé par la nature. Mais quand j’ai commencé mes études, j’étais très attiré par les portraits, surtout ceux de la peinture classique. C’est pour cela que j’ai décidé d’aller à l’Académie d’Anvers. À force de peindre, tu commences à chercher ce qui te définit vraiment. C’est ainsi que j’ai commencé à incorporer de plus en plus de paysage et de nature dans mes peintures. Ce que je recherchais, c’était la liberté
KVA Est-ce qu’il t’est difficile de te séparer de tes toiles ? Tu passes tellement de temps à travailler dessus, j’imagine que tu entretiens une relation particulière avec chacune d’entre elles.
BS Ce n’est pas simple, mais depuis que je travaille avec Tim, je sais que je vais devoir dire au revoir à mes peintures. C’était plus compliqué quand j’étais étudiant car je ne peignais que pour moi. Maintenant je sais que les peintures seront placées. Cela fait également partie de mon processus, les pièces doivent quitter mon atelier pour créer de l’espace pour de nouvelles productions. C’est important de libérer mon espace mental. Et je peux toujours regardermes précédentes toiles grâce aux images prises. J’ai hâte aussi de les revoir toutes ensemble lors de ma première rétrospective.
KVA Est-ce que tu archives ton travail ?
BS La galerie s’en occupe ! Je suis très chanceux car je ne suis pas très doué pour cet exercice.

Ben Sledsens, « Girl in the Yellow Flower Dress », 2018.
Huile, acrylique et peinture à la bombe, 200 × 150 cm.
Avec l’aimable autorisation de Tim Van Laere Gallery, Anvers.
KVA Je me demandais si tu savais qui possédait tes peintures ?
BS Je ne connais pas tous les collectionneurs personnellement, mais je sais dans quelles collections elles se trouvent.
KVA Tu sais donc quelles toiles je possède !
BS Exactement !
KVA Est-ce que ton succès te met sous pression ?
BS Il y a une pression mais je crois que c’est très normal. Si tu t’engages dans ce genre de carrière et travailles avec des galeries comme Tim Van Laere, qui est mon galeriste principal, ou Nino Mier — avec qui je travaille à Los Angeles, alors tu sais que tu devras faire face à une certaine pression. Mais elle est positive. Ce qui est le plus difficile pour moi est de trouver une idée et une image à peindre. La toile blanche est toujours une épreuve.
KVA Comment travailles-tu ? Est-ce que tu travailles à partir de quelque chose que tu vois ? As-tu un modèle face à toi ou tout provient de ton imagination ?
BS C’est principalement mon imagination.
Je fais mes recherches et lorsque je trouve une image qui m’inspire, je l’utilise pour construire ma composition. Cela évolue ensuite dans mon propre univers et devient totalement différent. Je trouve l’inspiration partout, que ce soit sur Internet ou en regardant de vieilles peintures. Je suis toujours à la recherche d’inspiration.
J’imagine que c’est la même chose pour toi ?
KVA Oui. Je crois que la grande différence entre ton travail et le mien est que je dois faire face à un calendrier très serré. Je dois réaliser quatre collections — deux qui défilent et deux autres intermédiaires mais qui n’en demandent pas moins de travail — par an, je suis un rythme constant et si je ne suis pas prêt, je ne peux pas dire : « J’ai besoin d’un mois supplémentaire ». C’est la partie la plus difficile : respecter l’agenda tout en préservant le niveau de créativité et d’exigence que je me suis fixé. Un autre point différent est qu’en travaillant pour Berluti, je peux toujours partir de quelque chose d’existant, que ce soit une technique artisanale ou une paire de chaussures. Je peux toujours trouver un point de départ, ça facilite la création. Et une collection évolue pour devenir la suivante.
BS Ce que je trouve difficile avec la mode, c’est que tu conçois une pièce que tu dois ensuite donner à l’usine qui va la réaliser, et tu dois être satisfait avec le résultat. Alors que moi, lorsque je peins, je suis le seul maître à bord, je peux toujours contrôler. Être dans ta position ne doit pas être simple.
KVA Oui mais il peut aussi y avoir de belles surprises ! Ça fait partie du jeu : je travaille avec des artisans incroyables, des personnes qui ont un savoir-faire que je n’ai pas. Particulièrement ici, chez Berluti, où la couleur est un aspect très important. Désormais, lorsque je pense à une nouvelle collection, c’est à la couleur que je me confronte en premier, alors que c’est le point que j’abordais en dernier lorsque j’étais chez Dior. C’est devenu un élément essentiel de ma vie professionnelle. Dans ma vie personnelle, je m’habille souvent en noir, quasiment jamais en couleurs. Mais en vieillissant, je me suis distancié de plus en plus de mon travail : je ne fais pas de vêtements pour moi mais pour des personnes imaginaires, bien plus jeunes et cool que moi ! Je crois que c’est très important, car sans cela la marque risquerait de vieillir en même temps que moi… C’est passionnant de travailler avec ces artisans. Nous avons de grandes conversations. Ils ont des idées précises sur la manière dont les choses doivent être faites car ils maîtrisent ces techniques depuis de nombreuses années. Et je fais irruption dans leur monde, sans le connaître, et leur dis : « Pourquoi ne pas faireles choses dans cet ordre, ou de cette manière ? » C’est lors de ces dialogues créatifs que les meilleures choses surgissent. Je crois que mon travail est meilleur lorsque j’ai en face de moi des personnes de caractère.
BS Je comprends ! Mais alors, que fais-tu quand tu travailles sur une veste et que la couture n’est pas parfaite ?
KVA Je hurle et ils doivent la faire à nouveau !
BS Ah ah !
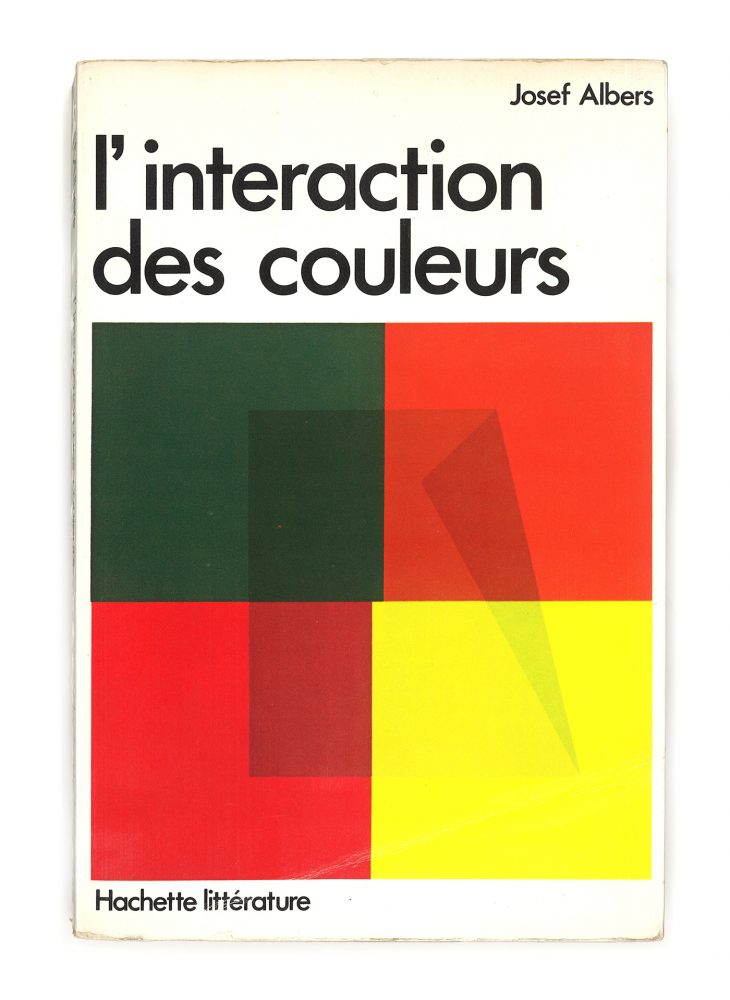
Joseph Albers, « L’interaction des couleurs », Librairie Hachette, Paris, 1974.
Publié originellement en 1963 par Yale University Press, New Haven.
Bibliothèque Magali Lahely
KVA Chaque croquis est réalisé dans une multitude de couleurs et de matières. Ça n’est pas comme une peinture. Si ça n’est pas fait correctement, nous y travaillons, et quelques jours plus tard, une nouvelle version arrive. Il y a toujours des moyens d’améliorer le résultat. C’est ce que nous faisons durant toute la saison. Nous avons un mannequin cabine, nous essayons le vêtement sur lui, nous faisons les fittings, ce qui veut dire que nous corrigeons, nous refaisons, nous ajustons. Ce processus est très différent du tien. Et aussi, si une de ces pièces me plaît, que ce soit une veste ou une paire de baskets, je peux toujours en avoir une et vendre les autres !
BS C’est vrai !
KVA Tout comme toi, je suis assez mauvais avec les archives. Je ne garde pas mes anciennes collections. Mais je le fais volontairement car je n’aime pas trop regarder en arrière. J’espère toujours que ma nouvelle collection sera meilleure que la précédente. Quand je regarde ce que j’ai réalisé auparavant, je me focalise sur les erreurs. Je préfère garder dans mon esprit l’image de l’histoire que je cherche à raconter avec chaque défilé, notamment avec la musique et les mannequins choisis. Pour moi, chaque show est un peu comme un personnage ou un court-métrage.
BS C’est drôle car c’est l’opposé pour moi ! Quand je suis sur une peinture, je ne vois que les défauts. Mais si je mets la toile de côté pendant quelques semaines et que je la reprends, je ne vois plus ces erreurs !
KVA Est-ce que tu montres ton travail en cours à tes amis ou tu attends que la toile soit terminée avant de la partager avec ton entourage ?
BS Je ne publie pas sur Internet les étapes de travail mais ça ne me gêne pas que mes amis les voient lorsqu’ils passent à l’atelier.
KVA Est-ce que tu te concentres sur une seule peinture ou tu arrives à travailler sur plusieurs toiles en même temps ?
BS Cela dépend. Parfois une, parfois quatre ! Mais la plupart du temps, je fais de longues sessions sur une seule toile. Quand je ne peux plus la voir, que tout devient flou, alors je travaille sur une autre.Et toi, est-ce que tu dessines pour faire tes collections ?
KVA Un peu mais pas tellement. Je fais des mood boards. Beaucoup de collages également. Mon travail naît en grande partie des discussions que je peux avoir avec mon équipe. Puisque je fais quatre collections par an, je peux toujours dire « tu te souviens de ce modèle que nous avons fait il y a trois saisons ? Nous devrions essayer d’y ajouter ceci et de transformer cela, avec ce genre de couleurs ». Il s’agit vraiment plus de conversations que de croquis. Parfois j’aimerais en faire plus, mais je n’ai pas vraiment le temps de faire ça. En plus, notre travail est très industrialisé. Tous nos dessins techniques sont faits sur ordinateur, un peu comme ceux des architectes. Si je faisais des croquis très élaborés, très précis, ils ne seraient pas assez techniques, ça serait une perte de temps. Est-ce que tu prépares une nouvelle exposition ?
BS Oui, mais ça sera en 2020, ça n’est pas pour tout de suite. Mais j’ai finalement peu de temps car il y aura deux expositions, une à la Kunsthalle de Lucerne et une autre chez Tim. Et il y a aussi les expositions collectives et les foires, j’ai toujours quelque chose à faire !
KVA Est-ce que tu écoutes de la musique en travaillant ou tu es dans le silence ?
BS J’écoute de la musique et des podcasts ou la radio. J’aime entendre des gens parler car ma pratique est tellement solitaire que j’ai l’impression de participer à une conversation. La radio me permet aussi de savoir ce qui se passe dans le monde, moi qui suis isolé dans ma bulle. Et toi ?
KVA J’ai très peu de moments où je travaille seul. Lorsque cela arrive, je m’isole dans mon bureau et demande à mes collaborateurs de me laisser seul pour digérer ce sur quoi nous sommes en train de travailler. Parfois je vais mettre de la musique un peu forte pour faire comprendre que ça n’est pas le moment de me déranger. Mais à part ces rares moments, j’aime travailler en silence car j’ai généralement tellement de choses à considérer. Nous avons tellement de deadlines et de rendez-vous ! Parfois, quand je suis en rendez-vous avec une personne, je sais déjà que vingt-cinq minutes plus tard, je serai avec une autre personne. Je deviens nerveux quand il y a trop de bruit, cela me distrait. Je suis toujours celui qui va se lever en milieu d’une réunion pour fermer une fenêtre, pour ne plus entendre les bruits de l’extérieur. Je pourrais tuer pour un téléphone qui sonne au milieu d’un rendez-vous ! J’ai du mal à me concentrer car j’ai beaucoup à gérer. Évidemment, mon entourage se moque parfois de moi pour cela car c’est devenu un peu une obsession. C’est vraiment tout le contraire de toi !
Je pourrais payer très cher juste pour ne voir personne !
BS Ah ah ! C’est drôle, moi je suis toujours jaloux des personnes qui ont plein de collègues. On désire toujours ce que l’on n’a pas.
KVA Exactement…
Fille d'aujourd'hui, femme de demain
Sigrid BouazizNatacha Ramsay-Levi
Après avoir officié aux côtés de Nicolas Ghesquière chez Balenciaga et Louis Vuitton, Natacha Ramsay-Levi est devenue la directrice artistique de Chloé en avril 2017. Une poignée de collections lui ont suffi à mettre en place une mode plurielle, teintée de romantisme et d’évasion. Il s’en dégage une décontraction spontanée, un chic qui se définit par une élégance naturelle, en opposition à une sophistication trop étudiée. Une qualité que l’on pourrait attribuer à la comédienne Sigrid Bouaziz : entre théâtre, cinéma d’auteur et rôles pour la télévision, la jeune femme incarne par sa capacité de déplacement une certaine idée de la modernité. Si Natacha et Sigrid ont déjà eu l’occasion de se croiser, elles n’avaient pourtant jamais pu s’entretenir l’une avec l’autre. Pour Revue, elles racontent leurs intuitions et leurs besoins de création.
Photographe Mélanie + Ramon
Styliste Jack Borkett
Natacha Ramsay-Levi Je t’ai découverte Sigrid à travers ton rôle dans Personal Shopper, le film d’Olivier Assayas. Ce que tu joues, tes choix, ta beauté très française m’ont donné envie de te rencontrer. C’est pour cela que je t’ai invitée à venir assister à nos défilés !
Sigrid Bouaziz Nous avons des amis en commun mais nous n’avions jamais eu l’occasion de nous croiser. Je sais que ça peut sembler un peu superficiel de l’affirmer en introduction de cette discussion, mais la mode que tu proposes chez Chloé, c’est vraiment tout ce que j’aime, que ce soit dans les inspirations, les imprimés, la coupe. Il y a vraiment quelque chose qui touche à « une vraie personne ». Ça réconcilie avec la mode je trouve.
NRL Tu es parisienne, n’est-ce pas?
SB Tout à fait.
NRL Il n’y a pas tellement de gens qui ont cette culture parisienne, qui habitent là depuis longtemps, connaissent bien les différents quartiers. Je crois qu’entre nous, il y a cette reconnaissance là également. Je retrouve une énergie qui est celle de Paris.
SB Même si toutes les parisiennes ne sont pas pareilles.
NRL Exactement. Mais il se dégage de toi quelque chose que je trouve très singulier, une sorte d’aisance naturelle. J’ai l’impression qu’on peut te croiser autant à Saint-Germain que dans le 20e.
SB J’ai l’impression que l’on parle toutes les deux de cette même femme qui se nourrit culturellement de beaucoup de choses,qui est vivante dans la ville.
NRL Dès que tu commences à être un tout petit peu publique, il y a ce phénomène de personnes qui se reconnaissent. Je le vois maintenant avec Chloé et j’imagine que c’est aussi ton cas avec ta carrière. J’avoue que c’est un des aspects qui me plaît le plus. Les choses se font assez naturellement. Il se forme une communauté de points de vue, de façons de regarder le monde, de centres d’intérêt. Ce qui fait que lorsque l’on se rencontre pour la première fois, on a souvent l’impression que l’on se connaît déjà !
SB Mais c’est une vraie question, de comprendre pourquoi et comment on se reconnaît. C’est comme une rencontre avec un metteur en scène. Il va reconnaître quelque chose en toi, et c’est presque inconscient. C’est ce qui s’est passé avec Olivier Assayas, avec lequel je n’ai pas passé d’essai. On s’est reconnus à un endroit. C’est assez mystérieux.


NRL Oui ! C’est vrai que les filles que nous invitons au défilé, c’est parce que j’ai envie de les découvrir. Moi je suis obsédée par les femmes, sinon je ne ferais pas ce métier-là ! Le féminin est un sujet génial, et c’est également celui de Chloé. J’aimerais te demander quel est ton rapport à la mode ?
SB J’ai un rapport amour/ haine avec ce milieu car je suis née dedans, mais je ne l’assume pas trop. Mon père a créé une marque qui s’appelle Ventilo et qui n’existe plus aujourd’hui.
NRL C’est drôle, j’ai fait référence à cette marque il y a quelques jours ! Elle a fait partie de cette époque où le prêt-à-porter français était encore très créatif.
SB J’ai donc grandi là-dedans. Ma mère, qui a été mannequin dans sa jeunesse, était la muse de mon père. J’ai commencé à faire moi-aussi du mannequinat, un peu malgré moi. Mais j’ai toujours eu un rapport de défiance par rapport à ce monde-là. J’ai rencontré des gens biens et des gens moins bien. J’ai fait quelques campagnes, pour Vanessa Bruno ou APC. Je me souviens d’une série d’images géniales faites par Mark Borthwick. C’était les belles années où les photographes étaient libres de réaliser des campagnes créatives. Même si j’ai vécu des belles choses, j’ai décidé d’arrêter ça pour me consacrer au métier d’actrice en passant le conservatoire et en refoulant la mode. Mais malgré moi, elle revient !
NRL Oui mais désormais tu peux choisir, c’est une autre position.
SB La mode, c’est toujours un peu compliqué quand tu es comédienne. Je ne voulais pas non plus qu’on m’identifie comme la « it-girl », je ne voulais pas qu’on m’enferme dans le cliché de la branchée parisienne : on ne sait plus ce que tu peux jouer car on te voit trop dans des images de mode… L’image ne doit pas primer sur ton travail d’actrice.
NRL Tu inities beaucoup de projets je crois ?
SB Oui, j’essaie de dire des choses, que ce soit en mettant en scène
un spectacle ou en réalisant des courts-métrages ou des clips.Ce sont des outils différents, de la même manière que toi aussi dans la mode tu as à ta disposition différents moyens pour communiquer
un message.
NRL Ça te permet également de ne pas être dans l’attente.
SB C’est sûr que tu subis le désir — ou non — de quelqu’un. Tu passes ton temps à être choisi ou à ne pas être choisi. Il faut savoir que l’on t’adresse une majorité de « non » pour une poignée de « oui ». Ce sont des refus que l’on oublie sinon on deviendrait fou. Ce n’est pas toujours évident. Du coup, pour moi, faire les choses par soi-même est indispensable. Quand on est actrice, on a souvent un besoin d’expression qui est inaliénable. Monter ses propres projets est aussi parfois compliqué car dans le regard des autres, cela peut être interprété par : « Ah, elle ne travaille pas donc elle s’occupe en faisant ses propres trucs. » Mais ça n’est pas que ça. Je pense que si je travaillais beaucoup, j’aurais malgré tout ce besoin de m’exprimer à travers mes projets personnels. Ça part d’un vrai désir. Et toi, qu’est-ce que ça a changé dans ta manière de créer de te retrouver à la tête de Chloé ?
NRL Cela n’a rien à voir. Jusqu’ici j’ai travaillé pour Nicolas (Ghesquière) pendant quinze ans. Et j’aurais pu continuer quinze années supplémentaires car il a un univers tellement étonnant, toujours en mouvement, qu’il est impossible de s’ennuyer. Mais j’ai passé mon temps à créer en essayant de mettre les lunettes de quelqu’un. Bien sûr, il y avait beaucoup de moi dans ce que je lui proposais, mais c’était pour la marque et pour lui. Aujourd’hui, il s’agit de définir ce en quoi, moi, je crois pour Chloé. Il n’y a pas d’autre filtre que le mien. Tout est différent, tout est pensé. Il y a la partie instinctive, que je connaisbien pour l’avoir pratiquée, et la partie réflexive où j’essaie de comprendre comment les choses s’assemblent, ce qu’elles véhiculent, comment elles se transforment en matière. Cela reste des messages de mode, mais quand même, il y a des messages qui passent. J’ai lu tel livre, mis tel artiste ou telle musique en avant, et tout cela parle. C’est génial de pouvoir s’exprimer ainsi, à la fois de pouvoir sortir ses obsessions et leur donner du sens. C’est quelque chose qui se nourrit et qui est très inspirant.
SB Je retrouve chez toi un plaisir de la mise en scène de quelqu’un de vrai, tu sculptes des vêtements à partir de tout ce qui t’a nourri. C’est là où je trouve que la mode devient vraiment intéressante.
NRL Avant les défilés, j’écris le texte de présentation avec Thierry, l’un de mes collaborateurs, et Pauline Klein, une amie écrivaine. La collection printemps-été 2019 s’intitule « Hippie modernism », titre emprunté à un catalogue qui regroupe les travaux de plusieurs architectes, artistes et réalisateurs. C’est après-coup que j’ai réalisé qu’il y avait dans ma vie, dans les objets et les livres qui m’entourent, plein de liens avec ces différents penseurs. Quand tu commences à tirer sur un fil, tu comprends que tout est lié et produit du sens.
SB Est-ce qu’il y a des motifs qui t’inspirent de manière récurrente ?
NRL La mode a pour principe d’être changeante, j’adore ce media car il ne pose pas de limites sur les zones où tu peux poser ton œil. Par exemple, j’adore prendre un élément ringard pour le transformer en autre chose. C’est notre chance de faire ce métier, qui n’est pas vraiment de l’art et qui joue sur les références : pouvoir tout regarder. Il y a des leitmotivs qui reviennent, mais je ne regarde jamais la même chose. L’antiquité par exemple, pour ses formes simples. Les bijoux, avec leur charge émotionnelle, qui portent en eux une trace, un souvenir. D’ailleurs cette dernière collection — printemps-été 2019 —était très inspirée par les souvenirs de vacances.
SB Ça se ressentait énormément, c’était un vrai plaisir. Il y avait quelque chose de solaire, de jouissif, de très généreux, et ça fait du bien.
NRL Le corps et le vêtement doivent parler ensemble.
SB D’ailleurs, je tiens à te dire que ça m’a fait plaisir de voir ces mannequins avec ces fesses voluptueuses! Ça change de ce que l’on voit habituellement ! J’aime ce côté généreux et pas sage. Prendre les inspirations à plein d’endroits différents pour les faire siennes. On sent que tout est chargé de références, même si on a pas besoin de les re-connaître pour apprécier le résultat. Je viens de réaliser un film en 16mm, je suis actuellement en train de le monter. J’ai filmé ma maison d’enfance et son jardin. On retrouve cette question des symboles. Il y a énormément d’objets dans cette maison, c’est extrêmement chargé. J’ai repris toutes les poupées de ma mère, qui en possédait une centaine, et je les ai filmées une par une. Il y a également beaucoup de reliques de mon adolescence. J’ai adoré les utiliser. Tout le monde ne verra pas ce qu’il y a derrière, mais je suis sûre que leur charge d’histoire se sent.
NRL Cette capacité à sentir, je crois que c’est un truc très féminin, quelque chose qui ramène à la figure de la sorcière. J’ai d’ailleurs lu cet été un livre qui s’appelle Rêver l’obscur, sous-titré femmes, magie et politique, écrit par Starhawk. Cette question-là est un peu à la mode aujourd’hui, mais je crois vraiment à la différenciation entre les hommes et les femmes. On a chacun un pouvoir un peu magique. Le notre est à un endroit assez spécial, dans l’émotion. C’est là-dessus que j’ai envie de travailler, parce que c’est ça que je ressens. C’est pour ça que j’ai des obsessions sur des femmes comme toi ! Pour moi, il y a quelque chose d’un peu magique à être une femme. Et qui dit magie, dit symbolisme.



SB J’ai beaucoup d’amies femmes, beaucoup de tribus, et c’est la chose la plus importante dans ma vie. Je suis émerveillée et bouleversée par ces amitiés féminines, toutes ces femmes guerrières qu’il y a autour de moi et qui sont toutes porteuses de quelque chose de très fort et puissant.
NRL Pour le premier défilé, j’ai parlé de l’idée de « travailler avec les faiblesses ». Les années 80, cette idée de femme indépendante à épaulettes, ça n’a plus beaucoup de sens aujourd’hui. Nous sommes complètes avec nos forces et nos faiblesses. Il y a cette transparence, cette acceptation de montrer les deux faces, chez toutes les femmes que j’aime. Je crois que tu as mis en scène un spectacle autour de Sylvia Plath ?
SB Oui, elle a une histoire tragique, elle s’est suicidée à l’âge de 30 ans, et pour autant, je me suis beaucoup reconnue en elle car elle était aussi une midinette. Elle n’était pas torturée comme pouvait l’être Sarah Kane. Quand tu lis son journal, tu la découvres en train de se regarder dans le miroir, à se demander si elle est bien habillée, à parler des nouvelles chaussures qu’elle a achetées. Je me reconnais en elle car moi aussi je suis parfois légère, obsédée par ces petits détails, et ça n’est pas pour autant que je n’ai pas des choses plus profondes à dire.
NRL Toutes les femmes artistes que l’on admire travaillent sur ces oppositions. Il y a cette œuvre de Chantal Akerman que j’adore : In the Mirror. C’est juste une femme qui se regarde dans le miroir d’une armoire et qui décrit son corps. C’est d’une simplicité extraordinaire et c’est très fort.
SB Est-ce que le futur est un sujet qui te parle ?
NRL Je suis très sur le présent. Pour moi, la seule question liée à celle du futur concerne la Terre. Le rapport à la technologie, c’est bien, mais je n’arrive pas à me concentrer dessus car il y a des choses plus préoccupantes. Je me demande s’il y a surtout des moyens de faire quelque chose maintenant pour notre planète car c’est extrêmement urgent.
SB Je suis complètement d’accord avec toi.
NRL Il faut se poser les bonnes questions : qui on est, comment on vit, qu’est-ce qu’on fait.
SB J’ajouterais qu’il faut recréer du sens. Du lien.
NRL De l’intelligence.
SB Dans ma génération, je ressens cette perte de sens. On traverse une crise identitaire.
NRL Pour moi le vrai futur est de revenir à des problèmes très simples. Je pense notamment au texte de la céramiste Valentine Schlegel, qui a écrit ces phrases très simples dans l’un de ses catalogues. Cela s’appelle « notes pour un scénario d’un film autobiographique » :
Je bats la terre
Je pose du plâtre
Je pioche un mur
Je pioche la terre
Je cloue du cuir
Je coupe du bois
Je rame
Je tourne un pot
Je fais des confitures
Je sculpte du bois
Je rame
Je mets mes godillots
Je roule pieds nus à la plage un cordage
Je plante
Je coupe les arbres
J’épluche
Je ramasse tout à la plage
Je brode

C’est très simple, c’est réduit à presque rien, et pourtant, je pense que le futur se rapporte peut-être à ça. Tout le reste abîme la planète. Comment faire que ces quelques lignes aient de la valeur ? C’est ça qui est important.
SB Face à l’immobilisme, il faut revenir à des choses essentielles.
NRL Un peu d’idéalisme, un idéalisme simple et courageux,
serait bien.
C.Q.F.D. de la nature relationnelle mode
Luca Marchetti
Depuis quelques années déjà, les programmes d’études supérieures consacrés aux dites fashion studies proposent une variété toujours grandissante d’enseignements sur les aspects les plus abstraits et conceptuels de la mode. On y trouve des cours qui en dissèquent l’imaginaire, qui analysent sa mise en image, qui étudient la psychosociologie ou la sémiotique du vêtement, ou qui explorent la pratique naissante du fashion curating… jusqu’à s’aventurer sur le sujet — toujours très polémique — de la mise à mort culturelle et industrielle de la mode-même.
Comme si la simple matérialité du vêtement n’était plus une pré-occupation pour les intellectuels de la mode de nos jours, la plupart des publications dans ce domaine, de l’éclairant Critical Fashion Practices qui analyse le travail des créateurs les plus ouvertement conceptuels de ces dernières décennies, jusqu’à Fashion Tales consacré au potentiel de la mode à inventer des imaginaires de fiction, semblent aussi suivre ce virage. Parmi les titres les plus inspirants, Thinking through Fashion mérite d’être considéré avec une attention particulière, car ce livre ne propose pas uniquement une lecture philosophique de la mode de ces trente dernières années, mais il démontre également que la plupart de la production vestimentaire contemporaine a comme effet principal de nous connecter à des expériences auxquelles nous n’aurions pas accès sans l’intermédiaire du vêtement.
La mode y est présentée comme un agent relationnel qui nous permet d’appréhender “autrement” le corps, l’espace, nos semblables ou encore notre capacité d’imagination.
L’artiste anglais Leigh Bowery, performeur et créateur de vêtements, décédé dans les années 1990, avait été un pionnier dans cette exploration. En concevant ses tenues pour des performances présentées au sein de clubs ou lieux d’art londoniens, il veillait toujours à entraver la perception des cinq sens plutôt qu’à la favoriser. Par le dépaysement proprioceptif et la déformation de l’apparence, il souhaitait réécrire les codes de notre présence dans le monde. Si une telle approche radicale est envisageable de la part d’un artiste, on en retrouve aussi des traces dans le travail de créateurs de vêtements tout à fait tournés vers le prêt-à-porter.
Il suffit de citer Hussein Chalayan pour lequel la mode a toujours été un outil pour définir les mécanismes de construction de l’identité individuelle et collective. Dans son projet Place to Passage, par exemple, le vêtement est métaphorisé par un véhicule spatio-temporel susceptible d’accompagner l’individu dans les métamorphoses intérieures toutcomme dans ses déplacements géographiques.

Hussien Chalayan, Place to Passage, 2003.
Extrait de film, avec l'aimable autorisation d'Hussein Chalayan/Neutral.
L’écho des question-nements de Bowery et de Chalayan se ressent également dans l’approche au vêtement de Rick Owens, dont le sujet plus récurrent est notre relation à l’altérité, autant celle que l’on peut trouver à l’intérieur de nous-mêmes que celle dérivée d’une apparence physique plutôt humanoïde qu’humaine, ou alors, par une provocante reconfiguration du rapport à l’autre qu’il a même utilisé en tant qu’accessoire à même le corps des mannequins, lors d’un défilé.
La liste des designers de vêtement impliqués dans une relecture des codes de la représentation et de la construction du genre compte aujourd’hui un nombre impressionnant de noms. Parmi les moins connus et les plus originaux, le canado-jordanien Rad Hourani — basé entre Montréal et New York — a choisi l’axe de la neutralité, investiguée en tant qu’aspect inhérent à l’espèce humaine qui détermine autant l’émergence des traits de genre dans l’individu que nos relations de séduction et de communication avec l’autre.
Toutes ces problématiques sont visiblement proches de celles que l’on retrouve au cœur des disciplines artistiques parallèles à la mode, de la danse contemporaine jusqu’à l’architecture ou la performance. L’hybridation des approches artistiques est d’ailleurs un autre signe typique de notre époque et les fondations ouvertes par nombre de grandes maisons de luxe présentant une programmation à cheval entre mode et arts en sont une confirmation indiscutable. Certainement la Fondazione Prada de Milan, plus que d’autres, a saisi la nature relationnelle de la marque de mode dans le contexte de la culture de nos jours. Contrairement à plusieurs de ses homologues qui ont souhaité s’installer dans une création architecturale “monolithique” posée comme un objet urbain dans le tissu métropolitain, elle a plutôt choisi une approche plus fragmentaire et éclatée. La Fondazione n’a pas investi « un édifice », mais toute une série de micro et macro-structures déjà existantes, cousues les une aux autres par des interventions telles des passerelles, des tunnels ou des rampes inclinées. Considérée par le prisme de sa programmation, la forme de la Fondazione fonctionne tout à fait comme un miroir architectural d’un contenu artistique qui se veut aussi « relationnel ». Là où l’opération de l’archistar Rem Koolhaas a souhaité créer un réseau de sites indépendants et connectés entre eux par des interventions de raccord, le chef d’orchestre artistique du projet, Germano Celant, a imaginé une programmation essentiellement faite de projets collaboratifs, de performances, d’activités participatives et de commandes artistiques où le rôle joué par l’exposition d’œuvres en tant qu’objets est sensiblement secondaire vis-à-vis de l’importance accordée à la mise en relation entre artistes, publics et genres créatifs.
Bien que l’orientation relationnelle de la culture vestimentaire puisse paraître d’un premier abord surprenante, le phénomène paraît quasiment une évidence si l’on suit la perspective de Lucas Mascatello, artiste et stratège de marque vivant à New York. En dehors de tout contexte académique, dans un article publié sur la plateforme éditoriale SSense en septembre, il appliquait à la mode la notion d’« aposématisme », ou bien la stratégie qui permet aux organismes vivants de s’adapter à leur contexte de vie en émettant des signaux relationnels destinés à leurs semblables. La mode, matériau d’expression de l’individualité par excellence, serait alors utilisée par les individus pour mettre dans une relation logique la surabondance de stimuli identitaires véhiculés par l’environnement médiatique dans lequel ils vivent et par conséquent, pour maximiser leurs possibilités d’être compris et d’établir des relations avec leur contexte de vie.
En élargissant la visée d’une telle analyse au contexte de toute la culture dans son ensemble, le rapport relationnel que le vêtement nous aide à établir avec le monde pourrait bien façonner le futur proche de tout l’univers de la mode. Demain, la mise en relation entre les innombrables diversités que le monde globalisé a généré en vue d’une cohabitation heureuse risque de s’imposer à nous davantage comme une obligation que comme une opportunité.
C.Q.F.D. de la couture
Luca MarchettiJules Julien
Le monde de la couture aime la surprise, le geste théâtral, le spectacle — ce n’est pas nouveau — et depuis ses origines la mode fait son cinéma à coups de scandales, de provocations, de statements et d’ultimatums. En l’espace d’un peu plus d’un siècle, on a vu passer en revue des concepts originaux comme la mode du nu (ou la mode sans vêtements), la mode de l’anti-mode (ou la mode sans mode), le luxe accessible (ou le luxe du non-luxe), jusqu’aux récentes déclarations de la prétendue mort de la mode.
Mais parmi toutes ces prises de position, le paradoxe vestimentaire d’une « couture sans coutures » occupe probablement la place d’honneur. Plus encore que la prouesse technique de réaliser un vêtement sans le coudre, celle de réaliser une silhouette donnant cette impression en raison du fait que les quelques coutures existantes — réduites au minimum indispensable — ne sont quasiment pas visibles, paraît encore plus excitante.
Dans l’histoire de la mode moderne, cette chimère de style a été poursuivie par des grands couturiers tout comme par des marques de grande diffusion. Après avoir implanté son atelier multidisciplinaire à Venise, l’espagnol Mariano Fortuny réalise déjà en 1907 la robe Delphos, devenue « un classique » non seulement parce qu’ elle a été instantanément adoptée par le gynécée de l’intelligentsia artistique, mais aussi parce qu’elle était obtenue d’une seule coupe de soie plissée, sans coutures et ajustée sur le corps uniquement par des perles de verre de Murano au niveau des épaules. La même silhouette fuselée et plissetée a été ensuite reprise plus récemment par le champion incontesté de cette technique, le japonais Issey Miyake, peut-être moins connu pour ses collections A-Poc obtenues à partir d’un seul rouleau de tissu, lui aussi sans coutures, que les clients peuvent customiser au ciseaux. Quant à la France, il faut rappeler au moins certaines créations surnaturelles d’Azzedine Alaïa où la minimisation de coutures donne l’impression que ces robes fusionnent avec la peau de celles qui les portent. À la même époque, plus au sud, Gianni Versace expérimentait matières innovantes et tissus métalliques tricotés afin d’obtenir aussi un effet de « deuxième peau » grâce à un vêtement sans coutures apparentes. Pareillement, le marché de l’accessoire n’a pas échappé à cette passion. Si aujourd’hui les polémiques sur le nombre de peaux de crocodile ou de python nécessaires pour réaliser un sac à main ont touché des grands noms de la maroquinerie comme la maison Hermès, d’autres, telles que Bottega Veneta, vantent l’élégance de leurs sacs-cabas réalisés avec une seule peau afin d’obtenir une surface finie sans aucune discontinuité.
Ces dernières années, les progrès technologiques en termes de production ont également permis de démocratiser l’utopie pragmatique non-cousu. La collection de vêtements d’extérieurs seamless d’Uniqlo 2017-2018 en est un exemple tangible : elle associe à l’allure fluide de ses doudounes sans couturesl’intéressant atout d’augmenter considérablement l’imperméabilité des pièces tout à fait indifférentes à l’impact du vent et de la pluie.
Le niveau de technicité de ces produits peut certainement en expliquer en partie le charme et le succès. Mais pour mieux comprendre, il n’est pas inutile de relire les notes que Roland Barthes, sémiologue et fin analyste de la culture « pop » naissante, publie à propos de la Citroën DS mise sur le marché en 19551. Aérodynamique, sinueuse, aux lignes fluides et aux formes qui dissimulent toute trace d’assemblage mécanique (vis, boulons clous, charnières…) cette voiture s’inscrit dans l’imaginaire culturel de l’époque non pas comme une machine qui aurait été construite, mais comme une créature qui aurait été créée. L’analyse de Barthes nous reconduit à la mode en nous rappelant que depuis bien longtemps le designer de vêtements n’est plus un tailleur ou un couturier, mais un « créateur ». L’aura de la création de mode tiendrait donc à ses connotations divines ? Peut-être, tout comme, en quelque sorte, l’apparence svelte de la Citroën 19 au nom explicite de dé-esse relève aussi du sacré.
Le vêtement sans coutures nous aide alors à croire en cette part de magie de la mode que l’univers du luxe préfère appeler « le rêve », et en raison de laquelle on s’abandonne volontiers à l’irrationalité de désirs — et de bien des achats — que l’on ne saurait justifier rationnellement. Et en marge de ces considérations intellectuelles, on n’oubliera pas que, si la mode est encore perçue aujourd’hui comme un lieu de la culture où peut exister une certaine liberté d’expression, c’est aussi parce que son imaginaire s’est construit — pour le meilleur et pour le pire — sur des fondations qui tolèrent et cultivent le paradoxe, l’invraisemblable, l’ambiguïté et la contradiction, tout en revendiquant le droit de montrer sans expliquer et d’expliquer sans dire.

Issey Miyake, Printemps Été 2016
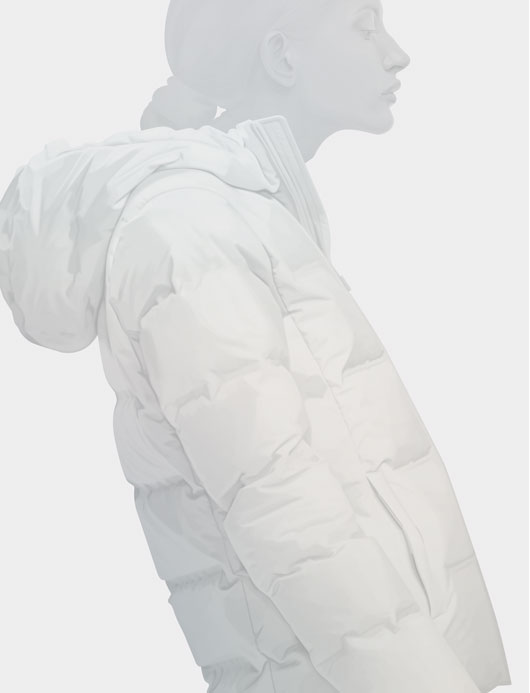
Uniqlo, Automne Hiver 2017

Comme des Garçons, Automne Hiver 2017
C.Q.F.D. de la technique dans la mode
Luca Marchetti
Quand on parle de technique à propos du design de mode, on fait spontanément référence à une production vestimentaire réalisée par des procédés traditionnels, tel le dessin, la coupe manuelle et bien évidemment la couture. Le terme « technologie », en revanche, évoque plutôt ces expérimentations contemporaines comme le tissu intelligent — mieux connu sous son nom anglophone de smart textile — ou le vêtement robotisé — autrement dit wearable — que l’on pourrait résumer sous la notion de « mode innovante ».
L’interrogation sur la justesse d’une telle opposition n’est pas banale. Elle est d’ailleurs à l’origine d’une longue tradition spéculative qui, en réfléchissant à la nature et aux enjeux de la production — du grec τέχνη, techné —, se soucie de mieux comprendre l’ontologie de l’être humain. Loin d’être une méthode, la technologie relève plutôt de cette galaxie réflexive et se définit comme la « théorie générale des techniques ou l’ensemble des savoirs, des pratiques et des termes propres à un domaine technique en particulier ». La technique est donc un savoir appliqué, la technologie reste abstraite.
Pour indiquer le travail de ces créateurs qui se servent de ressources de pointe, au sens industriel ou scientifique du terme, il vaudrait alors mieux parler de vêtement à haute technicité plutôt que de vêtement technologique. La proximité lexicale entre les deux expressions rend également plus simple d’envisager que la haute technicité du vêtement puisse aujourd’hui se retrouver parmi les savoir-faire qui qualifient, non seulement le prêt-à-porter (éternellement assoiffé de nouveautés en tout genre), mais aussi la haute couture, historiquement considérée responsable de « canoniser » l’excellence artisanale dans le domaine du vêtement.
A-POC
Lancée en 1999, en collaboration avec son assistante Dai Fujiwara, la désormais iconique ligne de vêtements A-POC d’Issey Miyake marque un point de non- retour dans l’histoire de la mode à haute technicité. La subversion dans la conception vestimentaire est ici totale. La première collection est entièrement réalisée en matières synthétiques et contient une seule forme tubulaire de nylon rouge reliant une série de 23 pièces, sans solution de continuité. Technologiquement complexe, le principe est pourtant simple : un processus de réalisation assistée par ordinateur permet à l’utilisateur de « finir » aux ciseaux le fourreau de tissu tricoté, en suivant des lignes d’assemblage qui permettent d’obtenir des formes différentes, en fonction des coupes opérées. Non seulement la science entre de plein pied dans le prêt-â-porter en remplaçant l’attrait du style par une forme d’aspiration intemporelle basée sur la technicité, mais le geste créatif de Miyake redéfinit l’idée même du « fait main » qui passe du côté du créateur à celui du consommateur.

« A-Poc Making, Issey Miyake and Dai Fujiwara », édité par Vitra Design Museum & Miyake Design Studio, Weil am Rhein, Allemagne, 2001.
Couverture du livre: graphisme de Thorsten Romanus, photographie d'Irving Penn © 1999
Bibliothèque Justin Morin
LOUIS VUITTON
Les plus jeunes adeptes de la mode trouvent aujourd’hui en Louis Vuitton une pleine expression de la culture pop et sophistiquée, globalisée et en même temps nourrie de références pointues, qui caractérise notre présent. Leurs aînés, en revanche, se souviennent peut-être d’un temps où la maison ne proposait pas encore de prêt-à-porter, étant plutôt connue pour être le fleuron français de l’artisanat du cuir. Les initiales LV monogrammées sur les articles de maroquinerie les plus vendus au monde étaient alors synonyme de savoir-faire patrimonial, de fait main et de métiers d’art. Dans cette perspective, il est intéressant de regarder de plus près les techniques utilisées pour les collections contemporaines, notamment celle du printemps-été 2019 par Nicolas Ghesquière. On y trouve notamment les manteaux « gommo » dont la base du tissu est une membrane souple de jersey recouverte de polyuréthane, coupée à l’ultrason et thermosoudée, procédés qui semblent contredire cette tradition manuelle. Mais ce n’est qu’une impression superficielle car, au contraire, ces solutions renouent avec la plus noble histoire du design. Il suffira de rappeler l’expérience italienne des années 1950 et 1960— époque à laquelle la machine inspirait le futur et ne faisait pas peur — où l’artisanat et la plus haute technicité se trouvaient naturellement alliés dans l’objectif commun de réinventer la création industrielle.

Louis Vuitton, Printemps Été 2019 © Avec l'aimable autorisation de Louis Vuitton
IRIS VAN HERPEN
La mode d’Iris Van Herpen puise dans la recherche scientifique autant pour l’imaginaire de ses créations que dans les processus de production des pièces. La collection « Shift Souls » du printemps-été 2019, par exemple, tire son esthétique des recherches sur l’ingénierie de l’ADN. Les silhouettes qui la composent ont été conçues pour révéler des visages anamorphiques par le simple mouvement du corps qui le porte, symboles des identités possibles qui se cachent dans notre patrimoine génétique. Si leur réalisation renvoie à des processus sophistiqués tels le termo-pliage de la soie sur du mylar et la découpe de dentelles au laser, c’est le contexte dans lequel la collection a été présentée qui détermine sa valeur culturelle. En tant que membre invité de la Chambre Syndicale de la Haute Couture, Van Herpen institutionnalise la compatibilité de la haute technicité avec le domaine le plus conservateur de tout l’univers de la mode qui, depuis le XIXe century, en écrit la tradition institutionnelle.

Iris Van Herpen, Printemps Été 2019, © Avec l'aimable autorisation d'Iris Van Herpen
C.Q.F.D. de la marque de mode contemporaine
Études Studio
À contre-courant des lois classiques du marketing qui prônent la cohérence absolue des codes et la lisibilité immédiate de toute expression institutionnelle, le collectif Études Studio anime à Paris une marque de mode d’un nouveau genre.Elle s’est construite par rencontres et affinités électives entre ses six membres, toujours en mettant à l’honneur la pluridiscipli-narité des métiers et de la production. Sa philosophie se lit en filigrane dans son nom qui, en juxtaposant deux mots signifiant la même chose en deux languesdifférentes, rappelle autant l’intelligence créative de l’étude que l’importance d’une signature collective et directement inspirée des dynamiques internes au studio d’artiste.
Études Studio a maintenant cinq ans. Inscrite depuis 2012 parmi les noms les plus suivis dans le panorama international, la marque de mode française y fait figure de paradigme de ce qu’est une enseigne de style contemporaine. Tout en étant connue principalement pour son prêt-à-porter, elle a habitué son public de clients, lecteurs et spectateurs à une panoplie d’expressions créatives qui s’étendent bien au-delà du vêtement. Si d’un côté cet éclectisme réfléchit celui de l’univers actuel du style (qui s’étend de la création et ses multiples mises-en-ambiance tous médias confondus, à l’interaction en temps réel avec les populations de clients et de followers), il parle aussi de la nature d’Études, née non pas d’un projet commercial, mais du partage d’une même sensibilité créative parmi les membres du collectif qui l’a créée.
Jérémie Egry et Aurélien Arbet, co-fondateurs de la marque, se rappellent : « C’est dans les suburbs grenoblois, où nous faisions à l’époque du graffiti ensemble qu’a vu le jour un premier projet de streetwear, intitulé Hixsept, correspondant clairement à l’époque et à l’âge que nous avions.» À partir de ce moment le groupe a commencé à s’agrandir, à l’instar d’un rhizome deleuzien, en intégrant d’autres têtes pensantes, d’autres savoir-faire et en s’ouvrant à d’autres finalités. Les dernières collections de Hixsept furent donc dessinées par José Lamali, commercialisées par Antoine Belekian et vendues dans la boutique grenobloise de Marc Bothorel. L’arrivée de Nicolas Poillot en 2006 correspond au moment de la création de la maison d’édition JSBJ — Je Suis une Bande de Jeunes. Jérémie poursuit : « Au fil des différents projets initiés en dix ans, nous avons pu expérimenter, apprendre, prendre conscience de ce qu’étaient les outils (la direction artistique, la publication de livres, la photographie, la création de mode) et de ce que nous avions envie de faire. Puis en 2012 nous avons senti la nécessité d’affirmer la cohérence de ces univers en les rassemblant sous une même entité qui serait plus en phase avec nos âges et notre époque».
Cependant, dans Études Studio le livre a pris une place totalement complémentaire à la création de mode sans en devenir une déclinaison. Nicolas Poillot précise : « La ligne éditoriale se développe principalement autour de la photographie contemporaine tout en y intégrant des collaborations avec des artistes contemporains. Le positionnement reste de niche, les tirages limités et les publications se font aussi bien avec des noms émergents ou plus établis. Tous sont également susceptibles d’être impliqués dans des side project pluridisciplinaires et ponctuels. De toute façon, au départ de tout ce qu’Études fait, on retrouve la notion de collaboration, d’échange et de rencontre. » En regardant attentivement le fonctionnement de la marque, on peut même avoir l’impression que la réflexion menée autour du livre en est le pivot. Tel un incubateur, le livre est envisagé en interne comme un territoire de recherches et d’expérimentations. Un aspect confirmé par Jérémie : « Le livre fait sens car c’est un objet qui nous a beaucoup affectés. Étant une génération pré-Internet, c’est un objet physique qui a capté notre intérêt alors que nous étions très jeunes. La revalorisation de cet objet, dans une époque où il est amené à disparaître, est très intéressante. »

Dike Blair, Untitled, 1992.
La pertinence de cette approche se comprend encore mieux en considérant que la mode vit aujourd’hui une situation tout à fait similaire. C’est entre autre en réaction au phénomène fast-fashion, aux multiples scandales d’ordre éthique qui ont marqué nombre de marques internationales, et au galvaudage de la singularité que nous attachons à la notion de style par l’impressionnante entropie d’images produites, partagées et consommées en temps réel, que le marché du prêt-à-porter est en train de se muer en un univers complexe et fascinant de niches et de micro-niches, d’éditions limitées et de productions hybrides, toutes revendiquant à leur manière une qualité esthétique, matérielle ou culturelle accrue. Que l’on parle de vêtements ou de livres, le statut que ces deux artefacts ont dans la culture contemporaine les rend moins nécessaires, moins irremplaçables, et plus obsolètes, d’où le fait qu’on leur prête l’attention que l’on prête aux choses rares.
Études n’a pas vocation à être une marque intellectuelle, mais sa logique interne stimule l’intellect en suggérant qu’une marque de mode aujourd’hui est avant toute autre chose un « point de vue ». Sa pertinence tient donc au choix d’une posture, à savoir d’une manière qui lui soit propre d’interpréter notre socio-culture et de la rendre plus intelligible par ce qu’elle crée. Compte tenu de la variété de phénomènes (matériels, visuels, performatifs, olfactifs, artistiques et conceptuels…) qui se retrouvent aujourd’hui compris dans la notion de mode, cette marque a tout intérêt à valoriser une production « transesthétique » qui nous accompagne à travers différentes esthétiques et modalités perceptives. « Le point de vue à la base de chaque projet est le même, [seule] sa traduction est différente, tout comme les enjeux et les contraintes », insiste Jérémie, « mais la réflexion est toujours commune à tout ce que l’on fait. En ce moment, par exemple, nous publions un livre qui retrace cinq années de travaux photographiques. Bien que ces images puissent sembler tout à fait détachées de ce que les gens voient et pensent d’Études, pour nous elles représentent notre ADN. Par elles on parle d’observer la ville et de l’influence que cet espace à sur l’individu. »
À la lumière de ces considérations on pourrait légitimement affirmer que la marque de mode a aujourd’hui la marge de manœuvre d’un discours traditionnellement réservé à l’art, à savoir celui d’une production capable de stimuler un éveil de la conscience dans son public, pour banal et quotidien qu’il puisse être. Nicolas indique :
« Art et mode sont indissociables pour nous, et ce n’est pas du tout un choix opportuniste, au contraire, c’est pour nous une manière assez naturelle de travailler. Le fait que l’art soit lié au mythe du détachement de tout propos fonctionnel ou de tout acte commercial, est quelque chose qui nous fascine. Le geste artistique, sa liberté, est inspirant d’où le fait que l’œuvre, l’image, la performance ou l’artiste même, soient toujours au départ de notre démarche »
Quand Jérémie affirme que l’expérience de l’art a été le déclencheur qui leur a donné l’envie de créer Études, on ressent dans ces propos la conscience que la phase de banalisation vécue par l’art de nos jours, en raison de son succès commercial et d’une audience de plus en plus populaire, n’est que la contrepartie de l’imprévisible moment d’« artisation » vécu par la mode — pour le dire avec les mot de Lipovetsky— avec laquelle l’univers artistique aime se lier de complicité. L’art a certainement encore un rôle d’éclaireur dans notre culture. Mais parallèlement à cela, on soupçonne aujourd’hui la marque de pouvoir s’instaurer en tant que forme artistique nouvelle ou, du moins, comme un acteur culturel à part entière en effaçant le stéréotype désormais désuet entre commerce et création.
Texte par Luca Marchetti
Goldfingers
Julien DossenaSurkin
Depuis 2013, saison après saison, Julien Dossena affirme sa vision de la femme Paco Rabanne. En se détachant du patrimoine futuriste de la maison, il a su déjouer les écueils rencontrés par ses prédécesseurs et mettre en place une mode contemporaine. Elle se révèle dans d’étonnants jeux de contraste : minimale mais chaleureuse, mariant technicité et fluidité, rigueur et sensualité. Ce goût de la pluralité, Julien Dossena le partage avec le musicien Benoit Heitz, plus connu sous le nom de Surkin. Digne représentant de la scène électronique française, celui que l’on a découvert à travers ses albums Action Replay (2007) et USA (2011) aime à multiplier les projets parallèles, faisant fi de toute étiquette. Collaborateurs et complices, les deux directeurs artistiques reviennent sur leur parcours commun.
Julien Dossena Si je me souviens bien, c’est une amie commune qui nous a présentés l’un à l’autre il y a environ sept ans. À ce moment-là, on se croisait souvent mais on se connaissait assez peu. Ça a changé lorsque nous avons commencé à travailler ensemble, il y a maintenant deux ou trois ans. Pour la musique de mes défilés chez Paco Rabanne, j’avais l’habitude de travailler avec Michel Gaubert. Je t’ai invité en tant que consultant et Michel a tout de suite vu que nous nous comprenions parfaitement et nous a conseillé de travailler véritablement ensemble.
Surkin Exactement ! La première collaboration sans Michel a eu lieu sur la collection automne hiver 2016-2017, où j’ai travaillé autour d’un morceau de Laurie Anderson. Il y a quatre ans, je n’avais jamais vu de défilé de mode, ma connais-sance de ce milieu était assez limitée. Tu m’as invité à en voir un, et ça a été une révélation. J’ai adoré le format ! Je suis assez impatient de nature, j’ai du mal à rester statique plus de trente minutes. Un show, c’est quelque chose de concentré ; les lumières s’allument et c’est parti pour une dizaine de minutes très construites, avec un début et une fin. Il y a une vraie émotion et je ne pensais pas que ça pouvait me toucher autant. Avant que l’on ne travaille ensemble, on se voyait pour discuter de musique, pour écouter des morceaux, mais nos conversations ne se limitaient pas à ça.
JD C’est vrai que je m’y connais assez peu en musique. J’en écoute lorsque je travaille, mais c’est plutôt un fond sonore. C’est un médium que j’aborde plutôt à travers son pendant visuel, que ça soit les pochettes de disque ou les clips.
Evidemment, comme tout le monde, j’associe certains morceaux à des moments particuliers ; il y a aussi cette mémoire sentimentale…
Au final, nos discussions passent avant tout par les premières images que tu découvres sur les murs du studio. C’est ce qui nourrit nos idées et nous permet de rebondir d’une idée à un morceau et ainsi de suite.
S Très souvent, on parle ensemble d’une fille, on essaie d’imaginer ses occupations, la ville où elle habite, les gens qu’elle fréquente. Ça nous permet de poser un univers. Au-delà de cet aspect, la musique d’un show permet d’ajuster l’atmosphère globale. Si le défilé a une tonalité fun et que l’on souhaite l’atténuer, on va travailler autour d’une musique un peu plus austère. Ça permet de créer un décalage intéressant. On peut comparer la musique d’un défilé à celle d’un film : le spectateur peut s’en souvenir, mais le plus souvent, elle agit de manière presque inconsciente. Il faut donc comprendre et clarifier la collection avant d’appuyer dans telle ou telle direction, ou alors contrebalancer pour élargir l’univers. Ce sont des va-et-vient, des espaces de progressions et de tensions dans le temps.
JD C’est comme une onde sonore. Il y a des mouvements à l’intérieur même d’un défilé. Avec nos discussions, tu me fais découvrir des artistes que je ne connais pas. Finalement, mon ignorance musicale m’offre beaucoup de possibilités. Je n’ai pas peur de grand-chose, je ne juge pas.
S Là où j’ai dû faire attention, c’est qu’au début, j’étais assez tenté de théâtraliser mon intervention, notamment en cherchant à synchroniser certains effets. J’ai vite réalisé que c’est souvent mieux que tout ne soit pas synchronisé, qu’il y ait des décalages. Quand le défilé est trop « scripté », il y a un côté premier degré souvent gênant. Et il ne faut pas oublier que les gens qui sont assis au début de la salle ne voient pas la même chose que ceux qui sont installés à l’autre bout.
JD Ce rapport à la temporalité et à l’espace est quelque chose que l’on a pu développer avec les environnements sonores des espaces de vente Paco Rabanne.
S Oui, c’est aussi ce que l’on peut découvrir à Las Vegas, avec ces faux ciels bleus que l’on voit dans les centres commerciaux. Il y a quelque chose d’assez magique et aussi d’étrange dans cette manière de recréer la nature avec des moyens si primaires. Pour les boutiques, j’ai travaillé sur un paysage sonore qui se compose de plusieurs types de sons : des oiseaux, des cigales, des orages… La difficulté a été de faire en sorte que les différentes combinaisons puissent fonctionner musicalement. Celles-ci sont activées par une application qui réagit en fonction de paramètres géographiques et météorologiques : la localisation de l’espace, le taux d’humidité, la force du vent, la température. Ce principe produit donc un environnement sonore différent s’il est activé à Hong Kong ou à Paris, et selon les heures de la journée.
JD Ce que j’aime aussi dans cette forme de nature reconstituée, c’est qu’elle suggère une idée d’urgence ; il y a un petit peu d’anticipation. C’est comme un mini-glissement temporel où tous les oiseaux auraient disparu… C’est une image que je trouve très Paco Rabanne.
S Tout à fait. Avant de travailler sur ce projet, je suis allé faire un tour dans différentes boutiques pour voir comment le son était traité. La musique est souvent le parent pauvre des magasins. Souvent, on entend des personnes dire : « Attends, je vais demander à mon cousin qui adore la musique de te faire une playlist. » La playlist, pourquoi pas… Si tu es une marque avec un imaginaire rock, tu peux t’en sortir en piochant dans le rock des années 60-70. Mais pour Paco Rabanne, que pouvait-on choisir ? On aurait pu mettre de la musique expérimentale, les débuts de la musique électronique, ou alors quelque chose d’ultra-contemporain. Mais très vite, on s’est rendu compte que ça n’apporterait rien.
JD Je voulais quelque chose de vivant, une forme qui ne soit pas figée. Ma toute première idée était de travailler autour des sons que l’on peut entendre dans les spas : les clochettes, les gongs. Je sais que c’est assez étrange comme référence ! Ces bruits sont associés à la détente et je trouvais ça pertinent parce que je souhaitais que l’on envisage la boutique comme un endroit où l’on va passer un moment agréable. Les bruits de vagues, de pluie, tout ce registre sonore autour de la nature est quelque chose qui est très populaire. Il suffit de voir le nombre de vidéos de ce genre sur Youtube pour le constater. C’est intéressant de comprendre comment cela fonctionne esthétiquement et de l’emmener plus loin… C’est là que tu es venu avec cette idée de bruits d’oiseaux, ces gazouillis synthétiques, que tu avais entendus dans le métro au Japon.

CHRISTIAN MARCLAY, LE PHONOGUITAR, 1982.
© CHRISTIAN MARCLAY — GALERIE PAULA COOPER
S Finalement, même si ce projet est très différent d’un défilé, le processus de création reste le même et passe de nouveau par le dialogue. Ce que je trouve fascinant, c’est que la mode a quelque chose d’intense dans sa temporalité. Le temps accordé à penser et produire une collection est tellement court, ça me dépasse. Pour les shows, je viens généralement deux ou trois fois voir les boards en studio et à chaque fois je suis toujours surpris de voir à quel point les choses évoluent rapidement. En musique, on peut passer plusieurs années sur un album, on se laisse parfois un peu aller : le projet est fini quand il est fini, le cadre est très souple. Dans le milieu de la mode, tu as un calendrier à respecter, et ça passe par la date du défilé.
JD Mais c’est un travail d’équipe. C’est quelque chose qui se construit à plusieurs.
S J’ai constaté que dans des villes comme Londres, tu peux te retrouver dans des groupes avec des gens d’horizons différents : du théâtre, de l’art, du cinéma. À Paris, j’ai passé des années à ne fréquenter que des musiciens, il y a quelque chose de très consanguin.
JD Dans la mode aussi !
S Mais c’est tellement important d’ouvrir son monde ! Si j’ai choisi de faire de la musique, ça n’est pas par vocation. C’est surtout parce que je me suis retrouvé avec un ordinateur et un logiciel. J’ai fait une école d’art, la Villa Arson, à Nice. Comment avoir des idées si tu n’échanges pas avec d’autres milieux que le tien ?
Je ne sais pas vraiment pourquoi les milieux artistiques sont si peu perméables à Paris. Les musiciens à qui je dis que je fais des musiques de défilé sont toujours surpris, ça leur semble inaccessible alors que c’est quelque chose qui potentiellement les attire.
Par contre, ce que je trouve bien, c’est qu’aujourd’hui les choses semblent plus fluides. J’ai l’impression qu’il n’y a pas si longtemps, tu choisissais un métier et tu le faisais toute ta vie. Désormais, tu peux en changer plus naturellement. J’ai fait de la musique et j’ai ensuite créé un magazine. Unite or Perish est une publication transversale qui réunit des contributeurs de milieux différents — de la mode, de la musique, du cinéma… — comme Romain Gavras, Jackson ou encore M.I.A… Mais c’est vrai que cette édition était aussi liée à la sortie d’un projet musical et à une exposition.
JD Oui, c’est un projet global, et c’est ce que je cherche également à développer. Tu parlais d’idées et c’est là que se situent les enjeux aujourd’hui. Il s’agit plus d’idées que de médium. C’est ce qui permet de renouveler le système et de s’affranchir du marketing traditionnel. Pour moi, une réussite dans ce sens, c’est Blonde, le dernier projet de Frank Ocean. C’est à la fois un disque et un fanzine, des pop-up stores, des visuels produits avec des photographes et des graphistes… Il a mis en place tout un univers, et pour le faire, il s’est complètement affranchi des formules toutes faites que le système se contente trop souvent d’appliquer. Et toi, qu’est-ce qui t’a inspiré récemment ?
S J’ai découvert le travail de la chorégraphe belge Anne Teresa de Keersmaeker avec la pièce Drumming, sur une partition de Steve Reich, un compositeur que j’adore. La combinaison des deux disciplines, danse et musique, est incroyable. Il y a quelque chose de l’ordre de l’hypnose qui se produit.
JD J’ai aussi adoré cette pièce. J’ai découvert le travail d’Anne Teresa quand j’étais étudiant à la Cambre, à Bruxelles. La danse, l’opéra, ce sont des univers que j’explorais un petit peu plus à cette époque, sans doute parce que j’avais plus de temps. Ça faisait très longtemps que j’avais mis les arts scéniques de côté, et je m’y remets depuis peu. J’ai récemment vu une pièce de Joêl Pommerat, Cendrillon, et c’était assez dingue. J’aurais presque pu avoir un carnet pour noter toutes les petites choses qui m’ont inspiré pendant le spectacle, que ce soit les lumières ou la mise en scène.
S À Paris, il y a une telle offre culturelle que ça demande un peu de rigueur et d’organisation pour ne pas passer à côté des choses ! Je n’ai toujours pas été voir l’exposition David Hockney au Centre Pompidou alors que c’est l’un de mes peintres préférés. Et il est fort probable que j’y aille à la dernière minute !
JD Parmi les artistes que j’aime toujours autant et qui m’ont marqué à l’adolescence, il y a Donald Judd dont je prends toujours autant de plaisir àredécouvrir l’œuvre. J’ai visité la fondation à New York et je compte bien me rendre à Marfa un jour. Il y a aussi Sol LeWitt. Ce sont des classiques, leurs productions se révèlent toujours sous un nouvel angle dès lors qu’on les confronte à de nouvelles références. Ça se renouvelle constamment.
S Quand j’étais lycéen j’ai été marqué par une exposition de Christian Marclay.
JD Je l’aime beaucoup aussi.
S Je ne sais pas s’il est très à la mode, je ressens une certaine critique à son encontre. C’est un peu le même dédain que les cinéphiles peuvent avoir pour Tarantino. Ce sont des artistes que l’on aime ne pas aimer ! Mais Marclay est quelqu’un qui m’a énormément influencé. Quand une idée est bonne, elle est bonne ! Il a réussi à créer des œuvres qui parlent à tout le monde, là où un artiste comme Sol LeWitt — que j’apprécie également — demande un peu plus de bagage artistique.
JD Mais il y a chez LeWitt une qualité de l’espace pure, une certaine réalité graphique, qui est très directe et qui se ressent sans aucunement avoir besoin de la comprendre.
S Tu as raison. En tout cas, c’est certain que les premières œuvres qui te marquent adolescent ont un attachement qui dépasse tout.
JD Oui, elles sont fondatrices. Il y a un réalisateur pour qui j’ai eu énormément d’intérêt quand j’étais étudiant, c’est Michel Gondry. Ça peut paraître étonnant car personnellement, je n’aime pas vraiment ce qui s’apparente à du bricolage. Mais son univers est si singulier. Et dans sa sphère artistique, il y a évidemment Björk, qui m’a fait découvrir Chris Cunningham. Tout est lié.
S Cunningham, c’est vraiment une référence qui a marqué tous les gens de notre génération. Il a défini une esthétique à laquelle on sera toujours sensible !
C.Q.F.D. à propos de l’Abstraction
Luca MarchettiFelipe Oliveira-Baptista
L’abstraction n’est pas un terme que l’on relie immédiatement à la création de mode, celle-ci étant plutôt associée à des univers d’images très identifiables ainsi qu’au rapport bien concret que l’on entretient avec nos vêtements. Pourtant, parallèlement à sa complexité grandissante, le panorama de la mode contemporaine semble ouvrir de nouvelles possibilités créatives. Des collections spéciales ou limitées de grandes marques proposent, par exemple, des produits où les traits identitaires du sportswear côtoient ceux du luxe et se mélangent à une esthétique habituellement considérée avant-gardiste. Le sportswear est un terrain privilégié pour l’observation de ces nouveaux phénomènes. C’est dans ce domaine qu’évolue Felipe Oliveira-Baptista. Son design subtil n’est pas resté confiné à une niche desophistication élitiste, mais a su prendre des proportions tout à fait monumentales au cœur d’une marque parmi les plus emblématiques.
Luca Marchetti On t’a souvent qualifié de « minimaliste » ou de « conceptuel », mais je vois dans ton travail beaucoup d’émotion et un jeu constant d’évocations qui ne me paraît pas compatible avec ces étiquettes. Je parlerais plutôt d’un goût prononcé pour l’abstraction. Avant même d’élaborer plus sur ce sujet, qu’est-ce que ce mot évoque en toi ?
Felipe Oliveira-Baptista L’abstraction est pour moi liée à l’idée de minimalisme. Il ne s’agit pas uniquement de créer quelque chose de simple, mais aussi d’enlever le superflu. Je travaille sur des évocations. Ma toute première collection, présentée en 2002 lors du festival de la mode d’Hyères, était basée sur l’histoire d’une rencontre entre une robe à volants et un manteau queue-de-pie qui auraient passé une nuit ensemble à boire beaucoup d’absinthe, sans jamais se revoir. Les vêtements que j’ai réalisés correspondaient aux souvenirs que chacun avait de l’autre. En ce sens, ils étaient comme des abstractions de mémoire : le fait que cette mémoire ne corresponde pas vraiment à la réalité est en soi une abstraction d’une chose concrète. Le même processus se produit lorsque je travaille autour d’une thématique très narrative : j’aime pousser les motifs graphiques jusqu’à l’abstraction car il est souvent plus intéressant de ne pas pouvoir identifier la provenance des idées.
Luca Marchetti Peut-être l’idée de « soustraction » est celle qui nous mettra d’accord. J’ai entendu l’artiste Robert Motherwell dire : « La fonction de l’abstraction est de retirer une grande partie de la réalité. On commence avec autant de substance que l’on veut et on soustrait » — comme tu viens de le préciser : « enlever le superflu ». C’est intéressant dans un domaine comme la mode qui vit de « figuration », de storytelling, de tentatives de créer le rêve, d’identifier des muses et femmes ou hommes idéaux… En revanche ton travail semble parler d’autre chose : (dés-)équilibres de volumes, de formes, de géométries, de couleurs ou alors de la compréhension que la mode nous donne du monde… Que comprend-on du monde par la mode ?
Felipe Oliveira-Baptista Quand j’ai décidé de faire de la mode, j’ai compris que c’était une discipline qui touchait à beaucoup d’autres domaines, que ce soit l’architecture, la photo ou même la mise en scène, si on pense à la conception des défilés. Cette variété me pousse à être curieux. Tout devient une excuse pour aller plus en profondeur et pour explorer un sujet qui m’intéresse. En ce sens, ma pratique est un work in progress constant. C’est vrai que la mode est devenue très formatée, pour ne pas dire « marketisée ». Le storytelling est appuyé car désormais le contact que l’on a avec la mode passe par un smartphone et cela reste en deux dimensions.
La mode aujourd’hui se regarde et se consomme souvent de manière assez banale. Si par le passé, elle a beaucoup dit sur certaines mouvances sociales, je pense que c’est moins le cas aujourd’hui. Elle n’a jamais été autant déconnectée de la réalité et c’est dommage. Lorsque je travaille, je cherche mes inspirations, mais aussi mes motivations, dans des sujets qui sont en dehors de la stricte sphère vestimentaire, au-delà d’une notion de lifestyle qui me paraît bien basique. Je fais beaucoup de choses pour alimenter ma curiosité. Je viens notamment de publier un livre de photos sur Lisbonne et sur l’idée de la mémoire qui est une notion que j’ai déjà traitée en mode. Je fais beaucoup de dessins, de corps notamment, et pour revenir au début de notre conversation, effectivement ils se rapprochent de l’abstraction. Il y a toujours de nouvelles manières de regarder le corps et lorsque je fais un vêtement, je garde ça en tête même si, évidemment, je le fais de manière cadrée car je travaille pour une marque de sportswear et je dois prendre en compte une dimension de fonctionnalité. Ce qui peut paraître une contrainte ouvre aussi beaucoup de possibilités. Je dois dire qu’il y a cette idée de mélange des genres (esthétiques, sociaux, sexuels…) qui m’intéresse particulièrement chez Lacoste. Les spectres sociaux sont brouillés, par exemple. Je déteste l’idée de la mode comme phénomène élitiste : Lacoste est porté à la fois par des bourgeois et des gamins de banlieue, par des chauffeurs de taxi et des branchés. Je mélange les codes de toutes ces tribus, car j’aime que les références soient un peu plus diffuses.
Luca Marchetti Cette fluidité, autant dans le mélange de genres que dans la recherche de suggestions très diverses, me paraît encore aujourd’hui une sorte d’invariant dans ta vision aussi bien du style masculin que féminin. Penses-tu que la mode sportswear impose d’emblée une esthétique où les genres se mélangent plus facilement ? Le sport masculiniserait-il la femme, en termes d’imaginaire (je pense à l’énergie, à la force, à l’effort) et la mode féminiserait l’homme ? D’après ce point de vue, la mode sportswear amène l’homme un peu plus vers la féminité et la femme un peu plus vers la masculinité, ce qui en fait un beau laboratoire d’expérimentations…
Felipe Oliveira-Baptista Tout à fait, c’est une fluidité plurielle : de genre et de classe sociale. Le flirt entre la mode et le sport n’a jamais été aussi présent, mais c’est un phénomène qui trouve ses origines au-delà de la mode et du style. Aujourd’hui les gens bougent beaucoup plus, ils font plus de sport et ils « investissent » dans leur corps. Il y a dans cela un aspect très réel qui me parle. J’aime cette idée de rentrer dans la mode par l’angle du design et répondre à des besoins concrets. Cela me permet aussi de pousser les choses un peu plus loin comme tu l’évoquais : donner un peu plus de mode aux garçons, plus d’énergie et de pouvoir aux filles à travers la puissance du corps. Je travaille toujours les collections en parallèle et j’aime ces va-et-vient entre l’homme et la femme.
Luca Marchetti Après avoir vu ton exposition à Hyères en 2008 puis celle du Mudam 2008, je t’ai instinctivement situé dans le même imaginaire de la mode où je situe aussi Hussein Chalayan, Helmut Lang ou Raf Simons… Ils ont tous un rapport privilégié avec l’abstraction et on trouve dans leur travail l’écho de questionnements propres à l’art contemporain. Quel est ton rapport à l’art ?
Felipe Oliveira-Baptista Je suis honnêtement très flatté par ces belles références. Quant à l’art, il a toujours été très présent dans mon approche de la mode, mais aussi dans ma vie. Il permet de poser des questions sur notre société, sur ce qui rend heureux ou pas, sur ce qui est universel. Récemment, j’ai vu l’exposition de Wolfgang Tillmans à la Tate Modern de Londres, où certaines photographies donnent l’impression qu’il a mis tout l’univers dans une seule image. Tout est là, c’est très fort, ça pousse les choses en avant, ça m’inspire. Ensuite, en tant que directeur artistique d’une entreprise, je dois gérer ces formes de créativités pour les rendre compatibles avec les fonctionnements de l’entreprise, avec le marketing notamment. Les choses se complexifient puisque à ce moment-là, ça dépasse le cadre personnel, mais je trouve intéressant de travailler ces mêmes idées à l’intérieur d’un système. C’est aussi pour cela que les projets que je mène en parallèle sont importants ; ils me permettent d’avoir un contrôle total et de me maintenir en contact avec moi-même. Certes, ce n’est pas toujours évident de passer de l’un à l’autre, mais pour moi il est important de sentir que je ne rentre pas dans une formule, que je ne donne pas des réponses convenues, faciles ou linéaires. C’est un exercice excitant et délicat car le studio comporte une quarantaine de personnes, la création est divisée par « univers » — la collection runway, sportswear, Lacoste Sport, Lacoste Life, Lacoste Kids et à ceci s’ajoute le consulting pour les licences. Certaines collections sont beaucoup plus importantes que d’autres, en termes de volume, comme le sportswear proprement dit. Cela fait beaucoup de travail.
Quand je suis arrivé chez Lacoste, j’ai continué ma ligne personnelle jusqu’au moment où j’ai réalisé que ça n’était plus possible. Mais quand j’ai décidé de l’arrêter, j’ai choisi de garder le temps que je lui consacrais pour mes projets personnels car je ne peux pas être dans l’opérationnel cinq jours sur cinq. C’est aussi comme ça que j’alimente créativement mon équipe et que je l’anime. Je dois sortir de mon bureau et voir des choses ! La créativité est comme un muscle : il faut le travailler mais en prendre soin aussi. Quand un créateur vit dans une surenchère de production, à un moment donné, ça s’assèche.
Luca Marchetti Il m’arrive de temps en temps de devoir parler de l’histoire de la mode du début du XXe siècle et en le faisant j’évoque souvent René Lacoste ou Fred Perry comme des individus qui ont tout à fait annoncé l’esprit de l’époque contemporaine. Bien avant qu’un Zygmunt Bauman n’écrive Liquid Modernity ils avaient déjà reconnu dans la fluidité le sens de leur présent et du futur proche : un principe abstrait et dynamique qui habite la société urbaine dans son ensemble et qui l’entraîne dans une transformation incessante par accélérations et décélérations… C’était la fluidité des nouveaux vêtements de sport, celle du geste comme « moment esthétique » du corps et celle de la performance comme principe de dépassement de soi… Mais j’y vois aussi une forme de fluidité plus conceptuelle qui consistait à vouloir rapprocher les extrêmes comme le raffinement esthétique de la couture et la dimension corporelle du travail physique, la mode et le sport…
Felipe Oliveira-Baptista Oui, René Lacoste se voyait comme un inventeur. Pour lui, ce qu’il faisait était vraiment du design : la manche de sa chemise, il l’a dessiné ainsi pour libérer le geste et le corps. Il a inventé la première raquette en métal. Ce qui est intéressant, c’est qu’il a fait tout ça tout en étant particulièrement élégant, c’est ce mélange entre son style et ses idées qui est unique. Une forme particulière d’élégance aristocratique sur laquelle tout cet imaginaire s’est construit. Le logo crocodile, d’ailleurs, n’a pas été pensé comme un élément identitaire de la marque ; c’était le surnom donné à René par un journaliste, puis Robert George — un de ses amis artistes — le lui a dessiné. Il a cependant été la première personne à mettre un logo à l’extérieur d’un vêtement, mais la véritable fonction de ce signe est venue après. C’est plutôt son fils Bernard qui a développé la marque. René Lacoste a été à la fois un sportif, un inventeur et un entrepreneur. Je trouve cette liberté très inspirante. Et je me donne le rôle de maintenir cette énergie vivante.
Luca Marchetti On entend souvent parler de l’actuelle situation « chaotique » au sein du marché de la mode. Celui-ci est de plus en plus exigent en termes de volumes de production et de rythmes de travail : est-ce une réelle difficulté ou plutôt un « friendly chaos » qui crée aussi des niches et des zones de liberté créative, sans doute improbables, mais quand bien même possibles ?
Felipe Oliveira-Baptista Oui, le marché de la mode d’aujourd’hui crée des phénomènes qui semblent souvent inexplicables. Par exemple, en mars dernier, nous avons mis en vente une collection réalisée en collaboration avec Supreme : les 25 000 pièces sont parties en six minutes. J’ai eu du mal à y croire, mais c’est la réalité d’aujourd’hui… Et cela rejoint ce que j’évoquais plus tôt : pour travailler en restant créatif j’ai besoin de me nourrir et de développer mes idées. Oui, le monde va de plus en plus vite, oui, le marketing est de plus en plus important et demandeur, mais les créatifs sont le fuel pour ces machines donc il est important de trouver la manière de se protéger et de faire en sorte que chacun puisse trouver son propre rythme et sa propre manière d’aborder les choses. La mode reste un milieu qui est obsédé par le changement, la vitesse et la jeunesse. Mon avis pour se garder frais, est de prendre un peu de distance avec ça, de voir les choses venir… et d’y aller !
Présent progressif
Nicolas Ghesquière
Depuis novembre 2013, Nicolas Ghesquière est le directeur artistique des collections femme de la maison Louis Vuitton. Saison après saison, il dessine une mode résolument contemporaine, appliquée à redéfinir la modernité jusqu’à ses effets les plus discrets, qu’il s’agisse de coupes ou de tissus réinventés grâce aux dernières innovations techniques. Avec Justin Morin, il revient sur son processus de création et évoque les liens qui unissent l’art et la mode.
Justin Morin Tes références, qu’elles concernent la science-fiction, le design ou l’art contemporain, font que la presse te présente souvent comme un créateur « futuriste ». Ce raccourci a l’inconvénient d’occulter la puissance sensuelle de tes vêtements, un aspect pourtant très présent dans ton travail. Quel est ton rapport à la sensualité ?
Nicholas Ghesquière Il est vrai que l’on m’a attribué à un certain moment cette étiquette. Je comprends tout à fait que l’on ait besoin de résumer la production d’une personne par un ou deux mots. Mais lorsque ce moment perdure, cela devient réducteur. Je cultive différents aspects à travers mon travail, et cette pluralité-là me caractérise. Pour en revenir à la sensualité, je pense que mon arrivée chez Louis Vuitton m’a fait évoluer dans cette direction. Bien sûr, cela était présent avant, mais j’avais un peu mis cet aspect de côté pour me concentrer sur l’architecture des vêtements. Aujourd’hui, je connais de mieux en mieux la manière dont on les construit — ou déconstruit d’ailleurs ! Je suis plus à l’aise pour aborder la sensualité. Ce n’est pas quelque chose qui se résume avec la superficie de peau que l’on va dévoiler, le fait d’en montrer moins ou d’en montrer plus. Je dirais que la sensualité se joue dans le rapport entre mouvement et corps, et les manières dont la matière va s’appuyer ou non sur le corps. Certaines seront collées à la peau alors que d’autres seront plus fluides et s’envoleront. La combinaison de ces différentes qualités amène beaucoup de sensualité à la manière dont on porte les vêtements.
JM Tu joues finalement assez peu avec les clichés de la sensualité.
NG Effectivement, même s’il m’arrive de le faire je les utilise avec parcimonie. On a pu le voir avec le porno chic : les connotations sexuelles sont très importantes dans la mode. Mais à mon sens, les connotations sensuelles sont plus puissantes.
JM Il y a dans ton travail une très grande maîtrise qui est d’autant plus surprenante qu’elle semble relier des influences opposées les unes aux autres. Ce phénomène d’hybridation se joue pour toi entre quelles disciplines ?
NG C’est assez complexe parce que, finalement, cela vient de toutes parts. Certes, il y a des références que je peux définir, mais en même temps, c’est un mécanisme qui est universel. L’hybridation est un collage qui ne fait pas forcément sens au moment où il est fait. Mais si ce mélange d’idées, de matières, devient organique, compact, et que cet objet fonctionne en tant que tel, alors il devient une nouvelle proposition. C’est une recherche qui est quasi permanente.
JM C’est donc ton processus de création qui implique ce rapport à l’hybride.
NG Oui, clairement, je ne me satisfais jamais d’une thématique ou d’une référence directe. Même quand j’ai le sentiment d’avoir trouvé quelque chose d’intéressant, je veux toujours aussi lui apporter un accident, une plus-value. Cela peut prendre différentes formes : je vais chercher à le projeter dans la technologie, dans la sensualité, ou d’autres domaines qui vont se greffer à cette recherche de départ. C’est parfois trois ou quatre combinaisons, ça n’est pas forcément un duo d’inspirations.
JM Comment nourris-tu cette recherche ? Par des discussions avec ton équipe, avec les gens que tu rencontres ?
NG Cela prend beaucoup de formes. Je pense que c’est une manière d’observer mon environnement que j’ai certainement développée enfant. C’est le point de départ. Je crois également que c’est quelque chose qui me plaît profondément. Et ensuite, il y a évidemment les gens qui m’entourent. Leurs mots, leurs recherches, leurs réactions à ce que je vais leur montrer, ce qu’ils vont proposer à leur tour pour transformer ce collage. C’est assez riche de tout. Ce sont également des moments très simples de solitude où un déclic s’opère face à un modèle que l’on a sous les yeux depuis des jours ou des semaines — rarement plus longtemps, tellement le rythme s’est accéléré. Quand cela se passe, c’est génial. Après, il faut le matérialiser et là, cela se complique…
JM Nous avons eu l’occasion de travailler ensemble à l’occasion du défilé de ta collection pour Louis Vuitton automne-hiver 2016/17, pour lequel l’une de mes sculptures a servi de décor. Quelle relation entretiens-tu avec le monde de l’art contemporain ?
NG Je m’intéresse à l’art mais je ne suis pas un spécialiste, je me suis laissé guider. Le travail m’a amené à faire des rencontres, dont l’exemple le plus fort est Dominique Gonzalez-Foerster. Nous nous entendons très bien ; le jour où nous avons eu l’opportunité de travailler ensemble, il ne s’agissait pas de s’utiliser pour s’apporter une crédibilité. Elle n’en avait pas besoin, et moi non plus. Nous avions envie que cela devienne organique. Il fallait que l’art soit au service du paysage que nous cherchions à définir, par nos références communes et par nos différences. Dominique m’a également présenté de nombreux artistes, comme Philippe Parreno et Pierre Huyghe. Elle m’a récemment parlé de Helio Oiticica, un plasticien brésilien dont le travail m’a inspiré pour la collection croisière que nous venons de faire à Rio. J’ai également eu la chance de travailler avec Cindy Sherman. Elle a réalisé une série de photographies à ma demande, pour Balenciaga. Cela était d’autant plus précieux qu’elle fait très rarement ce genre de commande ; elle l’avait fait auparavant pour Chanel. La principale contrainte a été de faire des vêtements exclusivement pour elle, puisqu’elle les a gardés le temps dont elle en avait besoin. Plus récemment, notre collaboration sur le défilé a été aussi stimulante. Au final, je travaille assez peu avec des artistes, mais cela répond toujours d’une évidence, ça n’est pas calculé.
JM As-tu l’impression que l’art applique certaines stratégies de l’industrie de la mode. Je pense notamment au rythme des foires internationales, de plus en plus soutenu…
NG Ce qui est sûr, c’est que les échanges entre l’art et la mode ont toujours existé. Certaines collaborations s’imposent, là où d’autres ne semblent motivées que par une recherche de crédibilité. Quand les rencontres sont sincères, profondes, qu’on ne se pose aucune question sur leurs motivations, alors cela me plaît. Il y a de nombreux exemples qui incarnent ce trait d’union. Une personne comme Miuccia Prada, qui est une vraie collectionneuse, qui s’entoure de curateurs exigeants, fait un travail remarquable avec sa fondation.
JM Est-ce que tu as déjà ressenti le besoin de t’exprimer par un autre medium, comme d’autres créateurs de mode ont pu le faire ?
NG Pas vraiment. La seule fois où je me suis retrouvé dans un rôle de plasticien, c’était avec Dominique, dans un premier temps pour son exposition au musée d’art moderne de Paris, et ensuite, en Espagne, à León. Elle m’avait demandé de l’aider à construire une sorte de chaos, qui s’est concrétisé par une accumulation de volumes géométriques. La pièce s’appelait « La Jetée », en référence bien évidemment à Chris Marker, mais aussi à un bar qui se trouve au Japon. Je l’ai également aidée à réaliser des sortes de « chenilles-chaises », placées dans l’escalier du musée, où les gens pouvaient s’installer. J’ai pris beaucoup de plaisir à faire tout ça avec Dominique, c’était très intéressant.
JM Mais aujourd’hui, si on t’offrait la possibilité d’éditer une chaise, un exercice aussi classique que complexe, accepterais-tu ? Tu ne t’es jamais dit que telle ou telle idée mériterait d’être développée sous forme de mobilier ?
NG C’est vrai que le mobilier m’intéresse. Mais comme je suis assez obsessionnel, j’avoue avoir du mal à quantifier le temps que cela pourrait me prendre. Et ma priorité actuellement, c’est la mode et les vêtements.


JM Tu le relevais un peu plus tôt, le rythme est de plus en plus intense. Chez Louis Vuitton, les défilés croisières viennent s’insérer dans le calendrier traditionnel. Malgré le peu de temps qui sépare les collections, on constate une vraie cohérence entre elles, des passerelles se dessinent, et des codes s’affirment. Aujourd’hui, qu’est-ce qui te challenge ?
NG Être force de propositions ! C’est un peu cliché, mais au final c’est de cela qu’il s’agit ! Dans la réflexion, dans la démarche intellectuelle, il faut recommencer de zéro. On dit que le succès est dans la répétition, et en même temps, la mode se doit d’être témoin de son temps, de capter un moment. Aujourd’hui, si tout le monde a envie d’avoir un discours d’intemporalité — et je suis le premier à le faire — mon rôle c’est également ça : de proposer de la mode. Il faut que les gens puissent se dire : « Ah ça, c’était 2016 pour Louis Vuitton. ». Le flux de propositions de la mode est devenu tellement intense que je ne sais pas si l’on peut arriver à capter cela aujourd’hui, mais pour moi ça reste très important.
JM Nous manquons certainement de recul. Il est vrai que plusieurs de tes collections Balenciaga sont devenues des repères temporels. Et il est très probable que d’ici quelques années, avec un peu plus d’espace, on pourra dire la même chose de ton travail pour Louis Vuitton.
NG Je le souhaite. Mon travail est comme un fil que l’on peut remonter. C’est presque comme une collection infinie, c’est ça qui est intéressant. J’ai l’impression de chercher toujours la même chose, mais j’ai la chance de pouvoir aborder des thématiques en toute liberté. La prochaine étape avec Louis Vuitton, c’est de mettre en place ce que tu viens d’évoquer : cultiver cette cohérence, résonner avec le patrimoine de la maison en y apportant innovation et sensibilité. Nous parlons d’hybridation : c’est vrai qu’au départ, cette idée d’un créateur comme moi dans une maison comme Louis Vuitton a pu sonner comme une anomalie. Le courage mutuel a été de se dire que non, il y a une vraie sensibilité en commun, et que je vais pouvoir leur apporter quelque chose d’inédit. La greffe fonctionne. C’est parfois complexe parce que Louis Vuitton est une très grande maison, chaque décision prise a un impact à la taille de ce qu’elle est. Il faut être serein et bien posé dans ses choix. Entre les collections, la maroquinerie, les souliers, une partie de la communication, je crois qu’il me reste énormément à explorer. J’apprends aussi à m’économiser, car il n’est pas possible de tout faire en même temps. À être trop présent, le danger est de ne plus avoir de temps pour soi, celui-là même qui permet d’avoir une distance de réflexion nécessaireà une proposition riche. C’est ce qui peut être problématique dans la mode aujourd’hui. Tous les jours, j’ai un certain nombre de gens autour de moi qui sont en demande de réponses. C’est mon rôle de prendre ces décisions, parfois de manière très pragmatique, ou encore de leur apporter des idées et des briefs. C’est une chose que j’aime faire, mais qui demande d’être en forme pour la faire correctement.
JM Un autre aspect de l’industrie aujourd’hui est qu’elle semble s’être homogénéisée. Les réseaux sociaux font que tout le monde voit le défilé qui vient d’avoir lieu à l’autre bout du monde. Il y a un effet d’aplatissement géographique. Penses-tu que le lieu de création est toujours aussi important ?
NG Oh oui ! Je ne ferai pas le même travail à New York, une ville que je connais assez bien. J’ai un peu de mal avec certaines villes anglo-saxonnes. C’est vrai qu’elles bouillonnent souvent plus que Paris, qu’elles ont plus d’énergie, mais je n’y tiens jamais très longtemps. Je me verrais bien vivre un an dans un autre pays, comme si j’avais 25 ans ! Mais je pense qu’à Paris, il y a une combinaison de choses qui est tout à fait unique et qui, culturellement, me correspond complètement. Ça n’est pas toujours un climat facile, surtout en ce moment, mais je ressens une force. Ici, il y a une sorte de pudeur, de distance, de réserve, qui nous est parfois reprochée. C’est une manière de se protéger et elle me convient très bien.
C.Q.F.D. à propos du style
Ying GaoLuca Marchetti
Comme toute notion culturelle, celle de « style » dans le domaine de la mode se transforme à travers le temps et l’espace. Du point de vue historique, on observe aujourd’hui que le style ne se résume plus au phénomène essentiellement visuel largement étudié par les cultural studies à partir des années 60, mais qu’il intègre de multiples effets de dématérialisation, impulsés par la culture numérique. Du point de vue géographique, cette notion est profondément modifiée par les nouveaux échanges et équilibres culturels caractéristiques du monde globalisé des années 2000 — notamment la confrontation avec les cultures de mode asiatique où la sensorialité joue un rôle prépondérant.
Si une conception « verticale » du style comme émanation de la figure démiurgique du « créateur » paraît désuète, une définition « horizontale » du style comme résultat des pratiques sociales et identitaires des individus semble aussi devenue insuffisante. J’ai discuté de ces questions et d’autres avec Ying Gao, créatrice de vêtements dont le travail est en train de changer notre perception de la mode.
Luca Marchetti D’après votre compréhension de l’imaginaire contemporain de la mode, comment définiriez-vous le « style » ?
Ying Gao Dans le circuit de la mode, depuis presque toujours, l’existence du style est « prouvée » à travers les vêtements et les accessoires portés sur le corps humain, puisqu’ils sont pensés et fabriqués pour ce dernier, alors que dans une perspective plus large, et aussi avec l’intégration de la technologie, le style peut mener une existence au-delà de ce corps humain qui souvent constitue un support quelque peu figé. Aujourd’hui, le style pourrait être un concept pur, un statement, une intention, une interaction, une façon d’être dans ce monde évolutif, et surtout de plus en plus complexe.
LM Il semble assez clair pour moi que la culture contemporaine attribue une importance sans précédent à l’affect et aux aspects intangibles de l’expérience. Des phénomènes émergeants touchant à divers aspects de la vie urbaine sensibilisent les individus à la dimension immatérielle de leur quotidien. Je pense notamment à la diffusion massive de la technologie tactile, aux systèmes réactifs, aux fashion wearables, aux nouvelles stratégies de marketing expérientiel jusqu’aux parts de marché grandissantes occupées par les parfums ou encore les spas… Penses-tu que le style pourrait se définir sur la base de critères intangibles plutôt qu’en termes visuels ? Pouvons-nous nous identifier avec un état corporel particulier en lieu d’une couleur ou d’une forme ? Et dans ce cas, comment cela peut affecter ou transformer la mode?
YG L’intangible en tant qu’immatérialité et mutabilité donne de la valeur à l’absence au moyen de laquelle la présence est structurée, et privilégie le flux par rapport à la fixité, ainsi que les allers-retours entre ces polarités. La valorisation de l’intangible pourrait ainsi constituer une prise de position philosophique, une alternative à la prédominance accordée à la présence et à la visibilité.
L’intangible constitue une composante-clé à la fois des concepts créatifs et de la fabrication même de mes pièces. Des éléments ne pouvant être touchés ou captés font partie intégrante de la structure de mes vêtements. Dans certains cas, cette immatérialité est exprimée au moyen d’un tissu si diaphane qu’il semble à peine y être, comme si la matière première avait été l’air, de l’air auquel on aurait donné une forme visible. D’autres éléments impalpables sont également inhérents à ma pratique : une pièce peut être activée par le son d’une voix, le stimulus d’un regard, un éclat de lumière, animant tant le concept que le vêtement lui-même.
L’intangible, pour moi, se manifeste également par l’idée de la mutation. Le changement, le flux et la non fixité sont des attributs typiques de mes créations. Les vêtements changent d’aspect, se métamorphosent de manière imprévisible.
Je doute que ceci « transforme » le futur de la mode, car il s’agit, ici, de poser des questions qui n’auront jamais de réponse.
LM Parallèlement aux changements dans la conscience des individus — dans le sens d’une perception plus fine des couches intangibles de l’expérience — , l’augmentation mondialisée de la connectivité avec l’avènement de l’Internet 2.0 donne également accès à plus de contenus pour l’expression de soi. Est-ce que cela peut transformer la relation des individus à eux-mêmes, par le biais de la mode ?
YG Dans mon prochain projet de création intitulé Secondes natures, la participation du spectateur sera en quelque sorte récompensée par la possibilité qui lui est donnée d’observer l’effet médiatique de son propre vêtement, au lieu de lui renvoyer fidèlement sa propre image, comme un miroir, ce qui aurait plutôt pointé vers un caractère flegmatique du médium. En attirant l’attention du spectateur sur les éléments qui constituent l’image médiatique des « simulacres » de la mode, cette série de vêtements interactifs incite le spectateur à porter un regard attentif au processus de « fausse création », à l’« entre-deux » de l’univers de la mode.
En création de mode, le défi est de construire des vêtements dont le volume est fluide, offrant la possibilité de formes multiples et contrastant avec la forme univoque du vêtement traditionnel. Des artistes des avant-gardes historiques, tels la suprématiste russe Olga Rozanova, le futuriste italien Giacomo Balla et l’artiste française d’origine russe Sonia Delaunay, ont déjà souligné l’importance du renouvellement de la structure du vêtement et l’utilisation de nouveaux matériaux dans la création vestimentaire, et ce, dès les années 1920, faisant l’éloge d’un habillement poétique et modulable, notamment des vêtements dont les pièces pouvaient être assemblées de diverses manières.

Sonia Delaunay, Rythmes et couleurs
En recherche et création, les artistes en textiles électroniques et en arts médiatiques concentrent leurs recherches respectives sur la surface et la texture des nouveaux matériaux appliqués au vêtement de base, laissant la structure du vêtement dans une forme minimale. Avec eux, l’intégration de l’informatique aux vêtements laisse entrevoir des manières nouvelles d’envisager la communication portative. Ils songent visiblement à une intégration plus complexe, mais plus souple, de dispositifs technologiques aux vêtements en explorant le thème du ludisme. Personnellement, je préfère me concentrer davantage sur la structuredu vêtement. La création vestimentaire n’est pas un simple jeu de formes et de couleurs, mais aussi un processus de conception et de fabrication qui devrait être envisagé comme une stratégie conceptuelle.
LM La démultiplication des possibilités de communiquer et d’accéder à l’information a-t-elle augmenté le potentiel bien connu de la mode de faire fusionner la culture « haute » et culture « basse » ? Voire d’hybrider des esthétiques différentes (voire incompatibles) et de transformer des notions culturelles telles le bon ou le mauvais goût ?
YG Les projets de vêtement « intelligent » traitant de la relation de l’homme à son environnement deviennent en effet plus à propos aujourd’hui, à mesure que la technologie informatique exerce une pression grandissante sur notre capacité d’absorber les flux d’informations et les nouveaux schèmes d’interactions.
Charles Baudelaire a dit que la beauté était un dieu à double visage : l’un est celui del’instant, l’autre accompagne l’éternité. On ne crée pas de beauté, sans lier les deux aspects ensemble : l’élément éphémère, mortel, et l’élément éternel, immortel. Si la mode frappe tant les esprits, soit positivement soit négativement, si elle attire certains et en repousse d’autres, c’est qu’elle nous rappelle la dualité de notre nature, mortelle et qui pourtant aspire à l’immortalité. La technologie et la mode représentent sans doute deux des domaines les plus éphémères de notre temps : ce qui est nouveau aujourd’hui sera dépassé demain. Si les créateurs de mode ont toujours affirmé qu’ils travaillaient sur une matière éphémère, qui s’évanouit à peine venue, plusieurs d’entre eux semblent vouloir entamer une nouvelle réflexion sur le sujet aujourd’hui. L’intégration des nouvelles technologies et des nouveaux matériaux modifie-t-elle les finalités du vêtement, tant au niveau de la surface qu’au niveau de la structure? Attribuer de nouvelles formes et de nouvelles fonctions au vêtement serait-ce une piste de réflexion valable dans le processus de création des vêtements du futur ? Ce sont des questions que je me pose au quotidien.
LM Un phénomène récent, bien représenté par le nom du label français Vêtements ou par le manifeste Anti-Fashion de la prévisionniste des modes et des tendances futures Li Edelkoort, demande de recentrer l’attention de la création de mode sur les vêtements et les accessoires. Qu’est-ce que cela signifie pour le style ? S’achemine-t-il sur la voie de l’obsolescence ? Ou sera-t-il juste moins dû aux suggestions des créateurs et des marques et donc plus dépendant des choix personnels et des pratiques sociales des utilisateurs finaux ?
YG La mode a souvent été synonyme de démesure et d’excès. Elle, ou du moins une grande partie d’elle, continuera de l’être. Mais l’acte de se vêtir est profondément social ; il définit non seulement notre apparence, ou attitude, mais aussi nos mouvements et nos expériences subjectives dans un contexte social donné. Le style, dans cette perspective, ne peut qu’être constamment altéré en tant qu’expérience de vie.
LM À côté de la notion de style, la perception de l’authenticité — une autre notion-clé dans le domaine de la mode — évolue également. Dans un ouvrage récent le philosophe Yves Michaud invitait à l’envisager sous un angle affectif et émotionnel plutôt qu’en termes matériels, ou de « fabrication artisanale conforme ». D’après Michaud, la notion contemporaine d’authenticité se décrit en termes d’intensité affective et de présence à soi dans une situation donnée, définie dans le temps et l’espace. Plutôt que d’être une caractéristique de l’objet, elle devient une caractéristique de notre expérience avec lui… Dans ton approche de la mode, affection, émotion et « présence » jouent un rôle crucial : pourrais-tu définir l’authenticité de tes vêtements et accessoires sur cette base ?

YG Si l’évolution technologique conduit l’avenir vers la dématérialisation, la virtualisation et le multi-sensoriel, que deviendra alors le vêtement du troisième millénaire ? Le vêtement, malgré sa connotation d’élément de fioriture dans les sociétés modernes, a pénétré il y a très longtemps au cœur de notre existence en tant qu’objet social. Flügel soutient que l’habillement ne serait qu’un épisode de l’histoire de l’humanité, et que « l’homme vivra un jour sa vie, conforté dans la maîtrise de son corps et de son environnement physique, dédaignant les béquilles vestimentaires qui l’ont soutenu dangereusement au cours des premiers pas mal assurés de sa démarche vers une culture supérieure. En attendant, les béquilles sont toujours là. Nous pouvons toutefois veiller à ce que nos sciences en pleineéclosion nous permettent de les façonner de façon réaliste, de les employer convenablementet de faciliter ainsi notre progression.» (ibid., p.220). Le vêtement de Flügel a trois finalités principales qui sont constamment agissantes dans le monde civilisé : la parure, la pudeur et la protection. Même si la pudeur et la protection ont pris une importance considérable depuis l’adoption du vêtement, la parure semble être la cause première du port du vêtement à l’origine. Il est sans doute troublant de constater l’existence paradoxale puisque simultanée des notions de parure et de pudeur au sein du même groupe : la fonction principale de la parure est de magnifier l’apparence corporelle, d’attirer les regards de l’autre, alors que le but de la pudeur est l’opposé, puisqu’elle tend à nous faire dissimuler nos imperfections corporelles et à dissuader l’autre de poser son regard sur nous. Cette contradiction fondamentale constitue une introduction d’une richesse inestimable pour le développement de la mode dans les sociétés modernes : la mode est une histoire pleine d’ambivalence, de controverse et de compromis. L’authenticité, quant à elle, existera le jour où l’homme (re)deviendra nu.
This Charming Man
Peter Philips
Directeur de la Création et de l’Image du Maquillage Christian Dior, l’Anversois Peter Philips s’entretient avec l’artiste Justin Morin. Dans un français chantant, teinté de Flandre, il évoque le fascinant ballet industriel de la Maison, le courant grunge des années 90 et l’actrice Jennifer Lawrence.
Justin Morin L’univers de la cosmétologie m’a toujours fasciné, pour des raisons très personnelles. Ma mère travaillait dans une parfumerie et je l’ai souvent accompagnée pendant mon enfance.J’ai longuement observé les flacons de parfums, dont certains sont semblables à des prototypes de sculpture minimale. Les textures et les gammes chromatiques du maquillage, les campagnes publicitaires vantant les parfums, tout cela a eu un impact très fort sur moi, et je crois que l’on peut le voir dans mon travail de plasticien. Mes premiers chocs esthétiques ne sont pas survenus dans un musée, mais dans cette parfumerie. Il y a pour moi une valeur créative très importante dans cette industrie. Comment arrivez-vous justement à concilier le côté artistique de votre pratique avec ses objectifs commerciaux ?
Peter Philips Mon métier a différents visages. Mon rôle en tant que directeur artistique est de créer des produits et de développer des concepts. Je suis également maquilleur, je crée des looks pour différentes occasions, que ce soit des défilés, des campagnes publicitaires ou des shootings éditoriaux. Il m’arrive aussi de travailler sur des projets d’art. J’ai donc beaucoup d’opportunités pour exprimer ma créativité. Et c’est pour cela que je n’ai aucune frustration à mettre mon expertise au service de produits commerciaux. Ça n’est pas une restriction, au contraire. Mon objectif est que ces produits soient utilisés ; si au final, aucune femme ne les porte, les créer ne sert à rien. Pour cela, je dois essayer de rentrer dans leur tête, de comprendre ce qu’elles veulent.
JM Ces missions sont très différentes et complémentaires. Comment s’organise une de vos journées?
PP Elles ne sont jamais identiques, et c’est ça qui est excitant. Le processus est différent lorsque je travaille sur un shooting ou sur la création de nouveaux produits. Les interlocuteurs et les enjeux ne sont pas les mêmes. Par exemple, lorsque je suis sur un défilé, c’est la relation avec le créateur qui prime. Je l’écoute, je me mets au service de sa vision, au même titre que la personne qui s’occupe de la musique, ou qui pense la coiffure. Nous formons une équipe qui est là pour renforcer la vision du créateur. Un défilé dure une quinzaine de minutes, c’est très court comme moment pour faire passer un message de manière claire, forte, évidente. De temps en temps, je peux proposer quelque chose de spectaculaire, mais uniquement si cette proposition est en accord avec la vision du créateur.
JM Qu’est-ce qui différencie un look défilé d’un look produit ?

Paradise Lost, Steven Klein, Dutch Magazine, 2002.
PP La vision de mode, celle qui accompagne le défilé, est différente de celle de la beauté. Je le dis tout le temps, nous sommes là pour les femmes, leurs beautés, leurs manières de s’exprimer. Ce qui est certain, c’est que toutes veulent être belles, quelle que soit leur culture ou leur esthétique. Cela s’apparente souvent à quelque chose de très délicat, de très doux, qui n’est pas exagéré. C’est là où est la différence. Toutes les femmes ne veulent pas forcément être dans la dernière tendance. Pour un défilé, on est dans un univers de mode fantasmé. Quand je crée un produit, la beauté l’emporte sur la mode. Je pense aux femmes qui ne cherchent pas un total look pour accompagner le dernier sac. C’est un public plus large. Évidemment, la mode me permet de rendre tout cela plus excitant. Je pourrais créer chaque saison le teint naturel qui garantit une mise en beauté parfaite, mais je crois que ça serait très vite ennuyeux pour tout le monde. En ce sens, la mode est une excellente locomotive : elle permet d’expérimenter de nouvelles choses et de satisfaire l’envie de changement que peuvent avoir les femmes.
Et puis la beauté est différente de la mode car elle reflète quelque chose de personnel. J’ai une très bonne amie qui est une fanatique de vêtements. Comme toutes les femmes, elle adore recevoir des compliments. Quand on lui fait des remarques sur ses tenues, elle est flattée et n’hésite pas à donner le nom du designer. Quand on la complimente sur son teint, en lui demandant si elle rentre de vacances, elle ne dit pas « je porte le fond de teint Diorskin star 040 », elle ne partage pas ses secrets de beauté. Ca n’est pas une forme de coquetterie, c’est autre chose : la beauté touche à l’intime.
JM Qu’est-ce qui vous a surpris dernièrement ? Est-ce que l’un des produits que vous avez créé a suscité une réaction inattendue ?
PP Je suis chez Dior depuis presque deux ans. Pendant les premières semaines, j’ai eu beaucoup de réunions pour rencontrer toutes les équipes. On m’a également présenté tout ce qui constituait le catalogue Dior. Bien sûr, je connaissais déjà ces produits. Ce quim’a toujours étonné, c’est qu’il n’y a jamais vraiment eu de rouge à lèvres mat. Pour moi, c’est un produit essentiel, j’ai donc exprimé mon envie d’en créer un au plus vite. Il faut savoir que tout est fait en interne. Nous avons cherché comment adapter une formule existante, puis nous l’avons testée, et ensuite nous avons déterminé le bon moment pour lancer ce produit. Il y a un agenda de production qui est mis en place des mois et des mois en avance. Les lancements se font sur 33 pays, il faut anticiper la distribution de ces produits.Ils se retrouvent au même moment derrière un comptoir aux Etats-Unis, en Australie ou en Norvège. Il y a toute une chorégraphie industrielle qui est spectaculaire.
JM C’est vrai que le consommateur ne soupçonne pas toutes ces contraintes de production.
PP Oui, et cela peut prendre du temps. La première collection que j’ai entièrement dirigée chez Dior correspond à l’automne 2015. Techniquement, il n’était pas possible d’y inclure le rouge mat dont je viens de parler, il est donc arrivé un peu plus tard, pour Noël. Et pour mon plus grand plaisir, cette gamme Diorific mat a cartonné. Les retours étaient très bons,qu’ils proviennent des points de vente ou des filles que je pouvais croiser sur les défilés. C’est ce genre de décision qui participe à l’identité d’une marque. À côté de ça, il y a des produits révolutionnaires, comme Dior Addict. Je ne dis pas ça parce que je suis affilié à la Maison, mais c’est vraiment quelque chose d’incroyable. D’un point de vue innovation, c’est digne de la NASA ! Deux formules différentes, qui normalement ne peuvent pas se mélanger, cohabitent dans un même bâton de rouge à lèvres. Le logo CD contient une formule gel. Au contact de la chaleur des lèvres, les deux composantes s’activent et se mélangent, ce qui permet de ne pas perdre en intensité, et de faire des mariages inédits. On peut désormais combiner des formules cosmétiques à des ingrédients de type soin. Ce genre d’avancées technologiques ouvre des portes incroyables. Cela est possible car une maison comme Dior a plus de cinquante ans d’expertise en laboratoire. Cette expérience et ce savoir-faire sont précieux. J’évoquais les différents continents où sont distribués nos produits, et ces zones géographiques ont leur importance. La manière dont on va appliquerun fond de teint n’est pas la même en France ou au Japon. Une femme européenne, lorsqu’elle se maquille, cherche l’efficacité et la rapidité. Une femme asiatique aura une autre approche par étapes. Certes, cela tient du rituel, mais c’est aussi lié au climat de ces pays. Par temps humide, le maquillage ne tient pas de la même manière. Nous prenons tout cela en compte.

Série Beauté, Mark Segal, Vogue Paris, 2006.
JM Vous créez donc des produits spécifiques à certains pays ?
PP Oui, il existe des lignes particulières. L’exigence des pays en question, souvent asiatiques, nous inspire pour développer des gammes qui peuvent être ensuite adaptées à d’autres marchés. C’est le cas par exemple de la gamme Diorskin forever, avec sa routine en trois étapes.
JM Tous ces exemples sont autant de femmes auxquelles vous devez penser lorsque vous créez. J’imagine que la question de l’égérie est caricaturale, pour ne pas dire obsolète.
PP Effectivement, je ne pense pas à une femme en particulier quand je crée. Prenons l’exemple de Jennifer Lawrence, une de nos égéries. C’est une femme exceptionnelle, une très bonne actrice que j’ai eu l’occasion de rencontrer sur plusieurs prises de vues éditoriales et publicitaires. Elle ne rentre pas toujours dans le moule, elle peut avoir un petit côté garçon manqué. Quand je suis avec elle, je me sens inspiré. Mais ça ne veut pas pour autant dire que je pense à elle sept jours sur sept.
JM Vous soulevez quelque chose d’intéressant en évoquant le côté boyish de Jennifer. La question du genre, de la féminité et de la masculinité, vous traverse-t-elle lorsque vous travaillez ?
PP Lorsque j’ai commencé à maquiller, en 1995, on parlait énormément de grunge. La personnalité et la féminité étaient deux notions qui se rejoignaient. C’était une réaction à la période qui précédait, où l’hyper-féminité régnait. À mes débuts, il y avait également beaucoup d’expérimentations, notamment le maquillage pour les garçons. Aujourd’hui, les choses ont évolué, dans le sens où ces questions ont déjà été abordées. La maison Dior qui est connue pour son approche très colorée de la beauté, sa vision de la femme fleur, s’est naturellement orientée vers un travail autour du nude, d’une féminité « pure », une beauté presque naturelle, que je pourrais presque décrire comme unisexe. Je crois que nous sommes dans une époque où on ne peut plus définir les choses selon le modèle binaire féminin/masculin.
JM Puisque vous évoquez vos débuts, peut-on revenir sur le fameux visage de Mickey Mouse ? C’est un cliché qui a marqué toute une génération. Sans doute, car au moment où il a été créé, la presse de mode avait une puissance folle qui s’est dispersée aujourd’hui avec l’arrivée du digital…
PP Effectivement, cette image était forte parce qu’elle est apparue à ce moment-là ! Elle est née d’une petite équipe : Willy Vanderperre à l’image, Olivier Rizzo au stylisme (qui avait récupéré quelques vêtements des collections de Raf Simons, ainsi que quelques pièces vintage) et moi. On était des passionnés de mode. On était en Belgique, sans internet. Lorsqu’on avait un peu de chance, on réussissait à mettre la main sur un ID ou The Face, et on se le partageait. L’information dont on disposait était très limitée. Quand on était étudiantet que l’on venait à Paris, on essayait de rentrer dans les défilés avec des fausses invitations. C’était très excitant. Et on a pu faire cette image parce qu’on avait une très bonne relation, on se faisait confiance. Je ne leur avais pas dit ce que je voulais faire exactement. Ce surquoi on travaillait était très sombre, gothique, en un mot : belge ! J’avais envie d’un peu de légèreté, de twister ça. J’ai demandé aux garçons de me laisser seul pendant 15 minutes avec Robbie (Snelders), notre modèle. On s’est enfermé dans la cuisine, j’ai pris un vieux sweatshirt de Mickey comme modèle, et je l’ai reproduit le dessin sur son visage. À l’époque, en ce qui concerne les garçons, je n’aimais pas le maquillage « mise en beauté », avec une peau parfaite, un gloss pour les lèvres… Je voyais le maquillage pour hommes comme quelque chose de tribal, comme un camouflage guerrier, à l’image du film The Warriors de Walter Hill. Ce Mickey, dessiné de trois quarts, avait quelque chose de cet ordre là. Quand on est sorti de la cuisine, ils étaient bluffés. Il nous restait 30 minutes de lumière pour faire notre photographie.

Robbie Snelders par Willy Vanderperre, V Magazine, 1999.
JM Ça reste donc un bon souvenir !
PP Un très bon souvenir ! Beaucoup de photographes m’ont demandé de le refaire, et j’avoue que je ne comprenais pas, j’ai refusé, j’étais très naïf. J’ai malgré tout fait une Minnie Mouse pour Irving Penn, dans une version beaucoup plus couture, avec un traitement très différent.
JM Est-ce qu’il vous arrive d’avoir le trac avant de maquiller une personnalité ?
PP De temps en temps. Essentiellement parce que les actrices ne sont pas dans leur zone de confort. Je ne suis pas seulement là pour maquiller, il faut savoir aussi les rassurer. Elles savent qu’elles ne sont pas mannequins et peuvent être intimidées par cet exercice.Quand je travaille sur une campagne publicitaire pour Dior, je préfère faire le film avant la photographie, car je sais qu’une comédienne trouvera plus facilement sa place, son personnage. Ca sera plus simple pour elle ensuite de prendre la pose. Notre rôle, au styliste,au photographe, au coiffeur, est de la mettre à l’aise. Ca nous met un peu de pression, ce qui peut me rendre un peu nerveux. Mais ça fait partie de mon travail. Je me dois d’être à l’écoute, qu’il s’agisse d’une actrice, d’une journaliste beauté, d’une démonstratrice ou d’une cliente. Toutes leurs confidences me permettent d’affiner ma vision créative. Je suis comme une éponge !