Égérie
Mathilde Fernandez
Il n’aura fallu que quelques mini-albums – Live à Las Vegas (2015), Hyperstition (2018) et le récent Sensible (2021) – pour que Mathilde Fernandez dessine un univers aussi vaste et surprenant que le sont ses références. Dès la première écoute, c’est son chant lyrique qui interpelle. Couplée à une production électro pop, sa voix joue les contrastes et rappelle l’extravagance de chanteuses anglophones comme Lene Lovich ou Kate Bush. Du côté des artistes françaises, peu ou pas de filiation, si ce n’est Mylène Farmer que la jeune chanteuse cite volontiers, tant pour sa musique que pour ses vidéoclips. Tout comme son ainée, Mathilde Fernandez développe une œuvre plurielle, où les images dialoguent avec le son. Cette approche pluridisciplinaire s’explique sans doute par ses années d’études aux beaux-arts et ses expériences du côté des arts scéniques. Adepte des collaborations, elle s’est associée avec la plasticienne Cécile Di Giovanni pour une série de performances autour de la notion de rituels contemporains. Elle est aussi la moitié du projet musical Ascendant Vierge, où elle pose sa voix sur les rythmes gabber et techno du producteur Paul Seul. Là aussi, ce mariage inattendu brille par son énergie. Puissamment évocatrice, la musique de Mathilde Fernandez se nourrit de tout, qu’il s’agisse de mode, de littérature, de cinéma ou d’arts visuels. Nous avons demandé à l’artiste de partager les images qui l’ont marquée, comme autant de clés de lecture de ses mondes intérieurs.
Images de musique
Enfant, j’ai très vite appris à insérer les compact-discs dans la chaîne HI-FI de mes parents. Il y a beaucoup de pochettes qui m’ont intriguée. La première qui me vient est celle de Passion: Music for the Last Temptation of Christ de Peter Gabriel. C’est la bande originale du film éponyme de Martin Scorsese. Je trouvais l’image sur ce disque très mystérieuse, elle me mettait assez mal à l’aise. C’est un dessin abstrait, sale, qui laisse apparaître un profil christique. Cette pochette me fait penser à une image de fièvre, quelque chose qui n’est pas réaliste, quelque chose d’étrange. Je me souviens que la musique me transportait complètement, je faisais des spectacles de danse complètement mystiques que j’imposais à mes parents ! Aujourd’hui encore, ce disque me touche énormément.
J’ai grandi dans une petite ville dans le sud de la France. Adolescente, j’ai vécu une véritable fascination pour le gothique, mais je n’avais pas vraiment d’amis qui partageaient cette passion et avec qui échanger et découvrir de nouveaux artistes. C’est en parcourant les rayonnages de la médiathèque que j’ai découvert de nouveaux groupes, en étant attirée par les pochettes. Je me suis ouverte à la musique métal. Il y a eu Korn, et la pochette dessinée de l’album Untouchables. J’ai aussi découvert le groupe Nightwish dont j’aimais le côté kitsch des illustrations que l’on retrouve sur chacun de leurs disques. En allant de pochette en pochette, je me suis intéressée à la musique électronique. J’ai été marquée par les couvertures d’Aphex Twin qui mettent en scène son visage avec un sourire proche de la grimace. Ce rictus est devenu comme un masque, ou un logo qu’Aphex Twin a appliqué sur ces différents disques. Et puis, impossible d’évoquer les images de musique qui m’ont marquée sans parler de Mylène Farmer. Plus que ses pochettes, je suis très admirative de ses clips. Je me souviens de publicités qui passaient à la télévision et qui montraient des extraits de ses vidéos. Avant la musique, ce sont ses visuels qui m’ont donné envie de l’écouter. C’est comme ça qu’a commencé mon histoire d’amour avec Mylène Farmer. Qu’il s’agisse de rock, de pop ou d’électro, j’aime quand les artistes ont un univers visuel cohérent avec leur musique. Je trouve ça fondamental.
Images de cinema
Chez mes parents traînait une cassette vidéo de L’histoire sans fin (1984) de Wolfgang Petersen, c’est un film que j’ai vu de nombreuses fois, fascinée par son imagerie fantastique. Dans le cinéma pour enfant, j’ai aussi aimé Les Aventures du baron de Münchausen (1988) de Terry Gilliam. C’est un réalisateur que j’apprécie beaucoup. Même si je ne suis pas toujours convaincue par les choix esthétiques de ses derniers films, j’aime ce qu’il propose. C’est un réalisateur qui expérimente avec les nouvelles techniques qu’offrent le cinéma contemporain, comme la 3D par exemple, sans pour autant perdre son essence. Il y a d’autres cinéastes qui ont plus de mal à ne pas tomber dans la caricature d’eux-mêmes. Je pense à Tim Burton… L’Étrange Noël de Mr Jack (1993) et ses personnages sublimes ont complètement bercé mon enfance. Malheureusement, je n’ai pas retrouvé cette magie, cette touche si particulière, dans ses récents long-métrages. Toujours dans le monde de l’enfance, je me suis récemment intéressée aux différentes interprétations cinématographiques d’Alice au pays des Merveilles. Le réalisateur tchèque Jan Švankmajer a sorti une version incroyable, mélange d’images filmiques et d’animation. Le résultat est singulier et assez angoissant. Son film s’appelle Neco z Alenky (1988), littéralement « Quelque chose d’Alice ». Le point commun de tous ces films ? Leur aspect fantastique. C’est un genre qui m’attire. De manière générale, je suis plutôt attirée par les films de genre. J’adore aussi le film Black Moon (1975) de Louis Malle. Je trouve aussi qu’il y a une nouvelle vague de films d’horreur très intéressante, comme Midsommar (2019) d’Ari Aster, qui mélange fantastique et horreur. C’est bien plus effrayant que les films ketchup que sont les séries comme Conjuring et les autres titres du même acabit.
Images d’art
Je suis une très grande admiratrice du travail de Pierre Huyghe. Je trouve que ce qu’il fait est magnifique. J’ai vu son installation à la Documenta 13, en 2012 à Kassel. J’ai été étudiante en école d’art, et à cette époque, je voyais beaucoup d’expositions. C’est un peu moins le cas aujourd’hui, mais je découvre des artistes par le biais d’Instagram. Ce que je trouve intéressant, c’est qu’on y trouve des pratiques qui sont à la frontière de l’art, de la mode et du design. J’aime notamment le travail de l’artiste Jenna Kaes. J’ai aussi été marquée par des images anciennes. J’adore notamment la peinture médiévale. Je me souviens avoir eu un choc en découvrant la collection de la Kunsthaus de Zürich. Évidemment, les proportions des corps ne sont pas réalistes, mais je trouve ça terriblement charmant. La peinture flamande est aussi fascinante. Les représentations de l’enfer par Jérôme Bosch sont folles.

Jérôme Bosch, Le Jardin des délices, entre 1494 et 1505.
Huile sur bois, tryptique, 220 × 386 cm, Musée du Prado, Madrid (Espagne).
Détail, panneau central, L’Humanité avant le déluge.
Images de littérature
Adolescente, j’ai beaucoup lu Didier Van Cauwelaert, qui a un rapport au fantastique qui me transportait complètement. C’est un auteur très populaire, certains peuvent s’en moquer mais je m’en fiche, j’ai aimé le lire quand j’étais jeune. Parmi mes livres préférés, il y La Danse de la réalité (2001) d’Alexandro Jodorowsky. C’est une autobiographie qui m’a beaucoup marquée et a changé ma perception des choses. Jodorowsky a une façon d’aborder la réalité, l’objectivité, qui est intéressante car loin d’être commune. Si je dois conseiller un de ces ouvrages, ça serait celui-ci car il se répète beaucoup par la suite. Je ne suis pas forcement convaincue par l’adaptation cinématographique qu’il a réalisée, c’est toujours délicat de passer d’un récit écrit, nourri d’images personnelles, à un film qui traduit ces images à sa manière. Dans un autre registre, j’adore les bandes dessinées de l’australien Simon Hanselmann. Elles me font beaucoup rire et c’est quelque chose dont on a besoin en ce moment. Je conseille aux personnes qui ne le connaissent pas de le suivre sur Instagram, il met en ligne son travail et c’est un véritable bonheur. Et puis, aux antipodes, la poésie est un genre qui me touche énormément. Les textes de Sylvia Plath, malgré leur atmosphère suicidaire, sont sublimes.
Texte de Justin Morin
Les témoins
André Téchiné
Impossible de résumer la filmographie d’André Téchiné, tant celle-ci, qui affiche plus de vingt long-métrages, fait preuve d’une folle diversité, tant par les thèmes que par les époques abordés. Grand maître d’un cinéma que l’on pourrait – paresseusement – qualifier de romanesque et psychologique, il est aussi celui qui aura tourné avec les plus grands acteurs français, offrant même à certains d’entre eux leur premier rôle. Rare en entretien, André Téchiné a accepté de partager sa vision de la musique dans ses films. En préambule et à ce propos, il confiait : « je préfère que ça parte dans tous les sens, comme dans la vie. » Ainsi, cette discussion s’articule autour de cinq morceaux de musique, témoins de son œuvre, que nous lui avons demandé de reconnaître. Ceux-ci couvrent cinq décennies de cinéma, et brassent, dans un mélange kaléidoscopique, anecdotes de création et souvenirs dédiés à ses interprètes.
Marie France
On se voit se voir
Barocco, 1976
Justin Morin
Vous avez écrit les paroles de ce titre interprété par Marie France. Pourriez-vous me raconter l’histoire de ce morceau. Je me demandais également si vous aviez écrit pour d’autres artistes, en dehors de vos films ?
André Téchiné
Non jamais ! On ne me l’a jamais proposé. Je n’ai écrit que des petits moments chantés dans mes films, sans doute parce que parfois, je trouvais que les chansons que je connaissais ne pouvaient pas s’y injecter, donc il a fallu que je me mette au travail moi-même ! Mais j’ai aussi évidemment utilisé beaucoup de chansons qui préexistaient à mes projets. J’ai écrit les paroles de On se voit se voir et ai demandé à Marie-France Garcia de l’interpréter. Elle était tout à fait ravie. La musique est une composition de Philippe Sarde, qui signe la bande originale du film. Je souhaitais également un solo de saxophone, de façon à ce que l’instrument et la voix se détachent. De manière générale, j’aime beaucoup les chansons ! J’aime les utiliser dans mes films parce qu’elles sont comme une récréation. Ces moments n’ont souvent rien à voir avec le propos ou l’histoire qui est racontée. Ça crée un trou d’air qui peut réjouir ou faire rêver. Ils sont comme un changement de couleur par rapport à la musique d’accompagnement qui, elle, guide – éventuellement – le récit et le spectateur.
Justin Morin
Dix ans plus tard, vous avez renouvelé l’exercice de l’écriture des paroles avec le titre Prends moi, dans Les Innocents (1987), toujours pour Marie France.
André Téchiné
Absolument, elle est l’une de mes interprètes préférées.
Justin Morin
Actrice et chanteuse, mais aussi meneuse de revue, Marie France est connue pour être une figure de la nuit parisienne, elle a notamment été une des égéries du Palace. Êtes-vous ou avez-vous été un noctambule ? Comment l’avez-vous rencontrée ?
André Téchiné
Je pense avoir oublié les circonstances particulières. En 1976, à l’époque de Barocco, le Palace n’existait pas encore, il a ouvert deux ans plus tard. Mais son propriétaire, Fabrice Emaer, tenait le Sept, un club situé rue Sainte-Anne. À cette époque-là, je me couchais tard. Je n’étais peut-être pas un vrai noctambule mais je sortais beaucoup avec mes amis de l’époque, en particulier avec Isabelle Adjani ou Roland Barthes, toute une foule très hétéroclite. C’est sans doute au Sept que j’ai rencontré Marie France !
Jeanne Mas
Suspens
Le lieu du crime, 1986
Justin Morin
Ce morceau passe dans le café-dancing de Lili, le personnage interprété par Catherine Deneuve. Comment choisissez-vous ces titres pop ? Vous sont-ils conseillés par le compositeur avec lequel vous travaillez ?
André Téchiné
Ça peut venir de différentes sources, ça peut être des chansons que j’ai entendues sur disque ou à la radio, mais ça ne vient pas du compositeur. Souvent, ces morceaux créent un court-circuit intéressant. C’est aussi pour faire un peu entrer le monde extérieur dans le film. Ces titres m’apparaissent soit au moment du tournage, soit au moment du montage, mais je n’y pense jamais lors de l’écriture. Pour moi, c’est toujours quand le scénario devient du cinéma qu’il appelle le son. Je dois être dans un rapport très direct avec l’image pour voir naître la nécessité musicale.
Justin Morin
Ou alors, il faut que la musique soit dictée par une scène, comme dans Nos Années Folles (2017), où vous avez demandé à Alexis Rault, le compositeur de la bande originale, de créer une mélodie pour un spectacle qui a lieu dans le film. Pour ce passage, la musique a été travaillée en amont pour être prête lors du tournage.
André Téchiné
Tout a fait, mais c’était spécifique puisque que c’était lié à une chorégraphie. Le film montre un petit spectacle fauché, fait avec des bouts de ficelle, présenté par le personnage de Samuel, incarné par Michel Fau. Pour cette scène, il fallait que les danseurs puissent se préparer. Mais je le savais, je souhaitais un passage dansé à ce moment-là du film. Comme pour Barocco, où je savais que ça serait bien d’insérer une chanson à cet instant spécifique. La différence, c’est que Philippe Sarde a quasiment écrit cette chanson la veille du tournage et moi j’ai rédigé ces paroles, sur le moment, à toute vitesse !
Justin Morin
C’est incroyable d’apprendre que ces éléments sont quasiment improvisés car Barocco est un projet qui est esthétiquement très travaillé !
André Téchiné
Barocco est un film très préparé mais en même temps, il y a eu une part constante d’improvisation lors du tournage. À l’origine, son scénario ne tenait que sur quelques lignes écrites sur un mode expressionniste, un peu fantastique, sur le thème du double. Tout a pris corps à Amsterdam, où nous avons tourné, dans un travail acharné.
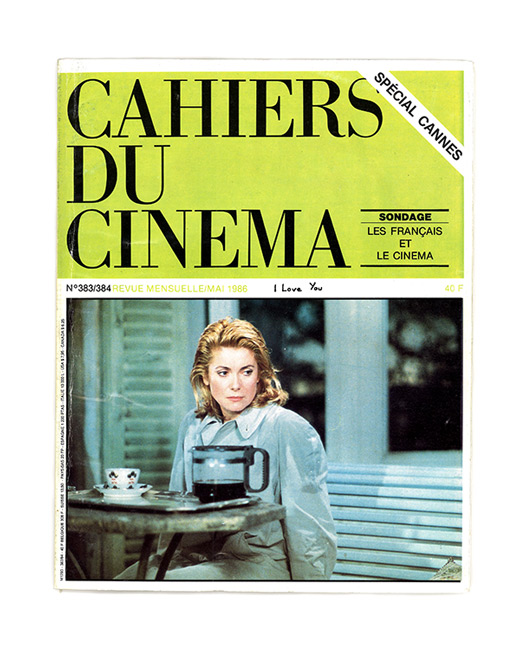
Cahiers du Cinéma, numéro 383/384 de mai 1986, revue éditée par les Éditions de l’Étoile, Paris.
En couverture: Catherine Deneuve dans Le lieu du crime, d’André Téchiné.
On a aussi la chance et le luxe – ou la folie –d’avoir sur ce film des moyens que je n’ai sans doute jamais eus par la suite. Je pouvais faire des mouvements de grue, arroser les pavés pour que les rues deviennent luisantes par rapport à la lumière des scènes nocturnes… Nous avions beaucoup de temps de tournage et de préparation. C’est d’ailleurs pendant ces moments-là que le scénario s’est entièrement constitué.
Justin Morin
Nous avons évoqué le travail de Philippe Sarde, avec qui vous avez collaboré sur pas moins de treize films. Plus récemment, vous avez travaillé avec Alexis Rault sur vos trois derniers longs-métrages. Il y a également dans votre filmographie deux artistes qui font irruption le temps d’un film, à savoir Max Richter sur Impardonnables (2011) et Benjamin Biolay sur L’homme qu’on aimait trop (2014). Comment se sont passées ces rencontres ?
André Téchiné
C’est vrai que ce sont des expériences qui ont été nouvelles et très enrichissantes pour moi. Je ne peux pas concevoir mes films dans une sorte de régularité. Chaque film doit être une expérience esthétique nouvelle, entièrement, radicalement. J’aime me renouveler ou aller ailleurs, et je fais plutôt mon film suivant en réaction à mon film précédent. C’est un peu comme ça que j’arrive à avancer.
J’ai découvert la musique de Max Richter à travers son travail sur le film Valse avec Bachir d’Ari Folman. Elle m’avait ébloui. Je ne parle pas allemand et maîtrise peu l’anglais ; il ne parle pas français, mais cela ne nous a pas empêchés de très bien nous entendre, même si nous nous sommes très peu vus. Je lui ai donné en référence la musique de Vivaldi et Stravinski pour orienter son travail sur Impardonnables qui est une histoire qui se passe à Venise. J’ai été très touché par l’originalité de sa partition et la manière dont elle irriguait le film, à la fois de manière souterraine et rigoureuse. Après Impardonnables, il a lui-même revisité Vivaldi (Recomposed by Max Richter : Vivaldi, the Four Seasons – 2012).
La rencontre avec Benjamin Biolay est passée par Catherine Deneuve, nous nous sommes connus chez elle. Nous avons décidé de nous lancer dans cette expérience car cela nous amusait et nous excitait. Je lui ai montré le film et à partir de là, il a composé très librement la musique. Il m’a livré une masse musicale assez abondante dans laquelle nous avons procédé à des coupes lors du montage. Dans L’homme qu’on aimait trop, je tenais également à ce chant traditionnel corse, interprété par les protagonistes lors d’une scène du repas. Il y a aussi un passage musical où Catherine et Mauro Conte, qui joue son chauffeur, reprennent Preghero, une chanson d’Adriano Celentano que l’on entend dans l’autoradio de la voiture.
Ingrid Caven
La la la
Ma saison préférée, 1993
Justin Morin
J’aurais aimé évoquer avec vous Ingrid Caven, et notamment vous interroger sur son premier mari, Rainer Werner Fassbinder. Est-ce un cinéaste qui vous a influencé ?
André Téchiné
J’aime énormément Ingrid Caven. J’adore cette chanson et les paroles écrites par Jean-Jacques Schuhl. Je tenais à ce qu’Ingrid soit là comme une espèce de personnage tout à fait improbable, un grain de folie. Je connaissais ce morceau, j’en étais amoureux et je voulais l’insérer dans le film. C’est un peu gratuit, mais ce côté-là m’intéressait ! Quant à Fassbinder, c’est un cinéaste, un homme de théâtre, un écrivain, et un acteur que j’aime beaucoup. C’est un ogre, un personnage gigantesque dans le cinéma allemand et dans le cinéma tout court. Mais je tiens à préciser que la présence d’Ingrid Caven n’est pas un hommage indirect à Fassbinder. Je tenais vraiment à sa présence si singulière, tout comme l’est sa manière de chanter. Dans le film, le relais musical se fait sur une composition de Sarde. Je n’arrivais vraiment pas à m’imaginer de la musique pour ce projet, hormis des carillons, et c’est ce sur quoi Philippe a travaillé. Hormis ces cloches, il y a cette chanson, Malaika, d’Angelique Kidjo que j’aime beaucoup et qu’on entend aussi bien pendant le générique de début que celui de fin.
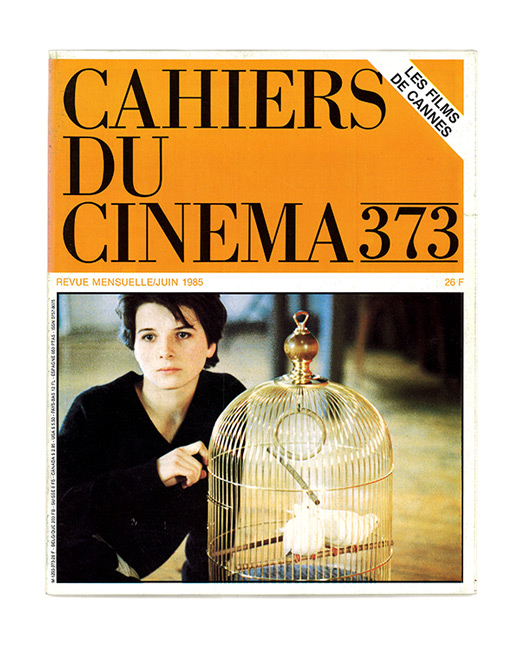
Cahiers du Cinéma, numéro 373 de juin 1985, revue éditée par les Éditions de l’Étoile, Paris.
En couverture: Juliette Binoche dans Rendez-vous, d’André Téchiné.
Vivaldi
Orlando Finto Pazzo, Acte 3
Qual favellar ? Anderò ! Volerò ! Griderò !
Les Témoins, 2007
Justin Morin
Pour ce film, j’ai choisi cet extrait de Vivaldi mais j’aurais pu vous faire écouter Les Rita Mitsouko, un groupe que l’on entend ici mais aussi dans Ma saison préférée ou Les Voleurs (1996). Mais j’ai sélectionné ce morceau pour vous questionner sur la musique classique, un univers que l’on retrouve dans plusieurs de vos bandes originales.
André Téchiné
J’aime effectivement beaucoup la musique classique. Dans Les Témoins, cet extrait de Vivaldi est interprété par Cecilia Bertoli. Elle a une puissance, une exaltation et une vitalité qui me plaît beaucoup.
Justin Morin
Il y a trois ans, Celine Sciamma – avec qui vous avez co-écrit Quand on a 17 ans (2016) – confiait à Revue qu’elle associait toujours un morceau de musique à l’écriture de ses projets, et que ce titre l’accompagnait tout du long.
André Téchiné
Je procède vraiment différemment sur ce point. Il y a parfois des intuitions, comme Vivaldi pour Impardonnables. Je me suis posé la question de la musique lorsque j’ai rédigé le scénario des Sœurs Brontë (1979). À ce moment-là, j’ai pensé à Robert Schumann et à ses Scènes de Faust, car il y avait pour moi une forme de proximité, de familiarité, entre les deux œuvres.
Mais c’est un cas particulier. De toutes façons, il n’y a que des cas particuliers quand on fait des films !
Par exemple, un film comme Les Roseaux Sauvages (1994) est un projet quasiment sans musique, hormis le titre Runaway de Del Shannon que l’on entend durant le générique de fin.
Sia
Chandelier
L’adieu à la nuit, 2018
Justin Morin
Ce morceau apparaît dans votre dernier film. C’est aussi la huitième fois que vous avez travaillé avec Catherine Deneuve, après avoir débuté votre collaboration avec Hôtel des Amériques (1981). À l’époque, vous avez dit d’elle qu’elle était un « sphinx à déchiffrer ». Avez-vous trouvé toutes les réponses à l’énigme ?
André Téchiné
(Rires) Non, pour moi elle n’a rien perdu de son mystère !
Justin Morin
Quel est le projet sur lequel elle vous a le plus surpris ?
André Téchiné
Elle est tout le temps surprenante, on ne sait jamais si elle va arriver au bout d’une prise tellement elle se remet à chaque fois en question. Elle n’utilise pas son savoir-faire, c’est le contraire d’une actrice de métier, elle ne cesse de se renouveler. Ça vient peut-être du fait qu’elle ne soit pas passée par des cours d’art dramatique, ou qu’elle n’ait pas fait de théâtre. Elle a dû inventer sa technique radicalement, au coup par coup, sur chaque film. Parfois en se protégeant, parfois en s’exposant.
Justin Morin
L’adieu à la nuit est votre dernier film sorti en salle. Quels sont vos projets ?
André Téchiné
Je suis en train de faire des corrections sur un scénario dont je viens de terminer l’écriture. C’est globalement achevé mais je dois reprendre certains éléments pour les rendre moins rigides et plus vivants. Tout ça, c’est un travail de détail qui est destiné à rendre le scénario plus convaincant.
C’est comme si on voulait donner une forme littéraire à ce qui va devenir un film. C’est une étape un peu inutile, puisque cette forme va être dépassée par le travail de mise en scène, mais elle reste nécessaire pour accrocher le lecteur et évidemment, les décideurs, puisqu’il s’agit ici de déclencher un financement !
Le film n’est pas encore financé mais j’ai un distributeur et une chaîne de télévision qui s’intéressent au projet, donc j’espère pouvoir le concrétiser prochainement !
Simple et funky
Ichon
Entendu depuis plusieurs années au gré des collaborations et des mixtapes, Ichon sort enfin son premier album. Avec Pour de vrai, il livre un disque puisant autant dans le hip-hop que la chanson française, loin des clichés, avec l’authenticité comme unique fil conducteur. Dans « Miroir », il chante :
DEVANT LE MIROIR JE ME SENS TIMIDE
TOUT LE MONDE ME CROIT INVINCIBLE
J’AIME TROP MÉLANGER MA GUEULE D’ANGE
ET LE DANGER
MON CŒUR PENCHE
Un disque signature comme une mise à nu, entre confessions de doutes et moments de plaisirs. Pour compléter ce portrait, nous avons demandé à Ichon de partager quelques morceaux qui font partie de son histoire, qui l’inspirent et le font vibrer.
Le Code
Myth Syzer (Ft Bonnie Banane, Ichon & Muddy Monk)
C’est la famille ! Dans un premier temps, j’ai eu la chance de rencontrer Loveni. Il rappait déjà, il gravait ses CD et les vendait au collège. Je rappais aussi, mais j’étais moins sérieux que lui. Nous étions une bande d’amis. Ensemble, nous avons créé ensemble le collectif Bon Gamin. Plus tard, on a été présentés à Myth Syzer. Il est arrivé à Paris aux alentours de 2009. On a directement été proches, ça a marché instantanément. Il sortait du lot à l’époque, c’était déjà un excellent beatmaker. Il avait notamment fait quelques sons pour le rappeur Ateyaba, dont le nom de scène à l’époque était Joke. Avant Thomas – le véritable prénom de Myth – on prenait nos instrumentaux sur Internet. Quand il est arrivé dans Bon Gamin, il devenu notre beatmaker attitré. Mais pour résumer, nous sommes des amis qui faisons de la musique ensemble. Moi je suis venu à la musique par l’écriture. Je devais avoir douze ans quand j’ai écrit ma première chanson et c’était un texte de rap pur. J’ai toujours beaucoup écrit, que ce soit sous la forme d’un journal intime ou de lettres, qu’elles soient à mes parents ou aux filles. Plus jeune, j’avais la sensation qu’on ne me comprenait jamais quand je parlais. Écrire me permettait de m’assurer que ce que je disais était clair.
Parce qu’on vient de loin
Corneille
J’ai chanté cette chanson – et tout le reste de l’album – en boucle quand j’étais enfant. C’est un succès populaire, ça n’est pas branché, mais c’est très sincère et c’est ça qui m’a touché à l’époque, et me touche aujourd’hui encore. Je ne connais pas Corneille mais sa simplicité me plaît !
Loving You
Minnie Riperton
Très beau. À écouter dès le matin, pour te mettre dans un état de douceur et d’amour. Et à écouter en boucle pour le reste de la journée !
Corps
Yseult
J’adore ce titre et j’adore Yseult. Elle apparaît dans le clip de « Noir & Blanc », le morceau que l’on a sorti cet été, avec Loveni qui m’accompagne. Il y a de l’amour entre Yseult et moi, comme avec toutes les personnes avec lesquelles je travaille. Je pense à PH Trigano et Crayon qui ont produit l’album. Ça n’est que de l’amour. Ça m’est déjà arrivé qu’on me demande de collaborer avec des artistes dont je ne me sentais pas proche, et je ne l’ai jamais fait. Évidemment, techniquement, je pense que je pourrais le faire, mais je ne le veux pas. Je me mets cette barrière parce que c’est ma vie et je n’ai pas envie de raconter des choses qui ne sont pas vraies.
Machine gun
Portishead
À l’époque où j’avais du mal à trouver des instrumentaux, je cherchais des titres sur Internet et je chantais dessus. Et j’ai notamment fait ça avec ce morceau de Portishead. « Machine gun » est un morceau à la production incroyable. La voix de Beth Gibbons l’est tout autant. Je me suis bien amusé avec ce titre, mais je ne j’ai jamais diffusé, c’était vraiment un délire pour moi ! Pour en revenir à ce morceau, je sais que The WeekEnd a reproduit quasi à l’identique ce beat sur « Belong to the World ». Aujourd’hui, j’écoute assez peu de rap américain car je trouve qu’on a tout ce qu’il faut en France, tant au niveau des producteurs que des chanteurs. Depuis quelques années, quand on fait quelque chose, on le fait bien, on a plus à rougir des comparaisons. La vraie force des Américains, c’est qu’ils n’ont pas peur de sortir des cases ! En réalité, j’écoute moins de rap qu’à mes débuts, mais quand j’en écoute, il est français. J’aime Makala, 13 Block, Hamza… Tout ce qui sort en ce moment est très bon !
Gisèle Part 4
Luidji
Je complète cette sélection avec un morceau contemporain et français ! J’ai écouté l’intégralité de Tristesse Business, l’album de Luidji, durant tout l’été. Il est fort !
Encore un peu
Ichon
C’est un morceau qui arrive au milieu de l’album, un peu comme une respiration. Avec Pour de vrai, j’avais envie d’être le plus authentique, je ne joue pas de personnage. Quand je dis quelque chose, c’est que je le pense. Je suis mon humeur du moment, que je sois introspectif, triste ou heureux. L’écriture d’« Encore un peu » a été rapide, c’est sorti tout seul. Je l’ai écrit pour une fille qui était mon amoureuse à l’époque. La production a pris plus de temps par contre. C’est peut-être l’un des morceaux sur lequel on a le plus cherché alors que c’est le morceau le plus nu, puisque c’est juste un piano voix. Il y a plusieurs versions, une avec une batterie, une autre avec un rythme différent et finalement, on est revenus à la version initiale. J’ai bossé environ trois ans sur cet album. Quand il a fallu établir l’ordre des titres, je l’ai placé instinctivement à cet endroit, sans savoir si cet effet de respiration que j’espérais aller fonctionner. Et les retours que j’ai me font très plaisir car apparemment c’est le cas. Si j’ai appris quelque chose avec ce projet, c’est qu’il ne faut pas avoir peur d’écouter son instinct.
Man on the moon
REM
C’est tiré de la bande originale du film éponyme. J’ai choisi ce morceau pour parler un peu de cinéma. Un de mes acteurs préférés est Jim Carrey. Dans ce film réalisé par Milos Forman, il joue le rôle d’Andy Kaufman, le comique américain. Ce film m’a un peu retourné le cerveau, notamment pour la prestation de Carrey. Il raconte qu’à chaque fois qu’il aborde un rôle, il cherche les similitudes entre le personnage et sa propre vie pour mieux se l’approprier. J’adorerais être acteur. J’ai déjà eu quelques propositions, mais ça ne me convenait pas, c’était trop loin de moi. Ça peut sembler paradoxal puisqu’on parle de rôle, mais j’ai besoin de pouvoir rattacher le jeu à ce que je suis, je cherche une forme de vérité.
Cucurrucucu Paloma
Caetano Veloso
C’est une chanson magique ! Elle m’apaise, elle me donne envie de chanter, c’est magnifique. Ce qui est fou avec ce titre, c’est qu’il fonctionne avec ton état, que tu sois triste ou malheureux. Je l’ai découvert par l’intermédiaire d’amis de longue date, lors d’un dîner, et j’en suis tombé amoureux.
Je l’ai intégré dans une de mes playlists. J’adore en faire ! J’en ai une qui s’appelle Cheminée, certainement ma préférée, qui est dans un mode chill, pantoufle et good vibes ! J’ai une playlist Petit déj. Avec celle-ci, je me vois
en train de couper et presser mon orange, quand il fait beau. Elle est parfaite pour bien commencer la journée, mais on peut l’écouter facilement jusqu’à 16 heures ! J’en ai une autre qui s’appelle Voyage ; elle est un peu plus éclectique, avec des sons qui bougent mais très solaire. J’ai Danse de la mort, avec une sélection de morceaux un peu triste, ceux qu’on aime écouter en marchant sous la pluie ! Et puis le rap, on le trouve dans ma playlist Sport. Toutes ces playlists, je les partage avec mes amis, je les mets régulièrement à jour. Il y a eu un long moment où je n’écoutais plus trop de son. Mais aujourd’hui, avec ce que la technologie nous apporte, tant pour écouter que découvrir, je retrouve le plaisir de la musique.
Propos recueillis par Muriel Stevenson
Planète sauvage
YelleBertrand Mandico
Réalisateur prolifique – sa filmographie compte plus d’une trentaine de courts et moyens métrages, Bertrand Mandico a confirmé la singularité de son univers avec Les Garçons Sauvages, son premier long-métrage sorti en 2017. Baroque et expérimentale, son écriture transporte dans des territoires luxuriants peuplés de créatures étranges où l’instabilité et les bouleversements semblent être la norme. Cette idée de changement, on la retrouve à travers le titre du quatrième album de Yelle et son clin d’œil astrologique. Intitulé l’Ère du Verseau, le disque du duo français – composé de Julie Budet et de Jean-François Perrier – assume sa mélancolie sans pour autant sombrer dans la noirceur. Avec ses percées de lumière, il conjugue les tourments à l’euphorie. Dans leur manière d’hybrider, qu’il s’agisse des sentiments ou des genres, Bertrand Mandico et Yelle partagent une sensibilité commune. Ils se rencontrent pour la première fois et échangent autour de la puissance des odeurs, du rôle des morts et de leur amour de la nature.
JB Tu es actuellement en salle de montage. Sur quoi travailles-tu ?
BM Je finalise mon deuxième long-métrage. Un film d’heroic fantasy qui se déroule sur une autre planète au féminin. Je ne peux pas en dire plus !
JB En ce moment, tout est chamboulé, mais as-tu déjà une date de sortie ?
BM Il y a une date de finition. Le film sera prêt au printemps 2021.
Après, advienne que pourra, que ce soit pour les festivals ou la sortie en salle.
Vous êtes en pleine promotion de votre nouveau disque ?
JB Oui ! Et normalement, si tout se passe bien, nous serons prochainement en résidence à La Rochelle pour préparer nos prochains concerts, dans une salle qui s’appelle La Sirène. Ils devraient avoir lieu jusqu’à la mi-décembre, uniquement en France. Tout ça, avec un gros point d’interrogation car les règles concernant les spectacles changent vite. Nous avons déjà modifié la tournée en décalant les dates américaines et européennes. C’est un peu triste de sortir un album et de ne pas pouvoir partir en concert, donc on cherche une solution pour pouvoir faire quelque chose, même si l’idée d’un concert assis et masqué ne nous enthousiasme pas, car ça ne nous ressemble pas. Mais nous avons réfléchi, et vu l’accueil du public pour ce disque, mais aussi sa frustration, on s’est dit que c’était aussi notre rôle d’avoir une proposition pertinente et de s’adapter à la situation. Ce qui ne nous empêchera pas de refaire des concerts debout lorsque ce sera de nouveau possible !
Je voulais te questionner sur ton rapport au son dans tes films.
BM La musique, c’est mon inspiration première quand j’écris ou quand j’imagine des films.
J’ai besoin d’avoir de la musique dans mes oreilles, pour imbiber mon cerveau. Et la combinaison musique-voyage est encore mieux. Le mouvement accentue l’afflux d’images. Lorsque je prends le train par exemple, musique aux oreilles, tête contre vitre, la lumière qui bat derrière mes paupières closes me met dans un d’état second et des séquences de films m’apparaissent très clairement.
C’est ma « Dreammachine ». D’ailleurs, Brion Gysin a imaginé sa machine à rêves dans les mêmes conditions…
Ensuite, sur mes tournages, il m’arrive très souvent de diffuser de la musique, pour créer un climat de concentration. Il y a souvent beaucoup de bruit quand je tourne. Je ne prends qu’un son témoin qui n’est pas de très bonne qualité et dont je me débarrasse très vite en montage.
On réenregistre les actrices en studio et on affine ainsi le jeu. On peut obtenir des nuances et des tonalités très particulières. C’est à ce moment-là que nous créons la bande-son, qui inclut les bruitages, et très vite la musique.
Mais pour toi, est-ce qu’à l’inverse, l’image est une source d’inspiration pour arriver à vos musiques ?
JB C’est assez particulier car nous n’avons pas vraiment de recette. Avec Jean-François, on a pas du tout les mêmes références, on a grandi dans des univers assez différents. On ne part pas tout le temps de la même chose. On peut par exemple partir d’un rêve, de quelque chose qui est arrivé en images durant la nuit. Ce qui est difficile quand on écrit une chanson, c’est qu’on a sa propre vision de ce que l’on a envie de raconter et qui ne parle pas forcément à tout le monde. On a toujours laissé la porte ouverte à différentes interprétations, notamment par les images et ce que les gens peuvent mettre dessus. Mais c’est vrai qu’il y a des moments qui sont très inspirants. Je te rejoins sur le train ! J’y écoute aussi beaucoup de musique et je me fais mes propres films.
BM Tu rêves d’images, mais est-ce qu’il t’arrive de rêver de sons ?
JB C’est arrivé, mais c’est de moins en moins fréquent. Par contre, ce qui est plus surprenant, c’est que j’ai des sensations olfactives très précises quand je rêve.
BM Tu penses que l’olfactif pourrait te guider dans l’écriture d’un morceau ? Passer d’une odeur à une autre pour imaginer le cheminement d’un disque.
JB Oui, complètement ! Je n’y ai jamais pensé, tu me donnes une idée ! Ce qui est certain, c’est que les odeurs peuvent me provoquer des émotions très vives. Enfant, je reniflais tout. Et je me rends compte que je continue de le faire. J’ai besoin de sentir tout ce que je mange. Avec la Covid, je suis un peu contrariée car j’aime beaucoup embrasser les gens, les prendre dans mes bras et les sentir. Parfois, ça peut me bloquer dans certains rapports humains si l’odeur me gêne. Ça ne veut pas forcément dire que la personne ne sent pas bon, c’est plus de l’ordre d’une réaction chimique.
BM Tu pourrais imaginer un concert olfactif ! Tout comme John Waters a mis en place une version en odorama de son film Polyester, où les spectateurs étaient munis de cartes qu’ils devaient gratter à différents moments du film, pour révéler des odeurs liées aux séquences. Évidemment, puisque c’est John Waters, les pastilles avaient des senteurs très particulières. Mêlant la guimauve aux odeurs corporelles les plus souterraines.
JB Je me souviens avoir vu enfant un spectacle de la compagnie Royal de Luxe qui s’appelait Peplum. C’était en extérieur ; il y avait un énorme ventilateur sur un rail qui passait devant le public et qui diffusait des odeurs. Elles étaient parfois réjouissantes ou au contraire très désagréables. Je me rappelle avoir été un peu nauséeuse à la fin du spectacle. Ça m’a vraiment marquée. Je me rappelle aussi que lorsque nous avons fait la première partie de Katy Perry, sur sa tournée American Dream, elle diffusait une odeur de barbe à papa dans les énormes salles qui nous accueillaient. C’était un peu écœurant à la fin de la journée de respirer ça !
BM Pour moi, pendant longtemps, l’odeur des concerts et des discothèques, c’était la cigarette.
À partir du moment où il n’a plus été possible de fumer dans ces endroits, j’ai découvert que l’odeur de la musique que l’on partage, c’était la sueur et les parfums qui se mélangeaient mal !
Diffuser de la barbe à papa, c’est peut-être une parade pour éviter ça, parce que finalement, ces odeurs nous renvoient aux humains que nous sommes, aux usines organiques que nous trimbalons toute la journée. Cette évidence peut déranger, le sucre remplace la clope.
JB La transpiration te transporte un peu dans l’intimité des gens. Ça peut en effet être désagréable car on partage une intimité à laquelle on a pas forcément envie d’être confronté. À l’inverse, il y a ce moment de chimie que j’évoquais plus tôt qui peut également se passer positivement. On peut aussi se rencontrer dans l’odeur.
BM Oui, il y des odeurs qui aimantent, des odeurs qui s’aimantent !
JB Et toi, est-ce que le rêve est une source de matière pour tes créations ?
BM C’est une matière à réflexion ! Je note mes rêves dans un carnet et j’essaie d’y comprendre ce qui s’y passe. Pourquoi le grand serpent blanc dans le marécage me parle. Cette pluie de jambes est-elle de bon augure.
J’ai utilisé une seule fois un rêve de façon littérale. J’étais invité par un festival en Islande et je j’ai décidé de profiter de cette opportunité pour y faire un film. Je m’étais fixé comme contrainte une unique journée de tournage. Des amis islandais m’ont proposé leur aide et m’ont demandé ce que je voulais filmer. À ce moment-là, je ne savais pas quoi faire, je ne voulais pas plaquer un scénario réfléchi sur un décor et un pays que je ne connaissais pas encore.


Les Garçons Sauvages, Bertrand Mandico.
Alors je me suis mis à guetter mes rêves. J’ai notamment rêvé d’un homme qui marchait sur une route et qui allait voir une femme bleue pour lui demander combien de temps il lui restait à vivre. C’était parfait et ce n’était pas un rêve hors de prix ! Je raconte mon histoire aux islandais ; tout se prépare, actrice, acteur, caméra 16, le minimum. Ma micro-équipe me parle d’une petite maison bleue, isolée, qui serait parfaite comme décor et me propose de voir si on peut l’intégrer au projet. C’est là qu’on m’apprend quelque chose d’assez troublant. Cette maison appartenait à un peintre décédé et c’est son fils qui en était désormais le propriétaire. Rien n’avait bougé depuis le décès de son père et il refusait tous les tournages qu’on lui soumettait… Mais, pour moi, il a curieusement accepté, très troublé d’apprendre le sujet du film et surtout qu’une femme bleue était censée vivre dans cette maison. Son père, qui y vivait seul, peignait des femmes bleues. Et il était inspiré par l’esprit d’une femme bleue qui venait le visiter ! Le fils du peintre a trouvé la coïncidence tellement troublante… Et moi donc !
Mais, je voulais évoquer tes clips, et plus particulièrement l’investissement du corps. Comment t’es-tu lancée dans cette aventure du corps mis en image et du corps sur scène ? C’est venu en même temps parallèlement à la musique ou ça a été travaillé progressivement ?
JB J’ai fait beaucoup de théâtre quand j’étais plus jeune, jusqu’à mes vingt-trois ans. Je n’ai jamais eu vraiment de problème à me mettre en scène. Pour moi, un chanteur ça n’est pas forcément une grande voix, c’est avant tout quelqu’un qui raconte des histoires et qui les partage sur scène, par la performance. Je pense que quand j’ai commencé, je n’étais pas très à l’aise, j’étais un peu raide. J’avais envie de plus mais il fallait que je lutte. Ce qui est drôle, c’est qu’à l’époque, je voyais une sophrologue qui avait un ami martiniquais. Ils sont venus me voir à un concert et après le spectacle, son ami m’a conseillé d’écouter du zouk. Il m’a dit que ça allait tout changer, que ça allait me débloquer au niveau des hanches et libérer mon corps. J’ai hoché la tête sans trop y croire, et puis quelques jours plus tard, chez moi, j’ai écouté beaucoup de zouk ! Et en effet, quelque chose s’est déverrouillé au niveau de mon bassin. On en a même fait une chanson !
J’ai toujours eu des facilités à assumer mon corps, à en jouer. J’ai toujours porté des combinaisons super moulantes mais fermées jusqu’au cou. Il y a cette idée d’en montrer beaucoup sans dévoiler. J’aime ce double jeu. Cette assurance est peut-être aussi venue avec l’âge, la confiance, il y a tout un tas de paramètres qui entrent en jeu. Car je ne vis pas mon corps de la même manière à différents endroits. Je peux être extrêmement pudique dans ma vie privée et ne pas avoir de soucis à d’autres moments. Il n’y a pas longtemps, j’ai tourné dans une série où j’avais une scène d’amour avec une femme qui était censée être enceinte. J’étais dénudée, avec dix personnes autour de moi. Je pensais que je n’allais jamais y arriver et au final, je n’ai eu aucun problème. J’ai un rapport au corps que je pourrais parfois qualifier d’utile, dans le sens où c’est un outil.
BM Je ne savais pas que tu étais comédienne.
JB J’ai tourné dans cette série en trois épisodes, pour Arte, qui s’intitule J’ai deux amours. Le réalisateur est Clément Michel, c’est la première personne qui m’a fait tourner dans un court-métrage – Une pute et un poussin, en 2009. Il m’appelle toujours, même si c’est pour faire un petit rôle, ou comme ce fut le cas plus récemment pour de la musique. J’aime beaucoup jouer, mais je ne suis pas forcément douée pour aller à la rencontre des gens, je suis certainement trop timide. Et je n’ai pas d’agent. Mais c’est quelque chose que j’aimerais faire plus.
Pour en revenir au corps, est-ce que tu sais d’où te vient cet intérêt qui est très central dans tes films ?
BM J’ai une fascination sans limite pour les corps, sans a priori, sur les sexes, la maturité, les cicatrices de la vie ou autre… Je suis complètement captivé par toute la diversité possible.
J’aime aussi l’idée d’un corps mutant, évoluant. Pour moi, le corps idéal se transformerait en permanence, à volonté. Il serait homme, femme, entre-deux, les deux,multiple, autre, autrement, avec encore plusde fantaisie, d’organes nouveaux ! Avoir des sortes de pénis aux coudes, des seins torsadés dans le dos ou des vagins croisés sur le sternum… Cette fascination m’étourdit, m’enivre et m’euphorise en même temps.
Et puis il y a eu aussi l’intérieur du corps…
Un jour de Pâques, quand j’avais treize ans, ma tante qui était aide anesthésiste dans un hôpital, me gardait chez elle. Elle avait des appels en urgence et j’ai lourdement insisté pour la suivre, car je rêvais d’assister à des opérations. Elle a demandé au chirurgien de garde si je pouvais venir exceptionnellement en observateur, ce qu’il a curieusement accepté.
Il y avait plein d’accidentés ce jour-là, qui arrivaient dans la salle d’opération et, petit à petit, voyant que je n’étais pas effrayé, on m’a laissé m’approcher de plus en plus proche. Jusqu’à ce que je puisse me mettre debout sur un tabouret pour mieux voir.
J’étais subjugué par l’intérieur des corps que je trouvais objectivement beaux et plastiques. Je voyais tous ces organes qu’on sortait et qu’on posait sur des tissus. On lavait l’intérieur des ventres, on réparait, on replaçait les organes. Il y avait des couleurs sublimes : vert amande, bleu nuit, rose nacré. Je trouvais les formes très sensuelles, voluptueuses même. Il n’y avait pas trop de d’odeurs car on m’évacuait au moment d’ouvrir, l’instant le plus critique pour les effluves.
Rien de tout ça n’était glauque, c’était à la fois assez abstrait et positif, car dans un contexte de réparation… Le chirurgien finit par me demander : « Alors, comme ça, tu veux être médecin plus tard ? » Et je lui ai répondu naïf et sûr de moi : « Non artiste ! » Il s’est tourné vers moi sa blouse et ses gants imbibés de sang : « Mais je suis un artiste, à ma façon… ! » Il avait raison. Dans mon souvenir, il ressemblait à Cronenberg.
J’ai une question particulière ! Il y a le cri qui tue. Est-ce que tu penses qu’il y a le chant qui fait jouir ?
JB Je pense, oui ! La voix peut être un organe très sensuel, voire sexuel. Il y a une manière de s’en servir, un peu comme un sextoy, elle peut être un outil de jouissance. Et avec ton cinéma, tu as déjà eu des témoignages dans ce sens ?
BM J’ai reçu via Facebook des messages de personnes qui avaient vu Les Garçons Sauvages et qui ont eu un orgasme ou une extase en le voyant.
Pas des messages graveleux, des témoignages sincères, entre émotion fébrile et trouble profond. Je me souviens d’un témoignage assez détaillé d’une femme qui s’est littéralement liquéfiée sur son siège durant le film. Ou d’autres personnes qui sont allées toucher et caresser l’écran à la fin de la projection… ça m’a surpris, évidemment ! Mais je ne savais pas quoi faire de ces « merci pour ce moment intense ».
J’aime l’idée du film qui nous échappe et creuse son sillon de trouble dans l’esprit de ceux qui l’absorbent.
J’imagine que c’est comme ça aussi parfois en concert ?
JB Certainement ! Je pense qu’on se met beaucoup de barrières, et ça n’est pas si facile de lâcher prise, de s’autoriser à se laisser envahir par les émotions.
BM Peut-être que dans une salle de cinéma, plongée dans le noir, on peut s’oublier, face aux images qui remplissent les murs… Ou dans une foule qui vibre, sous les lumières stroboscopiques, inondés de musiques… Les deux se rejoignent !
J’ai une autre question bizarre pour toi : as-tu déjà fait un concert dans un cimetière pour réveiller les morts ?
JB Ah ah ! Non, jamais !
BM Au-delà de la blague, je me demandais si tu convoquais les morts quand tu chantais.
Je te demande, car c’est quelque chose que je fais quand je filme. Je pense à certains cinéastes qui sont morts, de grandes figures qui m’ont impressionné, donné l’envie de faire des films. Je n’ai pas peur d’aller chercher des noms imposants, puisque tant qu’à faire, autant convoquer les plus grands ! Lorsque j’ai des difficultés à faire un travelling par exemple, je peux essayer de parler à Tarkowsky ou Max Ophuls, en leur demandant de m’aider, à trouver un état de justesse ou d’émotion… Eux qui savaient trouver dans leurs mouvements de caméra un état de grâce absolu. Cette façon de convoquer ses aînés, ses modèles, de ritualiser sa création, comme dans un rituel païen, j’imagine que c’est quelque chose que l’on peut faire dans toutes les disciplines. T’arrive-t-il de faire la même chose avant de monter sur scène ?
JB Pas vraiment, je suis très concentrée sur… moi ! Je pense plutôt aux morts et aux artistes que j’aime dans des moments de création, de recherche et de réflexion. Je fais des sortes de prière. Je ne crois pas en Dieu, mais je crois en beaucoup de forces, comme celle des esprits et de la nature. Je vais parler à la lune quand je sors promener mon chien la nuit ! J’habite à la campagne donc il n’y a pas de lumière autour de chez moi et je vois très bien les étoiles. Mais le rapport à la nature, on le retrouve aussi dans Les Garçons Sauvages.
BM Oui, tout à fait. J’ai grandi à la campagne, dans un petit village, et de façon assez solitaire. Je rentrais en communion avec la nature. J’adorais ramper ! Ce rapport à la forêt, ventre contre terre a une dimension sensuelle et sexuelle. Je me faufilais dans des passages creusés par des renards, sous des buissons, là où seul un enfant pouvait aller. Un peu comme dans les films de Miyazaki, notamment Totoro, j’ai le souvenir d’avoir découvert des lieux complètement inaccessibles et sublimes. Ce rite, ce parcours pour découvrir l’endroit secret, que la nature protège et qui va s’ouvrir à nous comme une fleur, continue à me hanter. Je regrette de ne plus ramper sous les buissons.
JB C’est aussi la nature dans tout ce que ça peut avoir de mystérieux, et parfois d’effrayant.
BM Oui, elle est paradoxale la nature, car elle peut caresser avec ses fruits et en même temps griffer avec ses branches. Il y a aussi des rencontres bizarres, des choses que tu n’identifies pas vraiment, que tu croises sans comprendre ce que tu vois, un fruit pourri mêlé à une charogne d’animal. Il y a parfois des aberrations. Tout ça fait beaucoup travailler mon imaginaire. C’est aussi le cas pour les petits cours d’eau, que j’aimais remonter quand j’étais enfant, toujours pour atteindre des zones inaccessibles, invisibles aux adultes… J’ai aussi une théorie selon laquelle tous les films qui se passent sur une rivière sont forcément réussis. Je pense à La nuit du Chasseur de Charles Laughton, Apocalypse Now de Coppola, Aguirre, la colère de Dieu de Werner Herzog, La rentrée des classes de Rozier, même l’Atalante de Jean Vigo ! Ça se passe sur un canal, mais je l’inclus ! Le cours d’eau insuffle une dimension mystique aux films qui les caresse.
Il y a également les sons de l’eau qui court ou de la pluie. Je suis friand de cette sonorité aquatique mêlée à la musique pour les bandes-son de mes films, c’est une récurrence.
Est-ce que vous utilisez ou détournez des sons naturels dans votre musique ?
JB Pas vraiment. On a utilisé des sons organiques, mais pas de sons de nature. Plusieurs fois, j’ai enregistré avec mon téléphone des bruits de nature, notamment des cris d’oiseaux. Je pense à un oiseau qui revient à chaque printemps et qui fait des sons très particuliers, mais c’est compliqué car il n’est évidemment jamais là quand nous l’attendons. La nature produit des sons très riches, et ce qui est fantastique avec la musique électronique, c’est que tu peux triturer cette matière pour la transformer en mélodie. Certains artistes, comme Jacques, font ça très bien.
BM Lorsque je travaille la matière sonore de mes films, je m’aperçois que je reviens toujours au même orage, au même vent… Je ne trouve jamais aucun son qui sonne aussi bien que celui-là. Il s’harmonise particulièrement avec la musique, mes images, je crois que j’utilise ce vent depuis bientôt plus de 10 ans… Si on parle d’éléments naturels, votre album L’Ère du verseau a un côté très liquide, ne serait-ce que par sa pochette.
JB On avait envie de raconter avec ce visuel l’endroit dans lequel on vit qui est fait de ça. De mer, de tempêtes, de ciels noirs parfois, de peaux mouillées…
BM Est-ce que l’idée du renouvellement d’images et de styles, comme chez David Bowie par exemple, est importante pour vous ? Est-ce que vous abordez chaque nouvel album en vous disant qu’il faut faire peau neuve, se métamorphoser ?
JB Non, on fait les choses de manière assez spontanée.
La musique dans un premier temps et les images ensuite. On n’aime pas trop l’idée de conceptualiser un album. Peut-être qu’on le fera un jour ; je ne dis pas que c’est une mauvaise manière de procéder. Au niveau du son, on se laisse porter, on fait vraiment de la musique « temporelle », on s’inscrit dans notre époque.
On fait notre son avec ce qu’on a comme outils, sans se dire qu’on a envie de sonner comme il y a trente ans ou comme ce sera dans vingt ans. Je crois que nous avons fait un disque qui est très 2019-2020. Évidemment nous n’avions pas prévu cette pandémie, mais c’est vrai qu’il se dégage de cet album quelque chose d’assez sombre. Finalement les choses se croisent et nous dépassent !
PROPOS RECUEILLIS PAR JUSTIN MORIN
Corps célestes
PerezOlivier Dubois
Interprète et chorégraphe, Olivier Dubois met à l’honneur une danse puissante et charnelle. C’est dans la répétition et le dépassement que ses interprètes révèlent toute leur singularité, émergeant individuellement au sein du collectif. À l’image des titres des pièces de sa compagnie – citons Tragédie (2012), Souls (2013), 7xrien (2017) ou Tropisme (2019) – , quelque chose de direct et de percutant se joue. On ressent cette même radicalité dans la musique de (Julien) Perez. Surex, son troisième album, sorti en février dernier, affiche treize morceaux dont la juxtaposition forme un poème surréaliste. Puisant ses références dans la littérature et le cinéma, son écriture, qu’il s’agisse de ses mélodies ou de ses paroles, est incisive. Les deux artistes cultivent le décalage, déconstruisant soigneusement leurs partitions pour laisser surgir l’inattendu. Se rencontrant pour la première fois, Olivier Dubois et Perez échangent sur les différents langages de leurs pratiques respectives.
OD J’aime beaucoup ta musique. Il y a quelque chose qui m’a naturellement plu. Ce que je trouve intéressant, c’est qu’il y a une multitude de couches qui la composent. Par exemple, j’ai beaucoup ri. Il y a d’autres émotions qui se mélangent, c’est une question d’angle d’approche. Ce qui est étonnant, c’est que j’ai ressenti ce que certains disent à mon propos : c’est « irrévérencieux ». Je me retrouve un peu piégé car j’ai toujours trouvé que cette formule était un raccourci. À un moment, en tant qu’artiste, on essaie d’être intègre et d’aller au bout de ses idées. Ça permet d’avoir une parole claire, c’est parfois déroutant et c’est perçu comme de l’irrévérence. En ce sens, j’ai trouvé qu’il y avait un écho entre nos deux univers. Je trouve également que dans ta musique, il y a une part érotique très forte. Ça me parle car, pour moi, la danse est par définition érotique. Il y a beaucoup de chair dans ce que tu fais, que ce soit à travers ta voix ou tes clips.
JP La dimension burlesque, ou comique, n’est pas toujours perçue dans ma musique, mais j’y attache beaucoup d’importance. Cet ancrage dans un matériau pop est ce qui permet tous ces différents niveaux de lecture. Choisir de faire ce que l’on appelle de la pop veut dire que l’on va travailler autour de choses que l’on considère largement partagées par une majorité de personnes, contrairement à une forme d’art avant-gardiste qui demande la maîtrise d’un certain jargon. Je fais très attention à ça. Avec quelques accords, l’auditeur pourra comprendre s’il s’agit d’un morceau mélancolique ou entraînant. On peut écouter ma musique de manière très éloignée, en faisant le ménage par exemple ! C’est de prime abord assez inoffensif, mais suivant la manière dont on va l’appréhender, avec plus ou moins d’attention, on va découvrir ces couches superposées. En étant attentif aux paroles, on va voir qu’elles ne sont peut-être pas si évidentes, il y a des distorsions de sens… Partir d’un format pop me permet de ne pas être trop ostentatoire dans les idées que je veux faire passer. J’ai aussi eu ce sentiment en découvrant ton travail.
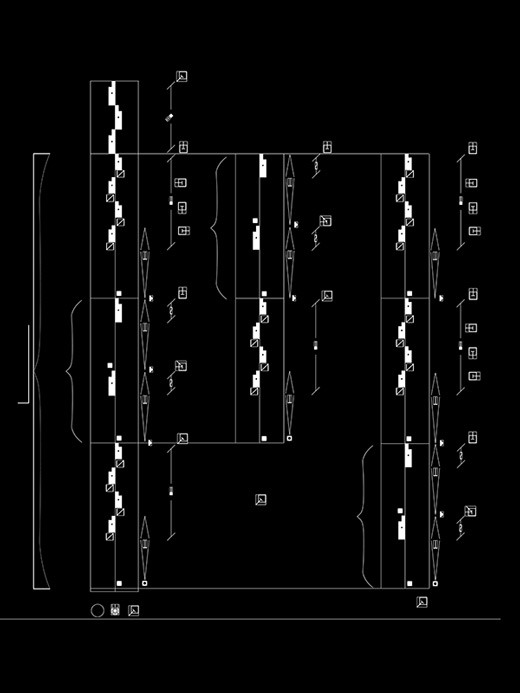
Extraits et détails provenant des partitions en système Laban de pièces d’Olivier Dubois. Notation Estelle Corbière.
OD La notion de pop en danse est très étrange car c’est un domaine où il n’y a pas beaucoup de classifications possibles. On associe souvent la pop à des spectacles qui seraient des succès publics, là où la danse contemporaine serait grisâtre.
En musique, j’avoue que la pop française m’ennuie considérablement. On a ce même problème en danse. Je vois une partie de la danse contemporaine française comme une grande fainéantise. On a dit qu’elle était intellectuelle. Pour moi, l’intellectualisation de l’art est son pire ennemi. L’intelligence oui, l’intellectualisation non !
Si la pop française ne m’attire pas, c’est que j’ai la sensation qu’elle fait peu ; peu importe si on n’a pas de voix ou pas de rythme tant qu’on a une idée. Mais une idée ne fait pas une œuvre !
Ce que j’aime dans ce que tu fais, c’est qu’il y a du travail. C’est choisi, dirigé, pointu. Est-ce que tu te sens appartenir à une certaine scène française ?
JP Il y a des personnes comme Julien Gasc, Chassol, ou Mathilde Fernandez dont je me sens proche. Je pense aussi à Jardin, un artiste belge. Il y a quelques francs-tireurs dont j’aime vraiment l’approche, mais après je te rejoins, la grande majorité des choses qui sortent ne m’intéressent pas vraiment. Souvent, c’est au niveau des textes que ça coince, c’est de la poésie très lisse, ça manque d’accrocs. L’idée de dire qu’une chanson est un poème mis en musique, c’est quelque chose de très français. C’est un lyrisme qui peut être assez gênant. Mais la langue française n’est pas évidente. Avant, j’avais un groupe – Adam Kesher – où je chantais en anglais. J’étais plus jeune et il y avait une forme de mimétisme dans ce choix. Je n’écoutais que de la musique anglo-saxonne donc ça me semblait logique de choisir l’anglais. À l’époque, nous avons tourné en Angleterre et un peu aux États-Unis. Un jour, j’ai eu une crise de doute car je me suis demandé comment ce public percevait ce que je leur racontais. J’imagine que je prononçais certains mots comme un français, d’autres comme un mec du Texas, et d’autres encore comme un type de Manchester, en mélangeant différents argots. Ça devait être insupportable à écouter ! C’est en prenant conscience de ça que je me suis dit qu’il fallait que j’écrive en français. La maîtrise de la langue me permettrait d’accéder à une forme de style. Au départ, cela a été très compliqué. Comme beaucoup de musiciens, pour trouver ma mélodie de chant, je chante en yaourt. Et à chaque fois, aujourd’hui encore, c’est des gimmicks anglais qui me viennent. Si j’essaie d’y mettre des paroles en français, je vais être obligé de trouver des compromis car il y a des sonorités qui n’existent qu’en anglais. Hier, j’écoutais Alain Bashung. Beaucoup de ses morceaux développent cette écriture qui est assez étrange, surréaliste, et j’ai l’impression que certaines de ses tournures de phrases sont faites pour coller à des mots anglais. Dans Osez Joséphine, il chante « et que ne durent que les moments doux, durent que les moments doux ». Je suis persuadé qu’initialement, il y avait quelque chose comme « what can I do what can I do ». C’est évidemment compliqué pour écrire, mais je trouve que c’est intéressant de réfléchir comme ça car ça apporte autre chose. On essaie de rendre la langue autre, c’est l’inverse de ce lyrisme que je trouve souvent gênant. La danse n’a pas ce problème de traduction ! Comment ton travail est-il perçu à l’étranger ?
OD Très bien. La danse française est subventionnée, même si les enveloppes sont de moins en moins importantes, ce qui lui permet de tourner. Pour reprendre ce que je disais un peu plus tôt, il y a eu en France dans les années 90 un courant qui a duré presque vingt ans et que l’on a appelé la non-danse. Il n’était plus question de performance physique ou d’effet. Quelques œuvres majeures sont apparues, puis on a eu droit à une sorte de fainéantise. Les années 90 ont suivi une décennie où l’on avait beaucoup d’argent, et il a fallu faire avec moins de moyens. Les costumes étaient comme ce que l’on pouvait voir dans la rue, les décors ont sauté, l’interprète a peu à peu disparu. Cette économie est devenue à un moment la signature française et elle s’est répandue dans le monde. La bonne nouvelle, c’est qu’aujourd’hui c’est devenu un courant et non plus une règle. On me dit souvent que je suis à part, que je n’appartiens à aucune famille. Tant mieux, car je préfèrerais être père de famille !
JP Souvent je me suis rêvé comme minimaliste, et je ne l’ai jamais été ! J’aime la musique des minimalistes new yorkais, je n’ai jamais réussi à faire quelque chose de proche. Le minimalisme, c’est quelque part le défi ultime de l’artiste, c’est vraiment d’arriver à la sève.
OD Je pense qu’il faut un sacré talent pour faire du minimal.
JP L’interprète a une place importante dans ton travail n’est-ce pas ?
OD Ce sont les rois. En tant que chorégraphe, tout ce que je fais est très partitionnel, c’est très écrit. Je travaille conjointement avec mon compositeur. Tout est inscrit dans la scénographie que je dessine. Il n’y a pas d’espace pour l’improvisation. Pour les danseurs, c’est un cadenassage infernal. Physiquement c’est extrêmement exigeant car ce sont souvent des partitions complexes qui s’étalent pendant une heure et demie, parfois plus, et où tout sera compté. Cela peut paraître un peu anxiogène, les interprètes pourraient se demander à quoi ils servent, mais je crois en leur puissance. Souvent, on ne comprend pas l’interprète comme un artiste, mais il en est un. Cette écriture si cadenassée contraint à la prise de décisions de l’interprète. La liberté ne passe que dans l’emprisonnement. Sinon, c’est faire ce que l’on veut. Il faut être emprisonné pour que cette audace vibre sur un plateau et que ça soit unique. Par contre, si tout est écrit, je ne travaille jamais l’approche du mouvement de mes interprètes. La dynamique est donnée mais ils gardent leur singularité.
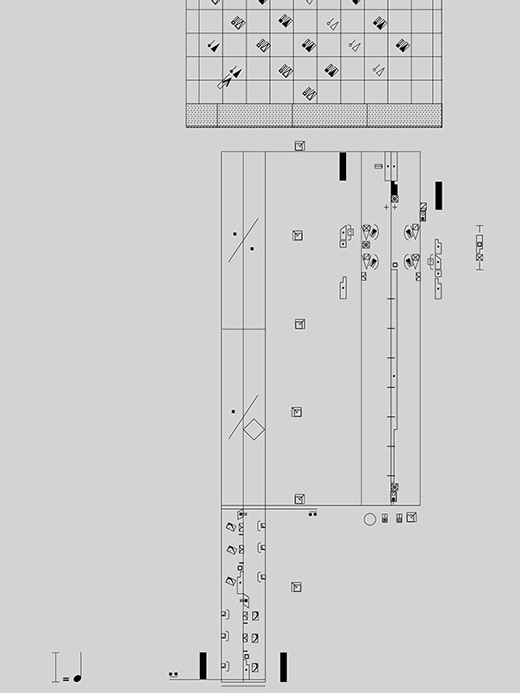
Extraits et détails provenant des partitions en système Laban de pièces d’Olivier Dubois. Notation Estelle Corbière.
C’est ce qui fait que dans mes pièces, il n’y a pas un interprète comme un autre, même s’ils ont tous la même démarche, la même cadence, le même objectif à atteindre. Ils sont magnifiés. Je le dis toujours : j’aime les interprètes glorieux sur un plateau, car ils ont traversé des turbulences incroyables. Mon plus grand échec serait d’avoir un interprète au sol.
JP Comment faire pour que ça n’arrive pas ?
OD À l’automne dernier, j’ai créé une pièce qui s’appelle Come out pour le Ballet de Lorraine. C’est basé sur un morceau de Steve Reich qui dure une douzaine de minutes. Nous en avons fait une version d’une heure. J’adore ce titre, mais j’ai l’impression que Reich s’est arrêté en plein milieu et n’a pas bossé jusqu’au bout ! Come out est un élan collectif. Tout comme l’était Révolution, l’une de mes premières pièces. Le principe est très simple : quinze femmes tournent pendant deux heures et quart autour d’une barre. Ces interprètes savent qu’elles vont devoir tenir pendant tout ce temps sans sortir du plateau. Chacune a une partition indépendante, c’est redoutable. Elles ont dû tout apprendre, pour pouvoir s’en emparer et faire face à d’éventuelles failles. On ne peut pas penser qu’il n’y aura pas de perte. Je dis toujours qu’il n’y a aucun problème à l’erreur. Une fois la partition digérée, il faut se concentrer sur comment gérer les soucis en une fraction de seconde. L’information est entre eux, la solution est entre eux. Parfois un cri poussé par l’un des interprètes leur permettra de se resynchroniser. Il ne faut laisser personne dans le fossé. On est faillible, on est des êtres humains, et c’est d’autant plus beau de voir comment on se redresse et on repart. Il faut arriver au bout, ensemble. C’est de ça dont il s’agit quand je dis qu’un interprète au sol serait un échec terrible.
JP Ce que tu dis a presque une portée politique.
OD L’art est politique, puisqu’il implique une prise de parole. Pour autant, je ne développe pas de discours politisé avec mon travail. La perception politique est intime et propre à ceux qui vont recevoir. Je pense que le rôle des artistes n’est pas de s’occuper de cela. Qu’en penses-tu ?
JP Je suis d’accord. Souvent il y a une confusion autour de cette dimension politique. Les artistes font des choses pour les adresser à un public, c’est donc porteur d’une vision du monde, d’une forme de hiérarchisation. Lorsqu’on écrit une chanson, on choisit de parler d’une chose et pas d’une autre. Mais souvent on confond le politique avec une forme de réaction sur des questions d’actualité. Et ça, c’est très différent. Qu’un artiste s’arroge le droit de commenter les sujets d’actualité, ça n’a pas de sens. Ils ne sont pas forcément les personnes les plus légitimes pour faire ça, même si certains le font bien. L’art s’inscrit dans une temporalité qui est différente de celle d’un polémiste ou d’un journaliste qui va réagir au jour le jour à ce qui se passe autour de lui. Souvent, je me suis demandé comment je pouvais reconnaître l’impact d’une œuvre, comment comprendre à quel point elle a pu me toucher. Cela se passe quand je regarde une pièce de théâtre, de danse, un film, ou quand je lis un bouquin, et que cela me donne envie de créer à mon tour. Il y a comme un passage d’une énergie. Cette excitation de l’imaginaire, ce passage de l’imaginaire à l’action est politique. Il y a des œuvres qui nous donnent les moyens d’agir.
OD Quand on parle de politique, on a tendance à oublier que le premier élan créatif vient de l’intérieur de soi. On est d’abord d’un égoïsme terrible, nous sommes les vampires de nous-mêmes. Ça ne peut fonctionner que comme ça, sur soi et en soi. C’est ensuite que cela va produire quelque chose qui ne nous appartiendra plus, mais qui est pourtant né de quelque chose d’intime. Si on cherche à avoir une approche politique dirigée, à vouloir parler de tel ou tel sujet, alors on fait du commentaire de société. Je ne comprends pas ces artistes qui vont dire : « Je vais faire une pièce sur le climat ou sur la guerre. » Créer, c’est être à la fois dans un état de vulnérabilité et de prétention.
JP Tu parlais de partition un peu plus tôt. La notation en danse est complexe car il y a différentes manières d’écrire la danse, n’est-ce pas ? Comment tu procèdes ?
OD Contrairement au solfège qui est un savoir accessible, il n’y a pas d’écriture universelle en danse. Moi par exemple, je ne sais pas lire la danse mais je fais noter toutes les pièces en Laban (C’est un système mis en place par Rudolf Laban, théoricien et chorégraphe allemand. C’est l’un des plus connus et il est utilisé à l’international depuis son apparition en 1928.) Et j’invente mon propre système d’écriture, qui est repris par mon annotatrice Laban pour ouvrir de nouveaux champs. Puisque je ne lis pas le Laban, pourquoi je fais noter mes spectacles? Parce que j’adorerais qu’un jour quelqu’un vienne me voir et me dise : « J’adore Tragédie mais j’aimerais la reprendre pour la rendre encore meilleure. » Mais malheureusement pour que cela arrive, il faut connaître cette écriture. Tant qu’elle n’est pas enseignée dans les conservatoires et les écoles de danse, elle restera un langage savant à la portée limitée.
Je voulais te demander comment tu développes l’univers visuel qui accompagne ta musique, notamment celui des clips ?
JP Le clip est un objet intéressant car purement promotionnel. Aujourd’hui, c’est une contrainte qui s’étend jusqu’aux réseaux sociaux, il est très difficile de sortir un disque sans être y présent et les alimenter avec des contenus visuels. Ce qui n’est a priori pas le domaine d’expertise des musiciens ! Mais c’est un passage obligé. J’ai eu quelques expériences malheureuses en matière de clips au début de ce projet. Rien de catastrophique, mais j’ai bien senti que pour que les clips servent ce que je voulais faire passer dans ma musique, il fallait que je reprenne la main dessus en travaillant avec des proches dont j’appréciais le travail ou alors en invitant des personnes que je ne connaissais pas directement, mais dont j’admirais le travail, comme le réalisateur Yann Gonzalez. En l’occurrence, pour Yann, il s’agissait vraiment d’une carte blanche autour du morceau « Les vacances continuent ». Pour le dernier, sur le titre « El Sueño », j’ai invité Alexis Langlois. J’étais très content car on se connaît depuis longtemps. Ce qui est intéressant pour ces réalisateurs, c’est que les clips sont aussi un laboratoire, c’est l’occasion de tester des choses.
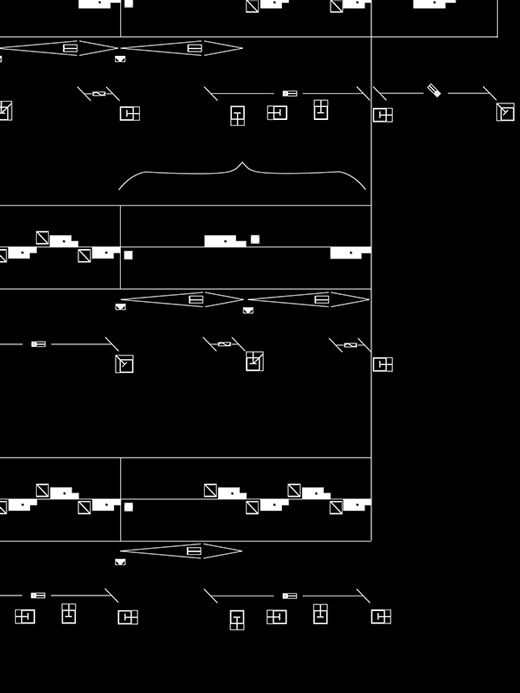
Extraits et détails provenant des partitions en système Laban de pièces d’Olivier Dubois. Notation Estelle Corbière.
OD Comment tu gères le fait d’être interprète du clip ?
JP Ça dépend ! Quand j’ai commencé à faire de la musique, je ne me suis pas dit « Je veux faire des clips ! »
Il y a donc un côté un peu amateur, on incarne quelque chose dans les clips qui doit être raccord avec la musique, et c’est bizarre car on n’est pas vraiment préparé à ça, mais certains musiciens le font naturellement.
Sur « El Sueño », Alexis a été très directif. Je ne suis pas acteur, donc c’était intéressant de travailler avec lui car il est très « mécaniste » dans sa manière de diriger. Il n’est pas du tout dans la psychologie.
Et toi, est-ce que tu pourrais t’amuser de chorégraphier un clip ?
OD J’adorerais ! J’ai eu des propositions mais je n’ai jamais pu le faire. Et j’adorerais être dans le clip! Ce que j’aime avec les commandes, c’est de rentrer dans la tête de l’autre, je ne cherche pas à reproduire mon travail. Il faut que ce soit un hybride au service de l’autre. C’est passionnant car ça permet d’apprendre. En tout cas, si à l’avenir tu cherches un chorégraphe…
Propos recueillis par Justin Morin
Causalité
Kazu
La casualité désigne ce qui n’offre rien d’assuré ou de certain. C’est de ce mot qu’est né le titre Kazuality, paru en 1997 sur le troisième album du groupe de rock Blonde Redhead, formation charismatique composée des jumeaux italiens Amedeo et Simone Pace et de la japonaise Kazu Makino. Plus de vingt ans après leurs débuts sur la scène new-yorkaise et une riche discographie, Kazu sort son premier album en solo. Intitulé Adult Baby, on pourrait en dire qu’il définit la casualité, tant son ambiance est délicate et virevoltante. Entre expérimentations sonores, mélodies aériennes et chant contemplatif, la musicienne propose un voyage d’une rare amplitude. Pour nous présenter ce disque, Kazu commente huit morceaux qui sont autant de clés pour comprendre son histoire et sa musique.
California dreamin’
Jose Feliciano, 1968
J’aime au moins autant cette reprise que l’originale de The Mamas & The Papas. Quand un morceau est vraiment très bon, vous pouvez en tirer énormément, malgré les transformations, ou les manipulations de la reprise. California Dreamin’ est une chanson simple. Vous pouvez chanter très facilement la mélodie qui est assez basique, et pourtant José Feliciano va partout avec cette mélodie. J’admire sa technique et la liberté qu’il a prise. L’émotion est si profonde. La façon dont il prononce ses paroles est puissante, et ce, même si elles sont très simples : « All the leaves are brown and the sky is grey ». Ça me fait m’interroger : à quel point les paroles d’une chanson doivent-elles être bonnes ? Quand la musique est si forte, est-ce que ce que l’on raconte est vraiment important ? Je n’ai pas la réponse.
Dip set forever
Cam’ron, 2004
C’est une de mes chansons préférées. J’écoute aussi des choses plus récentes en hip-hop, mais celle-là survit au temps ! Le hip-hop me fait penser que l’on n’a pas besoin d’en faire trop dans la composition. On peut se répéter encore et encore. Cette répétition peut créer un réel plaisir à l’écoute. Ce titre de Cam’ron, c’est un archétype. Quand le sample débarque, tu te sens super bien. C’est un sentiment auquel je repense quand je compose, car je me mets beaucoup de pression. Quand je suis bloquée, je me dis à moi-même : « Souviens-toi de ce que tu aimes dans la musique ! Tu as juste besoin de ça pour avancer. »
Sam Owens, qui a produit l’album avec moi et que je ne connaissais pas du tout avant, a été très surpris par la musique que j’écoute. Quand nous évoquions nos goûts, je lui citais quasiment tout le temps des artistes de hip-hop et de R’n’B. Moi, je ne m’en rendais même pas compte, c’est lui qui m’a dit : « Je n’imaginais que tu écoutais ça. » Après, je ne pense pas que cela m’influence vraiment. Quand je fais ma musique, je ne pense pas à celle que font les autres.
Solari
Ryuichi Sakamoto, 2017
J’ai rencontré Ryuichi il y a bien longtemps. À l’époque, je ne pensais pas du tout que je serais capable de faire un album solo. Il m’a toujours donné des occasions de créer à partir de sa musique. Même s’il disait souvent : « Oh mon Dieu. Ce n’est pas bon Kazu… Allez, Kazu, reprends-toi. » Pendant des années, il me donnait des bouts de musique, je travaillais dessus et lui renvoyais. Ça ne lui plaisait jamais. Malgré ça, il a toujours été généreux avec moi. Il m’a toujours encouragée. Je suis presque gênée de dire combien j’aime ce qu’il fait.
Quand il compose, sa musique est tellement proche de son cœur. Il travaillait sur la composition de Solari quand je lui ai envoyé les démos de mon album Adult Baby. Me dire que dans ces moments-là, ma musique faisait partie de sa vie… j’étais honorée et flattée. C’est comme si mes chansons s’étaient retrouvées juste à côté de sa musique pour un instant.
C’était étrange, car au début, il ne faisait pas de commentaires, mais dès que j’arrêtais de lui envoyer mes morceaux, il me disait : « Où en est ta musique ? Envoie-la-moi, je veux l’écouter. » Il ne m’a jamais fait de critiques, ni donné de conseils. Il était comme un producteur invisible. Il m’a motivée pour faire du bon travail. Et puis à un moment, quand j’avais cinq ou six chansons à peu près formées, il m’a demandé : « Kazu, j’aimerais jouer sur certaines chansons. Je peux ? » Évidemment qu’il le pouvait ! Sur « Salty », il a samplé ce que j’avais déjà enregistré, l’a inversé, et a introduit des sons très organiques. Sur « Meo », qu’il adore, il a joué du synthétiseur.
Here’s to you
Joan Baez & Ennio Morricone, 1971
Jaime beaucoup Ennio Morricone, il fait partie des compositeurs que j’écoute souvent. Je connais cette chanson depuis longtemps, mais j’en suis tombée amoureuse récemment. J’ai un ami d’extrême-gauche qui tient un bar où je traîne tous les soirs, et nous parlons beaucoup des chansons politiques. Moi, je n’ai jamais été très politique dans ma musique. Je vis sur l’île d’Elbe, dans un coin peuplé d’anarchistes. C’est assez étonnant. Et je crois qu’ils m’influencent ces derniers temps… je suis très ouverte d’esprit donc ça me va.
Todo homem
Tom Veloso, 2017
J’ai écouté de la musique brésilienne pendant de longues années parce que je vivais avec un musicien brésilien. Il m’a vraiment éduquée à cette musique. À cette période, j’ai rencontré des grands noms, comme Caetano Veloso (le père de Tom) ou encore Gal Costa… Nous avons eu de grandes conversations, et ils m’ont aidée, à devenir ce que je suis aujourd’hui. Leur grâce,leur confiance naturelle et leur approche très pure de la musique ont eu un immense impact sur moi. C’est aussi à leur contact que je suis devenue une artiste.
Ballade de Melody Nelson
Serge Gainsbourg, 1971
J’ai tellement écouté la musique de Serge Gainsbourg ! Je l’ai consumée jusqu’au bout, elle est dans mon sang désormais. Je le considère comme mon héros. Quand il terminait une chanson, il continuait à travailler dessus encore et encore. Il en faisait tellement de versions, c’est quelque chose que j’admire. J’ai le même sentiment avec certaines de mes chansons, j’ai l’impression qu’elles ne sont pas encore terminées. Je veux les ré-enregistrer et en faire d’autres choses.
Je pense que Gainsbourg était profondément punk. Beaucoup de gens pensent que je le suis aussi, mais je n’en suis pas sûre car j’aimerais bien faire partie de ce monde. Je travaille dur pour cela. Malgré ça, je me sens toujours un peu rejetée…
Pierre & Nicole
Bande Originale de La peau douce de François Truffaut
Georges Delerue, 1964
C’est un compositeur que j’ai beaucoup écouté donc sa musique a inconsciemment pénétré mon système. J’aime tellement son travail que j’ai l’impression de le connaître personnellement. J’ai lu dans un article que c’était quelqu’un de jovial, et pourtant sa musique est très triste. L’article expliquait aussi qu’avant de commencer à travailler, Delerue nettoyait sa maison de fond en comble. C’est exactement comme moi. J’ai besoin de passer l’aspirateur, de tout ranger… Tout ça parce que je n’ai pas envie de m’y mettre.
Adult Baby a été composé en Italie, sur l’île d’Elbe, un endroit que j’avais découvert avec les jumeaux et où nous avons commencé à jouer. À New York, je me sentais tout le temps stressée. Je luttais mentalement et physiquement alors je me suis mise à rêver que je m’échappais. J’ai rêvé de cette île, de pouvoir m’asseoir face à la mer. Je me suis demandé ce qui m’en empêchait. Pourquoi ne pas y retourner ? C’est ce que j’ai fait. Cette île a un pouvoir magnétique. Elle dégage des charges minérales et je m’en nourris.
Black Guitar
Blonde Redhead, 2010
Je l’aime énormément. Quand j’écoute cette chanson, je me dis qu’elle sonne super bien, même si on l’a mal produite. Je pense que j’ai beaucoup souffert de faire de la musique avec Blonde Redhead. Ça a été mon quotidien pendant tellement longtemps. Durant la composition et l’enregistrement de Penny Sparkle — notre huitième album, sorti en 2010, sur lequel se trouve Black Guitar — j’étais dans une période très sombre de ma vie. Je suffoquais, c’était très compliqué de faire naître la musique. Il y avait souvent des guerres d’ego entre nous. Je me dégoûtais même parfois. Avec mon album solo, il n’y a plus tous ces problèmes. J’étais moi-même étonnée de ne pas souffrir, de ne pas avoir à rendre de compte à qui que ce soit, de ne plus avoir à me regarder dans un miroir et penser : « tu n’arrives à rien ». Pendant Adult Baby, j’ai vraiment pris soin de moi. Ça m’arrive de craquer parfois, mais je me dis rapidement que c’est stupide. Je m’accepte beaucoup plus.
Nous sommes en train de refaire un album avec Blonde Redhead, nous en avons composé la moitié. Je ne sais pas ce que Amedeo et Simone ont pensé de mon disque, je ne leur ai pas encore donné de copies. Mais je vais bientôt les retrouver donc je pense qu’ils me feront des retours assez rapidement. Amadeo n’a pas entendu le produit fini, mais il a entendu quelques morceaux avant mixage… Je ne sais pas s’il se moquait de moi, mais il m’a dit : «Waouh, c’est un chef d’œuvre. J’aimerais que tu fasses aussi bien pour le groupe ! Pourquoi tu ne donnes pas autant pour le groupe ? C’est bien mieux que tout ce que l’on a pu faire ensemble. » Ça va me donner du fil à retordre, mais ça va être bien !
Des attractions des astres
Étienne DahoDamien Jalet
Creusant inlassablement le sillon d’une pop mélodique, parfois mélancolique, parfois embrasée, Étienne Daho a su traverser les époques et les cœurs. Blitz, son treizième album studio sorti en 2017, fait preuve d’une richesse galvanisante, témoignant une nouvelle fois de ses talents. Il s’entretient ici avec Damien Jalet, chorégraphe franco-belge, avec qui il a collaboré pour le clip du titre « Le Jardin ». De passage à Paris,au Théâtre National de la Danse de Chaillot, le prolifique danseur présente Skid, impressionnante création pour la GöteborgsOperans Danskompani. Sur un plateau à la pente vertigineuse, dix-sept danseurs se confrontent à la gravité dans un ballet aussi technique que symbolique. La discussion entre les deux artistes a lieu à l’issue de l’ultime représentation parisienne de la pièce.
Étienne Daho
La performance des danseurs semble tellement physique ! Un peu comme une ascension constante de dunes à toute vitesse !
Damien Jalet
C’est drôle que tu penses à cela car nous avons fait une série de photographies de promotion au Japon, à Tottori, où l’on trouve des dunes gigantesques, qui vont jusqu’à cinquante mètres de haut. C’est notamment là qu’a été tourné ce film que j’adore, Woman in the Dunes de Hiroshi Teshigahara (1964). Un homme se retrouve piégé dans une maison. Il n’arrive pas à s’en échapper car elle est située dans la dune. Dès qu’il tente de s’en extraire, elle se défait. C’est très angoissant, le sable envahit progressivement la maison. Ça m’a beaucoup inspiré pour Skid.
ÉD Ta pièce a effectivement quelque chose d’angoissant.
DJ Comme elle est assez abstraite, le public y voit beaucoup de choses différentes. C’est sûr qu’il y a un rapport à la mort, à la peur de tomber, à la chute, mais à côté de ça, il y a quelque chose de l’ordre de l’élévation et du lâcher prise. Dans la première séquence, que l’on appelle sleepers, il est question de cela. Lorsque quand tu t’endors et que tu t’abandonnes à la gravité… Quand tu fais de l’hypnose, la première chose que tu fais c’est de relâcher tes muscles.
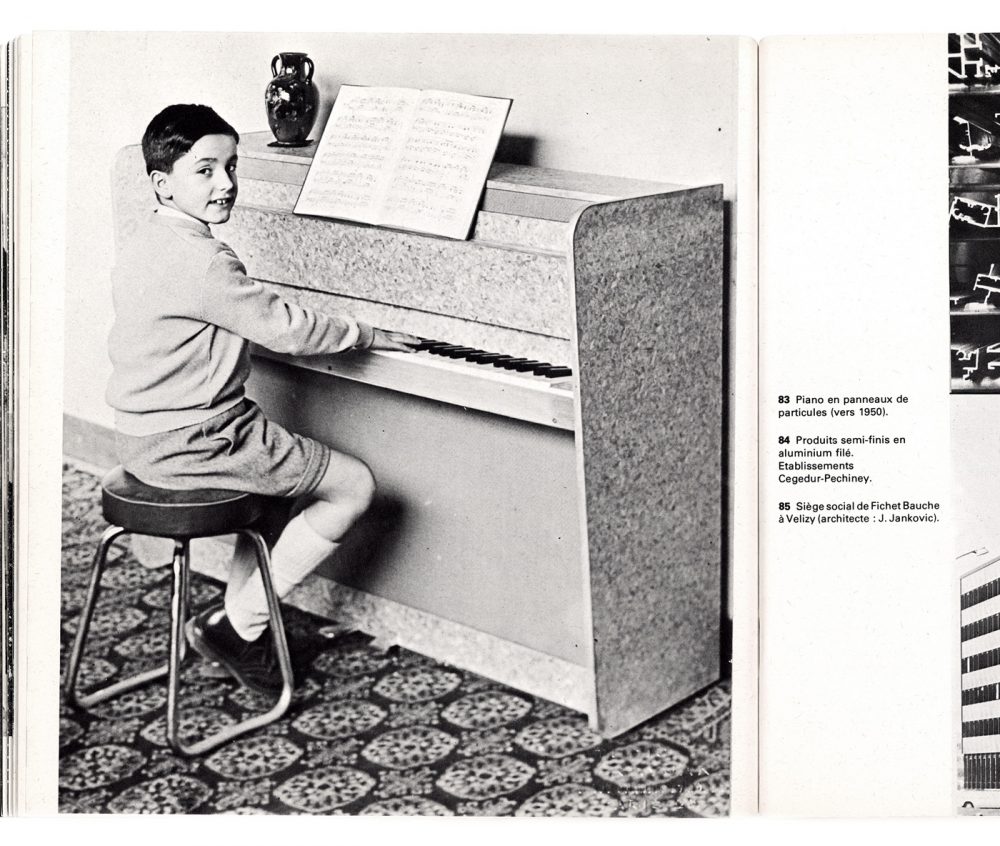
Piano en panneaux de particules, vers 1950
© Office de Diffusion des Panneaux de Particules
« matériau/technologie/forme » catalogue édité par le Centre de Création Industrielle, Établissement Public du Centre Beaubourg, à l'occasion de l'exposition éponyme au Musée des Arts Décoratifs, juin, 1974.
Bibliotheque Alexandru Balgiu
ÉD Comment les danseurs arrivent à gérer leur vitesse ?
DJ Cette pièce a été très compliquée à mettre en place. Cinq jours avant les premiers filages, les danseurs transpiraient tellement qu’on avait l’impression que la scène avait été savonnée. Nous avions répété sur une scène de cinq mètres et nous n’avons eu que dix jours pour l’adapter sur le plateau final qui est deux fois plus grand. La question des costumes a été décisive. Nous avons trouvé ces chaussures de jardinier japonais, avec ces semelles souples, qui facilitent l’adhérence des danseurs.
ÉD Chaque geste est chorégraphié ? On a parfois l’impression qu’il y a des choses qui sont de l’ordre de l’accident, comme par exemple lorsqu’ils se télescopent ou lorsqu’ils tombent.
DJ Effectivement tout est chorégraphié ! On a travaillé beaucoup pour que ce côté accidentel semble réel. La scène devait être inclinée à quarante-cinq degrés. Avec Aimilios Arapoglou, qui m’a assisté sur le projet et qui est également sur scène, nous nous sommes rendu compte que c’était ingérable. La scène est donc inclinée à trente-quatre degrés. Initialement les corps des danseurs devaient tomber dans la fosse d’orchestre. C’est pour cela qu’il y a ces références symphoniques dans la musique qu’a fait Christian Fennesz, qui a notamment remixé des compositions de Mahler.
ÉD La musique est superbe, elle est oppressante mais elle emporte.
DJ Je voulais montrer comment notre corps est une machine anti gravitationnelle.
ÉD Cette idée d’élévation, c’est quand même quelque chose qui est constant dans tes recherches. C’est d’ailleurs pour cela que nous nous sommes rencon-trés. Nous avons cet ami commun, le metteur en scène Arthur Nauzyciel. J’avais envie de danse pour le clip du « Jardin », j’avais envie de quelque chose de très joyeux. Je lui en ai parlé et c’est lui qui m’a conseillé de te voir. Je t’avais déjà vu danser, justement dans une pièce d’Arthur, L’image, d’après une nouvelle de Samuel Beckett. Il y avait aussi Lou Doillon sur scène, qui faisait ses premiers pas au théâtre. C’est drôle car à ce moment-là, on commençait à travailler sur son premier album. Tout était déjà lié.
DJ Moi j’ai toujours été fan. Je t’ai vu chanter sur la Grand Place à Bruxelles quand j’avais 14 ans. J’ai tout de suite été en connexion ! Ce clip qu’on a fait ensemble, c’était une super occasion de matérialiser toutes ces histoires et connexions communes. Le processus de création, c’est aussi ça : tu rencontres véritablement les gens quand tu travailles avec eux.
ÉD De toute façon, on ne voit vraiment que les gens avec lesquels on travaille. Et après on les perd de vue, c’est malheureusement souvent comme ça. On travaille en famille, avec les gens que l’on aime, ça nous permet de nous retrouver.…
DJ D’autant plus que lorsque tu es fidèle à tes collaborateurs, tu peux aller un peu plus loin à chaque nouveau projet. La création devient un point de rencontre. Quand tu fais une pièce, tu es rarement seul. C’est la différence entre ton travail et le mien. Toi, tu es dans un rapport plus introspectif.
ÉD Tout à fait, c’est vraiment un métier de solitaire. C’est l’isolement qui m’apporte toute la matière dont j’ai besoin. C’est pour cela que je pars pour écrire, comme j’ai pu le faire récemment en Angleterre. Je suis parti pendant deux ans, uniquement pour cela, dans un petit endroit où je n’avais ni affaires, ni amis. C’est ce qu’il me faut pour que je sois en état de recevoir des choses.
DJ Tu t’isoles complètement au point de ne voir personne ?
ÉD Non. Mais les gens que je rencontre sont des personnes que je ne connais pas. J’aime beaucoup Londres. Pendant longtemps je suis allé à Ibiza, pour des tas de raisons. Et depuis quelques années, j’aime Londres. Je suis vraiment un citadin et c’est une ville parfaite pour marcher, pour prendre des photos, pour se laisser envahir par des images, par des choses inattendues. Le fait d’être anonyme dans un endroit, c’est très bien. La célébrité isole forcément, elle coupe.
DJ Quand tu commences un album, tu as une idée de départ ou tu laisses les choses se développer par elles-mêmes ?
ÉD Je laisse venir les choses. Je ne sais pas comment l’expliquer. J’ai confiance. C’est comme une intuition. Pour chaque album, il y a des muses, qu’elles soient réelles ou fictives, ou des fantômes.
DJ Je suis très fantôme aussi !
ÉD Il faut vraiment convoquer les fantômes, il faut que ça parle.
DJ Je t’ai vu récemment en concert à Bruxelles, c’était incroyable, le public était déchaîné. Il y avait une forme d’amour, c’était dingue. J’étais vraiment impressionné. J’ai pu voir à quel point la musique t’habite.
ÉD Mon corps et ma tête sont faits pour ça.
DJ Tu préfères être en studio ou sur scène ?
ÉD Ça n’a tellement rien à voir, les deux sont complémentaires. J’ai besoin de cette phase d’écriture pour ensuite rentrer dans un moment de laboratoire. Je parlais d’isolement et de solitude, mais c’est la première étape de travail, car dans les suivantes, on ne fait rien tout seul. On réussit avec les autres.
DJ Pour moi cette notion de collectif est tellement importante ! Je pars d’une idée et ce qui m’angoisse toujours, c’est de trouver la bonne ! Comment est-ce que je peux mettre tout le monde sur le même diapason ? Si tu mets tes danseurs sur une pente, ils seront obligés de trouver une manière de danser inédite. Et c’est super beau car chacun a une manière différente de le faire. Je ne fais que des choses qui relèvent de la collaboration, que ce soit avec un plasticien ou un musicien. Je ne crée pas la chorégraphie seule dans ma tête pour l’enseigner ensuite aux danseurs. Je suis tout le temps dépendant des interprètes avec qui je travaille. Tout ça est très social car tu dois constamment composer avec cet aspect, ce ne sont pas des objets que tu déplaces, ce sont des gens ! Du coup quand tu édites, quand tu commences à couper, à mettre les choses en place, tu ne peux pas t’empêcher de faire mal à certains ego.
ÉD Pour moi, ça a été très intéressant de te voir travailler sur le clip, de voir comment tu dirigeais les danseuses. Et tu as même réussi à me faire danser, ce qui n’est pas rien !
DJ Mais j’ai toujours trouvé que tu étais un super danseur. À chaque fois que je t’ai vu en concert, je l’ai constaté.

Trisha Brown, « Untitled & Untitled », dessins au crayon à mine de graphite sur papier, 1973. © Trisha Brown
Trisha Brown « So That The Audience Does Not Know Whether I Have Stopped Dancing » édité par Peter Eleey, Pamela Johnson & Kathleen Mclean, Walker Art Center, Minneapolis, 2008.
Bibliothèque Alexandru Balgiu
ÉD Quand la musique t’envahit, ton corps bouge de manière innée. Par contre, faire quatre gestes chorégraphiés sur le clip, pour moi ça a été très dur ! J’avais l’impression d’être incapable de coordonner mes mouvements.
DJ Je ne sais pas comment tu as rencontré Arthur.
ÉD C’était en 1986, à l’aéroport de Nice. J’étais allé au festival de Cannes, je ne sais plus vraiment à quelle occasion, certainement pour faire une télé stupide. Sur le retour, le vol avait plusieurs heures de retard et c’est comme ça que l’on a fait connaissance.
DJ Quelle a été ta première collaboration avec lui ?
ÉD Je suis intervenu dans Kadish, une lecture d’un poème d’Allen Ginsberg, qu’il a présenté en 2013. J’ai enregistré quelques lignes…
DJ Ah oui, vous avez quand même pris 25 ans pour faire quelque chose ensemble ! Alors que nous avons commencé à travailler ensemble un an après notre rencontre, qui a eu lieu dans un ascenseur d’hôtel, à Buenos Aires ! On est tout de suite devenus amis. C’est quelqu’un d’extrêmement important car il m’a permis de prendre énormément confiance en moi. Ça a toujours été un échange, je l’ai aussi beaucoup soutenu. On collabore depuis 2006 et je pense avoir travaillé sur toutes ses pièces depuis. C’est beau quand ça se passe comme ça. On revient sur ce que tu disais sur le fait de collaborer avec des amis… C’est important car c’est très difficile de créer. Je ne sais pas quel est ton rapport face à la création. Ça t’emporte mais ça peut être complètement anxiogène aussi. C’est pour ça que je suis très admiratif des gens comme toi qui sont depuis longtemps sous l’œil public. Cela demande un certain centrage pour continuer de garder son cap.
ÉD C’est comme une intuition, comme une lanterne que tu suis. Moi je ne me pose pas la question. J’ai confiance, tout le temps. Je sais que ça va arriver. C’est plus fort que tout le reste.
DJ Le désir doit être plus fort que la peur.
ÉD Oui ! La peur se matérialise en obstacles. Quand j’ai un projet, je n’imagine jamais que je ne vais pas pouvoir le faire. Il faut transcender la gravité, on peut parler de choses graves légèrement. La gravité fait partie de notre quotidien. Qu’est-ce que tu en fais ? Une chanson, c’est très court, c’est trois minutes. Ça se promène, ça se ballade partout, ça sort de la radio pour sauter dans la cuisine ou dans un casque. C’est ça qui est fou avec les chansons.
DJ C’est quelque chose qui est vraiment spécifique aux musiciens ! Le tube, c’est de la magie totale.
ÉD Oui ! Ça a le pouvoir de créer un lien avec les autres. Une chanson va rappeler à son auditeur qui il a embrassé, quand, où… Mes chansons, souvent je m’en rends compte, ont accompagné des moments extrêmement intimes. Je connais des personnes qui se sont mariées sur une de mes chansons qui s’appellent « Ouverture ». Choisir ce titre pour un moment si intense et important, c’est fou. Pénétrer l’intimité de cette manière…
DJ Je suis hyper jaloux ! Personne ne va se marier avec une pièce de danse ! Mais il est vrai que la danse et la musique ont une relation très spéciale, elles sont liées. Je ne sais pas comment expliquer, mais la danse matérialise le son. À chaque fois que je dois travailler sur des clips vidéos, je me demande comment faire pour retranscrire, suivre les contours sans pour autant illustrer. Lorsque j’ai travaillé sur Suspiria de Luca Guadagnino, où je me suis occupé des séquences dansées, j’ai donné mes partitions rythmiques à Tom Yorke qui faisait la musique du film. Il m’a dit « tu rigoles, je ne travaille pas comme ça ».
ÉD La chorégraphie a été faite avant la musique ?
DJ Tout à fait. Tom a passé six mois à essayer de remettre de la musique sur quelque chose qui avait déjà été dansé, ça a été un vrai casse-tête chinois.
ÉD Mais c’est très dur.
DJ Je sais ! À un moment, il était tellement coincé qu’il s’est plongé dans les règles mathématiques de ce que je lui avais transmis presque un an auparavant. Il a fait une séance de méditation, il a ensuite joué sur ces chiffres, et c’est comme ça qu’il a débloqué la situation. Il a dû se mettre dans une situation de lâcher prise. C’est ce que nous avons fait, Sidi Larbi Cherkaoui et moi, sur notre version du Boléro, en 2013 à l’Opéra de Paris. Nous avons travaillé sans musique pendant trois semaines, nous nous basions uniquement sur les structures rythmiques parce qu’on ne voulait pas se laisser écraser par la puissance de l’œuvre. Il nous fallait une certaine résistance. Pour Skid, la musique a été créée dans des conditions particulières. Fennesz, avec qui je travaille depuis 10 ans, n’a eu que deux semaines pour ajouter la musique sur la pièce. Il m’a proposé des choses qui collaient trop à ce qui se passait sur scène, ça ne me satisfaisait pas totalement. Ce qui nous a sauvé, c’est qu’il avait sorti un album quelques mois auparavant. J’ai essayé quelques uns de ses morceaux, et c’est comme si cela avait été créé pour. Il a réajusté certains titres pour la pièce.
ÉD Comment ça se passe dans la tête d’un danseur ? Il danse sur la musique ou il compte ?
DJ Ça dépend des pièces. Pour Skid, toute la partie centrale est hyper comptée. J’aime bien mettre les danseurs dans des rapports très mathématiques car ça les met en transe. Ils sont dans des comptes qui font six-huit, six-deux, deux-deux… Ça n’est que ça. C’est douze pages de partition rythmique dans la tête. Tu ne peux pas lâcher une seconde sinon tu es perdu. Tu es amateur de danse ?
ÉD Oui mais je connais peu de choses. J’ai vu pas mal de pièces d’Angelin Preljocaj. Quelques ballets à l’Opéra Garnier également. Mais pour moi, ce lieu, c’est avant tout le Fantôme de l’Opéra, c’est plein de fantasmes. C’est le premier livre de poche que j’ai lu, vers 8 ou 9 ans. Cette histoire d’amour, sous l’Opéra, m’a marqué ! J’ai pu visiter les sous-sols de Garnier, c’est fascinant de découvrir ce lac artificiel.
DJ L’eau est un élément important pour moi, notamment pour sa connexion avec l’inconscient. Pour la prochaine pièce que l’on jouera à Chaillot en mars 2020, on va recouvrir le plateau d’eau pour créer un lac noir. Moi j’adore ce théâtre car c’est notam-ment ici que se passe La Jetée de Chris Marker, dans les sous-terrains de Chaillot. Je suis obsédé par ce film et son rapport au temps. D’ailleurs, ce qui me fascine avec la musique, c’est qu’elle a le pouvoir de re-convoquer le temps.
ÉD Tout à fait. Et si c’est le cas pour le public, ça l’est aussi pour moi ! Quand je rechante une chanson, je me retrouve dans l’émotion qui me traversait au moment où je l’ai écrite. Ce qui fait qu’il y a certaines chansons que je ne peux pas chanter…
DJ Lesquelles ?
ÉD « La baie » par exemple. Il y en a quelques unes comme ça, des histoires d’amour brisé… Ça me remet toujours dans cet état, alors j’essaie d’éviter ! Il y a suffisamment de choses compliquées à gérer par ailleurs ! Tu ne trouves pas que le XXIe siècle est très décevant ? Toutes les choses qui ont été mises en place, qui étaient pleines de promesses, ne se concrétisent pas. Les libertés régressent… Des choses que l’on pensait acquises ne le sont pas.
DJ Ou sont remises en question. De voir qu’on se retrouve de nouveau avec des personnes qui pensent que la terre est plate me désole ! Mais malgré ça, je garde espoir.
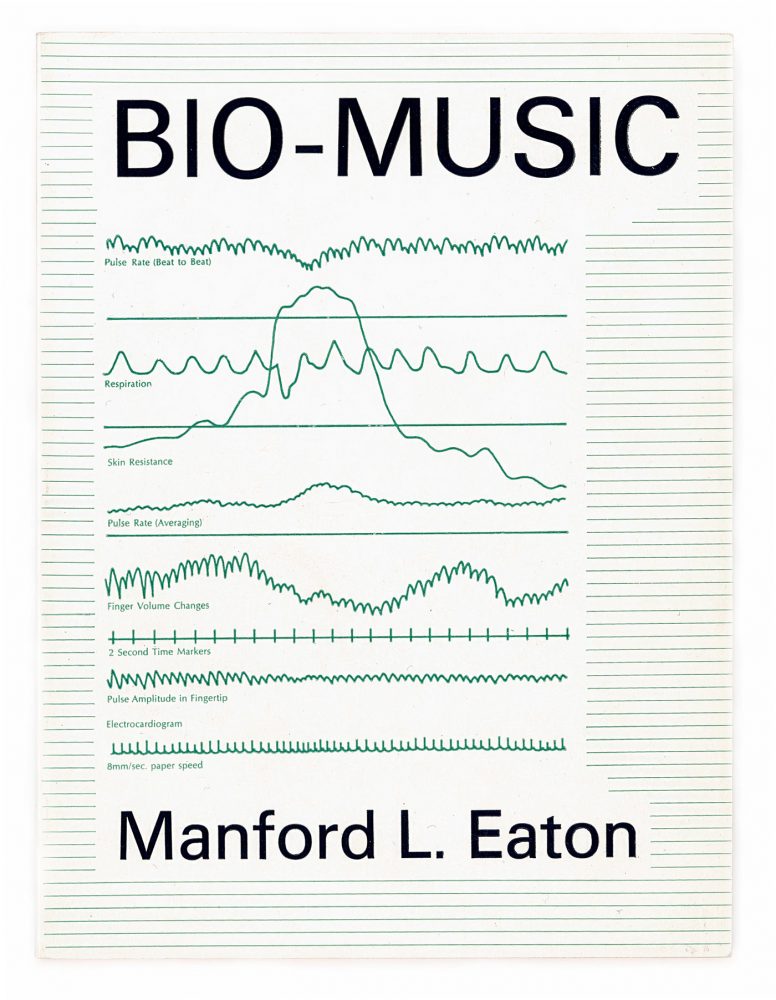
Manford L. Eaton, « Bio-Music » Something Else Press, Barton, 1974.
Bibliothèque Alexandru Balgiu
ÉD Exactement. C’est pour cela qu’on est là. C’est notre fonction d’artiste. On est dans l’art de la transformation. On transforme. On lutte contre la gravité.
À la lumière noire
Chloé Thévenin(La)Horde
Figure de proue de la nuit parisienne et depuis bien longtemps affranchie de cette étiquette, Chloé est à la fois DJ et musicienne. Ses aventures scéniques l’ont amenée à jouer à travers le monde et à de riches collaborations artistiques, qu’il s’agisse de bandes originales pour des films ou de projets avec des plasticiens. Son dernier album, Endless Revisions, confirme la finesse de son style et l’élégance de ses expérimentations. Elle rencontre (La)Horde, collectif à trois têtes — formé par Jonathan Debrouwer, Marine Brutti et Arthur Harel — et aux nombreux corps. Ces derniers sont présents sur scène dans le cadre de spectacles, de films et de performances : autant de déflagrations chorégraphiques rythmées au son du jumpstyle, danse et courant musical popularisé sur internet. Toujours en mouvement, les quatre échangent autour de leur pratique et de leur histoire.
Chloé Depuis combien de temps êtes-vous en résidence à la Gaîté Lyrique ?
Arthur Harel Nous y sommes depuis un an et y restons jusqu’en décembre prochain. On y développe notamment une plateforme web consacrée aux danses post-internet. L’idée est de rassembler les différents contenus que les danseurs autodidactes produisent et publient sur le réseau.
Jonathan Debrouwer On cherche aussi à questionner ces nouvelles formes de représentation, car avec Internet, la danse s’est adaptée à l’écran. Il y a aussi une manière particulière de la filmer. C’est un axe de recherche qui vient compléter notre travail artistique.
AH On souhaite ramener de la nuance. Internet est tellement vaste qu’on perd parfois l’origine des vidéos, c’est tellement partagé qu’on ne sait plus qui a fait quoi, d’où ça vient, qu’est-ce que ça raconte. Plus concrètement, on tente de mettre en place un lieu où différentes communautés avec différentes pratiques artistiques liées au corps pourront se rencontrer.
JD C’est en tombant par hasard sur une première vidéo de jumpstyle que l’on a essayé de comprendre ce qu’était ce mouvement. On a tenté de retrouver la source et c’est comme ça que nous avons initié ce cycle.
Chloé Et les utilisateurs pourront ensuite uploader leur propre contenu sur cette plateforme ?
AH Exactement. On travaille avec un développeur et le collectif de graphistes CCC. Ce projet, c’est vraiment un outil que l’on a souhaité développer en parallèle à notre travail artistique car on ressentait le besoin d’identifier les choses. On ne veut pas s’approprier les choses.
Marine Brutti Il est aussi né du besoin d’avoir une définition que l’on puisse partager. Puisque nous travaillons en collectif, nous cherchons à mettre en place un vocabulaire commun.
AH Chloé, si je ne me trompe pas, tu as fait des soirées qui s’appelaient : « I hate dancing » ? Pour quelqu’un qui fait danser les gens, c’est original !
Chloé Un des morceaux de mon premier maxi, Erosoft, s’appelait ‹ I hate dancing ›. Ma première compilation mixée — à l’époque, en 2004, on faisait encore des compilations mixées, ça ne se fait plus aujourd’hui — portait le même titre. Quand j’ai commencé la musique électronique, c’est parce que j’aimais danser. Il n’y avait que quelques clubs à Paris, j’allais dans les raves… Personne ne cherchait à avoir un style en particulier, les gens venaient de milieux différents. Il y avait une ouverture, une tolérance que l’on ne trouvait pas forcément dans d’autres styles de musique, et que l’on ne retrouve plus forcément aujourd’hui dans le milieu électronique. Mais c’est cette idée-là que j’aimais au départ quand j’allais dans ces soirées. J’en suis venue à mixer car je voulais écouter cette musique dans ma vie, au quotidien.
MB C’est drôle que ce soit la danse qui t’ait amenée à la musique ! Je crois qu’il faut d’ailleurs préciser que nous ne sommes pas danseurs !
Chloé Comment vous définissez-vous alors ?
MB On est metteur en scène et on est chorégraphe : on met en scène de la danse. On aime bien les rapports très fonctionnalistes : que ce soit une danse qui illustre un beat ou un mouvement que l’on va voir émerger dans un geste quotidien.
JD D’ailleurs le DJ a sa propre gestuelle. Comment tu gères le fait qu’on te regarde jouer ta musique ?

Olivier Degorce, Le Queen, Paris, 1997.

Olivier Degorce, After à l’hôpital Saint Louis, Paris, 1992.

Olivier Degorce, Le Queen, Paris, 1995.
Chloé C’est une bonne question, car au départ, le DJ était plutôt dans l’ombre. Je me souviens qu’au début, les DJs n’avaient pas de style à proprement parler.
JD Il y a une démocratisation de la représentation. Maintenant, avec un smartphone, tu te représentes tout le temps.
Chloé Avant de faire de la musique électronique, je faisais un peu de guitare, je jouais avec des quatre pistes, mais je ne me suis jamais vue en chanteuse, je n’ai jamais cherché à me mettre en avant. Ce qui me plaisait, c’était d’essayer des choses, d’expérimenter. Quand j’en suis venue à la musique électronique, j’ai compris que c’était comme un multipiste géant qui me permettait d’intégrer les sons que je venais d’enregistrer. Pour en revenir au côté performatif, le DJing n’est qu’une part de mes activités. J’aime aussi jouer en live la musique que je compose (alors qu’en tant que Dj, tu joues la musique des autres). Mon concert est moins fonctionnel, il n’est pas forcément fait pour danser. Le DJing me permet de m’amuser avec le public. Je le travaille en écoutant des choses nouvelles pour les mélanger avec des morceaux plus anciens, mais je ne le fixe pas, je veux réagir en fonction du public. C’est vraiment du spontané. En ce moment, je tourne beaucoup le live de mon dernier album et je suis amenée à faire des choses un peu différentes. Par exemple, le festival Sonar m’a invité à jouer… à 14 heures ! J’ai donc proposé un « Slow mo live », quelque chose de très lent, de l’ordre de l’hypnose, où les gens peuvent s’allonger. J’aimerais vous demander comment vous avez commencé à travailler ensemble ?
JD On s’est rencontré en 2011 et on a fondé le collectif en 2013. On sortait tous d’études artistiques.
Chloé Le fait que vous alterniez les formats, que ce soit des spectacles, des films, des installations, c’est un choix ?
AH C’est naturel. On a une mémoire commune et plein d’idées. Quand il s’agit de les activer, on discute et on cherche la forme la plus appropriée.
MB Les formats s’enchaînent naturellement. Dans le cas du jumpstyle, on a fait une pièce pour le répertoire de l’école de danse contemporaine de Montréal en 2014 qui s’appelle Avant les gens mouraient. Dans la foulée, on a ensuite fait un film, Novaciéries. Suite à ce projet, on a fait une performance d’une heure qui mélangeait jumpstyle et ballet de machines là où nous avons tourné le film. Ce qui est beau avec ce décor d’usine, c’est qu’il re-situe cette danse dans un contexte post-industriel. C’est un point qui résonne avec le fait que les danseurs de jumpstyle sont souvent issus de classe populaire.
AH Il y a tellement de choses à dire, mais notre envie est de rester dans l’expérimentation. L’idée n’est pas de nous mettre en scène, mais de garder cette liberté de représentation en faisant plusieurs choses. J’imagine que c’est pour cette même raison que tu as fondé ton propre label ?
Chloé Oui, il s’appelle Lumière Noire. C’était initialement une soirée que j’organisais au Rex. Ce nom est à l’image de mes activités : opposées mais complémentaires. D’ailleurs pour l’anniversaire du label, nous allons faire un live avec Vassilena Sarafimova, une joueuse de marimbas avec qui je collabore depuis deux ans, au Centre Pompidou, et ensuite on quittera le musée pour aller en club, au Rex…
JD Tu as aussi travaillé avec Anri Sala, non ?
Chloé Oui, il représentait la France à la Biennale de Venise en 2013. C’était un projet compliqué mais très intéressant. L’exposition s’appelait Ravel Ravel Unravel, un jeu de mots entre le verbe to ravel (« emmêler » en français) et le nom de famille de Maurice Ravel. J’étais amenée à manipuler deux platines. Sur celle de droite, il y avait Concerto pour la main gauche de Ravel. Sur celle de gauche, le même morceau mais retravaillé avec l’aide d’un compositeur qui a décalé plusieurs notes. Anri Sala ne m’a pas demandé de composer mais d’essayer de recaler les deux disques. Il voulait faire une vidéo en plan séquence, donc il a fallu que j’apprenne ces variations, tous ces décalages. Le film capte ma gestuelle, les mouvements que je fais pour essayer de re-synchroniser les deux disques.
MB Est-ce que tu as des envies particulières pour tes visuels lorsque tu composes ?
Chloé Oui, mais ça dépend surtout des rencontres. Des budgets aussi ! En ce moment, sur le live, j’ai une scénographie qui a été réalisée par le collectif Scale. Ils ont imaginé un dispositif de modules sur lequel est réalisé un mapping vidéo. En DJ set, je viens avec mes clés usb, c’est encore autre chose ! Bien sûr j’ai plein d’envies, mais celles-ci sont vraiment bousculées et transformées par les rencontres. Je pense que c’est là que ça peut être créatif et intéressant. Ça fait très longtemps que je joue dans les clubs : parfois c’est compliqué car j’ai passé une semaine en studio à composer, la veille j’ai fait un live, et je dois être prête à jouer à 4 heures du matin. À priori sur le papier ça me fait peur, mais quand j’y suis je suis trop contente. Je me demandais comment vous aviez trouvé vos danseurs ?
JD Pour To da bone, par Internet. On les a contactés via leur chaine youtube. Ils ont un rapport particulier à l’anonymat et n’utilisent que des pseudonymes. Du coup, pour rentrer en contact, il faut user de stratégie : laisser un commentaire, récupérer leur contact Facebook, et réussir à obtenir une session Skype pour leur expliquer le projet.
Chloé Internet permet pas mal de choses. Ça me fait penser à la tecktonik qui a été un phénomène incroyable qui est arrivé aussi vite qu’il est reparti.
JD C’est une danse qui est née au Métropolis, une discothèque de Rungis, au tout début de Youtube. En terme de style, la tecktonik se joue dans les bras, alors que le jumpstyle est dans les jambes et s’est développé de manière très forte sur Internet à partir de 2006/2007.
Chloé Est-ce qu’on peut dire que la tecktonik c’est l’ancêtre du jumpstyle ?
JD C’est vraiment deux styles différents. La tecktonik existe encore mais a changé de nom, car le mot a été déposé comme marque. Les danseurs à l’origine de ce courant ont été obligés de se renommer car ils ne se retrouvaient pas dans l’utilisation marchande. On l’appelle aujourd’hui danse électro.
MB Ce que le grand public a pu percevoir de la tecktonik, c’était vraiment le pire car c’était lié à son exploitation commerciale. Les danseurs à l’origine de ce courant sont des virtuoses, c’est très beau. Ça n’a rien à voir avec un style vestimentaire… Le jump est vraiment né dans les clubs, entre la Belgique et la Hollande, à la fin des années 90.
Chloé Et le gabber ?
JD On le situe à la fin dans années 80, en Hollande.
MB Mais jump et gabber sont proches, ce sont des cousins. Le gabber c’est un style de musique, sa danse s’appelle hakken.
JD Techniquement, le gabber est plus rapide, on est sur du 190 à 210 BPM, le haken se danse entre 10 et 15 secondes. Le jumpstyle appartient au hardstyle. C’est une musique qui a un BPM de 140 à 160, les sessions de danse font entre 20 et 35 secondes maximum.
AH Le gabber a flirté avec un esthétisme extrême… On ne peut pas nier qu’il y a eu une grande bataille entre la communauté de ravers qui dansait sur du hakken et certaines personnes qui ont essayé de rentrer dans ce groupe avec des intentions politiques. Le jumpstyle est pratiqué par des danseurs beaucoup plus jeunes « soit-disant » apolitiques.
MB On précise ce « soit-disant » car être apolitique aujourd’hui n’est pas anodin. Ça dénonce pas mal de choses. En tout cas, ces danseurs n’ont pas de couleur politique.
JD Et c’est vraiment une communauté qui s’est créée via Internet. Le hardstyle est apparu dans les clubs, mais ces derniers ont fermé petit à petit et les danseurs se sont réfugiés sur le net. C’est comme ça qu’il y a eu un effet de propagation. Désormais tous les danseurs sont isolés, il n’y a pas de club avec des soirées spécifiques où ils vont tous pouvoir se rejoindre. Ils organisent un événement une fois par an dans une capitale européenne, le plus souvent Berlin. Aujourd’hui donc, ils apprennent le jumpstyle sur Internet. Tout arrive par l’écran. Ils commencent très jeune, dans leur chambre. Ils se filment car il n’y a pas de professeur, ils sont obligés de voir leurs vidéos pour comprendre leurs erreurs. Comme ils ne sont pas spécialistes, ils re-postent pour avoir des retours de danseurs expérimentés, à savoir les auteurs des vidéos à partir desquelles ils ont appris.
MB C’est quelque chose qui nous a beaucoup intéressé : ils n’ont pas posté ces vidéos pour la posture, ils l’ont fait parce qu’ils avaient besoin d’un miroir et qu’ils n’avaient personne qui les regardait. Après ça a créé une cooptation que l’on remet aussi en question : pourquoi est-ce majoritairement des garçons, principalement blancs et hétérosexuels ?
AH Est-ce que les outils ont aussi évolué pour toi ?
Chloé Oui, c’est vrai que l’accessibilité est très différente. Avant, faire un morceau de musique électronique, c’était très compliqué. J’ai commencé avec un Atari. À ce moment-là il n’y avait pas d’ordinateur ultra-puissant, il a fallu que j’achète des samplers, des synthétiseurs… Tout était très cher. Et ensuite, il fallait comprendre le fonctionnement de tous ces appareils. Il n’y avait pas de tutoriels avec des personnes sympas qui prennent une heure pour t’expliquer comment utiliser tout ça ! Quand j’étais plus jeune, tout le monde voulait faire partie d’un groupe de rock. Aujourd’hui, tous les jeunes qui veulent faire de la musique souhaitent avoir des platines chez eux. Ils peuvent faire plus facilement des compositions : quand tu achètes un ordinateur portable Mac, tu as le logiciel Garage Band qui est intégré dans le système. J’ai toutefois une réserve car j’ai l’impression que la qualité, ou plutôt l’exigence, n’est plus la même. Prenons l’exemple du mastering : c’est un vrai métier que d’être ingénieur du son. De nos jours, tu as des logiciels qui te permettent de faire toi-même ton master. La chaîne de production se réduit beaucoup et je sens vraiment la différence. En l’occurrence, je l’entends car j’ai aiguisé mon oreille et entends ses nuances. De la même façon qu’auparavant pour écouter de la musique, les gens investissaient dans des chaines hi-fi… Désormais, on achète un bon casque car on écoute des morceaux compressés en basse définition à partir de son téléphone. C’est marrant car j’ai investi pour la première fois de ma vie dans des bonnes enceintes pour écouter la musique chez moi, et c’est génial. Je ne peux que vous le recommander !
MD On va y penser !

Olivier Degorce, Lady B (FR), Rex Club, Paris, 1994.

Olivier Degorce, Rave à l’Aqualand de Gif-sur-Yvette, 1992.

Olivier Degorce, Jérôme Viger-Kohler et Gwenola Froment, American Center, Paris, 1995.
Photographies extraites du livre Plastic Dreams, publié par Headbanger Publishing.
L'impossible, nous ne l’atteignons pas, il nous sert de lanterne
Xavier VeilhanGrand Blanc
Entre deux projets d’exposition, parmi lesquels le Pavillon Français pour la prochaine Biennale d’art contemporain de Venise, Xavier Veilhan a rencontré Grand Blanc. Le quatuor, dont le premier album Mémoires vives a séduit par son énergie et ses reflets cold wave, s’est épanoui à travers les expérimentations d’un home studio. Un goût prononcé pour la recherche sonore et ses labyrinthes infinis qui résonne comme une évidence avec la pratique de Veilhan, grand amateur de musique et fin observateur de cette industrie depuis de nombreuses années.
Xavier Je crois que le premier titre que j’ai entendu de vous, c’était Samedi la nuit, en 2014.
Benoit Exactement, ça fait deux ans.
Xavier Vous avez eu d’autres expériences musicales avant Grand Blanc?
Camille Non, c’est notre premier groupe.
Vincent J’ai joué dans des groupes de reggae à Mantes-La-Jolie mais rien de mémorable !
Camille Hormis Vincent qui est originaire de Mantes-La-Jolie, on vient tous de Metz. On connaît bien Le Carrosse, ta sculpture qui se trouve sur la place de la République.
Xavier C’est une pièce qui provient de l’exposition que j’ai faite il y a quelques années au Château de Versailles. Jean-Jacques Aillagon qui a initié le projet est devenu par la suite le président de l’association des amis du Centre Pompidou-Metz, donc c’était un peu une manière de l’accompagner…
Vous avez un univers visuel, à travers vos pochettes, vos clips, qui est assez fort. C’est quelque chose qui vous intéresse ou vous vous laissez guider par votre maison de disque ?
Benoit Non non, ça nous intéresse beaucoup mais c’est peut-être l’endroit où l’on se retrouve le moins, c’est le domaine le plus difficile lors de nos discussions. Pour tout dire, c’est assez bordélique. C’est étrange car nous avons souvent des retours positifs sur la représentation visuelle de notre musique et sur sa cohérence, alors que c’est assez improbable pour nous.
Camille Penser les images, ça ne nous est pas naturel, là où faire de la musique l’est. On aime l’art en général, et nous faisons tous les efforts du monde pour nous mettre d’accord. On s’est longtemps demandé ce qu’on allait mettre sur la pochette de Mémoires vives.
Xavier Qui a fait le visuel?
Camille C’est un jeune artiste qui s’appelle Max Vatblé.
Benoit On a beaucoup de mal à penser les visuels avant la musique.
De manière générale — et ce sont des mots un peu larges — nous n’avons pas une idée très responsable de la création. C’est très anarchique entre nous. Les morceaux apparaissent quand il y a une possibilité entre nos quatre sensibilités.
Tous les espaces où la musique se révèle une fois terminée, que ce soit à travers les pochettes ou les retours du public, ce sont des endroits que nous avons complètement investis pour comprendre ce que nous faisions. Car on le comprend pas trop au moment où on le fait.
Camille Mais on espère que ça changera. On rêverait de savoir un peu où l’on va. C’est super intéressant de mettre en place un processus pour tester une série de choses et de voir comment cela se développe, au lieu de faire et de comprendre ensuite.
Xavier Dans mon travail, j’établis souvent des règles très strictes, des protocoles. Et je ne les suis pas du tout. Ces principes installent une certaine pression, et dès lors que je ressens qu’ils entravent quelque chose qui me semble plus important, il suffit de m’en défaire.
Camille Mais ça n’est pas pour autant que tu arrêtes de te fixer ces règles.
Xavier Il y a quelque chose qui se passe et qui s’accumule au fur et à mesure : ce que tu as fait précédemment créé une ligne avec ce que tu vas faire, et cela compose déjà quelque chose, que tu le veuilles ou non. Moi cela fait vingt-cinq ans que je fais des expositions, et je cherche toujours à échapper à une sorte d’image qui est la dernière chose que les gens ont vue de moi.
Vincent C’est vrai que c’est un peu ce que l’on a essayé de faire avec Mémoires vives. À la sortiede notre EP, nous avons eu des retours très forts qui nous catégorisaient dans certains styles de musique. L’album a été une tentative de sortir de ce cadre.
Xavier Il y a beaucoup de choses dans votre album, tant en quantité que stylistiquement. Il m’évoque des sons de new wave que j’écoutais à l’époque où cette musique-là se faisait, sans que je puisse dire pourquoi. Il n’y a rien de vraiment précis, mais je pense notamment au rapport à l’image, et plus particulièrement au travail de Peter Saville pour New Order, qui a créé des images très raffinées pour accompagner une musique assez brute et lyrique.
Benoit À nos débuts, nous faisions du folk avec des influences world, comme on en faisait beaucoup il y a cinq ou six ans. Mais on ne s’y retrouvait pas trop. On a découvert DAF, Joy Division, les synthétiseurs au même moment. Et surtout, on a découvert ce qu’était un home studio, et à quel point il était facile de produire de la musique aujourd’hui. Vincent et Luc étaient en école d’ingénieur du son. Nous avions toujours fait et joué de la musique acoustique, une musique contrainte par sa propre durée et par le geste. Quand on a compris qu’un son pouvait valoir par sa texture, et pas uniquement par sa place dans un arrangement, on s’est énormément ouverts. On a fait notre crise d’adolescence à retardement ! Cela explique un peu l’anarchie que l’on retrouve dans ce disque. Et plein de choses ont fait sens : on s’est retournés vers ces groupes pour plein de raisons. Dans leurs chansons, il y a une culture de l’ennui et un rapport à la politique complètement désenchanté qui ne nous est pas étranger. Il ne faut pas oublier qu’on vient de Lorraine, et que nos grands-parents nous parlent du bruit des bombes et de comment ils ont perdu leur maison. En plus de cela, nous voulions chanter en français, et la new wave dans les années 80 était une langue vernaculaire : il n’y avait pas que l’anglais, on chantait en allemand, en grec… Mais c’est marrant car nous n’avons jamais souhaité faire un revival.
Xavier Ce qui me frappe, c’est la magie qui se met en place lorsque tu trouves la bonne combinaison entre les gens. C’est quelque chose qu’on a moins dans l’art puisqu’on est plus isolé, même si moi je travaille avec une équipe. Nous sommes une dizaine à l’atelier. C’est très important pour moi, même si ça n’apparaît pas beaucoup dans l’œuvre une fois qu’elle est dévoilée.
Camille J’ai du mal à imaginer comment se passe le travail à l’atelier. Que font les gens qui travaillent avec toi ?
Xavier Certains s’occupent de l’organisation, de l’administration, de la gestion. C’est très important car c’est ça qui fait que tu peux emmener créativement les projets là où tu le souhaites, sans te soucier des trois prochains mois. La gestion du temps est aussi primordiale que celle de l’argent. D’autres s’occupent de la production des œuvres : il y a des choses que l’on fabrique nous-même et d’autres pour lesquelles on fait appel à des spécialistes. Par exemple hier, nous avions la visite d’une personne avec qui on travaille spécifiquement le carbone, et qui est basée dans le bassin d’Arcachon. Il y a aussi quelques stagiaires, qui font de la recherche de documents, de matériaux. Ce matin, j’ai travaillé avec Alexis Bertrand, un scénographe avec qui je collabore depuis une dizaine d’années, avec qui je développe la maquette du Pavillon Français pour la Biennale de Venise.
Benoit Tu travailles avec une idée du lieu en général ?
Xavier Oui, c’est très important pour moi. J’ai beaucoup de mal à penser à une exposition si je ne peux pas m’imaginer les gens qui arriveront dans l’exposition. Souvent on imagine que l’artiste va créer quelque chose à partir de rien, sans se projeter sur le moment de la vision, alors que moi, c’est plutôt le contraire, ce n’est que le moment de la vision des visiteurs qui m’intéresse. Les objets que je fais sont comme des capteurs ou des émetteurs. Dans ma génération d’artistes, ceux qui ont commencé à faire des expositions au début des années 90, il y a eu ce qu’on a appelé l’esthétique relationnelle. Le critique Nicolas Bourriaud a développé cette idée selon laquelle — dit de manière très expéditive — l’exposition produit un objet en elle-même par sa durée, son contexte, les liens qu’elle met en place. Je m’intéresse beaucoup à cette vision de l’art lié à son contexte : comment encastrer des objets artistiques — qui sont de l’ordre de la fiction, du récit, de l’imaginaire — dans la réalité pour qu’ils prennent part au réel.
Camille Dans cette optique, il serait intéressant d’envisager un concert comme une exposition.
Benoit En un certain sens, je pense que c’est déjà le cas pour les concerts, vu que c’est une forme très basique de mise en scène. Mais elle est assez décevante en soi.
Xavier C’est marrant, je suis d’accord avec ce que tu dis mais en même temps, je prends comme exemple ces moments-là. Plus précisément ce qui se passe sur le dance floor. J’ai commencé à écouter de la musique avec le punk. Je suis passé ensuite par le hip-hop qui était en train d’apparaître. C’est toujours des trucs que j’écoute aujourd’hui. Et après ça, j’ai eu une sorte de révélation avec la musique électronique car c’est la première fois que je retrouvais de manière quasi-certaine un moment que j’avais vu quelquefois apparaître dans certains concerts punks ou hip-hop. Ce moment correspond au tapis volant du dance floor : quand tu sens que tout le monde est là, dans le même état. C’est ce que je vous envie du concert. Cette expérience cadrée temporellement et dans l’espace, tu ne l’as jamais en tant que plasticien.
Camille Tu n’as jamais eu d’expérience de collaboration sur scène ?
Les objets que je fais sont comme des capteurs ou des émetteurs. Dans ma génération d’artistes, ceux qui ont commencé à faire des expositions au début des années 90, il y a eu ce qu’on a appelé l’esthétique relationnelle. Le critique Nicolas Bourriaud a développé cette idée selon laquelle — dit de manière très expéditive — l’exposition produit un objet en elle-même par sa durée, son contexte, les liens qu’elle met en place. Je m’intéresse beaucoup à cette vision de l’art lié à son contexte : comment encastrer des objets artistiques — qui sont de l’ordre de la fiction, du récit, de l’imaginaire — dans la réalité pour qu’ils prennent part au réel.
Camille Dans cette optique, il serait intéressant d’envisager un concert comme une exposition.
Benoit En un certain sens, je pense que c’est déjà le cas pour les concerts, vu que c’est une forme très basique de mise en scène. Mais elle est assez décevante en soi.
Xavier C’est marrant, je suis d’accord avec ce que tu dis mais en même temps, je prends comme exemple ces moments-là. Plus précisément ce qui se passe sur le dance floor. J’ai commencé à écouter de la musique avec le punk. Je suis passé ensuite par le hip-hop qui était en train d’apparaître. C’est toujours des trucs que j’écoute aujourd’hui. Et après ça, j’ai eu une sorte de révélation avec la musique électronique car c’est la première fois que je retrouvais de manière quasi-certaine un moment que j’avais vu quelquefois apparaître dans certains concerts punks ou hip-hop. Ce moment correspond au tapis volant du dance floor : quand tu sens que tout le monde est là, dans le même état. C’est ce que je vous envie du concert. Cette expérience cadrée temporellement et dans l’espace, tu ne l’as jamais en tant que plasticien.
Camille Tu n’as jamais eu d’expérience de collaboration sur scène ?
Xavier Si. J’ai développé plein de choses où j’ai essayé de mettre en présence son et image. Mais ça n’est pas quelque chose de nouveau, cela date de la tragédie grecque. Il y a eu plein de tentatives de fusion de ce genre, comme ce qu’a pu faire l’école du Bauhaus, ou même Pink Floyd à Pompéi… J’ai notamment fait un projet avec Air au Centre Pompidou, qui s’appelait Aérolithe. C’était très méditatif, avec des acrobates, une femme japonaise au koto, et Air qui jouait des mélodieshyper répétitives.
Vincent Si j’ai bien compris ce que j’ai lu dans la presse à propos de ton projet pour la Biennale de Venise, tu vas transformer le pavillon en studio son avec des instruments de musique que tu es en train de créer. Les visiteurs seront amenés à les manipuler ?
Xavier Non pas vraiment. Le public sera un peu comme les visiteurs inopportuns d’un studio. C’est plutôt axé sur le travail de la musique, ça ne sera pas un concert. Ce qui est très particulier à Venise, c’est que les professionnels viennent cinq jours pour l’ouverture de la Biennale alors que l’événement dure six mois.

Live at Pompeii, Pink Floyd, 1971.
Je vais déménager à Venise, et chaque jour des 173 que compte la manifestation, il y aura un événement musical : une chorale folklorique locale, de la musique baroque, de la musique expérimentale, ou tout autre chose. Nous y travaillons actuellement avec Christian Marclay, qui est le commissaire de l’exposition. Christian est un artiste dont l’une des particularités du travail est qu’il est axé autour du son et de la musique. Une de ces dernières œuvres, très connues, s’appelle The Clock. C’est une compilation de scènes de films où apparaissent des horloges et des pendules. Le film dure 24 heures et les 24 heures sont représentées à l’écran. C’est une œuvre fascinante, au-delà de la description que l’on peut en faire, car elle estcomplètement saisiepar le temps de la fiction, qui est le même que celui de la réalité. Il synchronise la réalité avec l’œuvre.
Camille Qui jouera ?
Xavier Il y a des gens connus, comme Quincy Jones, Christophe Chassol, Sébastien Tellier, Alexandre Desplat, et d’autres qui le sont moins, ou pas du tout.
Benoit Et cela est censé aboutir à un enregistrement ?
Xavier Oui mais l’invitation est très ouverte. Nous sommes en train de formuler ça, c’est un peu compliqué. Nigel Godrich, le producteur de Radiohead, va avoir une semaine de programmation où il pourra inviter d’autres musiciens. Tous pourront enregistrer, le studio sera opérationnel techniquement, ils repartiront avec leur disque dur de musique, mais ni nous, ni la Biennale n’avons un droit de regard sur ce qui est produit. L’idée est plutôt de mettre en place une sorte d’école d’ingénieur du son. Et en dehors de cette « école », si les relations se créent, il se passera peut-être autre chose ! Le projet s’appelle Merzbau musical. Le Merzbau c’est une œuvre de Kurt Schwitters, très importante dans l’histoire de l’art : il a commencé à traiter son appartement en sculpture, jusqu’à l’envahir. C’est un peu la première installation d’art contemporain.
Camille Est-ce que tu es aidé d’un acousticien dans la conception de cet espace ?
Xavier J’ai parlé avec plein de personnes et j’ai décidé de ne pas faire appel à un acousticien. Il y a de nombreuses écoles en matière d’acoustique. Par exemple, Nigel Godrich te dira qu’un studio c’est plusieurs endroits de nature différente qu’il aménagera en mettant des tapis, en ouvrant une fenêtre, en y amenant du bois, qu’il exploitera en fonction de ce qu’il recherche. De mon côté, mon ambition n’est pas de faire le studio ultime.
Je voulais savoir qui écrivait les paroles de Grand Blanc ? C’est un travail à huit mains ?
Benoit À deux mains, un cerveau et tous les gens qui sont dans ma tête ! C’est moi qui écrit, même si évidemment on en parle entre nous. Avant de faire ce groupe, j’écrivais d’une manière assez désastreuse et classique, je sortais d’une prépa littéraire. Quand j’ai commencé à écrire pour quatre personnes, j’ai découvert une certaine propriété de l’écriture, qui est qu’elle peut être partageable par des moyens que je ne connaissais pas trop et qui ne sont pas l’identification.

Allgemeines Merz Programm, Kurt.
J’ai commencé à procéder par des textes hyper morcelés, très symboliques, basés sur le surgissement d’images. Je me suis mis à écrire de cette manière pour faire de la place aux autres. Ça se résume aussi à des petites punchlines, parce qu’on a tous écouté du rap ! Ma manière d’écrire a beaucoup évolué avec la réalisation de l’album, car je l’ai abordé en même temps que la production musicale, histoire de laisser le moins de place possible au texte. On a vraiment essayé d’avoir une écriture faite pour se fondre dans la musique. Dans les interviews que l’on a pu faire avec la presse musicale, on a du se battre énormément pour rappeler que c’est une aberration de parler de texte pour une chanson. Une chanson, c’est un art vivant.
Xavier Quelles sont tes références en matière d’écriture ?
Benoit En chanson, on écoute beaucoup de musique anglo-saxonne où les voix sont un peu sous-mixées. En littérature, je m’inspire de René Char mais aussi de Robert Desnos, qui n’est pas un poète majeur mais que j’apprécie beaucoup, notamment pour ses premiers travaux avec les surréalistes jusqu’à ses premiers poèmes d’amour lyrique. La transformation stylistique de son écriture est très intéressante.
Xavier Et dans les groupes de votre génération ?
Camille On aime beaucoup Flavien Berger. Il écrit de manière très poétique, parfois c’est alambiqué, parfois c’est simple. L’écart entre les deux donne quelque chose de très beau. Il utilise aussi souvent les mots pour leur sonorité. Il a un titre qui s’appelle Liquide où il joue avec le mot en le chantant pour lui donner cet état aqueux.
Xavier Je trouve qu’il se passe plein de choses intéressantes en musique aujourd’hui. Il y a des genres qui ont annexé la mélancolie, comme le hip-hop. Tout le monde l’a dit par exemple à propos de PNL, mais moi je le ressens beaucoup plus avec la scène d’Atlanta, avec des rappeurs comme Young Thug. On est face à une vision dépressive mais très belle. J’aime aussi beaucoup l’album de Gucci Mane, produit par Mike Will. C’est ultra minimaliste. Et sinon, le cinéma, c’est quelque chose qui vous inspire pour créer votre musique ?
Benoit Camille et Vincent sont certainement les plus cinéphiles. Pour la réalisation de l’album, on s’est fait voir des films pour mettre en place une espèce de décor. Le film de l’album, c’est Escape from New York de John Carpenter. La maquette de Surprise Party s’est appelée Carpenter pendant très longtemps.
Camille Un autre film très important, c’est This is Spinal Tap ! Mais je crois que c’est un film commun à tous les groupes de rock’n’roll.
Xavier J’adore ce film ! C’est marrant parce qu’il n’y a rien sur le monde de l’art contemporain dans ce registre de la comédie parodie, alors qu’il y aurait vraiment de quoi faire !
Pas de deux
WoodkidSidi Larbi Cherkaoui
Si Woodkid, son avatar musical, a vampirisé son emploi, Yoann Lemoine est avant tout réalisateur. On doit au français une quinzaine de clips, parmi lesquels certains succès de Lana Del Rey, Taylor Swift, Moby ou encore Drake. Il est également passé derrière la caméra pour mettre en image les quatre titres tirés de son album « The Golden Age ». Sidi Larbi Cherkaoui est tout aussi prolifique. Depuis le début des années 2000, le chorégraphe belge a signé plus d’une vingtaine de spectacles, seul ou en collaboration. Récemment nommé directeur artistique du Ballet Royal de Flandres, il est également à la tête de sa propre compagnie, Eastman, dont les productions se jouent aux quatre coins du globe. Les deux hommes se rencontrent pour la première fois et échangent autour des nombreuses relations qui unissent l’image, le son et le mouvement.
Yoann Lemoine Je crois savoir que tu vis à Anvers. Que fais-tu actuellement à Paris ?
Sidi Larbi Cherkaoui Je travaille sur une nouvelle adaptation de Casse Noisette, d’après une mise en scène du Russe Dmitri Tcherniakov. Nous sommes trois chorégraphes sur le projet, chacun d’entre nous travaille sur une partie différente. C’est une version très sombre, qui s’inspire de la vague de grand froid qui a touché la Russie dans les années 40. Le spectacle aura lieu en mars à l’Opéra Garnier. Pour moi, c’est très agréable de travailler avec Dmitri. Habituellement, en tant que chorégraphe, je dois penser à tout à ce qui entoure la danse. Ici, je me concentre uniquement sur le mouvement.
YL Casse Noisette fait partie du répertoire classique. En tant que chorégraphe contemporain, comment tu situes ton intervention ? Classique ou contemporaine ?
SDL C’est difficile à dire. Je crois que cela dépend du danseur qui interprète le mouvement. J’ai l’impression d’avoir plus de responsabilité face à des danseurs de formation classique, car ceux-ci vont reproduire parfaitement chaque nuance de gestes ou de rythmes, là où les danseurs contemporains injectent des éléments très personnels. Lorsque je fais un mouvement avec l’intention d’être classique, je n’y arrive pas, ça devient contemporain… C’est un sujet qui n’est pas simple. Me demander la différence entre classique et contemporain, c’est me demander les différences entre aujourd’hui et hier. Qu’est-ce qui a vraiment changé finalement ?
YL Est-ce que la définition d’un grand danseur a changé ?
SDL Oui, je pense que c’est beaucoup plus démocratique en ce moment. On prend conscience que des danseurs peuvent être géniaux sans pour autant venir du classique.
Je ne veux pas que la chorégraphie ait besoin de la musique, car la musique n’a pas besoin de la chorégraphie.
YL J’ai travaillé il y a 2 ans avec le New York City Ballet, sur Les Bosquets, un ballet de JR où je faisais la musique. Il a amené Lil Buck sur le projet, un danseur qui vient du hip-hop.
SDL Oui j’ai vu ça, il est incroyable ! On a l’impression qu’il sait tout faire ! Un peu comme toi d’ailleurs, entre les clips, la musique, la scène ! Moi ce que j’aime beaucoup dans ton travail de réalisateur, et notamment sur les clips de ton album, c’est qu’il y a une continuité qui s’installe. On attend la prochaine vidéo pour connaître le développement de l’histoire.
YL L’idée derrière ça était de comprendre pourquoi on fait un album aujourd’hui. Pourquoi on met douze chansons dans un ensemble, et pourquoi elles deviennent indissociables les unes des autres ? On vit dans un monde où tout est morcelé, on accède à la musique en streaming, on peut télécharger les titres un par un. Je voulais voir si celafaisait encore sens de penser un disque comme un projet global, s’il pouvait trouver sa place,son identité. En ce qui concerne la continuité entre les quatre clips de l’album, c’est aussi quelque chose qui s’est construit sur le moment, encouragé par les réactions positives. J’espère pouvoir aller plus loin dans cette direction pour la suite de mes projets musicaux.D’ailleurs, si on regarde quels sont les artistes qui fonctionnent aujourd’hui, ils ont tous une conception visuelle très forte. Ca ne suffit plus d’être juste musicien. Et toi, as-tu déjà réalisé des chorégraphies pour des clips ?
SDL Oui, pour Sigur Ròs, sur le titre « Waltari ». C’était une très bonne expérience, car je n’avais aucune contrainte, j’avais vraiment carte blanche. Le clip fait une dizaine de minutes, ça nous a laissé l’espace, le temps, de créer une rencontre. Je ne sais pas comment tu fais pour mettre en place quelque chose, pour créer une tension, en quatre ou cinq minutes. En danse, on prend généralement deux heures pour créer tout cet univers, cette dramaturgie du spectacle.
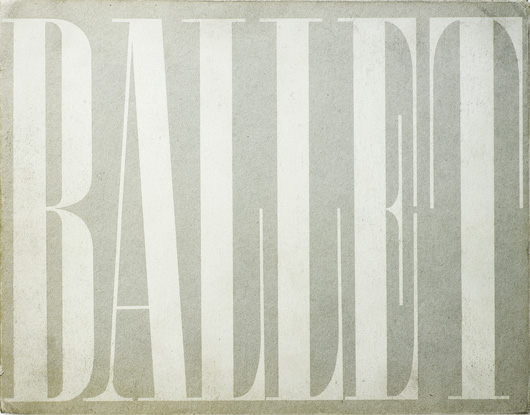
Alexey Brodovitch, Ballet,
New York, 1945.
YL Ce qui est certain, c’est que le format traditionnel du clip est de moins en moins pertinent. Il y en a tellement qui sortent, presque quatre à cinq par jours… Le seul moyen de se détacher est de faire des formats différents, un peu plus longs, ou qui sortent un peu de la chanson.
SDL Comment procèdes-tu quand tu reçois un morceau que tu dois clipper ? Qu’est-ce qui vient en premier à ton esprit ?
YL Ca dépend du titre. Il y a toujours les premières idées, que je développe toujours pour mieux les évacuer, car en général, elles sont assez toxiques.
SDL Elles sont trop premier degré ?
YL Oui, ou parfois, elles sont simplement un peu trop inspirées par quelque chose que j’ai vu récemment, sans m’en rendre compte. Le cerveau à ce sujet marche d’une manière particulière. Aussi entraîné et conscient que l’on soit, on passe obligatoirement par ce phénomène de réappropriation. Je laisse le cerveau faire, parce qu’il faut qu’il le fasse, et une fois cette étape passée, les secondes idées arrivent et sont souvent plus convaincantes.Elles sont plus critiques, moins instinctives. C’est l’inverse de se mettre à danser de manière spontanée sur de la musique.
SDL Le contexte dans lequel les choses se font est déterminant. Il y a des moments où l’on peut être très intuitif, sur l’immédiateté, et d’autres où l’on est dans la continuité d’un développement personnel. Pour Casse-Noisette, j’ai préparé des éléments chorégraphiques spécifiques mais il y a également de la matière sur laquelle j’avais déjà travaillé, sous uneautre forme. En y changeant certains aspects, on ne la reconnaît plus. Mais cette base est là, dans ma tête, très structurée. Elle vient de mon expérience, de mon vécu.
YL Est-ce que ça n’est pas ce que l’on définit comme la signature ou l’identité d’un artiste ?
SDL Je ne sais pas. Je ne me pose pas cette question d’ailleurs. Cette « identité » est quelque chose qui est perçu de l’extérieur par un regard critique. Moi, je ne vois que des points qui se connectent. Si mon travail a une identité, alors elle se trouve dans ces points que je relie,dans les rapports que je crée, entre les mouvements, les danseurs ou encore les gens avec qui je collabore. Ou dans les rapports entre les gestes et la musique. Souvent en danse, on essaie de créer le mouvement indépendamment de la musique, pour qu’il ait sa propre valeur. Par contre, quand la chorégraphie se cale au bon moment sur la musique, les deuxpeuvent chanter ensemble. L’exemple parfait pour illustrer ça, c’est Marvin Gaye. Quand tu enlèves les instruments de ses morceaux et qu’il ne reste que la voix, ça reste magnifique. Je cherche ça ! Je ne veux pas que la chorégraphie ait besoin de la musique, car la musique n’a pas besoin de la chorégraphie. Je travaille à un dialogue, je cherche à créer du beau à travers cette rencontre.
J’en suis toujours à déconstruire les codes de la beauté classique. Je ne suis pas encore arrivé à me débarrasser de ça.
YL Cette question du beau est très importante pour moi, c’est un peu mon démon. C’est une notion très subjective, qui peut changer d’une culture à l’autre. Je n’arrive pas à me soumettre à cette tendance très actuelle du punk moderne. J’en suis toujours à déconstruire les codes de la beauté classique. Je ne suis pas encore arrivé à me débarrasser de ça.
SDL Je ne sais pas s’il faut vraiment s’en débarrasser, c’est avant tout une question de valeurs. Il faut pouvoir se reconnaitre dans ce que l’on fait.
YL Exactement, il faut avoir conscience de ce que l’on fait et de ce que l’on est.
SDL Et c’est là où cela peut parfois devenir une sorte d’obsession.
YL L’obsession, le lâcher prise, ce sont des états sur lesquelles je travaille en ce moment. J’essaie d’apprécier l’expérience, d’appréhender différemment le processus.
SDL Je peux comprendre ça. Le clip, l’album, tu ne peux plus y toucher une fois qu’ils sont diffusés. Alors qu’avec le spectacle vivant, il y a toujours la possibilité de revenir, ça n’est jamais vraiment fini à la première. J’ai un peu plus d’espace que toi, dans la mesure où un spectacle n’existe que lorsqu’il est joué. Il n’existe pas dans l’absolu.
YL Dans la musique ou la réalisation, il y a une phase de préparation qui va crescendo avec la date butoir. Une fois celle-ci passée, l’objet ne m’appartient plus. Quand je donne un concert, les choses sont un peu différentes, même si les jeux de lumière ou les projectionsvidéos sont également programmés. Et puis, contrairement à un danseur, j’ai d’énormes problèmes avec ma présence scénique. Évidemment, il y a des moments de grâce où l’émotion, le public, l’ampleur de tout ça t’emmène. C’est magnifique de les vivre, mais c’est insoutenable de les revoir en vidéo.
SDL Je peux totalement comprendre. Je ne regarde pas les vidéos dans lesquelles je danse. Le rapport avec soi est souvent difficile. C’est d’ailleurs pour ça que j’aime être chorégraphe, parce que je suis dans le rapport aux autres. Les imperfections des autres nous touchent beaucoup plus que les nôtres.
YL Comment as-tu commencé à danser?
SDL J’ai appris en regardant la télévision : les épisodes de Fame, ou encore les clips de Janet Jackson, période Rythm Nation. Je connais tous les mouvements de ces chorégraphies-là. C’était mon classique à moi, ces mouvements saccadés, à l’unisson, sur cette musique funk.
YL Si Janet t’appelait demain pour te demander de chorégraphie son nouveau clip, le ferais-tu ?
SDL Ca dépend de ce qu’elle et son équipe cherchent. Parfois, les gens font appel à toi mais attendent une chose très précise, ils souhaitent que tu reproduises quelque chose que tu asdéjà fait. Donc ça n’est pas si évident. Et puis, en toute honnêteté, je crois que je suis moins attiré par les artistes pop. Je crois que j’ai un peu décroché à un moment, peut-être avec l’arrivée du digital. Le son est devenu plus froid…
YL Le digital a surtout altéré notre rapport à la vitesse. Un artiste peut parfois sortir deux albums par an. On a plus vraiment le temps de se concentrer. Pour en revenir aux questions de réalisation, est-ce frustrant pour toi de travailler sur une chorégraphie qui va être redécoupée par le cadrage et le montage ?
SDL C’est très frustrant. Je dis toujours en rigolant qu’il faudrait faire une version choreographer’s cut d’Anna Karénine. Je crois que même Joe Wright, le réalisateur, aurait aimé monter son film différemment. Ce qui est problématique avec l’industrie du cinéma, c’est que l’on fait quelque chose qui est toujours repris par quelqu’un d’autre. Je crois que c’est pour cela que j’ai autant aimé l’expérience avec Sigur Ros. Christian Larson, le réalisateur du clip, comprend le mouvement et le rythme. Pour ce travail, j’avais filmé la chorégraphie avec mon iphone, pour lui montrer comment j’imaginais le résultat. Les mouvements de la caméra sont aussi importants que ceux des danseurs.

Fame, casting de la saison 3, 1983–84.
YL Dès que la caméra se met à bouger, elle existe, elle devient un personnage. Et lorsqu’elle ne bouge pas, elle est malgré tout présente, elle est le spectateur dans son siège. D’ailleurs, je suis très curieux de voir ce qu’il va se passer ses prochaines années avec la réalité virtuelle. Les nouveaux casques offrent déjà des expériences curieuses. Mais que va-t-il se passer quand le virtuel proposé sera plus attrayant que le monde dans lequel on vit ? Je crois que l’éducation doit occuper une place importante dans ce débat. Il est important que certaines personnes guident et apprennent aux plus jeunes à voir la beauté dans l’imperfection. C’est en cela que j’espère que la pop puisse apporter d’autres modèles. À ce sujet, qu’as-tu pensé du succès du clip de « Chandelier » de Sia ?
SDL J’ai bien aimé cette proposition, même si ça n’est pas ma chorégraphie préférée. J’aime beaucoup la voix de Sia, et Maddie Ziegler, la petite danseuse présente dans ce clip, est très bien. Mais j’ai personnellement préféré le morceau suivant qui mettait en scène Shia Labeouf et Maddie dans une cage, pour le titre « Elastic Heart». Le fait dans mettre en scène un homme et une enfant est beaucoup plus risqué, le résultat était plus touchant.
YL C’est intéressant de voir qu’un titre comme celui-ci touche des masses, et devient numéro un dans le top. Je pense que c’est là qu’il peut y avoir un rôle à jouer. Récemment, j’ai beaucoup aimé Inside out, la dernière production des studios Pixar, car il racontequelque chose que l’on dit rarement aux enfants, à savoir l’importance d’être triste. Cela peut sembler assez mièvre, mais c’est essentiel. Cela accompagne cette idée qu’il faut savoir accepter l’imperfection. J’ai trouvé ce film très intelligent, et ça me réjouît de voir qu’il est possible de faire un cinéma populaire qui à la fois commercial et intelligent.
SDL Pour terminer, y a-t-il un clip dont tu es le plus fier ?
YL J’aime beaucoup ce que j’ai fait pour « Jewels » de Black Atlass. Techniquement, il y a une absence totale de mouvements, tout a été mis en place à partir de scans 3D. Le résultat est assez dérangeant, il y a cette idée d’une personne qui chante mais qui semble prisonnière de son propre corps. C’est très réaliste mais il y a quelque chose qui sonne faux. On peut y voir une critique de la surenchère de la retouche, de la digitalisation des corps, de la perte du charnel… Quant à la dernière question que j’aimerais te poser : si tu devais faire danser un acteur, qui choisirais-tu ?
SDL Ca n’est pas évident ! Je viens de collaborer avec Benedict Cumberbatch, et il est vraiment excellent. J’avoue que je ne le connaissais pas avant notre rencontre. C’est quelqu’un de très analytique, et de très poli également. Nous avons travaillé sur Hamlet, j’assurais la chorégraphie du mouvement, la mise en scène était de Lynsdey Turner. Il ne s’est jamais fâché, alors que ça n’était pas toujours évident. Il est à la fois capable d’écouter les conseils qu’on lui donne tout en ayant une idée très claire de ce qui est le mieux pour lui. Il sait faire la part des choses. Actuellement, il est sur un film Marvel, Dr Strange, dans lequel il aura le rôle titre. Étant fan de comics, j’avoue que j’aurais adoré travailler sur ce projet.