Le chant
d’un cygne
Édouard LouisGus Van Sant
Alors que l’on attendait impatiemment le retour de Gus Van Sant au cinéma après son dernier film, Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot, sorti en 2018, le réalisateur américaina surpris ses admirateurs en réalisant la quasi-totalité de la seconde saison de la série anthologique Feud. Consacré à la dispute opposant l’écrivain Truman Capote à sesriches amies, le récitrevient sur les blessures des différents protagonistes, et l’impact qu’un simple texte peut avoir sur le réel. Une réflexion sur le pouvoir de la littérature qui pouvait difficilement laisser Édouard Louis insensible. L’auteur français, qui vient de publier son sixième livre, intitulé Moniques’évade, a dévoré les épisodes consacrés à l’inénarrable Capote. Il s’entretient ici avec le réalisateur autour de cette figure disparue il y a tout juste quarante ans et qui pourtant ne cesse de fasciner.
Édouard Louis
Gus, je viens de terminer la série Feud – Capote vs the Swans, que tu as réalisé autour de Truman Capote. C’est une série incroyablement puissante, qui aborde les questions de l’homosexualité, de l’amitié, du pardon, de la littérature, dont j’aimerais qu’on parle aujourd’hui. Mais avant cela, je voulais te demander simplement quel avait été le point de départ de ce projet ?
Gus Van Sant
Il y a deux ans, lors d’un diner, mon ami Robin Baitz m’a raconté qu’il était en train d’écrire autour de cette histoire entre Truman Capote et ses « cygnes », le surnom que Truman avait donné à ses riches amies. Il se trouve que je connaissais plutôt bien le sujet puisque j’avais lu l’article intitulé La Côte Basque, publié en 1965 dans le magazine Esquire. Ce texte a causé une rupture entre Capote et ces femmes. De Truman, je connaissais également les trois ou quatre chapitres de Answered Prayers, son roman inachevé. Le fait qu’il n’ait jamais réussi à terminer son livre, mais aussi son rapport avec Andy Warhol – dans les années 50, Truman a essayé de garder Andy à distance, car il le trouvait trop insistant… Quelques années plus tard, il a accepté son invitation et s’est mis à écrire pour son magazine Interview… –, la période du Studio 54, j’étais familier avec tous ces éléments. Quant à Ryan Murphy, qui a produit et imaginé la série, je connaissais une partie de son travail, notamment la série Hollywood, inspirée du livre Full Service de Scotty Bowers. J’ai demandé à Robin Baitz s’il pensait que Ryan accepterait qu’un réalisateur extérieur vienne travailler sur ce projet… Il lui a demandé, sa réponse était positive : « Si c’est ce que Gus souhaite, il peut le faire ». C’est seulement ensuite que j’ai réalisé que je devais vraiment le faire ! (rires). Ryan a écrit le contour de l’histoire, Robin l’a rempli et j’ai réalisé six épisodes sur les huit de cette saison.
Édouard Louis
Que pensais-tu de Truman Capote et de son œuvre littéraire avant de travailler sur cette série ?
Gus Van Sant
Je crois que j’ai lu In Cold Blood [De sang froid] lorsque j’avais 13 ans. Le livre appartenait à la mère d’un ami, il était placé sur la table de la cuisine, c’était plutôt un gros livre. Rien que le titre semblait menaçant. Cette femme m’a dit que c’était un très bon livre. In Cold Blood a eu beaucoup de succès, notamment auprès des femmes au foyer, sans doute car il permettait à ses lectrices, vivant dans des coins reculés comme le Connecticut, de lire la même chose que les femmes de l’aristocratie new-yorkaise.

Truman Capote tenant sa couverture du magazine Interview à La Factory. COuverture réalisée par Richard Bernstein, janvier 1979. Photo: George Rose. Extrait du livre Richard Bernstein Starmaker: Andy Warhol’s Cover Artist de Roger Padilha & Mauricio Padilha, publié par Rizzoli, New York, 2018.
C’est comme ça que je l’ai découvert. À cette période, il faisait quelques interventions à la télévision pour présenter son livre. Ma mère disait qu’elle l’aimait car il parlait avec une drôle de voix mais aussi parce que la manière dont il disait les choses était précise et belle. Elle se sentait bien en l’écoutant.
Récemment, j’ai relu ses livres. Pour moi, il est l’un de ces auteurs comme Norman Mailer qui maitrisait parfaitement la description avec subtilité et nuance. Son écriture était poétique. Et c’est quelque chose qu’il a perdu dans Answered Prayers.
Édouard Louis
Dans Feud, nous sommes témoins de la fascination que Truman exerce sur les femmes de son entourage, ses cygnes. C’est intéressant car il semblerait que cette fascination s’étendait à bien plus de monde, comme à ta mère… Est-ce que tu étais conscient de ce parallèle pendant la réalisation de la série ? À quel point ton rapport biographique à Capote a-t-il joué ? Est-ce que la fascination de ta mère pour Capote par exemple t’a inspiré en filmant les actrices qui jouent les Cygnes de Capote ? Tu les filmes d’une façon si sensible, si généreuse en un sens…
Gus Van Sant
Pas directement, mais j’ai fait des parallèles à d’autres niveaux entre la vie de Truman et la mienne car Truman est né dans une toute petite ville de La Nouvelle-Orléans. Mes parents sont aussi nés dans une petite ville du Sud, du Kentucky. Ma mère était plutôt réservée, mais elle avait une sœur par exemple qui avait une voiture noire, une Jaguar convertible, un choix vraiment excentrique. Ses goûts étaient marqués par sa situation… Et pour en revenir à Capote, j’ai pensé à sa mère lors du tournage, cette mère assez excentrique elle aussi, la mère de cet homme gay. Elle l’a pratiquement abandonné en le laissant à sa propre mère… Truman a vécu avec sa grand-mère. Il y a une photo célèbre de lui, habillé d’un costume blanc alors qu’il avait cinq ans. La mère de Truman voulait être une femme du monde, elle voulait vivre à New York sur Park avenue. Elle s’est mariée avec un homme plutôt riche, elle voulait vraiment intégrer cette aristocratie mais n’a jamais réussi à atteindre les cercles les plus prestigieux.
Édouard Louis
Et Truman en intégrant ces cercles a offert à sa mère une forme de revanche. C’est ce que tu montres dans la série.
Gus Van Sant
Oui, une forme de revanche contre cette société dans laquelle sa mère n’avait pas été acceptée. Truman est allé au lycée à Greenwich, dans le Connecticut, pas très loin de Darien, où j’ai moi-même grandi. Ce sont des petites villes en périphérie de New York, beaucoup d’hommes prenaient le train le matin pour aller y travailler et rentraient le soir. Je crois qu’il est resté une année ou deux à Greenwich. Il se rendait aussi à New York avec les filles qu’il avait rencontré au lycée, ils essayaient d’aller dans des clubs huppés ou de jazz, tous ces endroits dans lesquels tout le monde à l’époque voulait rentrer. Truman était déjà en train de s’évertuer à monter l’échelle sociale, dès le lycée, et il n’a cessé de vouloir le faire tout au long de sa vie… Et toi Édouard, comment est-ce que tu as découvert l’œuvre de Truman Capote ?
Édouard Louis
Assez tardivement. C’est assez étrange car je me pose des questions depuis longtemps sur la place de la fictionet du réel dans l’écriture, je m’interroge sur la façon dont le réel peut permettre de subvertir les formes littéraires canoniques, et les livres de Capote participent à cette réflexion, mais pour des raisons qui me sont inconnues, j’ai mis du temps à les lire. Je crois avoir commencé il y a deux ans, avec De sang Froid. Et cette lecture a été extrêmement forte. C’est un livre immense.

Photogramme extrait de l’épisode 1 de la série Feud : Les Trahisons de Truman Capote, créée en 2023 pour FX par Ryan Murphy, réalisée par Gus Van Sant.
Je connaissais Capote et sa personnalité à travers les photo-graphies que j’avais vues de lui, à travers des entretiens. Et je me souviens comment, en lisant De Sang Froid, je me demandais à quel point ce « corps gay », avec sa petite voix fluette qui fascinait ta mère, Gus, comment ce corps-là, aussi délicat, aussi vulnérable et haut en couleur à la fois, avait pu écrire une histoire sombre, violente et aussi terrible. Il y a un mystère, une contradiction, comme si Proust ou Barthes avaient écrit les livres de Faulkner.
Truman Capote le disait lui aussi : il était comme sorti de lui-même pour écrire ce livre, et cet écartèlement l’a laissé sans forces, épuisé, ce qui expliquait en partie, selon lui, son incapacité à écrire après De sang Froid. D’ailleurs, je voulais te poser une question par rapport à Feud et à ce roman. Dans De sang Froid, deux hommes entrent dans une maison et massacrent la famille qui y vit. Capote raconte ce fait divers, mais aussi ce qui a amené à son exécution, l’histoire de ces meurtriers, leur passé, leur enfance, les humiliations qu’ils ont vécues. Et en faisant ça, il rend l’histoire de ces hommes qui ont commis ce crime horrible plus complexe, et on ressent même une forme d’empathie pour eux. On perçoit que le crime qu’ils ont commis a une histoire, qui dépasse ces deux individus. Évidemment ça ne rend pas le crime moins horrible, et Capote n’essaye pas de le rendre moins horrible, mais il y a cette tentative de comprendre pourquoi ils l’ont fait. Et pour moi, il y a quelque chose de similaire qui se joue dans Truman vs the Swans. Le crime n’est pas aussi terrible évidemment, et même beaucoup moins, mais la série commence également avec un (plus petit) crime : Truman trahit ces femmes new-yorkaises, les Cygnes. Le crime n’est pas si petit d’ailleurs car une femme s’est suicidée en partie à cause de cette trahison. Truman Capote trahit ses amies les plus proches, ces femmes qu’il voit tous les jours,il les expose, il raconte leurs secrets dans ce texte que tu mentionnais, La Côte Basque. Et au fur et à mesure que l’histoire se dévoile, on découvre des éléments qui expliquent pourquoi l’écrivain a fait cela à ses amies. Sa mère a été humiliée socialement, et il a voulu prendre sa revanche. Il a été humilié en tant qu’homme gay par une de ces femmes de la très grande bourgeoisie, qui l’a traité de « tapette ». On voit aussi que Capote fait des mauvais choix parce qu’il est tétanisé par l’angoisse de ne pas réitérer le succès qu’il a rencontré avec In Cold Blood. Tous ces éléments qui se cumulent dissolvent en quelque sorte sa responsabilité, la complexifient, exactement comme Truman lui-même a complexifié le crime des meurtriers dans son roman. Plus on avance dans ta série, et moins on en veut à Truman, ou en tout cas on comprend ce qui s’est passé. Est-ce que c’était ton intention Gus ? Est-ce que tu as fait une série pour pardonner Truman ? Est-ce qu’il y a selon toi un rapport entre l’art et le pardon ?
Gus Van Sant
Je ne sais pas. Dans tous les films que j’ai pu faire, je m’investis à travers ce qu’on pourrait appeler des « incantations » : rappeler les réalités auquel le récit fait référence. C’est ce que fait le cinéma : on a une histoire, et dès qu’on commence à la filmer, des acteurs jouent des actions, des mouvements, des moments, et rendent cette histoire vivante, et donc plus complexe. Pour ma part, quand je réalise un film ou une série, j’essaye d’interpréter ce qui est écrit dans le scénario. Pour Feud, la construction des scènes venait de Ryan Murphy. Mais je crois qu’il aurait pu écrire presque n’importe quoi, je l’aurais quand même compris et interprété comme l’histoire que je connaissais, avec ma propre perception de la situation. La structure de Ryan a été extrêmement utile pour comprendre ce qu’il fallait mettre en avant parmi toutes les pièces de ce puzzle, et quand les dévoiler. Robin, en tant que scénariste, est connu pour ses longs dialogues. Il a inventé Truman dans ces situations, car il n’y avait pas nécessairement de retranscriptions de ce qu’il a dit à ces femmes. Capote en a parlé en interviews, mais il fallait d’une certaine manière remplir les vides. Robin avec ses dialogues explique beaucoup de choses. Et je dois ajouter que Tom Hollander, qui interprète Truman, a été très fort pour rendre ces raisonnements essentiels, car à la lecture des scénarios, j’ai parfois pensé qu’il fallait en couper certains. J’avais peur que ça soit trop long, que ça manque de rythme. Et au final, ça n’a pas été le cas grâce à Tom qui a toujours compris l’intérêt de ces mots, ce qui a rendu son interprétation encore plus juste. Moi je ne pouvais que réagir à la réalité du tournage : tout était très rapide. On a commencé à tourner le premier épisode sans que l’intégralité de scénario ait été écrit. Tant qu’on est pas sur le plateau, les choses ne sont pas concrètes. Donc avant que le tournage ne commence, je me suis contenté de réfléchir au placement des caméras, c’est tout, car il y avait trop de paramètres que je ne pouvais pas maîtriser. Au final, mon travail a été de filmer la rencontre de ces différents talents, ceux de Ryan, de Robin, Tom Hollander, de Naomi Watts. J’ai filmé tout cela et j’ai en fait ma propre interprétation.
Édouard Louis
Oui, justement, en parlant du placement des caméras et de cette question du pardon que j’évoquais, j’ai justement trouvé que tout, dans la manière dont tu réalisais la série, l’angle, les mouvements de caméras, les zooms, j’ai trouvé que tous ces éléments allaient dans le sens du pardon, ou au moins, du refus de condamner. Comme s’il existait une manière purement formelle de pardonner, en dehors du discours. Comme si un mouvement de caméra pouvait représenter une forme de pardon.

Couverture du magazine Interview, réalisée par Richard Bernstein, janvier 1979. Extrait du livre Richard Bernstein Starmaker: Andy Warhol’s Cover Artist de Roger Padilha & Mauricio Padilha, publié par Rizzoli, New York, 2018.
Je trouve que tu es très délicat avec tes personnages. Que ta caméra à la fois les caresse, les accompagne comme une amie, à d’autres moments les replace dans une situation plus grande.
Cela m’a fait penser à Kafka, et à cette idée Kafkaïenne sur laquelle Geoffroy de Lagasnerie a écrit, selon laquelle, enfin de compte, tout le monde est innocent de tout. Kafka dans la lettre au père énumère les excès de son père, mais il lui dit qu’au fond, il sait qu’il est innocent – que le problème se trouve ailleurs. Au fond, j’ai ressenti ça dans la manière dont tu as filmé Truman et son amie Babe Paley. Peut-être cela n’était pas conscient, car comme tu viens de le mentionner, quand tu crées, tu te laisses porter par une intuition, plus que par un discours. Tu m’as dit un jour que parfois le corps sait mieux que la tête ce qu’il faut faire…
Gus Van Sant
Oui !
Édouard Louis
J’ai aussi trouvé que la série dépeignait de manière très juste l’homosexualité. Comme si cette série était aussi un Portrait de l’homosexuel – un des plus beaux que j’ai vu depuis longtemps : qu’il s’agisse d’homophobie, de désir, de fascination pour la masculinité, de l’amitié avec les femmes,aussi compliquée puisse-t-elle être, de la relation à la mère ou encore des rêves de gloire, qui sont certainement une forme de revanche face aux enfances souvent difficiles que les gays peuvent avoir vécus… Ce désir d’évasion, comme Jean Genet qui s’évadait sur les toits… Pour moi, la série parle vraiment d’homosexualité en général, pas uniquement celle de Truman… C’était ton intention ?
Gus Van Sant
J’ai lu quelques romans de Jean Genet ! De Jean-Paul Sartre également, quand j’étais au lycée…En tout cas, ces récits font partie de mon histoire et ressortent consciemment ou non. Quand j’étais enfant, de mes 11 à 14 ans – à peu près au moment où Truman terminait In Cold Blood –, j’ai eu un professeur d’art à l’école qui était homosexuel. Il portait une cravate noire fine avec un costume parfaitement taillé, il était Canadien francophone. Il nous a appris l’art nouveau, à faire des mobiles à la manière de Calder, il peignait également dans notre salle de classe. Il partageait avec nous ce qu’il faisait durant ses week-ends, on venait dans sa classe juste pour l’écouter. Pour moi, il a été une sorte de connexion avec la vie homosexuelle new-yorkaise du début des années 1960. Ce sont aussi ces souvenirs, en plus des livres lus, que j’ai sans doute, inconsciemment, déployé dans la série. Donc je crois que les choses se transmettent, d’une manière ou d’une autre.
Édouard Louis
Dans le cinquième épisode, que tu n’as pas réalisé, intervient James Baldwin. L’auteur vient pour aider son camarade. Et à travers les moments qu’ils partagent ensemble, tu pointes l’importance des communautés, de la communauté gay et du soutient qu’elle peut apporter. Je suis curieux de savoir combien cette dimension compte pour toi. Est-ce que tu es plutôt entouré ou solitaire dans la création ?
Gus Van Sant
Je suis plutôt seul ! Je me bats seul. Et toi ?
Édouard Louis
Pour moi il y a un lien important entre amitié et création. Évidemment, dès que l’on essaie de faire quelque chose de nouveau, ou au moins de différent, on doit faire face à des réactions violentes, qu’elles soient d’ordre artistique ou politique. Et je crois que l’amitié m’a permis de ne pas avoir peur de ça. J’ai été si souvent insulté pour mes livres, par des journalistes, des critiques littéraires ou des universitaires… L’amitié permet de se donner une légitimé propre, et de ne pas être autant heurté par les critiques. Si Thomas Ostermeier, ou mes amis Didier Eribon ou Nan Goldin aiment ce que j’écris, alors le reste n’a plus vraiment d’importance.
C’est d’ailleurs ce qu’on voit dans Feud. Truman, pour pouvoir écrire, a besoin d’avoir des personnes autour de lui. À partir du moment où il perd l’amitié de ses femmes, il ne peut plus rien faire. On voit bien comment l’absence d’amitié affecte sa capacité à créer. Évidemment, il y a des artistes qui travaillent dans la solitude, je pense à Thomas Bernhard, mais c’est un mystère pour moi. C’est cette même solitude que tu cultives dans la création ?
Gus Van Sant
Je croyais que la question concernait le combat, pas l’écriture !
Édouard Louis
On peut considérer les deux termes comme synonyme ! (rires)
Gus Van Sant
Oui, dans ce cas, je crois que l’on a besoin d’immunité pour créer. L’écriture est une forme d’amitié sociale, un tournage l’est aussi. Il y a toujours un groupe de proches avec qui je partage mes projets, mes convictions et mes doutes. Mais quand il s’agit de se battre, alors oui, je me bats seul.
Édouard Louis
Une amitié, pour qu’elle dure, doit aussi savoir pardonner – désolé, c’est un sujet qui m’obsède et sur lequel je veux t’entendre (rires). Si Truman était ton ami et écrivait sur toi comme il l’a fait dans La Côte Basque sur les Cygnes, est-ce que tu lui aurais pardonné ?
Gus Van Sant
Peut-être ! Je ne suis pas sûr ! (rires) Cela dit, j’ai quelques amis qui ne parlent plus à leur famille, et je trouve ça toujours surprenant, voire choquant. C’est dur pour moi de voir certaines personnes couper définitivement les liens avec les autres. Je crois que je serais dans le pardon. Je ne comprends pas qu’on puisse arrêter de se parler. Peut-être que c’est différent en France ! (rires)

Photogramme extrait de l’épisode 1 de la série Feud : Les Trahisons de Truman Capote, créée en 2023 pour FX par Ryan Murphy, réalisée par Gus Van Sant.
Je constate par contre qu’il y a des personnes qui ne me parlent pas, non pas à cause de moi, mais à cause de mon art. Ils ont entendu parler de moi, n’ont jamais vraiment rien vu mais ont décidé qu’il valait mieux ne pas me parler. Je suis parfois confronté à ces personnes. Quand je les rencontre, ils se tournent et s’en vont !
Édouard Louis
Quoi ? Mais qui sont ces gens ? Des catholiques radicaux qui t’en veulent de parler d’homosexualité ?! (rires)
Gus Van Sant
C’est peut-être ça ! Ou alors, peut-être à cause de Drugstore Cowboy, mon second film qui parlait d’addiction aux drogues. Je me souviens qu’à l’époque de sa sortie, j’étais à une fête et j’ai entendu quelqu’un qui ne savait pas qui j’étais dire « C’est absurde, c’est stupide, c’est ridicule ». Et quand j’ai essayé de parler à cette personne, elle a simplement répondu qu’elle ne voulait pas me parler.
Édouard Louis
C’est tellement grotesque que c’est hilarant ! Bon, il est vrai aussi que produire des oppositions, quand on est un artiste, c’est une chose saine. Truman a lui aussi produit des lignes de fracture, tu montres dans ta série que certaines personnes le haïssaient, comme Gore Vidal notamment…
Gus Van Sant
Oui, mais ce qui est aussi fou avec Capote, c’est qu’il n’a plus été capable de créer à un certain moment. Il n’a jamais fini Answered Prayers. Il a traversé presque deux décennies pendant lesquelles il n’a pas été capable de terminer ce livre, alors qu’il n’arrêtait pas de dire qu’il écrivait. Il était devenu une célébrité qui faisait un peu trop la fête et ne travaillait plus vraiment. Je vois parfois ça à Hollywood, avec certaines personnes qui atteignent une certaine notoriété et validation, et qui ensuite n’arrivent plus à écrire ou réaliser.
Édouard Louis
Et pourtant l’incapacité de Capote à terminer ce livre a contribué à sa légende. Un peu comme Rimbaud, qui a renoncé subitement à la littérature. C’est aussi l’une des raisons pour laquelle on l’aime autant, non ? Beaucoup de gens disparaissent mais peu disparaissent d’une façon aussi légendaire que Rimbaud ou Capote. Et d’ailleurs, peut-être qu’inconsciemment Truman a compris que son blocage allait couronner son œuvre, peut-être plus qu’Answered Prayers l’aurait fait s’il l’avait terminé.
Gus Van Sant
Oui c’est vrai. Et puis il y a aussi un côté chasse au trésor avec ce dernier livre achevé. « Où est-ce que ce roman est passé ?! ». A-t-il été détruit ? Peut-on le retrouver ? Beaucoup de personnes pensent qu’il est entreposé dans un dépôt oublié. D’autres pensent qu’il est disséminé dans ses correspondances. Je ne pense pas que ça soit le cas car cela a déjà beaucoup été étudié… Et pour d’autres, il n’a jamais été écrit, donc il n’existe pas ! Le mystère reste entier et participe à la fascination pour Truman Capote…
Ce qui brûle guérit
João Pedro Rodrigues
Présenté comme une « fantaisie musicale », Feu Follet, le nouveau long-métrage du réalisateur portugais João Pedro Rodrigues ne ment pas sur son programme. Entre passages chorégraphiés, scènes érotiques entrecoupées de discussions philosophiques et jeux initiatiques, il fait souffler une douceur euphorisante. Mais sa légèreté ne l’empêche pas de toucher à des sujets importants, tout en se concentrant sur cette histoire d’amour et de désir. Sixième long-métrage d’une carrière rythmée par de nombreux courts et documentaires, Feu Follet est l’occasion de revenir sur une œuvre exigeante et polymorphe, peuplée de personnages hors normes. Avec un goût prononcé pour la frontière ténue qui sépare le réel de la fiction, João Pedro Rodrigues aime les points de bascule. Rencontre avec un réalisateur prolifique et inclassable.
JM Feu Follet est un film qui change constamment de registre. Il mute de film d’anticipation à fable politique, puis il devient une comédie musicale qui se développe en romance… Et cette richesse se concentre en soixante-sept minutes, une durée atypique. Est-ce que ces métamorphoses et cette concentration faisaient partie de vos premières intentions ?
JPR Changer de registre au sein d’un même film est effectivement quelque chose qui me tient à cœur. C’est peut-être plus visible avec Feu Follet car il est plus court que mes précédents long-métrages. Cela change plus vite. J’aime l’idée qu’un film évolue. Quand j’écris, je ne pense pas de manière consciente à ces ruptures de genre, c’est quelque chose qui se met en place de manière organique.
JM Feu Follet est aussi surprenant car c’est la première fois dans votre filmographie que vous vous engagez sur le terrain l’humour de manière aussi affirmée. Était-ce pour vous une manière de lutter contre les dernières années que l’on vient de traverser ? Ou est-ce que cela n’arrive que maintenant, car la comédie reste un registre très compliqué à maîtriser et qui demande d’autres codes ?
JPR Je pense que la comédie est le genre le plus difficile. Je n’en vois pas assez, surtout dans ce que l’on appelle le cinéma d’art et essai. La plupart se prenne trop au sérieux. Pour Feu Follet, mon but était de faire une comédie. Nous l’avons écrit avec João Rui Guerra da Mata et Paulo Lopes Graça avant la pandémie. Je ne me souviens plus très bien si c’était en 2018 ou 2019.

Photogramme extrait du film O Fantasma, avec Ricardo Meneses, Beatriz Torcato et Andre Barbosa, réalisé par João Pedro Rodrigues en 2000.

Photogramme extrait du film Odete, avec Ana Cristina de Oliveira, Nuno Gil et João Carreira, réalisé par João Pedro Rodrigues en 2005.
Pendant le confinement, je l’ai modifié et le Covid a été introduit dans l’histoire. J’ai pensé qu’il était impossible d’ignorer cette pandémie que nous avons traversé et que nous vivons encore. Certes, le film a été écrit comme une comédie, mais son tournage a vraiment été très heureux. On a passé un bon moment, même si c’était court. Je n’avais jamais fait un long-métrage dans un si court espace : deux semaines et deux jours.
JM Un tournage en novembre 2021 et une sélection au Festival de Cannes 2022, tout a été très rapide.
JPR Oui, mais je dois dire que tout était très bien préparé. Mes idées étaient claires et nous avions commencé à répéter avec les acteurs il y a longtemps déjà, dès 2020. Puisque tout était déjà en place, le film a pu se faire vite.
JM Pour en revenir à la comédie, quel type d’humour appréciez-vous au cinéma ?
JPR Je pense à des réalisateurs classiques américains comme Ernst Lubitsch ou Billy Wilder. Il y a chez Wilder une truculence, c’est un humour assez caustique. Dans la comédie musicale, je pourrais citer Jacques Demy.
JM La musique, plus particulièrement le chant, est un élément que l’on retrouve dans plusieurs de vos films, de Feu Follet à Mourir comme un homme (2009). Quelle place prend la musique dans votre vie ?
JPR J’utilise la musique avec parcimonie dans mes films. Je trouve qu’il y a toujours trop de musique au cinéma, mais aussi en général dans la vie. Nous nous trouvons actuellement dans cet hôtel qui diffuse cette radio alors qu’il n’y avait rien quand je me suis installé un peu plus tôt… Il me semble que désormais les gens ont du mal à vivre dans le silence. Et c’est quelque chose que je ne comprends pas vraiment. Chez moi par exemple, je suis dans le silence, particulièrement quand je travaille. Lorsque j’écoute de la musique, c’est vraiment pour l’écouter, pas pour passer le temps.

Photogramme extrait du film Odete, avec Ana Cristina de Oliveira, Nuno Gil et João Carreira, réalisé par João Pedro Rodrigues en 2005.
Au cinéma, je pense que la musique doit avoir un sens. Elle doit apporter quelque chose de supplémentaire au film et ne pas se contenter d’être là comme fond sonore. Elle est souvent trop illustrative. Selon moi, tous les éléments d’un film doivent être là pour une raison. Il s’agit d’une question d’équilibre autour du récit qui dicte les règles du jeu.
JM Votre avant-dernier film, L’Ornithologue (2016) fait figure d’exception sur ce point.
JPR Effectivement, il y a sur ce film une bande originale au violoncelle composée par Séverine Ballon. Mais ça n’est plus vraiment une exception car j’ai depuis retravaillé avec elle sur un autre projet qui a été présenté en août 2022 au festival de Locarno. C’est un documentaire coréalisé avec João Rui Guerra da Mata – mon compagnon avec qui j’ai co-réalisé d’autres films –, et qui est basé sur un autre long-métrage, à savoir le premier film de ce qu’on appelle la nouvelle vague portugaise, Les vertes années (The green years, 1963) de Paula Rocha. Notre documentaire s’appelle Où est cette rue ? Ou sans avant et après (Where Is This Street? or With No Before And After, 2022). Nous avons revisité les lieux des vertes années car j’habite dans le quartier où ce film a été tourné. J’ai toujours habité là, dans l’appartement qui appartenait à mes grands-parents, dans ce même bâtiment construit par mon grand-père. Nous nous sommes demandé si mes grands-parents avaient vu le tournage de ce film ? C’est le point de départ du projet. C’est un film que nous avons tourné pendant le confinement et qui lui aussi a été infecté par le Covid, car la pandémie a pris une présence qui n’était pas prévue.
JM Il y a dans ce film quelque chose du dispositif de La dernière fois que j’ai vu Macao(2012), qui est un portrait de la ville à travers une fiction dont les personnages principaux n’apparaissent pas à l’écran.
JPR Oui, mais c’est moins narratif. Il y a moins de romanesque. Dans ce documentaire, on note seulement la présence d’Isabel Ruth, la seule actrice des vertes années qui est encore vivante.
JM La dernière fois que j’ai vu Macao montre justement une facette plus expérimentale de votre travail. Au-delà de vos longs-métrages, vous avez réalisé de nombreux courts et documentaires, toujours avec cette volonté de ne pas vous répéter. Qu’est-ce que représente le cinéma pour vous ?
JPR Je suis obsédé par cette idée de ne pas me répéter et de ne pas refaire le même film. Certains réalisateurs que j’apprécie se sont souvent répétés et je n’aime pas cette idée de trouver une place confortable dans le cinéma.
Je ne cherche pas une recette qui serait la mienne, j’essaie de me remettre en question. J’ai commencé à aller au cinéma quand j’étais adolescent à l’âge de 15 ans, j’ai vu beaucoup de films et mon désir de réaliser vient sans doute de là. Initialement je voulais être ornithologue, j’ai même étudié la biologie avant de me consacrer au cinéma.
J’ai l’impression de devoir oublier le film précédent pour pouvoir passer au suivant. Les courts-métrages me permettent d’essayer de nouvelles choses.
JM Chacun de vos films est une plongée dans l’intimité de vos personnages. Est-ce que l’on peut dire que votre statut de réalisateur vous a transformé d’ornithologue à anthropologue ?
JPR L’anthropologie reste une discipline scientifique, et je ne pourrais pas avoir la prétention de me présenter en tant qu’anthropologue. Mais je pense que mes films sont souvent des documentaires, même lorsqu’ils sont des fictions. O Fantasma (2000) est une sorte de documentaire sur Lisbonne. Les lieux sont vrais. Tout part du réel. J’essaie avec mes films d’arriver à une sorte de sublimation de ce réel à travers le romanesque et le récit.
JM Vous parlez un français parfait. L’avez-vous appris par le cinéma ?
JPR J’aime beaucoup parler les langues. J’ai appris le français à l’école, mais j’ai eu plus de cours d’anglais que de français. Je viens souvent en France, ce qui me permet de le pratiquer. J’ai aussi du plaisir à lire en langue originale. Lorsque j’étais jeune, à la cinémathèque portugaise, les copies des films projetés venaient d’autres cinémathèques, notamment la française, et n’étaient pas sous-titrées. Je pense que j’ai aussi appris le français par ces projections, car il fallait comprendre !
JM Travaillez-vous déjà sur d’autres projets ?
JPR Je prépare un autre film qui sera peut-être tourné l’année prochaine. Il se passe durant la révolution des œillets, en 1974 et s’appelle Le sourire d’Alfonso. C’est l’histoire d’un adolescent qui découvre sa sexualité. La révolution des œillets a représenté un moment de liberté, mais cette liberté n’était pas pour tous. Je me souviens avoir entendu à la télévision à l’époque que le 25 avril, jour de la révolution, n’était pas fait pour les putes et les pédés. Ce futur film parle de ça.
JM Ce numéro de Revue traite du désir. C’est un thème qui parcourt votre œuvre, d’O Fantasma à Feu Follet, qui abrite en son cœur une histoire d’amour. Vous considérez-vous comme un cinéaste du désir ?
JPR Le « cœur » de Feu Follet, comme vous le dites justement, c’est cette histoire d’amour. Ce qui fait que ce film existe c’est que l’on croit à ces personnages. Leur choix a été fondamental. Si je n’avais pas trouvé ces acteurs, ce projet n’aurait pas pu se faire. Il y a cette radicalité dans ma démarche. Mauro Costa, qui joue le prince, n’avait jamais fait de cinéma mais a fait une école de théâtre. Quant à Andre Cabal, le pompier, il a une formation de danseur. Mais j’ai senti que ça allait marcher quand j’ai commencé à les mettre ensemble et à les faire répéter.

Photogramme extrait du film O Fantasma, avec Ricardo Meneses, Beatriz Torcato et Andre Barbosa, réalisé par João Pedro Rodrigues en 2000.

Photogramme extrait du film Odete, avec Ana Cristina de Oliveira, Nuno Gil et João Carreira, réalisé par João Pedro Rodrigues en 2005.
Quant au désir, c’est ce qui fait bouger la vie. C’est ce qui fait que l’on se trouve et l’on se quitte. C’est quelque chose qui est très humain. Je pense que j’essaie d’être près de cette humanité, de cette idée de chercher quelqu’un, de toucher l’amour.
joão pedro rodrigues
entretien avec justin morin
Intérieur jour
Justin Morin
Une chaise à l’acier froid et chromé pour une salle d’interrogatoire. Un papier peint psychédélique comme métaphore des névroses d’un personnage. Un luminaire réduit à une forme minimale pour préfigurer le futur. Les éléments de mobiliers sont autant d’indices narratifs, précieux éléments muets qui dévoilent l’histoire qui se joue dans les films. Qu’il s’agisse de récits d’anticipation, de drames contemporains ou de long-métrages d’horreurs, chaque genre a développé ses propres codes en matière de design d’intérieur. Et il arrive que le décor devienne un acteur à part entière, renouvelant ainsi les règles d’usage. Retour sur sept films à l’approche singulière.
Mon oncle
Jacques Tati
1958
Troisième film du réalisateur français Jacques Tati, et premier essai en couleur, Mon oncle est une satire sociale qui met en parallèle Monsieur Hulot (interprété par le réalisateur), aussi doux rêveur que gaffeur, et la famille de sa sœur. Cette dernière vit en compagnie de son mari, industriel ayant fait fortune dans le plastique, dans une somptueuse villa moderniste qui fait leur fierté. « Toutes les pièces communiquent », lance-t-elle fièrement à tous les visiteurs. La maison, remplie de gadgets technologiques, semble pourtant peu attirer le petit Gérard, 9 ans, et son chien, qui préfèrent tous deux faire les quatre cents coups dans le terrain vague de la ville. Au générique de Mon oncle sont crédités Henri Schmitt et Eugène Roman pour les décors, mais aussi Jacques Lagrange, peintre et proche collaborateur du réalisateur.
Hautement chorégraphié, le film fait se succéder les trouvailles visuelles. L’action passe de l’usine et de sa logique fordiste à la place animée du village, de l’immeuble foutraque de Monsieur Hulot à la maison cubique de sa sœur. Et le jugement de Tati sur l’architecture moderniste est sans appel : cette dernière manque cruellement d’âme. Et pourtant, en voyant aujourd’hui cette comédie, on ne peut que sourire en constatant que certaines de ses formes, qu’il s’agisse du plan de la villa Arpel – du nom de ses habitants – ou de son mobilier, sont aujourd’hui célébrées, voire reprises par certains designers. Ultime ironie, trois pièces iconiques de ce décor ont été reproduites et réalisées par la Maison Domeau & Pérès. On retrouve donc le sofa de Madame Arpel, composé de deux cylindres de mousse, l’un pour l’assise, l’autre pour le dossier. Tapissés d’un vert sapin graphique, ils reposent sur des pieds métalliques noirs. Dans la même couleur, le banc de M. Hulot amuse par ses proportions et sa forme de haricot. Enfin, une chaise à bascule jaune aux piètements métalliques blancs revisite ce classique du mobilier à la sauce moderniste. Dévoilées en 2007 à Paris dans un décor récréant la Villa Arpel, exposé au Pavillon français de la Biennale d’architecture de Venise en 2014, ces pièces au statut hybride, entre sculpture et design, font aujourd’hui partie de collections publiques et privées, témoignant à la fois de l’histoire du cinéma et du design.

Mon oncle, Jacques Tati, 1958
Dolor y gloria
Pedro Almodovar
2019
Si l’on doit résumer les décors des films qui jalonnent la carrière de Pedro Almodovar, on pensera certainement à des bibelots accumulés dans des intérieurs aux couleurs criardes. Après tout, le réalisateur fut le fer de lance de la Movida, courant culturel et artistique célébrant l’exubérance et la joie de vivre dans l’Espagne des années 1980, tout juste sortie du régime dictatorial de Franco. Si son cinéma s’est assagi esthétiquement, il n’en reste pas moins inventif et fort en rebondissements. Son vingt-et-unième film, Douleur et gloire, met en scène Antonio Banderas dans le rôle de Salvador Mallo, réalisateur empêtré dans ses douleurs physiques et morales. Difficile de ne pas y voir une dimension autobiographique tant les similitudes entre Almodovar et Mallo sont nombreuses. Bien évidemment, on pense à la métamorphose physique de Banderas. Mais d’autres détails, bien moins explicites, sont présents. L’appartement de Mallo est une copie de celui d’Almodovar – il en reprend du moins les éléments de mobilier les plus singuliers. Signé Antxón Gómez, collaborateur de longue date, ce décor est un mélange de quotidienneté et d’exceptionnalité. Ainsi, les yeux aguerris des amateurs de design pourront reconnaître la lampe Eclisse créée en 1967 par Vico Magistretti. Un cabinet signé Piero Fornasetti, reconnaissable par son motif de papillons multicolores, est posé dans le salon, non loin d’un ensemble de chaises 637 Utrecht de Gerrit Rietveld, elles-mêmes à proximité de la lampe Pipistrello de Gae Aulenti. À quelques pas d’une fausse affiche d’un film de Salvador Mallo, un poster sérigraphié signé Enzo Mari, célèbre designer italien dont le travail a infusé tout un pan de la culture populaire, ajoute une touche colorée et graphique. Les clins d’œil se succèdent et pour autant, nul effet de showroom. Ici, le décor n’est pas là pour être ostentatoire mais pour raconter l’intime. Dans sa banalité, il est un témoin d’une histoire personnelle qui s’est construit dans le temps, au fil des objets et du mobilier glanés ici ou là.

Dolor y gloria, Pedro Almodovar, 2019
Evangelion : 3.0 + 1.0
Thrice Upon a Time
Hideaki Anno
2021
Légende de l’animation japonaise, la franchise Neon Genesis Evangelion déchaîne les passions depuis 1995, année de diffusion des 26 épisodes de la série originelle, déclinée par la suite en deux long-métrages, puis revisitée avec la tétralogie cinématographique Rebuild of Evangelion. Débutant comme une série d’action classique mettant en scène des adolescents pilotant des robots en charge de repousser une invasion extraterrestre, l’anime surprend par la place qu’il accorde à l’introspection de ses personnages, abordant frontalement le thème de la dépression. Au fil des formats – le titre est passé d’épisodes de 25 minutes réalisés sur celluloïds peints à la main à des long-métrages exploitant les possibilités offertes par les nouvelles technologies –, Evangelion impressionne par ses qualités techniques en termes de réalisation. Initialement prévu pour 2008, le film final Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time sort finalement en 2021, surmontant ainsi la dépression de son réalisateur, les embrouilles juridiques autour de la licence, une pandémie mondiale et l’impossibilité de conclure une œuvre devenue prisonnière de sa propre histoire. Les décors, à l’image de la complexité de l’œuvre, sont magistraux. Ils oscillent entre abstraction graphique et hyper-réalisme architectural. Le film s’ouvre sur une séquence épique de dix minutes se passant à Paris, montrant l’étonnante transformation de la ville lumière, où les immeubles Haussmanniens se surélèvent pour abriter du matériel de combat. Un peu plus tard, les protagonistes se retrouvent dans la campagne japonaise, dans un village de fortune qui abrite une société en pleine reconstruction. Dans le documentaire Hideaki Anno: The Final Challenge of Evangelion, sorti en parallèle du film, on découvre qu’une immense maquette a été réalisée afin de reconstituer cette ville. On y voit le réalisateur déplacer et replacer minutieusement les habitations, poteaux électriques et autres containers afin de leur trouver leur juste place. On pense évidemment à l’art de la maquette, grand classique du cinéma d’anticipation, notamment brillamment exploité dans le Metropolis de Fritz Lang. Avec cette même démarche avant-gardiste, Anno injecte dans son film d’animation des scènes réalisées à partir de motion capture pour trouver le cadrage le plus innovant. Le réalisateur multiplie les expérimentations graphiques sans pour autant renoncer à son récit. En vingt-cinq ans, Evangelion a mis en place un univers d’une créativité folle tout en témoignant de l’évolution de l’animation japonaise. Une saga méta à la richesse inouïe.

Evangelion : 3.0 + 1.0 Thrice Upon a Time, Hideaki Anno, 2021
Suspiria
Dario Argento
1977
Thriller surnaturel, Suspiria raconte l’histoire de Suzy Banyon, jeune ballerine américaine qui s’installe en Allemagne, à Fribourg, afin d’intégrer l’une des meilleures écoles de danse au monde. Très vite, l’héroïne va comprendre que celle-ci abrite des secrets plus terrifiants les uns que les autres. Avec ce récit aux allures de conte, Dario Argento, maître du giallo – ce genre cinématographique italien à la frontière du policier, de l’horreur et de l’érotisme, particulièrement en vogue dans les années 1960 à 1980 –, a mis en place un univers visuel détonnant. L’école est un personnage à part entière. Ici, la photographie saturée signée Luciano Tovoli se met au service de décors d’une gamme chromatique affirmée. Argento le dira à plusieurs reprises : l’une des inspirations esthétiques est le Blanche Neige (1937) de Walt Disney aux couleurs si particulières dues au procédé Technicolor. Suspiria est d’ailleurs l’un des derniers films tournés selon cette technique, perçue comme dépassée et contraignante, mais qui permet de réaliser un travail minutieux sur les couleurs primaires. Celles-ci viennent donc souligner les styles des différentes pièces de l’école : motifs géométriques qui habillent les sols et murs, vitraux et portes façon Art nouveau et peinture murale inspirée par les énigmes graphiques de Maurits Cornelis Escher. Ce mélange bigarré produit un effet saisissant. D’autres détails, moins évidents, sont à noter. Argento souhaitait initialement faire se dérouler son récit dans un pensionnat pour enfants, mais a renoncé à cette idée au vu des complications commerciales. Pour conserver cet aspect enfantin, il décide de faire surélever les poignées de portes du décor, afin d’amener les actrices de Suspiria à recréer la gestuelle si spécifique d’un corps confronté à un obstacle trop grand. Quarante et un ans plus tard, en 2018, Luca Guadagnino réalise un remake de ce classique de l’horreur. Grand amateur de décoration d’intérieur, ayant réalisé plusieurs projets de rénovation et d’aménagement sous cette casquette, son Suspiria se révèle également une somptueuse proposition en termes de décors. Mais là où Argento joue sur la saturation des couleurs, Guadagnino va à l’opposé et développe une palette muette révélant l’architecture même de l’école, suggérant la lecture du bâtiment comme celle d’un corps. Deux visions opposées, hallucinées et complémentaires.

Suspiria, Dario Argento, 1977
Speed Racer
Lana & Lilly Wachowski
2008
Des Wachowski, les amateurs de cinéma retiennent principalement la saga Matrix, désormais totem de la culture pop. Moins connu et pourtant tout aussi inspirant, leur cinquième film derrière la caméra est l’adaptation d’un dessin animé japonais datant des années 1960. De courses en courses, Speed Racer, jeune prodige de la course automobile, va déjouer les plans de la Royalton Industrie et restaurer l’honneur de sa famille. Si Matrix repose sur un univers visuel fait de nuances de gris et de touches vertes, alors Speed Racer est une bombe colorée survitaminée, assumant la saturation de ses images. Au générique, pour les décors, on retrouve Owen Paterson déjà à l’œuvre sur les précédents films du duo. Mais Speed Racer est un film qui révolutionne le genre – une affirmation simple mais qui pourrait résumer la philosophie globale des Wachowski – et propose donc une approche inédite. Entièrement filmées sur fond vert, les images que l’on voit à l’écran sont factices. Si la technique n’est pas nouvelle, l’application est ici différente. En répliquant les effets de plan inhérents aux techniques d’animation traditionnelles (un décor peint sur lequel sont apposées des feuilles de celluloid figurant les personnages), Speed Racer joue avec les superpositions. Ici, la question du focus est totalement éludée, ce qui crée des « incohérences visuelles » qui font le style du film. Générés par ordinateur, les décors proviennent de photographies prises aux quatre coins de la planète par l’équipe du film. Pour ce faire, les ingénieurs ayant travaillé sur Speed Racer ont développé une technique baptisée « Quicktime Virtual Reality Sphere ». Celle-ci permet de photographier un environnement sous forme de bulle, à 360 degrés, et de plaquer les images sur n’importe quel volume, recréant ainsi des espaces de manière précise tout en permettant des axes de caméra impossibles dans le réel. Autre point notable de Speed Racer, le décor devient un élément de montage à part entière. Puisque les images qui composent l’arrière-plan sont en constante transformation, elles peuvent également faciliter le découpage de l’action. Ainsi un personnage pourra séparer l’écran en deux et créer deux fonds différents, sans aucune cohérence, de part et d’autre. Les possibilités offertes par ce procédé, là aussi héritées du dessin animé, sont infinies. D’ailleurs, malgré son scénario simpliste destiné aux enfants, Speed Racer est un film visuellement complexe, presque éreintant. Échec au box-office international, il est de ces ovnis visionnaires qui méritent une seconde chance.

Speed Racer, Lana & Lilly Wachowski, 2008
Mishima: A Life
in Four Chapters
Paul Schrader
1985
Cinquième film de Paul Schrader en tant que réalisateur, Mishima : Une vie en quatre chapitres est un joyau de sophistication. Sur une bande originale signée Philip Glass, on découvre la vie de l’écrivain japonais Yukio Mishima, géant de la littérature et figure controversée. Plutôt que de suivre un déroulé chronologique linéaire, Schrader décide de faire le portrait de l’auteur en adaptant trois de ses nouvelles, comme autant de facettes autobiographiques. Pour donner forme à ce parti pris original, il collabore avec Eiko Ishioka. De sa formation de graphiste, cette dernière a gardé un sens des couleurs et des formes. Très rapidement, elle œuvre pour le grand magasin nippon Parco dont l’avant-gardisme publicitaire n’est plus à prouver. Pour Schrader, elle réalise costumes et décors. Elle imagine des environnements stylisés proches de scénographies pour le théâtre ou l’opéra. Elle attribue à chaque roman une gamme chromatique précise : Le Pavillon d’or se distingue par son utilisation de l’or et du vert, La Maison de Kyoko se pare d’un rose acide, Chevaux échappés ponctue le noir et le blanc de notes rouges. Fort de cette direction artistique singulière, le film sera récompensé au Festival de Cannes en 1985 par le prix de la meilleure contribution artistique (tant pour sa photographie, sa musique que ses décors et costumes). Par la suite, Eiko Ishioka sera notamment créditée en tant que costumière, même si son influence sera souvent plus large. Citons notamment Bram Stoker’s Dracula (1992) de Francis Ford Coppola, chef d’œuvre gothique qui modernise le mythe du célèbre comte. Impossible également de ne pas souligner la fructueuse collaboration qui la lie au réalisateur Tarsem Singh : The Cell (2000), thriller horrifique offrant un rôle à contre-emploi à Jennifer Lopez, The Fall (2006), fresque onirique à la démesure inégalée, Immortals (2011), péplum mythologique et enfin Mirror Mirror (2012), exubérante relecture de Blanche Neige pour laquelle Ishioka décrochera une nomination aux Oscars. Décédée en 2012, Eiko Ishioka laisse derrière elle un passionnant corpus d’œuvres, récemment présenté au MOT Museum de Tokyo lors de l’exposition monographique Blood, Sweat, and Tears – A Life of Design.

Mishima: A Life in Four Chapters, Paul Schrader, 1985
Cleopatra
Joseph L. Mankiewicz
1963
Film de toutes les démesures, Cléopâtre est un monument à plus d’un titre. D’une durée de quatre heures (alors que Mankiewicz, son réalisateur, souhaitait sortir deux long-métrages de trois heures chacun !), le récit retrace la vie tumultueuse de la célèbre reine d’Égypte. Difficile de ne pas faire de parallèle avec son tournage étalé sur deux longues années, interrompu à cause d’importants soucis de santé d’Elizabeth Taylor, son actrice principale, ou encore suite à la relocalisation de son décor ! Les jeux Olympiques d’été de 1960 se passent alors à Rome, obligeant la production à changer son projet initial et à s’installer en Angleterre. Mais le climat britannique est bien différent de celui du bassin méditerranéen, et la pluie et le brouillard peinent à simuler la ville d’Alexandrie. Le décor et les palmiers importés supportent mal les intempéries. La Twentieth Century Fox prend alors la décision de démonter les plateaux et de les reconstruire dans les studios italiens de Cinecittà. C’est ainsi que le forum romain reprend des couleurs ! Mankiewicz demande à John de Cuir, en charge des décors, de construire la fameuse place en gonflant ses proportions de deux à trois fois par rapport à l’originale, afin de la rendre plus impressionnante. Lors de l’arrivée de Cléopâtre à Rome, la reine arrive sur un trône d’or porté par des serviteurs, suivi d’une réplique de Sphynx de dix mètres de haut sur vingt mètres de long. Quant aux intérieurs, ils ne manquent pas non plus de panache. La chambre de la protagoniste principale est synonyme d’opulence, avec ses palmiers dorés, ses colonnes, ses drapés et sa vaisselle sertie de (fausses) pierres précieuses. Souvent cité par Andy Warhol comme l’un de ses films favoris, Cleopatra raflera quatre Oscars lors de la cérémonie de 1964, récompensant son esthétisme (meilleure photographie, meilleure direction artistique, meilleure création de costumes, meilleurs effets visuels), laissant bredouille les acteurs et Mankiewicz. Longtemps considéré comme le film le plus cher d’Hollywood, éreinté par la presse à scandale en raison de la liaison des deux acteurs principaux (tous deux mariés par ailleurs, offrant à Taylor son quatrième divorce), l’histoire rocambolesque de Cléopâtre est généreusement commentée dans le documentaire Cleopatra: The Film That Changed Hollywood (2001), parfait complément à cette fresque épique.

Cleopatra, Joseph L. Mankiewicz, 1963
Texte de Justin Morin
C.Q.F.D. du cinéma
à l’ère des séries
Luca MarchettiThibaut de Saint-Maurice
Cinéma et séries télévisuelles, on pourrait croire qu’il s’agit plus ou moins de la même chose. L’un se regarde en salle, les autres se consomment potentiellement partout. Le film est compact, tandis que la série nous entraîne dans une narration itinérante. Mais il est toujours question d’images en mouvement, d’histoires, d’acteurs… et de gros budgets. J’en ai discuté avec Thibaut de Saint-Maurice, philosophe, afin de comprendre pourquoi, d’après lui, ces deux spécimens culturels n’ont rien à voir l’un avec l’autre.
Luca Marchetti
Depuis maintenant deux décennies on ne cesse de questionner le futur du cinéma, mis à mal par l’engouement global pour les séries. Comment un genre si proche du cinéma a pu s’imposer comme forme narrative incontournable dans notre présent ?
Thibaut de Saint-Maurice
Avant de s’incarner en un produit télévisé de grande consommation, le « mode sériel » est depuis la nuit des temps une façon pour les humains de « raconter la vie » et d’en transmettre la mémoire. La généalogie des séries remonte aux histoires orales et aux contes populaires anciens. Puis il y a eu le feuilleton… La période qui va de la fin des années 1970 aux années 2020 n’est, pour les spécialistes, que le troisième âge (d’or !) de la série. On pourrait l’appeler le « tournant ethnographique » ; lorsque les séries ont commencé à documenter la vie ordinaire en se penchant sur des univers professionnels singuliers qui génèrent des formes de pouvoir sur la vie réelle des gens, comme le commissariat, l’hôpital… Et d’autres milieux peu accessibles au regard des gens communs.
Luca Marchetti
Pourtant ces milieux ont aussi été l’objet de nombreux films. D’où vient donc la spécificité des séries vis-à-vis du langage cinématographique ?
Thibaut de Saint-Maurice
Comme le cinéma, la série a fourni un traitement critique, ou alors une célébration de ces lieux de pouvoir. Mais pour le faire de manière percutante et efficace elle a de son côté le « long terme » et la possibilité de raconter des situations complexes en les découpant en épisodes successifs, ce qui permet aussi une incroyable flexibilité scénaristique… tout peut évoluer, voire s’inverser au fil du temps. Ce sont des aspects essentiels pour investir les coulisses de réalités peu accessibles au plus grand nombre.
Un autre facteur de réussite, d’ordre stratégique, tient au fait que la plupart des séries a été portée par des chaînes du câble qui ont incessamment besoin de nouveauté et de pousser de plus en plus loin le curseur des intrigues, de la caractérisation des personnages et des formats.
Luca Marchetti
Le cinéma a depuis sa naissance essayé de donner une interprétation du réel et, dans certain cas, il a carrément souhaité proposer une version alternative de certains faits historiques. Peut-on s’attendre à ce que la série en fasse de même ?
Thibaut de Saint-Maurice
Absolument. La « grammaire communicationnelle » de la série décrite plus haut s’insère toujours dans un contexte social spécifique. Aujourd’hui on a le sentiment que les mécanismes qui font tourner le monde ne cessent de se complexifier. Et la compréhension de ses rouages demande souvent des compétences que nous n’avons pas. Il suffit de penser à la crise de confiance politique au sein des grandes démocraties analysée par le sociologue Anthony Giddens.
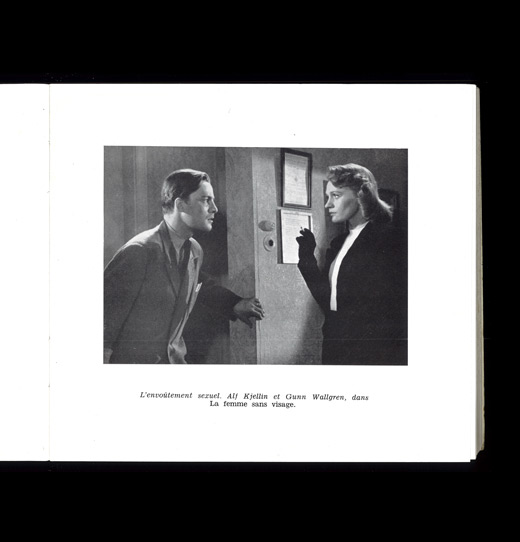
La Femme sans visage (Kvinna utan ansikte), film de Gustaf Molander, scénario d’Ingmar Bergman, 1947.
Extrait du livre Ingmar Bergman et ses films de Jean Béranger, édité par Le Terrain Vague, Paris, 1959.
Bibliothèque Alexandru Balgiu
En mettant en scène les coulisses du système, la série a une fonction pédagogique et même sans le vouloir, elle aide à réparer la confiance en l’institution. Elle transforme le spectateur en expert !
Luca Marchetti
Il y a une dizaine d’années, en constatant l’impact des grands blockbusters chinois sur le marché cinématographique international, certains se demandaient si le cinéma était en passe de devenir le « nouvel opium du peuple ». Est-ce que ce ne sont pas les séries qui auraient dû être pointées du doigt ?
Thibaut de Saint-Maurice
Pas du tout. Les séries, quoi qu’on en dise, développent chez le spectateur des compétences et des points de vue très divers, et inclut une expertise d’ordre démocratique et citoyen. Elles peuvent également stimuler un certain sens critique et une pensée individuelle qui n’est pas sans impact sur les questionnements existentiels et métaphysiques de chacun.
Luca Marchetti
Peut-on voir des emprunts linguistiques entre série et cinéma ?
Thibaut de Saint-Maurice
Pas beaucoup en fait. La série télé s’est construite indépendamment du cinéma : des éléments comme le générique, des pauses dans la narration censées accueillir les coupes publicitaires, le résumé des épisodes précédents qui suggère toujours une interprétation des événements racontés, mais aussi la technique de réalisation qui se fait souvent en présence d’un public face à deux-trois plateaux de tournage en intérieur qui se succèdent, les cadrages serrés… Tout ça confère à la série un langage tout à fait original. J’ajouterais aussi la présence cruciale de la figure du showrunner. Ce n’est pas un scénariste, ni un réalisateur, mais plutôt le « directeur artistique » de la série. Au cinéma cela n’existe pas. Le profil le plus proche est l’auteur-réalisateur dans le domaine des films d’essai. Dans le showbusiness contemporain, le showrunner a une légitimité et une « autorialité » que le réalisateur n’a pas…
Luca Marchetti
Il y a quand-même eu une filiation esthétique entre le cinéma et les séries, notamment au niveau de la photographie et de l’esthétique générale des images…
Thibaut de Saint-Maurice
Games of Thrones est souvent citée parmi les séries les plus proches de l’esthétique cinématographique, avec beaucoup de plans larges et beaucoup de tournages en extérieur. Ceux-ci restent quand-même limités en nombre et l’effet spectaculaire final tient surtout aux effets spéciaux numériques ajoutés en phase de post-production. Je citerais plutôt le jeu vidéo que le cinéma en tant que référence.
Dès les années 2010 on a vu arriver une génération de nouvelles séries avec une qualité esthétique remarquable, comme Mad Men. Ces séries qu’on rapproche le plus souvent du cinéma, visent la reconstitution historique ou la recréation « d’ambiances » typiques d’une époque ou d’un lieu… comme le néo-western Dead Wood. Mais il reste toujours une différence fondamentale entre les deux genres : la série est toujours portée par les dialogues, par la dynamique entre les personnages et non pas par la mise en image ou le récit, contrairement au cinéma. Ce qu’on valorise vraiment dans les séries c’est la vie ordinaire, la reconstitution des formes de vie d’une époque, d’un lieu, d’une famille comme dans Downtown Abbey, jusqu’au « normal de l’extraordinaire » quand il s’agit de dévoiler au monde le protocole royal dans The Crown.
Luca Marchetti
Et inversement alors ? Quels sont les apports de la série au cinéma contemporain, par exemple au niveau de la définition du film et du design des personnages ?
Thibaut de Saint-Maurice
Sur le plan de la conception même du film, le format de la série a systématisé au cinéma la logique des franchises « à thème » telles que les réactualisations de Superman ou Batman en y incluant le principe peu orthodoxe de sequels et de prequels bien que ceux-ci ne soient pas toujours justifiés par les sources originales de ces histoires (livres, bandes dessinées etc.). En deuxième lieu, la série a familiarisé le public avec des personnages aux vies complexes et des intrigues à rallonge même pour des blockbusters très populaires. Le personnage idéal de la série, à la fin du récit, a peu en commun avec ce qu’il était au début. De même, en ce qui concerne les intrigues, la série raconte des histoires de transformation, de révolution et de mutation. C’est essentiellement l’inverse de ce sur quoi le cinéma s’est construit, à savoir la définition d’un type humain,d’un état d’esprit, d’un caractère, d’un moment singulier de l’histoire. Le cinéma « fige » et définit un mode narratif statique, dans la série tout est mobile.
Luca Marchetti
Peut-on imaginer que le « grand saut » du cinéma dans le futur se produira lorsque le film se détachera du contexte de sa diffusion, notamment la salle : à l’image des séries qui vivent aussi bien à télé – pour laquelle elles sont nées – que sur un smartphone, sur un écran home cinéma 4K, ou encore dans une salle…
Thibaut de Saint-Maurice
Oui probablement. Mais le pas à franchir n’est pas anodin car le cinéma est le résultat d’un médium (le dispositif que vous décrivez), alors que la série est le résultat d’un nouveau « regard », notamment celui qui a été porté sur l’ordinaire, sur l’intime.
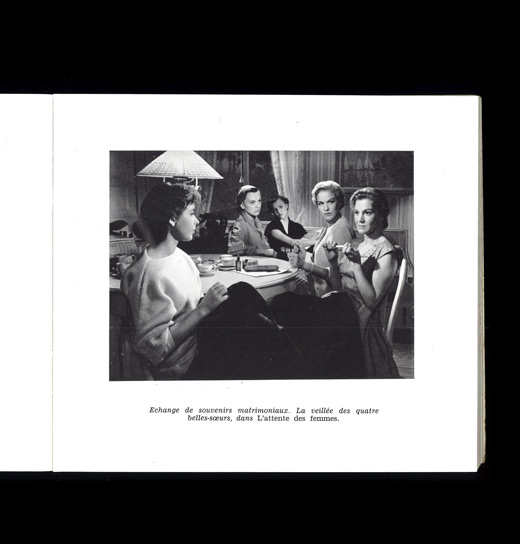
Carolien Niebling, The Sausage of the Future, 2017. Projet soutenu par l’ECAL et publié par Lars Müller Publishers.
Un autre obstacle à cela est le fait que le cinéma est né comme un art de l’image tandis que la série est un art de la conversation et du dialogue. Paradoxalement elle est plus proche de la radio que du cinéma !
Faux-semblant
Brice Dellsperger
Se plonger dans l’œuvre de Brice Dellsperger, c’est revisiter un pan de l’histoire du cinéma à travers les films fétiches de l’artiste. S’il a consacré certaines de ses pièces à David Lynch, Gus Van Sant ou encore Paul Verhoeven, son réalisateur de prédilection reste Brian de Palma, cinéaste de l’outrance et de la citation dont la filmographie fait d’incessants allers-retours avec celle d’Alfred Hitchcock. En récréant des scènes qui ont marqué sa mémoire de spectateur, l’artiste français leur rend hommage tout en soulignant les thèmes qui les traversent, dessinant ainsi les contours de sa propre réflexion. Identification, genre, artifice, les sujets de réflexion sont nombreux sans pourtant être convoqués solennellement puisqu’ici, tout s’apprécie à travers le plaisir pop du cinéma.
C’est en 1995 que Brice Dellsperger signe la première vidéo de sa série Body Double. D’une durée de quarante-huit secondes, diffusée en boucle, il y rejoue le rôle de Kate Miller, interprété par Angie Dickinson dans Dressed to Kill (1980) de Brian de Palma. En se travestissant pour se glisser dans la peau de cette femme au foyer, le vidéaste place le je et le jeu au cœur de sa pratique. C’est à la fois sa mémoire de spectateur et ses interprétations qui seront traitées à travers ces re-créations tout aussi rigoureuses dans leur mise en œuvre que ludiques dans leur réception. En 2020, Brice Dellsperger présentait son 37ème Body Double (de nouveau consacré à l’inépuisable Dressed to Kill).Ce nombre conséquent permet d’affirmer une chose : si le principe du remake est la ligne directrice qui sous-tend son travail, Brice Dellsperger ne s’impose aucune règle qui viendrait étouffer sa créativité. Dans Body Double 31, célébrant le Basic Instinct (1992) de Verhoeven, le personnage de Catherine Tramell affirme : « I don’t make any rules, I go with the flow. » (Je ne fixe aucune règle, je prends les choses comme elles viennent.) Une prise de position que l’artiste semble s’approprier. Y aurait-il pourtant quelques éléments qui viendraient contrarier cette liberté ? Brice Dellsperger répond :

Brice Dellsperger, Body Double 5, 1996, 5’40. Acteur : Brice Dellsperger. Production : Brice Dellsperger. Avec l’aimable autorisation de l’artiste et des galeries Air de Paris (Paris) & Team Gallery (New York).
« Le travail se construit sur les relations avec les gens avec qui je collabore, et bizarrement, j’ai parfois plus de retenue envers eux que l’inverse. Mais la limite la plus importante reste matérielle. Dans mes films, je ne construis que ce que l’on voit dans l’image. »
Évoquer l’œuvre de Dellsperger amène à aborder la question de l’interprète. S’il a commencé à jouer lui-même dans ses vidéos pour des raisons pratiques, il a également fait appel à d’autres comédiens, professionnels ou non. On retrouve notamment l’artiste Jean-Luc Verna, connu pour sa pratique décomplexée du dessin : « Il fait partie de mon cercle d’amis. Et puisqu’il est en permanence en train de jouer des personnages,cela me semblait assez naturel de lui demander. Contrairement à moi qui n’avait aucune dextérité, Jean-Luc se maquillait tout le temps, ce qui facilitait les choses ! Nous étions dans une communauté d’esprits ce qui a rendu la collaboration très naturelle. En parallèle, j’ai réalisé quelques castings sauvages en demandant à des personnes rencontrées dans la rue ou dans des clubs s’ils voulaient jouer pour moi. C’est un exercice particulier car contrairement à un casting classique où les gens viennent car ils souhaitent tourner pour toi, il faut là aller vers eux, se présenter et les convaincre. Aujourd’hui, je choisis des personnes qui sont déjà professionnellement engagées, mais je continue parfois de me mettre en scène, car je pense qu’il est toujours bien de revenir aux sources. » Il est pertinent également de s’attarder sur le titre même de la série de Dellsperger. Body Double est un thriller érotique de Brian de Palma sorti en 1984 dont l’intrigue, se déroulant à Hollywood, repose sur l’utilisation d’une doublure, ces acteurs anonymes employés lors de cascades ou autres scènes de nu. Si le vidéaste devient la doublure des personnages qu’il incarne, alors les autres interprètes avec lesquels il collabore sont quant à eux les doublures de l’artiste. Certains Body Double (le 8, d’après Return of the Jedi (1983) de Richard Marquant, ou encore les 9, 10 et 12, de nouveau consacrés au cinéma de Brian de Palma) se présentent sous la forme de triptyque. Les vidéos sont diffusées simultanément et on y voit trois interprètes différents rejouer la même scène. C’est dans cette substitution que se révèlent les singularités de ces acteurs – leur physique, leur gestuelle,mais aussi le caractère commun des personnages qu’ils incarnent, à travers les histoires archétypales qu’offre le cinéma. À propos de cet effet d’écho, Brice Dellsperger commente :
« Je pense que mon travail parle effectivement de cette universalité. Elle est difficile à accepter car elle n’est finalement qu’une banalité. Mais il s’agit aussi de la question de l’identification au cinéma. De quelle manière l’inconscient travaille lorsque l’on s’identifie à un personnage ? Comment se met en place cette possibilité de se reconnaître sans pour autant connaître ? Cependant je ne cherche pas vraiment à livrer une interprétation psychologique de mon travail. J’y vois plutôt une formule mathématique que j’applique et qui produit des effets variables en fonction des individus. Moi-même je ne peux pas voir mes films comme les autres les découvrent. »
Le cinéma célèbre l’artifice, que ce soit par son utilisation du maquillage – le plus rudimentaire des effets spéciaux – ou le principe même de mise en scène. En se travestissant, l’artiste utilise donc l’un des principaux fondamentaux du 7e art. Si la philosophe américaine Judith Butler questionne l’identité à travers le genre depuis les années 1990, la démocratisation et la vulgarisation de sa réflexion, digérée par la culture pop, est plus récente. Lorsqu’on demande à Dellsperger si son travail est politique, il répond : « Mes œuvres n’ont pas cette forme de radicalité qui était caractéristique de l’art politique tel qu’on le concevait lorsque j’ai débuté ma carrière. Ma pratique veut passer pour quelque chose qu’elle n’est pas, elle veut se faire accepter. C’est l’idée d’un rapprochement, de la séduction. Mais puisque cela fait un moment que je développe cette approche, et que tout est politique aujourd’hui, alors je pense que l’on peut dire que mon travail l’est également. Ma manière d’être politique se situe peut-être ailleurs et dépasse la question du genre. Isoler au sein d’un film un élément plutôt qu’un autre me permet d’apporter un éclairage nouveau. »
À travers la série des Body Double, on ressent la passion cinéphile du plasticien. Nous vient forcément l’envie de lui demander quels sont les derniers longs-métrages qu’il a vu. « J’ai apprécié After Blue (2022) de Bertrand Mandico, c’est un objet totalement incroyable. J’ai compris que je l’avais aimé car j’ai envie de le revoir. Dans un autre registre, j’ai revu Buffet Froid (1979) et Tenue de soirée (1986) de Bertrand Blier qui sont extraordinaires. Je ne sais même pas si on pourrait refaire des films comme ça aujourd’hui. Je reste très attaché à la période 1970-80 mais je continue à explorer et à chercher des films qui pourraient faire de nouveaux Body Double. » Les pronostics sont donc ouverts quant à l’inspiration de la 38ème doublure…

Brice Dellsperger, Body Double 12, 1997, 2’18. Acteurs : Alexia, Joy Falquet & Jean-Luc Verna. Images : Brice Dellsperger. Montage & effets spéciaux : Béatrice Marianni. Production : FIACRE. Avec l’aimable autorisation de l’artiste et des galeries Air de Paris (Paris) & Team Gallery (New York).
entretien avec muriel stevenson
Héros
Camille Moulin-Dupré
Auteur du Voleur d’Estampes, manga en deux volumes publié chez Glénat, Camille Moulin-Dupré est un passionné de cinéma. À travers ces illustrations et ce texte qui retrace son histoire, entre souvenirs intimes et plaisirs cinéphiles, il revient sur les films et personnages qui ont façonné son identité d’auteur.
Je suis auteur de manga. Avec un père peintre et une mère qui fut bibliothécaire, on pourrait voir une certaine logique à ce que je sois auteur de bande dessinée : le mélange entre le texte et les images.
Pourtant faire du manga n’était pas une évidence. Si j’en suis venu là, c’est que je voulais faire des films. Aussi loin que je me souvienne, je suis toujours allé en salle. Dès l’âge de trois ans, j’y ai accompagné ma mère durant les week-ends et les vacances. Adolescente, elle séchait les cours pour aller au ciné. Elle était passionnée par Truffaut et avait une fascination sans borne pour Christopher Walken. Assez naturellement, elle m’a emmené avec elle. Petit, j’ai pu voir toutes les daubes que je voulais (j’ai vu toutes les adaptations des Tortues Ninja). On pouvait aller en salle deux fois par jour, voir cinq à sept films par semaine. Du cinéma Hollywoodien. Du cinéma d’auteur. Du cinéma asiatique. Bref tout. Sans compter les cassettes vidéo.
Avec mon père, qui peignait avec la télévision en fond sonore, j’ai découvert les polars, la science-fiction et les films d’action, que l’on voyait sur Canal + ou en magnétoscope. J’ai une très grosse culture vidéoclub. Pourtant le cinéma n’était qu’un divertissement… Ce que je voulais, c’était faire les Beaux-Arts.
À cette époque, fin 90, début 2000, le Graal pour les étudiants était de posséder une caméra DV. Un caméscope numérique, une Sony de préférence, avec un Mac pour faire du montage. Tout le monde voulait faire des installations vidéo… Moi j’avais tout claqué dans un PC. Ni mes parents ni moi ne pouvions m’offrir de caméra.
Pourtant je sentais que je voulais faire de la narration en vidéo. Et peu importe si c’était en basse résolution. Pendant un temps, j’ai utilisé une webcam avec un dictaphone couplé à un micro de PC. On ne peut pas faire plus cheap. Tout le monde me le rappelait sauf mon professeur de vidéo qui m’encourageait. De l’image et du son: c’est tout ce qui compte sur un écran quand on a les bonnes intentions.
Mais très vite, je me suis heurté à deux réalités. Le cinéma est un art collectif et moi j’étais seul. Et j’ai compris que lorsque l’on ne sait pas cadrer avec un caméscope, comme c’était mon cas, alors il était compliqué de faire un film. Pourtant deux ou trois ans plus tard, un producteur me signait pour réaliser un premier court-métrage, avant même que j’obtienne mon diplôme. Et ça, c’est en grande partie grâce à Satoshi Kon.
Satoshi Kon le réalisateur qui m’a donné envie de faire du cinéma
Les amateurs de cinéma d’animation connaissent tous Satoshi Kon. Pourtant, le jour où j’ai découvert son premier film, j’étais seul dans la salle. Tout juste bachelier, avec un appétit délirant autour du Japon, Perfect Blue m’a mis une grande claque. En voyant ce thriller psychologique où une ancienne chanteuse de girls band sombre peu à peu dans la schizophrénie, je comprends que les films d’animation peuvent être pour adultes. Je suis fasciné par la façon dont Kon mêle le réel, l’imaginaire, l’onirisme, les cauchemars ou les visions délirantes. Et si j’utilise le fantastique et les cauchemars dans mon œuvre, c’est probablement du fait de son influence. Quelques années plus tard, je découvre sa série Paronaïa agent (2004), que je considère comme son chef d’œuvre. Il y a notamment un épisode qui se passe lors de la création d’un dessin animé. L’occasion pour le réalisateur de décrire tous les métiers : animateur, réalisateur, décorateur, coloriste. Cet épisode, c’est le déclic. À partir de là, c’est décidé, je peux faire de l’animation chez moi, seul, en autodidacte. Il me suffit juste d’enfiler toutes les casquettes. Je ne sais pas animer ? Pas grave, je filmerai au caméscope et je décalquerai plan par plan à la palette graphique. Je ne sais pas cadrer ? Là, désormais avec un ordinateur, j’ai tout le temps de peaufiner mon plan. Je réalise alors en autodidacte sept minutes d’animation, avec mon petit frère de sept ans comme interprète principal. L’animation vaut ce qu’elle vaut, par contre je soigne le découpage, le montage, le jeu avec la musique, et surtout le style graphique.
Quand Bruno Collet, un réalisateur de films d’animation passe à mon école des Beaux-Arts, je lui montre mon film, histoire d’avoir un avis. Une semaine plus tard, son producteur me laisse un message sur mon répondeur. Ils seraient très heureux que je réalise un court métrage pour eux.

Camille Moulin-Dupré, Mima, l’héroïne angoissée et son double maléfique du film Perfect Blue de Satoshi Kon.
Jean-Paul Belmondo, l’acteur pour lequel j’ai réalisé un film
Quand Jean-François le Corre, le producteur du studio Vivement Lundi! me propose de faire un film sur Belmondo, j’ai du mal à être enthousiaste. Bébel a beau être une icône du cinéma, pour moi c’est un vieil acteur qui n’est pas de ma génération. Mais faire un film n’est pas une occasion qui se refuse.
J’ai alors en tête un autre chef d’œuvre de Satoshi Kon : Millennium Actress (2001). La vie fictive d’une actrice qui a traversé tout le cinéma japonais. Avec Belmondo, je mesure bien que je peux faire la même chose avec le cinéma français. En regardant cinq films de Jean-Luc Godard et de De Broca, je me rends compte que l’acteur français a joué tous les genres : polar, aventure, comédie, drame, action… Et aussi, qu’il court toujours après une fille : Anna Karina, Jean Seberg, Ursulla Andress, Françoise d’Orléac… L’idée du film Allons-y! Alonzo! (2009) me vient instantanément : Bébel qui part à la poursuite d’une jeune femme, en explorant sa filmographie, le tout dessiné comme le journal de Tintin.

Camille Moulin-Dupré, Jean-Paul Belmondo en Pierrot le fou, extrait de mon film ALLONS-Y ! ALONZO !
Wes Anderson, le réalisateur par lequel je suis arrivé au manga
C’est en voyant Fantastic Mister Fox (2009) que m’est venue l’idée du Voleur d’estampes. En sortant de la salle, je me suis mis à raconter ma propre histoire de cambrioleur. Mais je voulais la transposer dans le Japon du XIXe siècle, avec une esthétique fidèle aux maîtres de l’ukiyo-e : Harunobu et Hiroshige.
Et voici comment m’est apparu mon nouveau film d’animation ! Un projet hybride que je voulais aussi transposer en livre. Au final le film ne s’est jamais fait.Il est devenu un manga en deux tomes édités chez Glénat. Aucun regret, bien au contraire : en quatre cents pages on peut raconter bien plus de choses qu’en quinze minutes d’un court-métrage.
Pourtant ce projet je l’ai vraiment pensé comme un film d’animation. Chaque case est un plan, chaque chapitre est une scène. Je compose mes doubles pages comme si elles étaient un cadre de cinéma. Le cinéma, c’est avant tout raconter en image plutôt qu’en mot. Aussi pour chaque tome, je dessine d’abord toutes les planches et ce n’est qu’une fois les images terminées que j’y ajoute les dialogues. Si une image se suffit à elle-même, pas la peine de rajouter du texte.
Le premier tome a été un succès inattendu, en grande partie par son style visuel, et aussi grâce à la passion grandissante du public envers le Japon. Cela allait faire un an jour pour jour que le livre était sorti. La veille, j’ai dit à ma fiancée à quel point j’étais heureux de fêter l’anniversaire du Voleur d’estampes, mais que le plus beau des cadeaux serait un coup de téléphone pour du travail. Et ç’a été le cas. Octavia Peissel, la co-productrice de Wes Anderson m’appelle pour me dire qu’il avait lu et aimé mon manga, et qu’il souhaiterait que je travaille sur son prochain film qui se déroule au Japon : Isle of Dogs (2018). Moi qui était autodidacte, j’allais travailler pour un grand cinéaste ! Comble de la chance, je me suis retrouvé dès le départ à travailler sous les ordres directs de Wes Anderson, avec Octavia comme relais entre nous deux. Wes est la personne la plus intelligente que j’ai rencontrée. Il a un regard terriblement affûté, il voit tout, la moindre erreur, instantanément. Avec lui, il n’y a pas de place pour l’imperfection. Il faut aussi accepter qu’on est là pour nourrir son imagination. Une imagination que je pressens comme perpétuellement en mouvement, et derrière laquelle on court toujours. Produire pour lui est long et exigeant mais il y a une véritable satisfaction à passer autant de temps sur une simple image. À la perfectionner. Surtout quand le résultat est là.

Camille Moulin-Dupré, Mon Voleur d’estampes, face au loup de Fantastic Mister Fox, de Wes Anderson. Le Voleur d’estampes, tomes 1 & 2 édité chez Glénat manga.
Mad Max Fury Road, mon film préféré
Immortan Joe, Furiosa. Un univers qui me transporte instantanément. Pourtant esthétiquement, c’est assez éloigné de mes goûts. Mais la fascination est bel et bien là. Mad Max Fury Road (2015) est tout ce que j’aime dans le cinéma. La première fois que je l’ai vu, c’était en après-midi. J’ai enchaîné ensuite avec une soirée spéciale qui projetait les deux premiers Mad Max, pour finir à nouveau sur Fury Road.
La nuit qui a suivi, j’ai rêvé en boucle des visages d’Immortan Joe et Furiosa. Puis j’ai été incapable de faire quoi que ce soit pendant une semaine. Même chose, toutes les fois où je l’ai revu. En réalisant cette illustration, j’ai de nouveau commencé à rêver du film…

Camille Moulin-Dupré, Immortan Joe et Furiosa, les héros de Mad Max Fury Road
Baby Rock
and Doll
Nicolas di FeliceCaroline PoggiJonathan Vinel
Après de nombreuses années à travailler dans l’équipe du designer Nicolas Ghesquière, et un rapide passage dans le Dior de Raf Simons, Nicolas di Felice a tout récemment été nommé directeur artistique de la maison française Courrèges. Enfance dans un petit village belge, non loin de néons de maisons closes, puis études à la Cambre à Bruxelles, qu’il ne termine pas pour rejoindre Paris, et Balenciaga.
Jonathan Vinel et Caroline Poggi font des films, le plus souvent ensemble, parfois séparément. L’un est né dans une banlieue proche de Toulouse, l’autre dans une des grandes villes de Corse. On peut notamment citer Bébé Colère, court-métrage sorti en 2020, commandé par la Fondation Prada ; Martin Pleure, réalisé intégralement sur le jeu vidéo Grand Theft Auto V, ou encore à leur premier long-métrage Jessica Forever.
Décrire les travaux des uns comme des autres en quelques mots serait réducteur, tant les mondes qu’ils proposent sont denses. Leur échange, une fin d’après-midi, en face du parc des Buttes-Chaumont, dessine les contours de leurs univers.
Nicolas di Felice
Je suis encore en train de prendre le rythme chez Courrèges. J’ai commencé il y a un an et demi. C’est la première fois que j’ai ce rôle de directeur artistique. J’ai tendance à être assez control freak : le rapport que j’ai aux vêtements est extrêmement précis. Je pense que jusqu’à présent, je donnais des directions très précises à mon équipe. Pour la collection qui défile en mars, je me suis forcé à lancer un genre de brief, et ne faire qu’un seul dessin. Je suis parti une semaine, et puis j’ai vu ce que mon équipe proposait. C’était très enthousiasmant de voir ce qu’ils comprenaient. Un certain nombre de pièces sont des propositions, des dialogues avec certains des stylistes – j’apprends à travailler avec cette nouvelle équipe.
Caroline Poggi
Après avoir travaillé avec Prada sur notre court-métrage Bébé Colère, Jonathan et moi avions pu assister au développement d’une collection : elle n’était prête que deux ou trois jours avant le défilé.
Jonathan Vinel
C’est tellement différent du cinéma, cette temporalité.
Caroline Poggi
En tout cas, c’est différent de notre façon de faire du cinéma. On est dans quelque chose de très préparé. Nos envies de scènes demandent beaucoup d’acteurs, de la lumière… On ne peut pas arriver et dire : on verra sur le moment. En assistant à ça, je ne comprenais pas.
Nicolas di Felice
Je connais vraiment ce genre de choses… Quand j’ai commencé chez Balenciaga en 2008, c’était encore très petit. Dans les vieilles collections, les vêtements sont parfaits – aussi parfaits que ce dont ils avaient l’air. On croirait qu’ils sont photoshoppés, mais non. On avait une équipe pour le défilé, et puis une équipe pour la pré-collection. Des stylistes travaillaient six mois sur cinq pièces. On les refaisait, encore et encore, jusqu’à ce qu’elles soient parfaites. Si la surpiqûre était un peu trop large, on recommençait tout le vêtement. De nos jours, on peut lancer un vêtement en patchwork de cuirs colorés cinq jours avant un défilé, alors qu’on n’avait pas commandé ces matières encore trois mois avant. Il faut alors, en un temps record, trouver le motif du patchwork, les cuirs, il faut lancer la pièce, la faire fabriquer… C’est un peu fou.
Revue
Vous pensez que les méthodes de travail ont changé entre 2008 et aujourd’hui ? Ou c’est quelque chose d’autre ?
Nicolas di Felice
Je pense que c’est une question de moyens… Aussi, je ne trouve pas ça confortable de faire les choses dans la précipitation. Même si j’ai déjà fait un certain nombre de choses, je me sens – peut-être comme Caroline et Jonathan – toujours en construction. On a envie d’être fier de ce qu’on fait, d’être sûr.
Caroline Poggi
Il y a un temps qu’on est obligé d’avoir, de mûrissement, pour laisser les idées grandir, avoir du relief. Même quand on cherche des pages d’illustration, que l’on pense à la façon dont on va les montrer à des gens, on pèse quelle image arrive en premier, en deuxième…
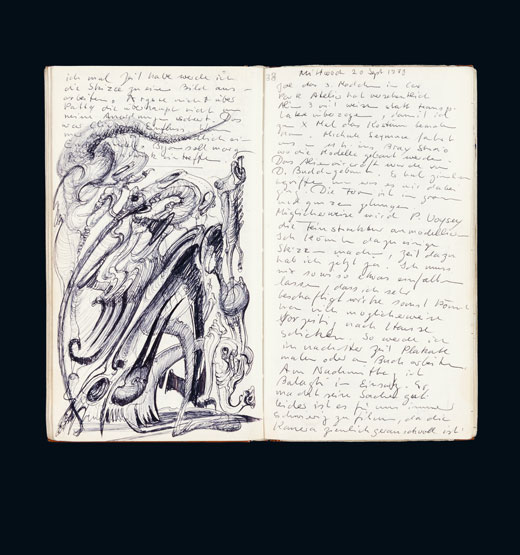

Extrait du livre d’H.R. Giger, Alien Diaries / Alien Tagebücher, Edition Patrick Frey, 2013 (première édition). Avec l’aimable autorisation des éditions Patrick Frey.
Tout ça a un équilibre, que tu ne peux pas trouver en deux jours. C’est dur d’arriver à quelque chose qui a du relief, une profondeur, une histoire, quand tu es dans la pression. Tu as tendance à marcher plus à l’instinct – même si ça peut être bien.
Nicolas di Felice
Ça peut être beau aussi… Une pièce à laquelle tu n’avais pas pensé, une scène que tu n’avais pas voulue…
Caroline Poggi
Je pense qu’il faut les deux. On peut garder cette notion d’instinct sur un temps plus long. C’est quand tu retravailles trop quelque chose que tu perds le désir.
Jonathan Vinel
Nicolas, est-ce que tu as une histoire de marque à respecter, ou est-ce que tu es totalement libre ? Est-ce que tu peux tout changer ?
Nicolas di Felice
J’ai hérité de la maison dans l’état dans lequel elle était, il y a un an et demi. Je n’ai eu aucune exigence de qui que ce soit. La famille Pinault, à qui Courrèges appartient, ne savait pas ce que j’allais présenter : je n’ai fait aucun dossier d’images, de croquis… J’ai été engagé sur une lettre, où je racontais ma vie. Ils ont parié sur moi, ne sachant absolument pas ce que j’allais faire. Je n’ai jamais rêvé d’avoir ma marque, avec mon nom. Ce qui me plaisait dans le projet, c’est de faire revivre une maison que j’affectionne beaucoup, et qui m’a toujours inspiré.
Jonathan Vinel
Mais qui a aussi un héritage.Nicolas di Felice C’est pour ça que, dès le début, j’ai voulu que l’on fasse des rééditions. Personne au marketing ne m’a rien demandé.
Quand j’ai repris la maison, il me semblait primordial de réfléchir à ce que je voulais proposer, et produire. On parle tout le temps d’écologie... Je voulais réfléchir à ce qui allait être produit, pour ne pas gaspiller. Formellement, mais aussi dans mes idées. Faire un hommage à la maison, ne pas arriver en détruisant tout à grands coups de massue. De manière générale, je n’aime pas trop ce genre d’entrée.
Je trouvais cette marque super belle, comme un petit symbole de quelque chose que je ne retrouvais plus autour de moi. Même le fait que ce soient des vêtements très géométriques, des à-plats de couleurs, des matières absorbantes, très nettes… Dans le flot d’images que je voyais, les images de Courrèges : tout à coup, juste une forme colorée. C’était une respiration très inspirante pour moi, que j’avais envie d’honorer.
Jonathan Vinel
Je me dis que parfois tu dois avoir des idées qui te plaisent, qui te semblent justes, mais qui ne le sont pas par rapport à Courrèges…
Nicolas di Felice
Oui, bien sûr… Mais ça ne me brise jamais le cœur de faire un choix.
Jonathan Vinel
Où vont tous ces trucs que tu ne peux pas faire ?
Nicolas di Felice
Je les transforme pour que ce soit Courrèges, je ne laisse pas tomber l’idée.
Caroline Poggi
Ç’a à voir avec la réception de ton travail : comment ça va être reçu, qui regarde… Comment tu montres un film, c’est pareil.
Jonathan Vinel
Quand on a une commande, on se positionne toujours par rapport à comment ça va être perçu, et comment on dialogue avec ça. Quand tu arrives dans une maison qui a une certaine histoire, j’ai l’impression qu’il y a forcément cette question de comment tu vas te positionner par rapport à elle : parfois, le fait que ça ne corresponde pas à la maison, ça peut aussi créer d’autres envies…
Nicolas di Felice
Les idées rentrent toutes, d’une manière ou d’une autre. Même si c’est seulement du point de vue de l’idée, ce que racontait la pièce… On lui fera raconter la même chose, mais différemment. Il y a ce truc d’opposés qui se rencontrent. Mes inspirations ne sont pas du tout des petites dames des années soixante : je suis inspiré par des choses qui sont sans doute similaires aux vôtres. C’est comme si ça passait très naturellement par un filtre, et que je les remélangeais.
Jonathan Vinel
À chaque collection, tu as une idée un peu globale ou tu la trouves au fur et à mesure ?
Nicolas di Felice
Je me dis tout en une seconde. La musique, le défilé, le lieu, le style… Ça vient comme un flash. Je vois les choses très vite. Le reste du temps, c’est pour tout traduire.
Jonathan Vinel
Pour moi, j’ai l’impression que c’est l’inverse. Au début, c’est plein de petites envies ; et il faut travailler pour qu’elles sortent de quelque chose de purement fétichiste, qui ne veuille pas dire grand-chose… Trouver l’histoire de ces envies en les montant ensemble.
Caroline Poggi
Il y a des images dont tu sais au fond de toi que ce sont des premières images.
Jonathan Vinel
Le totem, un peu.
Caroline Poggi
Ce ne sont pas forcément des images qui restent, au final. Mais c’est l’origine, le battement de cœur… Si tu as l’impression de te perdre, tu reviens à cette image et bon, c’est bon, tu peux repartir. Après, forcément, tu creuses, tu donnes des formes, du relief… Ça part de quelque chose d’intuitif, qui le devient de moins en moins. Tu es obligé de formuler tes idées en permanence, encore plus en étant deux : on passe notre temps à parler, à verbaliser. Petit à petit, il y a des codes, des genres, des ambiances, des sons, des musiques qui viennent héberger ces images initiales.
Nicolas di Felice
Quand je m’emballe dans les belles surprises que je rencontre dans le processus, j’essaie de me rappeler, me remettre dans ces images du début. Ou bien, quand on n’a pas le lieu que l’on veut pour faire un défilé, il s’agit quand même de trouver la manière de raconter l’histoire que l’on avait en tête. Heureusement, il y a une évolution au cours du processus : tout ce qui en fait partie est intéressant, même parfois certains incidents.
Jonathan Vinel
Est-ce que tu te racontes une histoire quand tu crées une collection ? Ou bien est-ce que ce sont des choses visuelles, sensorielles ?
Nicolas di Felice
Je ne me raconte que des histoires. À la Cambre, c’était assez troublant, parce qu’ils tenaient quand même à l’art en général. Tu découvres des artistes, des expositions qui résonnent un peu en toi. Mais j’avais du mal à venir avec des documents d’inspiration. Caroline, je t’avais entendu parler de votre court métrage After School Knife Fight, et je me reconnais dans cette idée de tenter de représenter un sentiment – c’est la fin de l’adolescence, ce film. Je n’étais inspiré que par ce genre de choses. Une fille que j’avais croisée à un festival de musique, qui dansait devant un mur de speakers… Mais va trouver cette image !
Caroline Poggi
Et même si tu en avais une image, elle ne représenterait pas le moment.
Nicolas di Felice
Pas vraiment.
Caroline Poggi
C’est un état.
Nicolas di Felice
Ce sont des moments, des sentiments, des rencontres. Après, heureusement, à trente-huit ans, j’ai eu la chance de trouver des artistes…
La première fois que j’ai vu des photos de John Divola, je me suis dit mais c’est exactement tout ce que j’aime. J’avais l’impression de comprendre totalement ce qu’il faisait, mais aussi d’être compris. Il y a aussi des photos de Mapplethorpe...
Maintenant, je peux faire des moodboards, mais pendant mes années d’école c’était problématique… Jonathan, Caroline, est-ce que vous fonctionnez avec des moodboards ?
Caroline Poggi
Je n’aime pas ce mot.
Nicolas di Felice
C’est vrai, moi non plus
Caroline Poggi
Mais je vois évidemment ce que tu veux dire. Moi aussi je dis comme ça, parce que c’est difficile d’appeler ça autrement. Et puis, nous en faisons.
Jonathan Vinel
Énormément. Le problème, c’est que souvent, dans les images, je cherche à montrer le sentiment qu’elles m’évoquent. Quand tu les montres, les gens vont voir des formes, des couleurs… Alors que c’est quelque chose d’intime qui te rattache à cette image. Souvent, ce n’est pas dans l’image elle-même.
Caroline Poggi
On a beaucoup de retours, en commission – alors que moi j’adorais nos moodboards, que j’étais contente de l’effet que ça produisait sur moi, que ça me donnait envie de faire le film – « C’est dommage, car les images ne correspondent pas trop à l’imaginaire qu’on s’en fait. » Et c’est vrai que ce n’est pas collé, ce n’est pas illustratif. C’est un état, quelque chose d’un peu plus large. C’est tellement dur à transmettre.
Jonathan Vinel
C’est déjà du montage. Les images ne sont pas là pour aiguiller une fabrication précise, mais pour donner un sentiment global de ce que l’on veut dans le film – de l’ordre de la sensation. C’est dur à capter. Souvent, les gens s’arrêtent précisément à ce que l’on voit dans l’image.
Caroline Poggi
« Mais il n’y avait pas cette scène dans le moodboard ? »
Jonathan Vinel
Parfois, on n’en fait pas, comme ça chacun projette ce qu’il veut.
Caroline Poggi
C’est dur de trouver la balance, surtout lorsque l’on fait un travail qui n’est pas naturaliste : arriver à transmettre l’atmosphère, l’univers, de tes plans, de tes scènes. Le problème c’est que ceux à qui s’adressent nos moodboards, qui souvent doivent financer le film, en voient tellement que c’est difficile de leur demander de faire un effort. Il faut que les choses soient simples, faciles à prendre.

Image extraite du livre d’H.R. Giger, Alien Diaries / Alien Tagebücher, Edition Patrick Frey, 2013 (première édition).
Avec l’aimable autorisation des éditions Patrick Frey.
Nicolas di Felice
Je vois très bien. Ce qui motive une collection, c’est souvent quelque chose que j’aurais du mal à exprimer par une image. Quand je fais les premiers briefs de collection, je parle à mon équipe, je leur raconte des histoires. J’ai l’impression – et c’est ce que je ressens aussi dans votre travail – que mes projets demandent beaucoup d’énergie, donc j’ai besoin d’être motivé par quelque chose qui me touche.
Jonathan Vinel
S’il n’y a pas déjà une image qui résume parfaitement, c’est peut-être là aussi que ça vaut le coup de le faire.
Caroline Poggi
Ce qui est difficile pour moi, c’est que je suis la dernière spectatrice de mes films. Je fais un film que j’aimerais voir au cinéma, que j’aime profondément, mais je suis tellement dans le process que je suis incapable de le voir. Jessica Forever, sorti en 2018, on l’a seulement revu dernièrement – quatre ans plus tard. Et encore, on le voit avec du recul – c’est notre film. Je trouve ça quand même fou comme métier.
Nicolas di Felice
Ce sont des films que vous faites avant tout pour vous ?
Caroline Poggi
Non, je les fais pour partager quelque chose que je n’arrive pas à retransmettre autrement.
Jonathan Vinel
Je les fais quand même pour moi, à la base. Quand j’ai commencé, c’était dans l’idée de m’amuser. Il y avait quelque chose de puéril à se dire cette image, avec cette musique, je n’ai jamais vu, j’ai envie de voir ce que ça fait. C’était de l’ordre du test : se dire que quelque chose n’a pas l’air possible, le faire, en être content, et voilà, c’est ça le film. J’ai toujours gardé ce rapport instinctif, de désir, de joie. Au début, j’arrive à les revoir ; mais après, avec toutes les critiques… Tout abîme ton film. Quand j’en fabrique un nouveau, je n’arrive plus à voir celui d’avant.
Nicolas di Felice
Tu as peut-être aussi des regrets, liés aux compromis nécessaires sur le tournage…
Jonathan Vinel
Oui. Parfois je me dis : comment j’ai pu faire ça ? J’ai envie de me couper la tête. Mais je suis toujours content de l’énergie dans laquelle on a travaillé. On a l’impression, quand même, d’être allé au bout de l’idée de ce qu’on voulait raconter.
Caroline Poggi
Mais alors toi, Nicolas, c’est quoi qui t’a fait commencer ? Tu savais que tu voulais faire des vêtements ?
Nicolas di Felice
Je n’étais pas prédestiné à faire ça. J’ai fait des études générales, les jésuites… Vient le moment où tu as 17 ans, et il faut choisir ce que tu fais. J’ai dit : la mode. On me demande tout le temps quels sont mes premiers souvenirs de mode. Je viens de la Belgique profonde, il n’y avait pas vraiment de magazines de mode. Mes parents n’achetaient pas Vogue. J’ai compris ce qu’était la mode par la musique, les clips : pouvoir être qui tu veux par le vêtement, la coiffure… Construire une image. Ensuite, quand j’ai découvert ce que c’était, j’ai vite été happé par le côté manuel de la chose. J’adore fabriquer des vêtements. Je prenais beaucoup de temps, à la Cambre, pour faire les vêtements.
Jonathan Vinel
Tu faisais tes vêtements, jeune ?
Nicolas di Felice
Dès que je suis arrivé à Bruxelles, oui. Je customisais tout.
Jonathan Vinel
Mais plus jeune ?
Nicolas di Felice
Non, je n’avais pas de machine à coudre. Mais je me déguisais tout le temps. Mes parents n’ont qu’une seule photo de moi habillé comme ils m’avaient habillé le matin. Sinon, il n’y a que des photos de moi déguisé.
Caroline Poggi
Moi aussi j’avais la malle aux déguisements, que je sortais le weekend. C’était un panier à linge blanc. On avait une petite caméra. Avec mes copines, on la posait, en mettant le petit écran devant nous pour voir le retour, et on se déguisait, on racontait des histoires.
Nicolas di Felice
Tu faisais déjà des films… Toi, Jonathan, tu faisais aussi des images, petit ?
Jonathan Vinel
Non, j’ai commencé assez tard. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire. J’aimais bien les films, mais je n’en regardais pas trop quand j’étais petit. À un moment, j’avais un pote qui voulait faire des films : j’étais chaud, j’ai acheté une caméra. J’y ai pris goût en faisant. C’est comme ça aussi que j’ai pris goût au montage : essayer de fabriquer des films en chopant des images sur Internet, et en voyant ce que ça racontait en les mettant ensemble. J’aurais voulu faire un BTS montage, mais je n’ai pas été pris. Alors je suis allé à la fac de cinéma. J’avais le sentiment d’être en retard, d’avoir zoné. J’avais redoublé ma seconde, puis j’avais arrêté un IUT qui me soûlait, donc je travaillais à l’usine à côté… Je me disais que si je choisissais le cinéma, il fallait que je travaille dur, que je me lance. C’est pour ça qu’on a commencé tôt à faire des films, même en étant à l’école. C’est quelque chose que j’ai vraiment appris. Je n’étais pas prédestiné à ça. Je pense aussi qu’on m’a montré les bons films aux bons moments, qui m’ont fait des chocs assez forts.
Nicolas di Felice
Quels films ?
Jonathan Vinel
Le premier c’était Elephant de Gus van Sant, que mon oncle m’avait emmené voir. J’ai pris un énorme kick. Deux mois après, j’ai vu Mulholland Drive de David Lynch. Ces deux films ont été très fondateurs : je me suis dit que c’était ce que je voulais faire. C’était aussi lié à la musique. À la base, j’étais bassiste dans un groupe de métal, et je voulais faire ça. Mon premier choc esthétique, c’était Slipknot et Korn. Caroline et moi, on parlait récemment du micro du chanteur de Korn, qui a été fait par HR Giger, celui qui a créé la créature et le vaisseau dans Alien.
Nicolas di Felice
Cette idée de musique est toujours importante dans vos films : vos choix de soundtrack…
Caroline Poggi
On travaille tout le temps avec la musique.
Jonathan Vinel
C’est même sans doute une des choses qui nous a donné envie de faire des films…
Caroline Poggi
… écouter certaines musiques au cinéma.
Jonathan Vinel
Ce sont des musiques liées à un univers, un sentiment.
Il y a ce truc ado, emo : je ne suis pas bien dans ce monde-là. On choisit des musiques agressives, un peu extrêmes. Des musiques qui essaient de tout casser.
After School Knife Fight, c’est le film qui en parle le plus. Pourtant, c’est le plus doux qu’on ait fait. On était en train d’essayer d’avoir les financements de Jessica Forever, un film avec beaucoup d’armes, qui traite de la violence. On a aussi fait Martin Pleure en attendant, celui qui a été fait dans Grand Theft Auto.
Nicolas di Felice
Habituellement, les jeux vidéo ne me touchent pas du tout esthétiquement. J’aime y jouer, mais en terme d’esthétique, j’aime plutôt les choses avec du grain, délavées, les VHS… Quand c’est trop en HD, ça me tend. Pourtant, je trouve que Martin Pleure est très beau. C’est ce contraste entre ce truc complètement froid de la super technologie, et Martin qui dit des choses touchantes.
Jonathan Vinel
C’est un film qui s’est fait très simplement, qui n’était pas écrit. Ce n’est même pas en le faisant que c’est devenu un film. Ça le devient parce que, à force, tu en as envie. Sur le moment, on ne savait pas.
Caroline Poggi
Tu attendais, on attendait, tu me disais : je ne sais pas ce que je vais faire, donc je vais filmer GTA, faire un avatar… De fil en aiguille, tu as écrit un texte. Comme Bébé Colère, notre dernier film : il y a eu les images, l’idée du Bébé, puis la commande de la fondation Prada. On a inclu le film dans leur commande.
Jonathan Vinel
Pendant le confinement, Prada est venu nous voir. Nous avions déjà commencé le film, mais leur commande y correspondait.
Caroline Poggi
Le début de l’idée de ce film, c’est de partir exclusivement d’images d’archives. Nous nous sommes dit que ces archives, nous les avions déjà – sauf que c’était nous qui les avions tournées. On est arrivés avec des images de la Corse, de Toulouse… Et après on a créé le Bébé, qui est un peu une archive aussi : c’est un asset qu’on a acheté, pimpé et animé.
Jonathan Vinel
Il existait déjà.
Caroline Poggi
Et c’était chouette que le film se retrouve sur YouTube. Il parlait avec le moment, avec les un an et demi que l’on venait de vivre, enfermés chez nous à se demander à quoi bon, et il y avait ce bébé qui se demandait exactement la même chose.
Revue
Et vous Nicolas, comment avez-vous envisagé ce moment des confinements, et notamment la production de défilé sous forme de vidéos ?
Nicolas di Felice
Une vidéo d’un défilé de mode, je trouve ça très compliqué. Le premier film, on l’a tourné en une seule prise, comme un vrai défilé. Et c’était diffusé une heure et demie après. J’ai l’impression que cette énergie se voit. Il manquait juste le public.
Jonathan Vinel
Même si un projet ne se passe pas exactement comme on aurait pu l’espérer, on garde toujours des choses des idées que l’on a eues.
Nicolas di Felice
J’ai l’impression que toutes les discussions que l’on a, les rêves que l’on s’échange, même si ça ne se fait pas, ça laisse toujours quelque chose que l’on peut ressortir le lendemain. Les grosses looses aussi, d’ailleurs.
Caroline Poggi
Il y a des personnages que l’on fait sauter de projet en projet. On se dit toujours : la prochaine fois, ce sera la bonne !
Nicolas di Felice
J’ai une robe, aussi, qui est là depuis le premier défilé. Et qui a un peu changé, mais finalement je l’ai trop changée… J’ai revu sa première version, et je me suis rendu compte qu’il fallait que je m’en rapproche à nouveau. Je pense que ça va être son moment, là.
Jonathan Vinel
Pour chaque collection, tu repars de zéro ? Ou il y a des idées, des fils que tu tires de collection en collection ?
Nicolas di Felice
Je tire des fils non-stop. Je ne repartirai jamais de zéro.
C’est une histoire que j’écris petit à petit. Qui a commencé depuis que l’on m’a donné l’opportunité de parler en mon nom. Je pense que je fais ça pour que ça ait un sens pour moi. Tout ce que je fais a été une évolution.
Le premier défilé, c’était la boîte blanche. Puis, le suivant, on était uniquement dans la nature, mais le carré blanc était peint sur l’herbe. Et la dernière campagne, ce sont les mêmes personnes qui étaient dans le carré blanc, endormies dans le métro. Et ensuite, le défilé de mars arrive.
Jonathan Vinel
Ça se déploie, comme des échos.
Nicolas di Felice
J’essaie de laisser quelques surprises, mais la trame est écrite. Je ne peux pas recommencer à zéro. Je fais un métier où on ne sait jamais quand ça va se terminer, et j’en ai conscience. Si ça se termine demain, j’ai envie de regarder ce que j’ai fait, et me dire que j’ai écrit une histoire qui a un sens pour moi.
Caroline Poggi
Quand je vois que nous on travaille sur un scénario pendant quatre ans… Ça correspond à ce que tu dis. Tu pars avec tes totems, tes images de cœur, et puis tu les fais grandir. Mais tu grandis aussi avec…
Les témoins
André Téchiné
Impossible de résumer la filmographie d’André Téchiné, tant celle-ci, qui affiche plus de vingt long-métrages, fait preuve d’une folle diversité, tant par les thèmes que par les époques abordés. Grand maître d’un cinéma que l’on pourrait – paresseusement – qualifier de romanesque et psychologique, il est aussi celui qui aura tourné avec les plus grands acteurs français, offrant même à certains d’entre eux leur premier rôle. Rare en entretien, André Téchiné a accepté de partager sa vision de la musique dans ses films. En préambule et à ce propos, il confiait : « je préfère que ça parte dans tous les sens, comme dans la vie. » Ainsi, cette discussion s’articule autour de cinq morceaux de musique, témoins de son œuvre, que nous lui avons demandé de reconnaître. Ceux-ci couvrent cinq décennies de cinéma, et brassent, dans un mélange kaléidoscopique, anecdotes de création et souvenirs dédiés à ses interprètes.
Marie France
On se voit se voir
Barocco, 1976
Justin Morin
Vous avez écrit les paroles de ce titre interprété par Marie France. Pourriez-vous me raconter l’histoire de ce morceau. Je me demandais également si vous aviez écrit pour d’autres artistes, en dehors de vos films ?
André Téchiné
Non jamais ! On ne me l’a jamais proposé. Je n’ai écrit que des petits moments chantés dans mes films, sans doute parce que parfois, je trouvais que les chansons que je connaissais ne pouvaient pas s’y injecter, donc il a fallu que je me mette au travail moi-même ! Mais j’ai aussi évidemment utilisé beaucoup de chansons qui préexistaient à mes projets. J’ai écrit les paroles de On se voit se voir et ai demandé à Marie-France Garcia de l’interpréter. Elle était tout à fait ravie. La musique est une composition de Philippe Sarde, qui signe la bande originale du film. Je souhaitais également un solo de saxophone, de façon à ce que l’instrument et la voix se détachent. De manière générale, j’aime beaucoup les chansons ! J’aime les utiliser dans mes films parce qu’elles sont comme une récréation. Ces moments n’ont souvent rien à voir avec le propos ou l’histoire qui est racontée. Ça crée un trou d’air qui peut réjouir ou faire rêver. Ils sont comme un changement de couleur par rapport à la musique d’accompagnement qui, elle, guide – éventuellement – le récit et le spectateur.
Justin Morin
Dix ans plus tard, vous avez renouvelé l’exercice de l’écriture des paroles avec le titre Prends moi, dans Les Innocents (1987), toujours pour Marie France.
André Téchiné
Absolument, elle est l’une de mes interprètes préférées.
Justin Morin
Actrice et chanteuse, mais aussi meneuse de revue, Marie France est connue pour être une figure de la nuit parisienne, elle a notamment été une des égéries du Palace. Êtes-vous ou avez-vous été un noctambule ? Comment l’avez-vous rencontrée ?
André Téchiné
Je pense avoir oublié les circonstances particulières. En 1976, à l’époque de Barocco, le Palace n’existait pas encore, il a ouvert deux ans plus tard. Mais son propriétaire, Fabrice Emaer, tenait le Sept, un club situé rue Sainte-Anne. À cette époque-là, je me couchais tard. Je n’étais peut-être pas un vrai noctambule mais je sortais beaucoup avec mes amis de l’époque, en particulier avec Isabelle Adjani ou Roland Barthes, toute une foule très hétéroclite. C’est sans doute au Sept que j’ai rencontré Marie France !
Jeanne Mas
Suspens
Le lieu du crime, 1986
Justin Morin
Ce morceau passe dans le café-dancing de Lili, le personnage interprété par Catherine Deneuve. Comment choisissez-vous ces titres pop ? Vous sont-ils conseillés par le compositeur avec lequel vous travaillez ?
André Téchiné
Ça peut venir de différentes sources, ça peut être des chansons que j’ai entendues sur disque ou à la radio, mais ça ne vient pas du compositeur. Souvent, ces morceaux créent un court-circuit intéressant. C’est aussi pour faire un peu entrer le monde extérieur dans le film. Ces titres m’apparaissent soit au moment du tournage, soit au moment du montage, mais je n’y pense jamais lors de l’écriture. Pour moi, c’est toujours quand le scénario devient du cinéma qu’il appelle le son. Je dois être dans un rapport très direct avec l’image pour voir naître la nécessité musicale.
Justin Morin
Ou alors, il faut que la musique soit dictée par une scène, comme dans Nos Années Folles (2017), où vous avez demandé à Alexis Rault, le compositeur de la bande originale, de créer une mélodie pour un spectacle qui a lieu dans le film. Pour ce passage, la musique a été travaillée en amont pour être prête lors du tournage.
André Téchiné
Tout a fait, mais c’était spécifique puisque que c’était lié à une chorégraphie. Le film montre un petit spectacle fauché, fait avec des bouts de ficelle, présenté par le personnage de Samuel, incarné par Michel Fau. Pour cette scène, il fallait que les danseurs puissent se préparer. Mais je le savais, je souhaitais un passage dansé à ce moment-là du film. Comme pour Barocco, où je savais que ça serait bien d’insérer une chanson à cet instant spécifique. La différence, c’est que Philippe Sarde a quasiment écrit cette chanson la veille du tournage et moi j’ai rédigé ces paroles, sur le moment, à toute vitesse !
Justin Morin
C’est incroyable d’apprendre que ces éléments sont quasiment improvisés car Barocco est un projet qui est esthétiquement très travaillé !
André Téchiné
Barocco est un film très préparé mais en même temps, il y a eu une part constante d’improvisation lors du tournage. À l’origine, son scénario ne tenait que sur quelques lignes écrites sur un mode expressionniste, un peu fantastique, sur le thème du double. Tout a pris corps à Amsterdam, où nous avons tourné, dans un travail acharné.
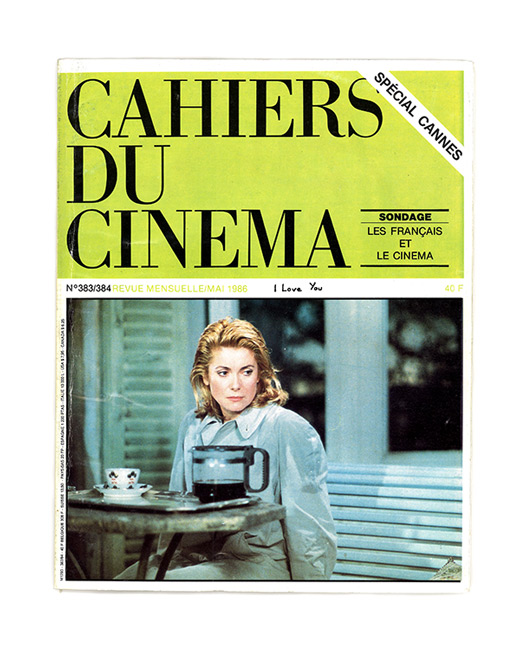
Cahiers du Cinéma, numéro 383/384 de mai 1986, revue éditée par les Éditions de l’Étoile, Paris.
En couverture: Catherine Deneuve dans Le lieu du crime, d’André Téchiné.
On a aussi la chance et le luxe – ou la folie –d’avoir sur ce film des moyens que je n’ai sans doute jamais eus par la suite. Je pouvais faire des mouvements de grue, arroser les pavés pour que les rues deviennent luisantes par rapport à la lumière des scènes nocturnes… Nous avions beaucoup de temps de tournage et de préparation. C’est d’ailleurs pendant ces moments-là que le scénario s’est entièrement constitué.
Justin Morin
Nous avons évoqué le travail de Philippe Sarde, avec qui vous avez collaboré sur pas moins de treize films. Plus récemment, vous avez travaillé avec Alexis Rault sur vos trois derniers longs-métrages. Il y a également dans votre filmographie deux artistes qui font irruption le temps d’un film, à savoir Max Richter sur Impardonnables (2011) et Benjamin Biolay sur L’homme qu’on aimait trop (2014). Comment se sont passées ces rencontres ?
André Téchiné
C’est vrai que ce sont des expériences qui ont été nouvelles et très enrichissantes pour moi. Je ne peux pas concevoir mes films dans une sorte de régularité. Chaque film doit être une expérience esthétique nouvelle, entièrement, radicalement. J’aime me renouveler ou aller ailleurs, et je fais plutôt mon film suivant en réaction à mon film précédent. C’est un peu comme ça que j’arrive à avancer.
J’ai découvert la musique de Max Richter à travers son travail sur le film Valse avec Bachir d’Ari Folman. Elle m’avait ébloui. Je ne parle pas allemand et maîtrise peu l’anglais ; il ne parle pas français, mais cela ne nous a pas empêchés de très bien nous entendre, même si nous nous sommes très peu vus. Je lui ai donné en référence la musique de Vivaldi et Stravinski pour orienter son travail sur Impardonnables qui est une histoire qui se passe à Venise. J’ai été très touché par l’originalité de sa partition et la manière dont elle irriguait le film, à la fois de manière souterraine et rigoureuse. Après Impardonnables, il a lui-même revisité Vivaldi (Recomposed by Max Richter : Vivaldi, the Four Seasons – 2012).
La rencontre avec Benjamin Biolay est passée par Catherine Deneuve, nous nous sommes connus chez elle. Nous avons décidé de nous lancer dans cette expérience car cela nous amusait et nous excitait. Je lui ai montré le film et à partir de là, il a composé très librement la musique. Il m’a livré une masse musicale assez abondante dans laquelle nous avons procédé à des coupes lors du montage. Dans L’homme qu’on aimait trop, je tenais également à ce chant traditionnel corse, interprété par les protagonistes lors d’une scène du repas. Il y a aussi un passage musical où Catherine et Mauro Conte, qui joue son chauffeur, reprennent Preghero, une chanson d’Adriano Celentano que l’on entend dans l’autoradio de la voiture.
Ingrid Caven
La la la
Ma saison préférée, 1993
Justin Morin
J’aurais aimé évoquer avec vous Ingrid Caven, et notamment vous interroger sur son premier mari, Rainer Werner Fassbinder. Est-ce un cinéaste qui vous a influencé ?
André Téchiné
J’aime énormément Ingrid Caven. J’adore cette chanson et les paroles écrites par Jean-Jacques Schuhl. Je tenais à ce qu’Ingrid soit là comme une espèce de personnage tout à fait improbable, un grain de folie. Je connaissais ce morceau, j’en étais amoureux et je voulais l’insérer dans le film. C’est un peu gratuit, mais ce côté-là m’intéressait ! Quant à Fassbinder, c’est un cinéaste, un homme de théâtre, un écrivain, et un acteur que j’aime beaucoup. C’est un ogre, un personnage gigantesque dans le cinéma allemand et dans le cinéma tout court. Mais je tiens à préciser que la présence d’Ingrid Caven n’est pas un hommage indirect à Fassbinder. Je tenais vraiment à sa présence si singulière, tout comme l’est sa manière de chanter. Dans le film, le relais musical se fait sur une composition de Sarde. Je n’arrivais vraiment pas à m’imaginer de la musique pour ce projet, hormis des carillons, et c’est ce sur quoi Philippe a travaillé. Hormis ces cloches, il y a cette chanson, Malaika, d’Angelique Kidjo que j’aime beaucoup et qu’on entend aussi bien pendant le générique de début que celui de fin.
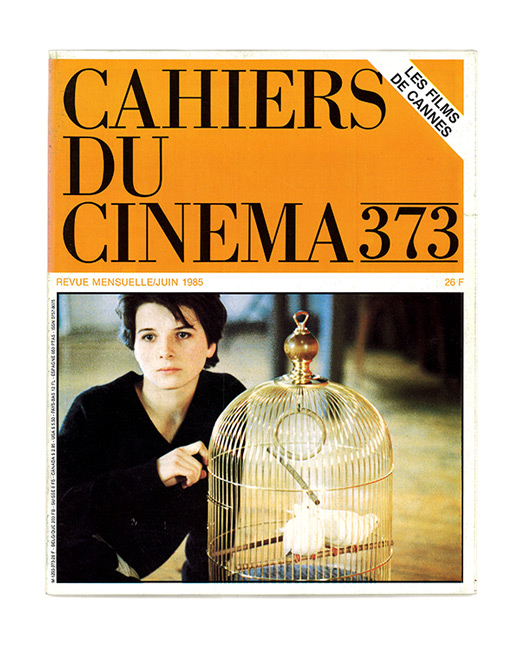
Cahiers du Cinéma, numéro 373 de juin 1985, revue éditée par les Éditions de l’Étoile, Paris.
En couverture: Juliette Binoche dans Rendez-vous, d’André Téchiné.
Vivaldi
Orlando Finto Pazzo, Acte 3
Qual favellar ? Anderò ! Volerò ! Griderò !
Les Témoins, 2007
Justin Morin
Pour ce film, j’ai choisi cet extrait de Vivaldi mais j’aurais pu vous faire écouter Les Rita Mitsouko, un groupe que l’on entend ici mais aussi dans Ma saison préférée ou Les Voleurs (1996). Mais j’ai sélectionné ce morceau pour vous questionner sur la musique classique, un univers que l’on retrouve dans plusieurs de vos bandes originales.
André Téchiné
J’aime effectivement beaucoup la musique classique. Dans Les Témoins, cet extrait de Vivaldi est interprété par Cecilia Bertoli. Elle a une puissance, une exaltation et une vitalité qui me plaît beaucoup.
Justin Morin
Il y a trois ans, Celine Sciamma – avec qui vous avez co-écrit Quand on a 17 ans (2016) – confiait à Revue qu’elle associait toujours un morceau de musique à l’écriture de ses projets, et que ce titre l’accompagnait tout du long.
André Téchiné
Je procède vraiment différemment sur ce point. Il y a parfois des intuitions, comme Vivaldi pour Impardonnables. Je me suis posé la question de la musique lorsque j’ai rédigé le scénario des Sœurs Brontë (1979). À ce moment-là, j’ai pensé à Robert Schumann et à ses Scènes de Faust, car il y avait pour moi une forme de proximité, de familiarité, entre les deux œuvres.
Mais c’est un cas particulier. De toutes façons, il n’y a que des cas particuliers quand on fait des films !
Par exemple, un film comme Les Roseaux Sauvages (1994) est un projet quasiment sans musique, hormis le titre Runaway de Del Shannon que l’on entend durant le générique de fin.
Sia
Chandelier
L’adieu à la nuit, 2018
Justin Morin
Ce morceau apparaît dans votre dernier film. C’est aussi la huitième fois que vous avez travaillé avec Catherine Deneuve, après avoir débuté votre collaboration avec Hôtel des Amériques (1981). À l’époque, vous avez dit d’elle qu’elle était un « sphinx à déchiffrer ». Avez-vous trouvé toutes les réponses à l’énigme ?
André Téchiné
(Rires) Non, pour moi elle n’a rien perdu de son mystère !
Justin Morin
Quel est le projet sur lequel elle vous a le plus surpris ?
André Téchiné
Elle est tout le temps surprenante, on ne sait jamais si elle va arriver au bout d’une prise tellement elle se remet à chaque fois en question. Elle n’utilise pas son savoir-faire, c’est le contraire d’une actrice de métier, elle ne cesse de se renouveler. Ça vient peut-être du fait qu’elle ne soit pas passée par des cours d’art dramatique, ou qu’elle n’ait pas fait de théâtre. Elle a dû inventer sa technique radicalement, au coup par coup, sur chaque film. Parfois en se protégeant, parfois en s’exposant.
Justin Morin
L’adieu à la nuit est votre dernier film sorti en salle. Quels sont vos projets ?
André Téchiné
Je suis en train de faire des corrections sur un scénario dont je viens de terminer l’écriture. C’est globalement achevé mais je dois reprendre certains éléments pour les rendre moins rigides et plus vivants. Tout ça, c’est un travail de détail qui est destiné à rendre le scénario plus convaincant.
C’est comme si on voulait donner une forme littéraire à ce qui va devenir un film. C’est une étape un peu inutile, puisque cette forme va être dépassée par le travail de mise en scène, mais elle reste nécessaire pour accrocher le lecteur et évidemment, les décideurs, puisqu’il s’agit ici de déclencher un financement !
Le film n’est pas encore financé mais j’ai un distributeur et une chaîne de télévision qui s’intéressent au projet, donc j’espère pouvoir le concrétiser prochainement !
Planète sauvage
YelleBertrand Mandico
Réalisateur prolifique – sa filmographie compte plus d’une trentaine de courts et moyens métrages, Bertrand Mandico a confirmé la singularité de son univers avec Les Garçons Sauvages, son premier long-métrage sorti en 2017. Baroque et expérimentale, son écriture transporte dans des territoires luxuriants peuplés de créatures étranges où l’instabilité et les bouleversements semblent être la norme. Cette idée de changement, on la retrouve à travers le titre du quatrième album de Yelle et son clin d’œil astrologique. Intitulé l’Ère du Verseau, le disque du duo français – composé de Julie Budet et de Jean-François Perrier – assume sa mélancolie sans pour autant sombrer dans la noirceur. Avec ses percées de lumière, il conjugue les tourments à l’euphorie. Dans leur manière d’hybrider, qu’il s’agisse des sentiments ou des genres, Bertrand Mandico et Yelle partagent une sensibilité commune. Ils se rencontrent pour la première fois et échangent autour de la puissance des odeurs, du rôle des morts et de leur amour de la nature.
JB Tu es actuellement en salle de montage. Sur quoi travailles-tu ?
BM Je finalise mon deuxième long-métrage. Un film d’heroic fantasy qui se déroule sur une autre planète au féminin. Je ne peux pas en dire plus !
JB En ce moment, tout est chamboulé, mais as-tu déjà une date de sortie ?
BM Il y a une date de finition. Le film sera prêt au printemps 2021.
Après, advienne que pourra, que ce soit pour les festivals ou la sortie en salle.
Vous êtes en pleine promotion de votre nouveau disque ?
JB Oui ! Et normalement, si tout se passe bien, nous serons prochainement en résidence à La Rochelle pour préparer nos prochains concerts, dans une salle qui s’appelle La Sirène. Ils devraient avoir lieu jusqu’à la mi-décembre, uniquement en France. Tout ça, avec un gros point d’interrogation car les règles concernant les spectacles changent vite. Nous avons déjà modifié la tournée en décalant les dates américaines et européennes. C’est un peu triste de sortir un album et de ne pas pouvoir partir en concert, donc on cherche une solution pour pouvoir faire quelque chose, même si l’idée d’un concert assis et masqué ne nous enthousiasme pas, car ça ne nous ressemble pas. Mais nous avons réfléchi, et vu l’accueil du public pour ce disque, mais aussi sa frustration, on s’est dit que c’était aussi notre rôle d’avoir une proposition pertinente et de s’adapter à la situation. Ce qui ne nous empêchera pas de refaire des concerts debout lorsque ce sera de nouveau possible !
Je voulais te questionner sur ton rapport au son dans tes films.
BM La musique, c’est mon inspiration première quand j’écris ou quand j’imagine des films.
J’ai besoin d’avoir de la musique dans mes oreilles, pour imbiber mon cerveau. Et la combinaison musique-voyage est encore mieux. Le mouvement accentue l’afflux d’images. Lorsque je prends le train par exemple, musique aux oreilles, tête contre vitre, la lumière qui bat derrière mes paupières closes me met dans un d’état second et des séquences de films m’apparaissent très clairement.
C’est ma « Dreammachine ». D’ailleurs, Brion Gysin a imaginé sa machine à rêves dans les mêmes conditions…
Ensuite, sur mes tournages, il m’arrive très souvent de diffuser de la musique, pour créer un climat de concentration. Il y a souvent beaucoup de bruit quand je tourne. Je ne prends qu’un son témoin qui n’est pas de très bonne qualité et dont je me débarrasse très vite en montage.
On réenregistre les actrices en studio et on affine ainsi le jeu. On peut obtenir des nuances et des tonalités très particulières. C’est à ce moment-là que nous créons la bande-son, qui inclut les bruitages, et très vite la musique.
Mais pour toi, est-ce qu’à l’inverse, l’image est une source d’inspiration pour arriver à vos musiques ?
JB C’est assez particulier car nous n’avons pas vraiment de recette. Avec Jean-François, on a pas du tout les mêmes références, on a grandi dans des univers assez différents. On ne part pas tout le temps de la même chose. On peut par exemple partir d’un rêve, de quelque chose qui est arrivé en images durant la nuit. Ce qui est difficile quand on écrit une chanson, c’est qu’on a sa propre vision de ce que l’on a envie de raconter et qui ne parle pas forcément à tout le monde. On a toujours laissé la porte ouverte à différentes interprétations, notamment par les images et ce que les gens peuvent mettre dessus. Mais c’est vrai qu’il y a des moments qui sont très inspirants. Je te rejoins sur le train ! J’y écoute aussi beaucoup de musique et je me fais mes propres films.
BM Tu rêves d’images, mais est-ce qu’il t’arrive de rêver de sons ?
JB C’est arrivé, mais c’est de moins en moins fréquent. Par contre, ce qui est plus surprenant, c’est que j’ai des sensations olfactives très précises quand je rêve.
BM Tu penses que l’olfactif pourrait te guider dans l’écriture d’un morceau ? Passer d’une odeur à une autre pour imaginer le cheminement d’un disque.
JB Oui, complètement ! Je n’y ai jamais pensé, tu me donnes une idée ! Ce qui est certain, c’est que les odeurs peuvent me provoquer des émotions très vives. Enfant, je reniflais tout. Et je me rends compte que je continue de le faire. J’ai besoin de sentir tout ce que je mange. Avec la Covid, je suis un peu contrariée car j’aime beaucoup embrasser les gens, les prendre dans mes bras et les sentir. Parfois, ça peut me bloquer dans certains rapports humains si l’odeur me gêne. Ça ne veut pas forcément dire que la personne ne sent pas bon, c’est plus de l’ordre d’une réaction chimique.
BM Tu pourrais imaginer un concert olfactif ! Tout comme John Waters a mis en place une version en odorama de son film Polyester, où les spectateurs étaient munis de cartes qu’ils devaient gratter à différents moments du film, pour révéler des odeurs liées aux séquences. Évidemment, puisque c’est John Waters, les pastilles avaient des senteurs très particulières. Mêlant la guimauve aux odeurs corporelles les plus souterraines.
JB Je me souviens avoir vu enfant un spectacle de la compagnie Royal de Luxe qui s’appelait Peplum. C’était en extérieur ; il y avait un énorme ventilateur sur un rail qui passait devant le public et qui diffusait des odeurs. Elles étaient parfois réjouissantes ou au contraire très désagréables. Je me rappelle avoir été un peu nauséeuse à la fin du spectacle. Ça m’a vraiment marquée. Je me rappelle aussi que lorsque nous avons fait la première partie de Katy Perry, sur sa tournée American Dream, elle diffusait une odeur de barbe à papa dans les énormes salles qui nous accueillaient. C’était un peu écœurant à la fin de la journée de respirer ça !
BM Pour moi, pendant longtemps, l’odeur des concerts et des discothèques, c’était la cigarette.
À partir du moment où il n’a plus été possible de fumer dans ces endroits, j’ai découvert que l’odeur de la musique que l’on partage, c’était la sueur et les parfums qui se mélangeaient mal !
Diffuser de la barbe à papa, c’est peut-être une parade pour éviter ça, parce que finalement, ces odeurs nous renvoient aux humains que nous sommes, aux usines organiques que nous trimbalons toute la journée. Cette évidence peut déranger, le sucre remplace la clope.
JB La transpiration te transporte un peu dans l’intimité des gens. Ça peut en effet être désagréable car on partage une intimité à laquelle on a pas forcément envie d’être confronté. À l’inverse, il y a ce moment de chimie que j’évoquais plus tôt qui peut également se passer positivement. On peut aussi se rencontrer dans l’odeur.
BM Oui, il y des odeurs qui aimantent, des odeurs qui s’aimantent !
JB Et toi, est-ce que le rêve est une source de matière pour tes créations ?
BM C’est une matière à réflexion ! Je note mes rêves dans un carnet et j’essaie d’y comprendre ce qui s’y passe. Pourquoi le grand serpent blanc dans le marécage me parle. Cette pluie de jambes est-elle de bon augure.
J’ai utilisé une seule fois un rêve de façon littérale. J’étais invité par un festival en Islande et je j’ai décidé de profiter de cette opportunité pour y faire un film. Je m’étais fixé comme contrainte une unique journée de tournage. Des amis islandais m’ont proposé leur aide et m’ont demandé ce que je voulais filmer. À ce moment-là, je ne savais pas quoi faire, je ne voulais pas plaquer un scénario réfléchi sur un décor et un pays que je ne connaissais pas encore.


Les Garçons Sauvages, Bertrand Mandico.
Alors je me suis mis à guetter mes rêves. J’ai notamment rêvé d’un homme qui marchait sur une route et qui allait voir une femme bleue pour lui demander combien de temps il lui restait à vivre. C’était parfait et ce n’était pas un rêve hors de prix ! Je raconte mon histoire aux islandais ; tout se prépare, actrice, acteur, caméra 16, le minimum. Ma micro-équipe me parle d’une petite maison bleue, isolée, qui serait parfaite comme décor et me propose de voir si on peut l’intégrer au projet. C’est là qu’on m’apprend quelque chose d’assez troublant. Cette maison appartenait à un peintre décédé et c’est son fils qui en était désormais le propriétaire. Rien n’avait bougé depuis le décès de son père et il refusait tous les tournages qu’on lui soumettait… Mais, pour moi, il a curieusement accepté, très troublé d’apprendre le sujet du film et surtout qu’une femme bleue était censée vivre dans cette maison. Son père, qui y vivait seul, peignait des femmes bleues. Et il était inspiré par l’esprit d’une femme bleue qui venait le visiter ! Le fils du peintre a trouvé la coïncidence tellement troublante… Et moi donc !
Mais, je voulais évoquer tes clips, et plus particulièrement l’investissement du corps. Comment t’es-tu lancée dans cette aventure du corps mis en image et du corps sur scène ? C’est venu en même temps parallèlement à la musique ou ça a été travaillé progressivement ?
JB J’ai fait beaucoup de théâtre quand j’étais plus jeune, jusqu’à mes vingt-trois ans. Je n’ai jamais eu vraiment de problème à me mettre en scène. Pour moi, un chanteur ça n’est pas forcément une grande voix, c’est avant tout quelqu’un qui raconte des histoires et qui les partage sur scène, par la performance. Je pense que quand j’ai commencé, je n’étais pas très à l’aise, j’étais un peu raide. J’avais envie de plus mais il fallait que je lutte. Ce qui est drôle, c’est qu’à l’époque, je voyais une sophrologue qui avait un ami martiniquais. Ils sont venus me voir à un concert et après le spectacle, son ami m’a conseillé d’écouter du zouk. Il m’a dit que ça allait tout changer, que ça allait me débloquer au niveau des hanches et libérer mon corps. J’ai hoché la tête sans trop y croire, et puis quelques jours plus tard, chez moi, j’ai écouté beaucoup de zouk ! Et en effet, quelque chose s’est déverrouillé au niveau de mon bassin. On en a même fait une chanson !
J’ai toujours eu des facilités à assumer mon corps, à en jouer. J’ai toujours porté des combinaisons super moulantes mais fermées jusqu’au cou. Il y a cette idée d’en montrer beaucoup sans dévoiler. J’aime ce double jeu. Cette assurance est peut-être aussi venue avec l’âge, la confiance, il y a tout un tas de paramètres qui entrent en jeu. Car je ne vis pas mon corps de la même manière à différents endroits. Je peux être extrêmement pudique dans ma vie privée et ne pas avoir de soucis à d’autres moments. Il n’y a pas longtemps, j’ai tourné dans une série où j’avais une scène d’amour avec une femme qui était censée être enceinte. J’étais dénudée, avec dix personnes autour de moi. Je pensais que je n’allais jamais y arriver et au final, je n’ai eu aucun problème. J’ai un rapport au corps que je pourrais parfois qualifier d’utile, dans le sens où c’est un outil.
BM Je ne savais pas que tu étais comédienne.
JB J’ai tourné dans cette série en trois épisodes, pour Arte, qui s’intitule J’ai deux amours. Le réalisateur est Clément Michel, c’est la première personne qui m’a fait tourner dans un court-métrage – Une pute et un poussin, en 2009. Il m’appelle toujours, même si c’est pour faire un petit rôle, ou comme ce fut le cas plus récemment pour de la musique. J’aime beaucoup jouer, mais je ne suis pas forcément douée pour aller à la rencontre des gens, je suis certainement trop timide. Et je n’ai pas d’agent. Mais c’est quelque chose que j’aimerais faire plus.
Pour en revenir au corps, est-ce que tu sais d’où te vient cet intérêt qui est très central dans tes films ?
BM J’ai une fascination sans limite pour les corps, sans a priori, sur les sexes, la maturité, les cicatrices de la vie ou autre… Je suis complètement captivé par toute la diversité possible.
J’aime aussi l’idée d’un corps mutant, évoluant. Pour moi, le corps idéal se transformerait en permanence, à volonté. Il serait homme, femme, entre-deux, les deux,multiple, autre, autrement, avec encore plusde fantaisie, d’organes nouveaux ! Avoir des sortes de pénis aux coudes, des seins torsadés dans le dos ou des vagins croisés sur le sternum… Cette fascination m’étourdit, m’enivre et m’euphorise en même temps.
Et puis il y a eu aussi l’intérieur du corps…
Un jour de Pâques, quand j’avais treize ans, ma tante qui était aide anesthésiste dans un hôpital, me gardait chez elle. Elle avait des appels en urgence et j’ai lourdement insisté pour la suivre, car je rêvais d’assister à des opérations. Elle a demandé au chirurgien de garde si je pouvais venir exceptionnellement en observateur, ce qu’il a curieusement accepté.
Il y avait plein d’accidentés ce jour-là, qui arrivaient dans la salle d’opération et, petit à petit, voyant que je n’étais pas effrayé, on m’a laissé m’approcher de plus en plus proche. Jusqu’à ce que je puisse me mettre debout sur un tabouret pour mieux voir.
J’étais subjugué par l’intérieur des corps que je trouvais objectivement beaux et plastiques. Je voyais tous ces organes qu’on sortait et qu’on posait sur des tissus. On lavait l’intérieur des ventres, on réparait, on replaçait les organes. Il y avait des couleurs sublimes : vert amande, bleu nuit, rose nacré. Je trouvais les formes très sensuelles, voluptueuses même. Il n’y avait pas trop de d’odeurs car on m’évacuait au moment d’ouvrir, l’instant le plus critique pour les effluves.
Rien de tout ça n’était glauque, c’était à la fois assez abstrait et positif, car dans un contexte de réparation… Le chirurgien finit par me demander : « Alors, comme ça, tu veux être médecin plus tard ? » Et je lui ai répondu naïf et sûr de moi : « Non artiste ! » Il s’est tourné vers moi sa blouse et ses gants imbibés de sang : « Mais je suis un artiste, à ma façon… ! » Il avait raison. Dans mon souvenir, il ressemblait à Cronenberg.
J’ai une question particulière ! Il y a le cri qui tue. Est-ce que tu penses qu’il y a le chant qui fait jouir ?
JB Je pense, oui ! La voix peut être un organe très sensuel, voire sexuel. Il y a une manière de s’en servir, un peu comme un sextoy, elle peut être un outil de jouissance. Et avec ton cinéma, tu as déjà eu des témoignages dans ce sens ?
BM J’ai reçu via Facebook des messages de personnes qui avaient vu Les Garçons Sauvages et qui ont eu un orgasme ou une extase en le voyant.
Pas des messages graveleux, des témoignages sincères, entre émotion fébrile et trouble profond. Je me souviens d’un témoignage assez détaillé d’une femme qui s’est littéralement liquéfiée sur son siège durant le film. Ou d’autres personnes qui sont allées toucher et caresser l’écran à la fin de la projection… ça m’a surpris, évidemment ! Mais je ne savais pas quoi faire de ces « merci pour ce moment intense ».
J’aime l’idée du film qui nous échappe et creuse son sillon de trouble dans l’esprit de ceux qui l’absorbent.
J’imagine que c’est comme ça aussi parfois en concert ?
JB Certainement ! Je pense qu’on se met beaucoup de barrières, et ça n’est pas si facile de lâcher prise, de s’autoriser à se laisser envahir par les émotions.
BM Peut-être que dans une salle de cinéma, plongée dans le noir, on peut s’oublier, face aux images qui remplissent les murs… Ou dans une foule qui vibre, sous les lumières stroboscopiques, inondés de musiques… Les deux se rejoignent !
J’ai une autre question bizarre pour toi : as-tu déjà fait un concert dans un cimetière pour réveiller les morts ?
JB Ah ah ! Non, jamais !
BM Au-delà de la blague, je me demandais si tu convoquais les morts quand tu chantais.
Je te demande, car c’est quelque chose que je fais quand je filme. Je pense à certains cinéastes qui sont morts, de grandes figures qui m’ont impressionné, donné l’envie de faire des films. Je n’ai pas peur d’aller chercher des noms imposants, puisque tant qu’à faire, autant convoquer les plus grands ! Lorsque j’ai des difficultés à faire un travelling par exemple, je peux essayer de parler à Tarkowsky ou Max Ophuls, en leur demandant de m’aider, à trouver un état de justesse ou d’émotion… Eux qui savaient trouver dans leurs mouvements de caméra un état de grâce absolu. Cette façon de convoquer ses aînés, ses modèles, de ritualiser sa création, comme dans un rituel païen, j’imagine que c’est quelque chose que l’on peut faire dans toutes les disciplines. T’arrive-t-il de faire la même chose avant de monter sur scène ?
JB Pas vraiment, je suis très concentrée sur… moi ! Je pense plutôt aux morts et aux artistes que j’aime dans des moments de création, de recherche et de réflexion. Je fais des sortes de prière. Je ne crois pas en Dieu, mais je crois en beaucoup de forces, comme celle des esprits et de la nature. Je vais parler à la lune quand je sors promener mon chien la nuit ! J’habite à la campagne donc il n’y a pas de lumière autour de chez moi et je vois très bien les étoiles. Mais le rapport à la nature, on le retrouve aussi dans Les Garçons Sauvages.
BM Oui, tout à fait. J’ai grandi à la campagne, dans un petit village, et de façon assez solitaire. Je rentrais en communion avec la nature. J’adorais ramper ! Ce rapport à la forêt, ventre contre terre a une dimension sensuelle et sexuelle. Je me faufilais dans des passages creusés par des renards, sous des buissons, là où seul un enfant pouvait aller. Un peu comme dans les films de Miyazaki, notamment Totoro, j’ai le souvenir d’avoir découvert des lieux complètement inaccessibles et sublimes. Ce rite, ce parcours pour découvrir l’endroit secret, que la nature protège et qui va s’ouvrir à nous comme une fleur, continue à me hanter. Je regrette de ne plus ramper sous les buissons.
JB C’est aussi la nature dans tout ce que ça peut avoir de mystérieux, et parfois d’effrayant.
BM Oui, elle est paradoxale la nature, car elle peut caresser avec ses fruits et en même temps griffer avec ses branches. Il y a aussi des rencontres bizarres, des choses que tu n’identifies pas vraiment, que tu croises sans comprendre ce que tu vois, un fruit pourri mêlé à une charogne d’animal. Il y a parfois des aberrations. Tout ça fait beaucoup travailler mon imaginaire. C’est aussi le cas pour les petits cours d’eau, que j’aimais remonter quand j’étais enfant, toujours pour atteindre des zones inaccessibles, invisibles aux adultes… J’ai aussi une théorie selon laquelle tous les films qui se passent sur une rivière sont forcément réussis. Je pense à La nuit du Chasseur de Charles Laughton, Apocalypse Now de Coppola, Aguirre, la colère de Dieu de Werner Herzog, La rentrée des classes de Rozier, même l’Atalante de Jean Vigo ! Ça se passe sur un canal, mais je l’inclus ! Le cours d’eau insuffle une dimension mystique aux films qui les caresse.
Il y a également les sons de l’eau qui court ou de la pluie. Je suis friand de cette sonorité aquatique mêlée à la musique pour les bandes-son de mes films, c’est une récurrence.
Est-ce que vous utilisez ou détournez des sons naturels dans votre musique ?
JB Pas vraiment. On a utilisé des sons organiques, mais pas de sons de nature. Plusieurs fois, j’ai enregistré avec mon téléphone des bruits de nature, notamment des cris d’oiseaux. Je pense à un oiseau qui revient à chaque printemps et qui fait des sons très particuliers, mais c’est compliqué car il n’est évidemment jamais là quand nous l’attendons. La nature produit des sons très riches, et ce qui est fantastique avec la musique électronique, c’est que tu peux triturer cette matière pour la transformer en mélodie. Certains artistes, comme Jacques, font ça très bien.
BM Lorsque je travaille la matière sonore de mes films, je m’aperçois que je reviens toujours au même orage, au même vent… Je ne trouve jamais aucun son qui sonne aussi bien que celui-là. Il s’harmonise particulièrement avec la musique, mes images, je crois que j’utilise ce vent depuis bientôt plus de 10 ans… Si on parle d’éléments naturels, votre album L’Ère du verseau a un côté très liquide, ne serait-ce que par sa pochette.
JB On avait envie de raconter avec ce visuel l’endroit dans lequel on vit qui est fait de ça. De mer, de tempêtes, de ciels noirs parfois, de peaux mouillées…
BM Est-ce que l’idée du renouvellement d’images et de styles, comme chez David Bowie par exemple, est importante pour vous ? Est-ce que vous abordez chaque nouvel album en vous disant qu’il faut faire peau neuve, se métamorphoser ?
JB Non, on fait les choses de manière assez spontanée.
La musique dans un premier temps et les images ensuite. On n’aime pas trop l’idée de conceptualiser un album. Peut-être qu’on le fera un jour ; je ne dis pas que c’est une mauvaise manière de procéder. Au niveau du son, on se laisse porter, on fait vraiment de la musique « temporelle », on s’inscrit dans notre époque.
On fait notre son avec ce qu’on a comme outils, sans se dire qu’on a envie de sonner comme il y a trente ans ou comme ce sera dans vingt ans. Je crois que nous avons fait un disque qui est très 2019-2020. Évidemment nous n’avions pas prévu cette pandémie, mais c’est vrai qu’il se dégage de cet album quelque chose d’assez sombre. Finalement les choses se croisent et nous dépassent !
PROPOS RECUEILLIS PAR JUSTIN MORIN
Un fantôme que l’on décrit avec complaisance est un fantôme qui cesse d’agir
Céline SciammaFishbach
Scénariste et réalisatrice, Céline Sciamma s’est imposée avec ses trois premiers films comme une auteur singulière, à même de capturer les tourments de ses personnages à travers une écriture aussi délicate qu’incisive. Naissance des Pieuvres (2007), Tomboy (2011), Bande de filles (2014) suivent au plus près des personnages aux destins contrariés pour lesquels on ne peut que vibrer. Cette mythologie moderne, faite de désir d’absolu et de passions, on la retrouve dans le premier album de Fishbach. Mais si À ta merci résonne de manière universelle, il est aussi plein d’une envoûtante étrangeté.
À l’occasion de cette rencontre inédite, les deux artistes reviennent sur leur parcours.
Céline Sciamma J’aime bien le clip qui accompagne la chanson ‹ Y crois-tu ›, celui où tu es éclairée par des écrans d’ordinateur ou de téléphone. Le dispositif est simple mais fonctionne très bien.
Fishbach C’est un clip qui a été fait dans des circonstances un peu particulières. Après les Transmusicales de Rennes, en décembre 2016, j’étais très fatiguée et ai fait de l’hyperacousie. Un tournage assez physique était prévu, je devais recevoir des litres d’eau, de la poussière… J’ai préféré annuler, cela n’était pas possible. Mon label attendait malgré tout un clip. J’ai eu cette idée et ai demandé à un ami de m’aider à la réaliser. On a fait ça dans ma chambre, silencieusement, tout doucement. Avec cette vidéo, je ne voulais pas donner trop d’informations, trop d’histoire. J’ai simplement suivi mon amour de l’esthétique du XIXe siècle et du clair-obscur, mais en essayant de la moderniser. Les visages ne sont plus éclairés à la bougie mais à l’iphone.
CS La première fois que je t’ai entendue, c’était avec le morceau ‹ Mortel ›. Je me suis sentie en intimité avec cette chanson, certainement comme plein de gens. C’est ce que j’aime dans la musique : ce principe d’intimité immédiate. Avec ton disque, il y a également une sorte de réminiscence temporelle car il me rappelle une époque particulière, certains sons des années 80. Dans mon travail, j’aime beaucoup cet aspect anachronique. Je fais des films sur la jeunesse mais ça n’est jamais la jeunesse d’aujourd’hui, c’est une jeunesse intemporelle. J’essaie de ne pas mettre de marqueur du temps. Par exemple, la façon dont les personnages sont habillés est plus liée à l’histoire qu’à une direction artistique stylistique. Il n’y a pas de téléphone portable — sauf dans Bande de filles, mais c’est le plus contemporain. Il y a cette idée d’une jeunesse de cinéma, fictionnelle, donc un peu mythologique aussi. Ta musique a aussi quelque chose de cet ordre-là. Quand j’ai écouté
tes paroles, j’ai vraiment été séduite. J’ai d’ailleurs des petites frustra-tions de mix, je me permets de te le dire ! Surtout sur ‹ Y crois-tu › : on aura beau l’écouter plus fort, elle sonnera toujours pleine. C’est un vrai parti pris.
F Effectivement, c’était notre volonté sur ce morceau. C’est le seul qui est comme ça mais on voulait quelque chose de pop, qui prend toute la place.
CS Certaines phrases étaient comme des énigmes pour moi ! J’ai dû attendre le clip pour comprendre que tu disais les mots « je suis la plage ». De dire tout ça, cela fait un peu fan, mais j’avoue l’être ! Globalement, je trouve que c’est un moment très enthousiasmant pour la variété française, on se retrouve face à une génération talentueuse, et qui décide d’être une génération. C’est assez beau de voir les liens, la façon dont les choses circulent, entre des jeunes artistes qui ont des univers très différents, comme Cléa Vincent, Juliette Armanet ou les Pirouettes. C’est une espèce de conversation que l’on a envie de suivre. Moi j’ai donc entendu un de tes titres, j’ai attendu ton album, je suis même allée te voir en concert alors que je n’y vais pas très souvent. Je vais plutôt voir des artistes comme Madonna ou des vieilles lunes comme Tori Amos !
F Je suis à côté de Madonna et Tori Amos, tu me flattes beaucoup trop !
CS La musique pour moi, c’est le possible surgissement de l’émerveillement au quotidien. Bien plus que le cinéma ou la littérature qui demandent du temps.
F C’est vrai, la musique, tu tombes dessus. Ou alors elle te tombe dessus ! Quand tu entends quelque chose qui t’interpelle à la radio et que tu mets le volume plus fort pour mieux l’entendre, c’est un moment cool et unique.
CS Je passe mon temps seule, chez moi, avec mon clavier, entre six et sept heures par jour. La musique est un compagnon de route. Pour écrire, je choisis toujours une ou deux chansons qui vont m’accompagner sur tout le projet. C’est le programme stylistique qui sera également le programme politique du film. Sur mes trois premiers, c’était des chansons d’Abba. On verra si ce sera encore le cas sur le prochain !
F Par exemple, sur Bande de filles, quel était le morceau ?
CS ‹ The Winner takes it all ›
F Je l’adore.
CS Elle est très belle. J’ai entendu à la télévision Françoise Hardy dire que c’était une de ses chansons préférées. Abba a cette particularité : ils font danser les gens sur des chansons tristes, et c’est ça que j’aime. Moi aussi je souhaite transmettre quelque chose d’ultra-vivant, des envies d’être, une énergie avec des histoires qui ne sont pas forcément légères. Je me demandais comment tu avais travaillé sur ton disque ?

Abba, Arrival, 1976.
Logo et pochette : Rune Söderqvist.
Photographie : Ola Lager.
CS Elle est très belle. J’ai entendu à la télévision Françoise Hardy dire que c’était une de ses chansons préférées. Abba a cette particularité : ils font danser les gens sur des chansons tristes, et c’est ça que j’aime. Moi aussi je souhaite transmettre quelque chose d’ultra-vivant, des envies d’être, une énergie avec des histoires qui ne sont pas forcément légères. Je me demandais comment tu avais travaillé sur ton disque ?
F Cela peut sembler paradoxal, mais quand j’ai commencé à faire des chansons, ça n’était pas pour être écoutée. Il n’y avait pas de volonté particulière. J’ai débuté avec une tablette, avec le micro de la machine. C’est le meilleur des outils ! Sur ces appareils, les sons utilisés sont assez synthétiques, un peu cheap, ça explique aussi pourquoi beaucoup y entendent les années 80. Les textes qui ont été écrits, j’ai eu besoin de les sortir, c’était une nécessité. C’est complètement intime. Ce sont des choses de ma vie, romancées, réécrites pour que je n’en dise pas trop, ou alors avec des codes qu’une seule personne pourra comprendre, tandis que les autres se les approprieront avec leurs propres histoires. J’ai retranscrit mes malheurs de jeune femme à travers mes mélodies. Une fois que tu décides de les chanter face à un public, il y a quelque chose de l’ordre de l’impudeur et de l’exhibitionnisme. Et du sport aussi ! La scène, c’est un bonheur physique. J’ai deux espaces de liberté dans le monde : le sexe et la scène. Je suis un peu chien fou quand je chante face à un public, j’ai beaucoup de trous noirs. On me dit : « tu as fait ceci ou cela » et je ne m’en souviens pas. Il n’y a rien de plus pénible qu’un concert où on te rejoue l’album à l’identique. Moi je voulais offrir quelque chose d’unique aux gens, de partager un vrai moment.
CS Sur combien de temps as-tu écrit cet album ?
F Autour de trois ans, même si certains morceaux sont plus anciens, et si j’ai fait d’autres choses pendant tout ce temps. Un morceau comme ‹ Un beau langage › ne ressemblait pas du tout à ce qu’il est aujourd’hui sur l’album. Je l’avais mis de côté et quand il a été question de faire un disque avec Entreprise, mon label, je l’ai retravaillé. J’ai fait le tour de tous mes morceaux, de toutes mes histoires. Certaines étaient vieilles mais elles me parlaient encore. C’est ce qui fait que certaines chansons sont assez universelles. Les interlocuteurs ont parfois changé. Ça permet aussi de relativiser : « j’ai aimé cette personne, maintenant je ne l’aime plus, et désormais j’en aime une autre ». Sur le prochain disque, il y a aura peut-être de nouveau des chansons que j’ai écrites il y a très longtemps. Mais j’avoue que je ne voulais pas faire de disque au début, j’avais très peur.
CS Parce que ça fige ?
F Exactement. Il y a des morceaux que je ne joue plus pareil sur scène depuis la sortie de l’album. ‹ On me dit tu › change constamment, et je ne suis pas très contente de la version qui figure sur le disque. Si j’avais eu six mois de plus pour ce disque, je les aurais pris et refait ce que j’avais envie de refaire. En même temps, ça fait du bien de lâcher, c’est comme une délivrance. J’imagine que c’est la même chose pour un film. Mais je ne sais pas trop, j’ai l’impression que la durée entre deux films est plus courte ?
CS Moi en moyenne c’est trois ou quatre ans, mais ça dépend vraiment des réalisateurs. Il n’y a pas vraiment de règle. Je voulais te demander d’où venait ton nom de scène ?
F C’est le nom de famille de ma mère que j’ai allégé d’une lettre. Je l’ai choisi au moment où j’ai dû créer un SoundCloud. Comme je n’osais pas écrire en français, j’ai travaillé avec un parolier. Je lui envoyais mes maquettes via Internet, d’où le compte. Je voulais mettre quelque chose de moi, mais qui en même temps ne soit pas moi… Fishbach, ça veut dire « rivière poissonneuse ».
J’ai un rapport à l’eau très particulier, c’est un lieu de méditation totale. Il y a plusieurs types d’eau. La mer est un sujet que j’ai pas mal exploité car c’est là que je suis née. C’est l’horizon le plus parfait, l’infini, l’imagination.
Et il y a aussi les eaux dormantes, les lacs, avec une tout autre symbolique que je trouve également passionnante. J’ai adoré lire L’eau et les Rêves de Gaston Bachelard. J’adore les sciences ! Je m’intéresse à plein de choses mais je ne suis pas une spécialiste. J’ai une piètre culture générale car j’adore m’émerveiller et découvrir par hasard. Par exemple, je suis fan de Balavoine et de Christophe, et je ne cherche pas à connaître tout ce qu’ils ont fait. Le jour où je découvre une nouvelle chanson, c’est un bonheur absolu ; je ne veux pas gâcher cela en écoutant toute leur discographie. Et toi, quel est ton rapport à la culture ? Es-tu à l’affût de ce qui se fait, de ce qui se dit ?
CS Tout à fait. Mais mon rapport à la culture est un peu séquentiel. Jusqu’à mes vingt ans, j’étais un rat de bibliothèque. Je me disais que pour m’en sortir, il fallait que je sois un puits de science, je ne croyais pas suffisamment aux possibles. Même pour draguer les filles, je me disais qu’il allait falloir que je sache plein de trucs, que je sois une personnalité séduisante. Du coup j’ai eu une adolescence assez solitaire et très studieuse. Ce n’est pas forcément une bonne façon de faire, je ne comprenais pas tout ce que j’ingurgitais. J’avais un côté étudiante : étudions la vie, et après on vivra ! Et j’ai commencé tard à vivre ! J’ai fait des études rigoureuses — hypokhâgne, khâgne — où l’on t’apprend justement à apprendre. Mais j’ai de la tendresse pour cette période-là, notamment car je serais incapable de faire ça aujourd’hui. Du coup, j’ai des espèces d’acquis sur lesquels je vis, ce qui est assez pratique ! J’ai ensuite procédé de façon un peu perverse polymorphe en suivant des fils, en fonctionnant par des associations d’idées, avec une certaine curiosité du présent, en regardant la télévision, en ayant un appétit pour tout.
F C’est drôle car moi j’ai arrêté tôt l’école, j’étais dans une forme de rébellion, j’ai eu très peur de tout ça. J’avais l’impression de ne rien apprendre, donc il a fallu que j’arrête pour faire mon propre apprentissage. Je me reconnais dans ce que tu dis car j’étais totalement l’inverse. Je me demandais si tu avais déjà fait des clips.
CS Jamais. On m’en propose souvent, je l’envisage à chaque fois, mais je n’ai jamais réussi. Tout comme la publicité. Je vais aux réunions, mais soit c’est trop cadré, et je me dis « pourquoi moi plutôt qu’un autre », soit je n’y arrive pas. Mon métier de réalisatrice, je ne le fais pas souvent, je pourrais donc envisager la pub ou le clip comme un exercice. J’ai plein d’amis qui le font pour se faire la main, tester de nouvelles caméras, rencontrer de nouveaux collaborateurs. Mais je n’ai jamais réussi, même si ça n’est pas fermé. Fabriquer une image, c’est impliquant, engageant. Autant écrire, je peux le prendre à la légère. Par exemple, si on me proposait de faire de la science-fiction, je pourrais le faire, je peux écrire tout ce que je n’aurais pas l’intuition de faire, la légitimité de produire par moi-même.
F Est-ce que tu travailles sur ton prochain film ?
CS J’entame son écriture mais comme j’écris aussi pour d’autres au même moment, ça n’est pas évident. Mais je fonctionne beaucoup en mémoire tampon : quand je m’y mets, cela veut dire que j’ai bien processé, cela devrait aller vite. J’aimerais bien tourner l’année prochaine.
F Tu peux déjà nous en parler ?
CS Je peux dire que ça ne sera pas un film sur la jeunesse, mais plutôt sur les 25-30 ans. Contrairement aux précédents, j’aimerais tourner avec des actrices professionnelles. Et ça ne sera pas un film contem-porain. Donc ça fait beaucoup de changement !
F Tu as travaillé avec Para One sur la bande originale de tes films, tu aimes la musique électronique ?
CS Oui, car c’est un genre musical qui te permet de travailler tous les sons. Tu peux faire des bruits de vent avec un synthétiseur. Je trouve ça cool de se demander quel est le son d’un parking ! Tu vas avoir une note pour l’humidité, une autre pour la lumière… Moi j’utilise énormément la sonothèque de David Lynch, toutes ses fréquences hautes et basses, que ce soit pour un son de tube néon ou d’un frigo. Le montage sonore, c’est quasiment la partie que je préfère, où je suis la plus heureuse, dans toute la fabrication du film. Tu es face à ce que tu as fait, que tu en sois satisfait ou non, et avec le son, tu vas au fond de ta pensée. Ça n’est pas un simple habillage. Il s’agit de trouver comment je vais parler au ventre des gens.
F Tu ne demandes pas à tes ingénieurs du son de capturer des ambiances ?
CS Si bien sûr, mais ça ne fonctionne pas toujours. L’eau par exemple est très dure à attraper. Dans Naissance des pieuvres qui est en partie sous l’eau, on a été obligé de tout réinventer et c’est ça que j’ai trouvé génial. Ça n’est pas évident de parler de son, de musique. Il faut inventer sa grammaire et se faire confiance.
F Oui ! La musique est impalpable. C’est là où je me sens le plus libre, car ça n’existe pas physiquement… Tu parlais de David Lynch… Moi souvent, les films me marquent autant par leur histoire que par leur musique. J’adore les compositions de François de Roubaix mais aussi celles de Vladimir Cosma… Un thème musical qui revient dans un film modifié, joué différemment, peut me tirer les larmes. Le générique d’Angelo Badalamenti pour Twin Peaks est incroyable. Son travail a sublimé la série. D’ailleurs, tu pourrais développer une série, c’est un format qui t’intéresse ?
CS J’ai travaillé un an et demi sur Les revenants, donc c’est quelque chose que je connais un peu. Mais pour faire une série, pour faire de la télé, il faut du pouvoir afin de signer véritablement le projet. Sinon tu es pris dans des logiques qui sont trop puissantes. Mais j’adorerais le faire. Plutôt une mini-série de six ou sept heures car je n’ai pas l’ambition de dépeindre un monde sur dix saisons. Cette année j’ai aimé Big Little Lies, j’ai trouvé ça marquant, notamment pour des questions de production et d’échelle. Les grandes séries des années 90, comme Les Sopranos ou Six Feet Under ce sont les scénaristes qui deviennent producteurs. Ils ont le pouvoir de raconter ce qu’ils veulent comme ils le veulent. Big Little Lies, ce sont les actrices qui deviennent productrices et qui disent : « On en a marre, on a entre 40 et 50 ans et on nous met à la poubelle. On va prendre le pouvoir, on va se produire et en plus on va faire une fiction qui parle de condition féminine. » Que ce soit à la télé ou de manière globale, il faut toujours regarder qui a le pouvoir — ça on le sait, c’est toujours la même chose — mais surtout qui le prend et comment !
Quatre Minutes Trente Fois Secondes
Jacques AudiardChristophe Chassol
Figure incontournable du cinéma français, le réalisateur Jacques Audiard cultive les récits ambitieux depuis plus d’une vingtaine d’années. Son dernier film, Dheepan, lui a valu la Palme d’or du Festival de Cannes en 2015. Il rencontre pour la première fois Christophe Chassol, dit Chassol, cinéphile accompli et musicien dont l’univers singulier tient autant du documentaire que de la création sonore. Alors que les deux hommes s’apprêtent à entamer leur nouveau projet, ils s’entretien-nent avec passion et humour de leur panthéon artistique.
Jacques Audiard Avant même d’entendre ton travail, j’ai beaucoup entendu ton nom à propos de tes musiques de film. C’est quelque chose que tu fais souvent ?
Christophe Chassol Oui. Actuellement, je travaille sur celle du prochain film d’Yvan Attal. C’est une comédie, un genre auquel je n’ai pas trop l’habitude de me confronter. J’ai surtout fait des musiques de film d’horreur ! J’aime bien ce cinéma pour sa musique. C’est là que je trouve la plus grande palette orchestrale. Une de mes références est notamment le compositeur Jerry Goldsmith, qui a fait énormément de bandes originales, parmi lesquelles La Planète des Singes, Patton, The Boys from Brazil, Poltergeist. Je le considère vraiment comme l’avant-garde d’Hollywood, il sait tout écrire : aussi bien des thèmes tonals que des choses plus expérimentales. Je suis aussi un très grand fan d’Ennio Morricone. Hier soir, j’ai revu le dernier Tarantino, les Huit Salopards, pour lequel il a fait la musique.
JA Et qu’est-ce que tu as pensé de ce film ?
CC Je l’avais vu au cinéma, je sautais sur mon siège tellement j’aimais ce que je voyais ! La musique de Morricone est tellement parfaite sur ce film. Est-ce que tu l’as vu ?
JA Oui mais je suis plus mitigé. J’aime beaucoup Tarantino, mais pour d’autres films. Il se saisit depuis longtemps maintenant de l’histoire de la ségrégation américaine, c’est quelque chose qu’il exprime de manière presque enfantine. Mais ce qui me fatigue, c’est plutôt le niveau d’ironie de son cinéma, cette stylisation de la forme.
CC As-tu une expérience du cinéma américain ?
JA Elle commence ! Je dois faire un film au début de l’été, donc c’est quelque chose de relativement nouveau, même si j’ai affaire à eux depuis un petit moment. Je pense aux acteurs, aux producteurs. J’avais évidemment des soupçons sur ce milieu, et ils se sont révélés exacts, jusqu’à la caricature ! Dans l’ordre des coûts, le cinéma coûte plus cher à fabriquer que la musique, la musique coûte plus cher à fabriquer que la littérature, etc. C’est un domaine qui est assez unique, un mélange d’industrie et d’art, il faut donc savoir de quel côté placer le curseur. Le cinéma américain a connu une décennie extraordinaire dans les années 70, mais depuis quelques temps il est moins pertinent. Je crois que ce déclin qualitatif est notamment lié à l’arrivée du numérique. Depuis la numérisation, l’industrie et la finance ont pris complètement le pas sur l’artistique.
CC C’est marrant car tu dis la même chose que nous autres musiciens. Le numérique et l’arrivée du home-studio ont fait du bien à la musique mais aussi beaucoup de mal. Je n’écoute quasiment rien de ce qu’il se fait actuellement.
A Aujourd’hui pour moi, la question de la musique se pose dans des choix de vie : comment l’éviter ? Comment éviter cette présence continuelle de la musique ?
CC Il faut écouter John Cage !
JA Tu pousses ton caddie, il y a de la musique, tu vas dans un café, il y a de la musique. De la musique que tu ne vas pas choisir ! De même que nous vivons dans un surcroit d’images, nous sommes désormais dans un monde où la musique est devenue banale.
CC Pour en revenir à ton projet américain, peux-tu m’en dire plus ?
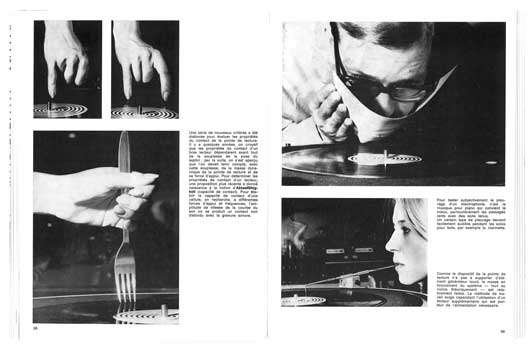
Mauricio Kagel, Détour vers une plus haute sous-fidélité, réalisation : E. Struvay & J.-Y. Bosseur.
Revue VH101, Musique Contemporaine, numéro 4, Paris, 1970.
JA C’est quelque chose qui m’a été proposé il y a longtemps par un acteur. C’est tiré du livre The Sisters Brothers de Patrick deWitt. C’est un western formidable, très drôle. Je l’ai donc adapté et on a commencé à faire des repérages aux Etats-Unis. Cela faisait sens, puisque l’histoire est un voyage d’Oregon City à San Francisco pendant la ruée vers l’or. Nous sommes allés en Alberta et aux alentours, et j’ai rapidement compris ce qu’une telle machine suppose : les devis y sont extravagants. À ceci s’est ajouté un sentiment plus étrange ; quand tu te rends en Alberta avec l’idée de faire un western, tout est là ! Les montagnes sont imposantes, le ciel est spectaculaire, les villages sont intacts, ceux-là mêmes que l’on vient de voir dans une série comme Deadwood, ou encore The revenant. Et en tant que réalisateur, tu es censé filmer tout ce fantastique décor de manière nouvelle. Je me suis donc dit que pour échapper aux coûts et surtout pour avoir un geste un peu inventif, il ne fallait pas rester là ! Donc on va faire ça un peu à l’italienne : entre l’Espagne et la Roumanie, le tout avec des acteurs américains. Je sens que je vais sortir de ce film sur les genoux !
CC Mais ça se passe toujours un peu comme ça, non? Un tournage est toujours éprouvant…
JA Je ne sais pas si tu as des rapports avec tes confrères musiciens, mais moi j’en ai très peu avec les réalisateurs, je ne sais pas comment ils font. J’apprends leurs manières de travailler par les techniciens. Un ingénieur du son, un chef opérateur, un machiniste fait deux ou trois films par an. Ce sont eux qui m’informent sur les tournages des autres. Je m’aperçois qu’ils ne font pas du tout les choses de la même façon! En ce qui me concerne, depuis un moment, si ce n’est depuis toujours, mon ressort majuscule est l’ennui. Les choses m’ennuient très vite !
CC Tu parles du tournage ?
JA Oui, mais également de l’écriture ! J’aimerais bien réussir à faire un film avec deux acteurs dans un salon. Mais comme j’ai peur de m’ennuyer, je pense tout d’un coup à faire sauter des mammifères marins. Mais pourquoi ce genre d’idée me vient ? C’est très compliqué quand même !
Je crois que si je n’avais pas le cinéma dans ma vie, je parlerais à moins de trois personnes par jour. Le cinéma, c’est le rapport que je veux entretenir avec le monde.
CC Est-ce que tu considères qu’il y a de l’humour dans ton cinéma ? Je te pose cette question car il m’est souvent arrivé de faire des tournées avec les différents artistes avec lesquels j’ai collaboré, comme Sébastien Tellier, Keren Ann ou Phoenix. Le tour bus, c’est la colonie de vacances, on enchaîne blague sur blague. On s’est rendu compte qu’il y avait deux sortes de personnes : celles qui cherchent le gag et les autres. Moi je sais que je fais partie de celles qui cherchent le gag. Je ne vais pas te dire que j’ai de l’humour, mais c’est un vrai sujet pour moi.
JA Je ne dirais pas que je ne cherche pas le gag mais que je fabrique la situation ! C’est marrant parce que cette discussion sur l’humour, je l’ai eue il n’y a pas très longtemps et je me suis rendu compte au bout d’une demi-heure que mon interlocuteur et moi ne parlions pas du tout de la même chose. Nous parlions de la comédie. Pour lui, la fonction de la comédie est le rire alors que selon moi, la comédie est une écriture, une forme dramaturgique très particulière. Le Misanthrope est une comédie d’une rigueur extrême. Woody Allen est un véritable artiste dans ce domaine. Il a fait des comédies très avérées, comme Annie Hall et d’autres, très frontalières d’autres états, comme Husbands and Wives, ou encore Crimes et Délits, qui est son chef d’œuvre absolu. Le fond de la comédie c’est la morale ! Alors que dans un film dramatique, celle-ci n’est pas nécessaire. Les musiciens avec qui tu as tourné font une musique dont le format me semble plus accessible que la tienne. Est-ce que tu réfléchis en ces termes ?
CC Pas vraiment. Toutes ces collaborations sont des rencontres ! Comme je suis plutôt quelqu’un de sociable, je rencontre plutôt des gens de ce milieu là, qui sont un peu plus accessibles que ceux de la musique contemporaine. La musique contemporaine, c’est compliqué non ? Je suis récemment allé à la Philharmonie voir Répons, une pièce de Pierre Boulez. C’est fantastique, c’est sophistiqué, le langage est incroyable, les musiciens sont virtuoses, c’est vraiment admirable comme musique. Mais j’ai malgré tout ressenti une impression d’exclusion : un refus de la tonalité, de la répétition, de la transe, de la rythmique, un peu comme si l’on nous disait : « Si tu danses, c’est vulgaire. » Je trouve ça dommage.
JA Je partage ton avis, je trouve que la musique contemporaine est très difficile. Mais il y a des choses que j’ai mis du temps à comprendre. Il y a des choses qui ne vont pas être très intelligibles, où des bouts vont nous manquer, où l’on manquera de culture, de patience ou d’attention. Je crois qu’il y a des créations qui ne servent qu’à fabriquer d’autres choses, qui ne sont que transitoires. Dans le champ du jazz, un musicien comme Albert Ayler sort des moments qui sont foudroyants, où l’on a l’impression que cela lui arrive comme une intuition, c’est la grâce même. Et il y a des pans où je ne sais même pas si l’artiste lui-même sait où il est. Mais ça sert à autre chose, ça sert au reste. Tout comme l’Art Ensemble of Chicago : tout n’est pas bien, mais certains moments incompréhensibles ont servi à d’autres musiciens.
CC Lorsque j’ai eu 17 ans, mon père m’a offert Bitches Brew, l’album de Miles Davis qui change un peu toute la donne. J’ai dû mettre un an avant de l’aimer, je me suis forcé à l’écouter.
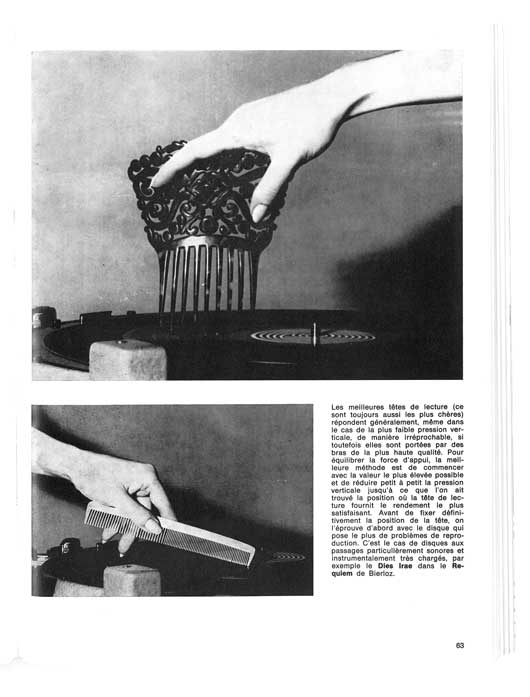
Mauricio Kagel, Détour vers une plus haute sous-fidélité, réalisation : E. Struvay & J.-Y. Bosseur.
Revue VH101, Musique Contemporaine, numéro 4, Paris, 1970.
JA Il faut voir tout cela avec un peu de perspective car c’est une histoire de l’art qui se construit. Il y a des choses que je ne comprenais pas, que je détestais, jusqu’au moment où cela s’est recalé. Le jazz est le genre à la fois le plus novateur et le plus classique, c’est la musique classique d’aujourd’hui. Et c’est tellement rare à l’échelle d’une vie, petite comme la mienne, d’avoir assisté à la création d’un pan de l’histoire de l’art.
CC Tu es né en quelle année ?
JA Je suis vieux, en 52 ! La disparition du support physique me rend dingue… Avant j’avais des vinyles, on m’a dit qu’il fallait passer au Compact Disc, je suis passé au Compact Disc. Maintenant tout est dématérialisé et je n’ai plus rien. Ce que j’aimais, c’était les pochettes. Il y avait une image, et puis il y avait du texte, et à l’intérieur, il y avait de la musique. C’était autre chose car tout était transmis en même temps : dans tes mains, tu écoutais, tu retournais la pochette…
CC Moi je suis né en 76, j’ai 40 ans. Quand j’ai commencé, j’écrivais toutes mes partitions à la main, à l’ancienne. Et en 2000, j’ai eu un ordinateur portable, et ma vie a changé. Avec les logiciels de partition, il me suffisait de faire « pomme c pomme v ».
JA Mais qu’est-ce que ça a changé véritablement ?
CC J’ai commencé à voir les waveforms, c’est à dire l’oscilloscope audio. Ça a changé mon rapport à la musique car je pouvais la visualiser. Ma notion du temps a changé : je peux désormais voir à quoi correspondent deux minutes trente secondes ou cinquante minutes. Ca m’a apporté une certaine acuité. Est-ce que le numérique a changé ton rapport au montage ?
JA Il l’a totalement changé. Cela a effectivement à voir avec le temps : sur les timeline, tu visualises ton film en termes de proportions, et désormais, avec les petits photogrammes, tu le visualises presque en couleurs. Auparavant, le montage analogique passait par la pellicule : on la coupe une première fois, une seconde fois, on rajoute du scotch, une troisième fois… Je suis convaincu qu’à un certain moment, le montage avait une fin car on n’en pouvait plus ! On n’en pouvait plus de chercher les bobines dans les boîtes, de l’extrême fragilité du support. Cette somme de fatigue faisait que l’on s’arrêtait. Aujourd’hui, avec le numérique, le montage est sans fin et je n’aime pas ça du tout.
CC En ce qui concerne la musique de film et le numérique, certains réalisateurs ont l’impression qu’on peut effacer et refaire à l’infini grâce au copier-coller, alors que ça ne se passe pas vraiment comme ça ! Donc oui, ça devient sans fin, mais au final, ça reste une question de décisions, de choix qui se déplacent.
JA Effectivement, mais tu ne décides plus sur les mêmes critères. Dans le domaine de l’écriture, je serais vraiment curieux de savoir en quoi le traitement de texte informatique a influé sur le style. On est passé de la perception de la page à celle du paragraphe et de la ligne. Je n’ai plus ce sentiment d’un grand flot, d’un bazar qui évolue en se nourrissant de l’intérieur. CC Ce qui me gêne dans le son à l’ère du numérique, c’est sa texture, trop propre, cette course au modernisme.
CC Dans Un Prophète, il y a une scène qui m’a marqué avec un cerf dans un bois, et qui m’a fait penser au compositeur John Adams. C’est un musicien que j’adore, c’est un peu l’enfant de Philip Glass, Steve Reich, Terry Riley.
JA Je l’aime beaucoup, notamment Nixon in China. Je ressens quelque chose chez lui, mais aussi chez Jaar et chez toi, qui est de l’ordre du récit. Ce que vous faites, c’est du storytelling. C’est comme s’il y avait à chaque fois un scénario, qui n’est peut-être pas premier, mais qui va apparaître en cours de route. Ça crée une musique très singulière. Pour moi John Adams, c’est peut-être quelqu’un qui a commencé originellement à faire du récit.
CC Il a une pièce qui s’appelle Shaker Loops qui est géniale. C’est un septuor à cordes qui, si on la résume grossièrement, reproduit le vent. Un récit, ça peut être aussi simple que ça : du vent, juste un souffle, la forme d’une onde.
JA Ce que j’aime, c’est que ces récits ne sont pas signifiants. Ces histoires sont très larges, elles peuvent changer à chaque écoute.
CC C’est précisément pour cela que j’aime la musique de film. Tu ne sais jamais quel va être le format du morceau ; il pourra durer deux minutes comme neuf.
JA Plus jeune, j’enregistrais des films entiers sur cassette audio et je les écoutais dans ma voiture. J’avais des grands classiques comme Psychose ou La règle du jeu de Renoir. Un bon film, il faut certainement l’avoir vu, mais tu peux également l’écouter. De ma génération, nous sommes tous allés à la cinémathèque française. Henri Langlois faisait exactement l’inverse : il projetait les films sans le son. Ça me rendait fou !
CC Je crois que si je réalisais un film, je ne prendrais pas de compositeur. Je ferais comme Kubrick qui utilise la musique Béla Bartók dans Shining. Il connaît tellement bien les pièces qu’il sait parfaitement où les placer.
JA J’ai une théorie à propos de Kubrick ! À partir de 2001, l’Odyssée de l’espace, son projet est wagnérien ! Il est dans une recherche d’art total. Je pense que 2001 est le livret d’opéra le plus exceptionnel qu’a produit le 20e siècle. Il va notamment utiliser la musique de Richard Strauss et de Ligeti, il se place dans un horizon post-wagnérien !
CC Tu trouves ça prétentieux d’avoir un projet d’art total ?
JA Non. Mais ce que je trouve incroyable avec Kubrick, c’est qu’il aura poussé le vieux système analogique jusqu’au bout. Tout tombe en miettes après, ça sera le dernier à procéder de cette manière, il aura tout donné. Par exemple, le ciel interstellaire de 2001, c’est ce qui servira ensuite de modèle à tous les réalisateurs. Je disais plus tôt que je me lançais dans des choses compliquées… lui, c’était simplement inimaginable, surtout sans le numérique ! C’était de l’artisanat.
CC En musique de film, il y a également un compositeur qui a servi de modèle à tous ceux qui ont suivi, c’est justement Goldsmith. En 1976, il fait la bande originale de The Omen, dans laquelle il place des chants gregoriens que tu retrouveras partout ensuite ! Cette année-là, il gagne l’oscar de la meilleure musique de film, face à ces concurrents : Bernard Herrmann pour Obsession de De Palma, Bernard Herrmann une seconde fois pour Taxi Driver de Scorsese, Lalo Schifrin pour Le voyage des damnés et enfin Jerry Fielding pour Josey Wales hors-la-loi. Le niveau était incroyable.
JA Les images que tu utilises pour les films qui accompagnent ta musique, d’où viennent-elles ?
CC J’organise des tournages, j’exploite ensuite les images et le son. J’ai été marqué par des documentaristes comme Johan Van der Keuken, avec des films comme L’Œil au-dessus du puits.
JA Ah oui, il a un rapport au son très particulier, je me souviens de Blind kind.
CC C’est marrant, je l’ai présenté l’année dernière au festival de films d’Alès où j’avais une carte blanche. J’y ai montré Le Bon, la Brute et le Truand et donc Hermann Slobbe, L’Enfant aveugle. Ce film m’a marqué car il a plein d’idées géniales de montage et d’inventivité avec la musique. Il y a une scène qui est géniale : la mère d’Hermann, un garçon aveugle, lui propose d’aller voir les courses automobiles. Tu les vois face aux voitures qui roulent à toute allure, avec les moteurs qui produisent un boucan terrible. Ensuite, tu le vois dans son salon avec un micro en train de faire le même vrombissement. Tu réalises que tous les sons que tu as entendus auparavant, plaqués sur les voitures, ce sont ceux-là. C’est ce que Van der Keuken fait : des allers-retours, il collecte de la matière, il a des idées de son, son son devient le son de ses images, et ainsi de suite, il construit comme ça. Quand je pars tourner, j’ai des idées en tête. Pour Indiamore, je voulais parler de la musique indienne. Je suis allé en repérage deux ans auparavant, j’y ai rencontré des gens qui m’ont en fait rencontrer d’autres. Je me laisse porter tout en organisant. Nous sommes partis deux semaines, et nous sommes rentrés avec beaucoup trop d’images par rapport au projet initial. Indiamore, c’est à la fois un film, un album et un concert. Et pour mon prochain projet, je veux faire quelque chose de… total !
JA Tu veux faire ta tétralogie aussi !
CC Je veux faire quelque chose qui se fabrique à partir de l’énoncé de sa fabrication. Tout est basé sur Le jeu des perles de verre, l’ouvrage d’Hermann Hesse. C’est une biographie fictive, qui présente notamment ce jeu qui réunit musique et mathématique. C’est assez compliqué à mettre en place car c’est une sorte de synthèse de la pensée et de la culture humaine. Mais pour résoudre cette équation, c’est finalement assez simple : il faut se lancer et commencer !
JA Je vois ce que tu veux dire : j’ai travaillé avec Nicolas Jaar, un artiste que j’aime beaucoup. Il voyage énormément, il m’envoyait des morceaux de New York, de Tokyo, de Mexico. C’était très beau, difficilement exploitable en auditorium car il y rajoutait plein de bruits de fond.
CC Pour un film, tu dois te débattre avec les dialogues, le son de source, et le sound design. Le sound design c’est assez pénible, c’est l’ensemble des sons organico-numériques que tu rajoutes. Dans les films d’horreur, il n’y a que ça souvent ! Personnellement j’aime quand les choses sont simples : les pas qui craquent dans un escalier, une porte qui grince. Je n’ai pas besoin d’un son créé numériquement pour avoir peur. J’aime l’utilisation que tu fais de la musique dans ton cinéma.
JA J’ai compris que j’avais besoin de deux types de musique qui vont fonctionner différemment : d’un côté le score, et de l’autre, des morceaux que je qualifierais presque de musique de source, un peu banals, parfois vulgaires. Le premier prend en charge les personnages, le second le temps de l’histoire.
CC Dans Un Prophète, il y a une scène qui m’a marqué avec un cerf dans un bois, et qui m’a fait penser au compositeur John Adams. C’est un musicien que j’adore, c’est un peu l’enfant de Philip Glass, Steve Reich, Terry Riley.
JA Je l’aime beaucoup, notamment Nixon in China. Je ressens quelque chose chez lui, mais aussi chez Jaar et chez toi, qui est de l’ordre du récit. Ce que vous faites, c’est du storytelling. C’est comme s’il y avait à chaque fois un scénario, qui n’est peut-être pas premier, mais qui va apparaître en cours de route. Ça crée une musique très singulière. Pour moi John Adams, c’est peut-être quelqu’un qui a commencé originellement à faire du récit.
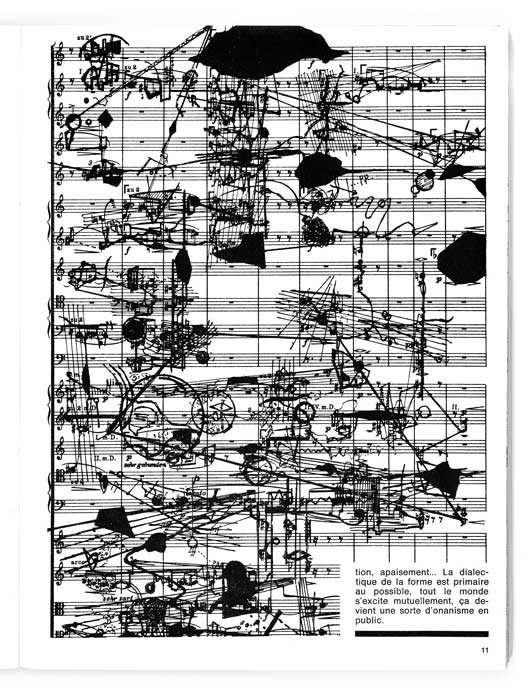
Entretien entre Jean-Yves Bosseur et Pierre Boulez.
Revue VH101, Musique Contemporaine, numéro 4, Paris, 1970.
CC Il a une pièce qui s’appelle Shaker Loops qui est géniale. C’est un septuor à cordes qui, si on la résume grossièrement, reproduit le vent. Un récit, ça peut être aussi simple que ça : du vent, juste un souffle, la forme d’une onde.
JA Ce que j’aime, c’est que ces récits ne sont pas signifiants. Ces histoires sont très larges, elles peuvent changer à chaque écoute.
CC C’est précisément pour cela que j’aime la musique de film. Tu ne sais jamais quel va être le format du morceau ; il pourra durer deux minutes comme neuf.
JA Plus jeune, j’enregistrais des films entiers sur cassette audio et je les écoutais dans ma voiture. J’avais des grands classiques comme Psychose ou La règle du jeu de Renoir. Un bon film, il faut certainement l’avoir vu, mais tu peux également l’écouter. De ma génération, nous sommes tous allés à la cinémathèque française. Henri Langlois faisait exactement l’inverse : il projetait les films sans le son. Ça me rendait fou !
CC Je crois que si je réalisais un film, je ne prendrais pas de compositeur. Je ferais comme Kubrick qui utilise la musique Béla Bartók dans Shining. Il connaît tellement bien les pièces qu’il sait parfaitement où les placer.
JA J’ai une théorie à propos de Kubrick ! À partir de 2001, l’Odyssée de l’espace, son projet est wagnérien ! Il est dans une recherche d’art total. Je pense que 2001 est le livret d’opéra le plus exceptionnel qu’a produit le 20e siècle. Il va notamment utiliser la musique de Richard Strauss et de Ligeti, il se place dans un horizon post-wagnérien !
CC Tu trouves ça prétentieux d’avoir un projet d’art total ?
JA Non. Mais ce que je trouve incroyable avec Kubrick, c’est qu’il aura poussé le vieux système analogique jusqu’au bout. Tout tombe en miettes après, ça sera le dernier à procéder de cette manière, il aura tout donné. Par exemple, le ciel interstellaire de 2001, c’est ce qui servira ensuite de modèle à tous les réalisateurs. Je disais plus tôt que je me lançais dans des choses compliquées… lui, c’était simplement inimaginable, surtout sans le numérique ! C’était de l’artisanat.
CC En musique de film, il y a également un compositeur qui a servi de modèle à tous ceux qui ont suivi, c’est justement Goldsmith. En 1976, il fait la bande originale de The Omen, dans laquelle il place des chants gregoriens que tu retrouveras partout ensuite ! Cette année-là, il gagne l’oscar de la meilleure musique de film, face à ces concurrents : Bernard Herrmann pour Obsession de De Palma, Bernard Herrmann une seconde fois pour Taxi Driver de Scorsese, Lalo Schifrin pour Le voyage des damnés et enfin Jerry Fielding pour Josey Wales hors-la-loi. Le niveau était incroyable.
JA Les images que tu utilises pour les films qui accompagnent ta musique, d’où viennent-elles ?
CC J’organise des tournages, j’exploite ensuite les images et le son. J’ai été marqué par des documentaristes comme Johan Van der Keuken, avec des films comme L’Œil au-dessus du puits.
JA Ah oui, il a un rapport au son très particulier, je me souviens de Blind kind.
CC C’est marrant, je l’ai présenté l’année dernière au festival de films d’Alès où j’avais une carte blanche. J’y ai montré Le Bon, la Brute et le Truand et donc Hermann Slobbe, L’Enfant aveugle. Ce film m’a marqué car il a plein d’idées géniales de montage et d’inventivité avec la musique. Il y a une scène qui est géniale : la mère d’Hermann, un garçon aveugle, lui propose d’aller voir les courses automobiles. Tu les vois face aux voitures qui roulent à toute allure, avec les moteurs qui produisent un boucan terrible. Ensuite, tu le vois dans son salon avec un micro en train de faire le même vrombissement. Tu réalises que tous les sons que tu as entendus auparavant, plaqués sur les voitures, ce sont ceux-là. C’est ce que Van der Keuken fait : des allers-retours, il collecte de la matière, il a des idées de son, son son devient le son de ses images, et ainsi de suite, il construit comme ça. Quand je pars tourner, j’ai des idées en tête. Pour Indiamore, je voulais parler de la musique indienne. Je suis allé en repérage deux ans auparavant, j’y ai rencontré des gens qui m’ont en fait rencontrer d’autres. Je me laisse porter tout en organisant. Nous sommes partis deux semaines, et nous sommes rentrés avec beaucoup trop d’images par rapport au projet initial. Indiamore, c’est à la fois un film, un album et un concert. Et pour mon prochain projet, je veux faire quelque chose de… total !
JA Tu veux faire ta tétralogie aussi !
CC Je veux faire quelque chose qui se fabrique à partir de l’énoncé de sa fabrication. Tout est basé sur Le jeu des perles de verre, l’ouvrage d’Hermann Hesse. C’est une biographie fictive, qui présente notamment ce jeu qui réunit musique et mathématique. C’est assez compliqué à mettre en place car c’est une sorte de synthèse de la pensée et de la culture humaine. Mais pour résoudre cette équation, c’est finalement assez simple : il faut se lancer et commencer !
« Nous devrions peut-être expliquer aux gens pourquoi nous avons fait ce film »
Haydée Touitou
Juste après le succès de Good Will Hunting, sûrement désireux de faire tourner sa chance à l’envers, Gus Van Sant réalise un remake plan par plan de Psychose d’Alfred Hitchcock. Sûrement l’un des films les plusemblématiques du maître du suspense. Au regard de l’élan de haine que la seconde version a déclenché, je me demande bien ce qu’il a pu se passer dans la tête de Gus Van Sant le jour où il s’est dit « tiens et si je réalisais un remake du meilleur film de l’histoire du cinéma ». Peut-être voulait-il simplement savoir à quoi ressemblaient des cinéphiles prétentieux et blasés lorsqu’ils sont révoltés ? Peut-être voulait-il surtout s’amuser un peu… Psychose fait partie de ces quelques films que tout le monde est susceptible d’avoir vu, et une fois qu’il a été vu, susceptibled’avoir inconditionnellement aimé. Aussi effrayant soit-il, un charme fou se dégage du film. Une sorte d’aura émane des oiseaux empaillés, du sang gris au fond de la douche, et de la voiture que l’on extrait de l’eau. Tellement de raisons pour Gus d’être fasciné, d’avoir désiré ce film. Sans qu’on puisse très bien dire pourquoi, Psychose représente parfois une sorte de film parfait, un monument intouchable, une œuvre de génie, un peu tout ce qu’on veut… Enfin, on peut commencer à dire pourquoi, mais on ne pourrait peut-être pas s’arrêter.
Tout commence lorsqu’Alfred Hitchcock cherche un nouveau livre à adapter. Cette idée lui traîne dans la tête car il a besoin de faire un film rapidement après La Mort aux Trousses. En chemin pour Londres depuis Los Angeles, Hitch achète un livre au duty-free, enfin pas au duty-free mais vous voyez ce que je veux dire… Le degré de trash du roman de Robert Bloch stimule fortement notre cher ami. Soyons honnête,il a vraisemblablement dû passer la bonne douzaine d’heures du vol à fantasmer sur cette histoire si morbide que même lui aurait eu du mal à l’imaginer.Son imagination explose en pensant à toutes les possibilités que permet cette histoire de mère empaillée. Évidemment il y voit un défi, jusqu’où pourra-t-il représenter à l’écran toute l’horreur que le livre contient ? Le studio lui affecte un jeune scénariste, Joseph Stefano, qui, à trente huit ans, a seulement travaillé sur deux films. Hitchcock regarde les deux films sans y porter grand intérêt et surtout ne porte pas grand intérêt à la personne qui en a écrit les scénarios. Il accepte néanmoins de rencontrer Joseph. Ce dernier a bien conscience que sa seule chance de convaincre se joue sur sa capacité à intéresser le maître du suspense en réglant rapidement la question centrale de l’adaptation : comment montrer la mère sans que le spectateur comprenne tout de suite qu’elle est morte ? La solution est peut-être de faire de Marion le personnage principal. Hitchcock, impeccablement habillé comme toujours, lève son regard sur le jeune scénariste et susurre : « nous avons besoin d’une star pour l’incarner ». Joseph sait qu’il a le job. Il faut maintenant oublier le livre et s’atteler à réaliser l’un des films les plus mythiques du cinéma.



Le travail commence et Joseph sait qu’il a une bonne scène entre les mains lorsqu’Hitchcock précise que cela a plu à sa femme Alma. Omniprésente, c’est sûrement elle que nous pouvons remercier pour la touche de génie dans les films de son mari. Un matin,le réalisateur et son scénariste imaginent comment Norman Bates enroule le corps de Marion dans le rideau de douche. Concentrés et quasiment seuls au monde, ils ont la peur de leur vie lorsque la porte s’ouvre doucement, comme si l’esprit de la mère de Norman Bates était en train de pénétrer les lieux. Avant qu’ils ne se mettent à crier, l’embrasure de la porte révèle qu’il s’agit simplement d’Alma venue vérifier l’avancement du film. Un film, d’horreur, qui se voulait différent car depuis le début, il était très clair pour Hitchcock qu’il serait en noir et blanc et qu’il ne coûterait pas plus d’un million de dollars. Car la couleur rendrait les images trop gores et qu’il voulait travailler avec son équipe de télévision de la série Alfred Hitchcock presents. Il se demandait simplement ce qu’il se passerait si une équipe talentueuse faisait un film à petit budget. La Paramount n’était pas enchantée par cette idée, surtout que Hitchcock était déjà en route vers Universal. Techniquement, Psychose était un film de la Paramount, produit par Shamley Productions Inc,tourné dans les studios d’Universal. Drôle de montage pour un film qui s’efforçait de rester secret pour préserver la surprise du spectateur. Joseph Stefano se souvient : « Je ne pense pas que les gens savaient vraiment ce qu’on fabriquait ». Et pour brouiller encore plus les pistes, l’équipe lance la rumeur d’un casting pour le rôle de la mère. Nombres d’agents hollywoodiens se seraient démenés pour avoir un rendez-vous. Hitchcock, maître du canular.
Toute l’équipe a évidemment tenu sa langue par respect pour celui qu’ils appellent parfois « Mr H. » et qui semblait pouvoir leur demander n’importe quoi.Janet Leigh n’a même pas lu le livre avant d’accepter, elle n’avait pas besoin d’en savoir plus que « Monsieur Hitchcock veut travailler avec vous » et elle ne fut pas déçue. « Tellement différent » se souvient-elle, en effet, sept jours de travail pour tourner une scène sous l’eau à moitié nue sur trois semaines de tournage, c’est différent. Faire en sorte de ne pas bouger d’un cil parce vous êtes censée être morte et que l’on fait un gros plan sur votre œil, c’est différent. Être la première personne à appuyer sur une chasse d’eau cinéma — une idée de Joseph celle-ci — la liste est interminable…
Psychose a tellement fasciné par quelques scènes emblématiques que peu de souvenirs du film sur la longueur persistent. On se souvient de la scène de la douche oui, peut-être de ce qui précède la scène de la douche, et du regard caméra final d’Anthony Perkins quand il dit avec cette voix si étrange « elle ne ferait même pas de mal à une mouche ». C’est le genrede film qu’on voit une fois ou deux et qu’on croit connaître par cœur, mais on finit toujours par être surpris car une fois que Marion meurt, il nous reste encore une heure de film à tenir, heureusement en la compagnie d’Anthony Perkins. Le film sort en 1960 et le public est au rendez-vous, même au-delà des attentes du studio. Par contre, les critiques démolissent Psychose. Joseph Stefano a une explication, enfin une théorie quelque peu torturée. Les critiques ont été forcés de voir le film en salle avec le commun des mortels et non lors de projections privées comme ils en avaient l’habitude, ceci encore une fois pour préserver le mystère autour de la mère. Stefano pense qu’ils se sont sentis vexésde ce traitement qu’ils ont considéré médiocre et parconséquent, ils auraient écrit de mauvaises critiques. C’était sans compter sur François Truffaut, ses copainset pleins d’autres qui ont fait de ce film une référencechez les critiques, et évidemment chez les réalisateurs,quelques années seulement après les mauvaises critiques originelles.
Cela étant dit, pourquoi tant de haine ? S’il est indéniable que la version de Gus Van Sant n’arrive pas à la cheville du film d’Hitchcock, il est certain que là n’était pas l’enjeu. Gus Van Sant n’a pas voulu entrer en compétition avec l’un de ses films préférés, mais plutôt produire une sorte de copie parfaite de l’œuvre du maitre, dans un souci d’expérience post moderne quasi artistique et très consciented’elle même. Gus Van Sant dit aussi qu’il souffre d’un « penchant pour les désastres intéressants ». Approchons nous et observons en détail pourquoi il y a plus derrière ce film que ce qu’il paraît au premier abord. Un nombre non négligeable de membres de l’équipe d’origine se sont retrouvés pour accompagner Gus Van Sant. Joseph Stefano d’abord, qui a réécrit son propre scénario pour s’adapter quelque peu au langage de l’époque mais aussi pour montrer ce qu’il n’a pas pu écrire dans les années 60. La scène de l’explication avec le psychanalyste, bien inutile dans l’original, a été retirée de la nouvelle version. Patricia Hitchcock, fille de, interprétait la collègue ridicule de Janet Leigh dansla version de son père. Vous vous souvenez « Teddy called. My mother called to see if Teddy called. » Devenue mamie gâteau, elle intervient en tant que consultante sur le film de 1998. Le moment où elle rencontre l’actrice qui va jouer « son » rôle chez Gus Van Sant vaut à lui tout seul que cette nouvelle version ait existé. La nouvelle actrice ressemble à une Barbie à peine sortie de sa boîte. Elle doit se pencherdu haut de ses talons aiguilles jusqu’à sa taille pour pouvoir embrasser Patty Hitch. Les décisions de casting de Gus Van Sant paraissent plus tolérables quand il s’agit des personnages secondaires. Viggo Mortensen qui montre ses fesses. Julianne Moore avec son look d’ado un peu attardée qui garde ses écouteurs quasiment en toutes circonstances.Mais surtout, d’autres formes d’art sont constamment sujettes au fac-similé, pourquoi en serait-il autrement au cinéma. Gus Van Sant a simplement entrepris une « tentative créatrice ». Il a saisi l’importance « d’expliquer aux gens pourquoi nous avons fait ce film » lors d’un entretien et ses raisons posent le débat calmement et définitivement : « Ça n’avait tout simplement jamais été fait ! » Il s’inquiétait aussi du fait que plus personne ne regardait de films en noir et blanc et il rêvait d’attirer un nouveau public à découvrir le classique d’Hitchcock.En effet, il s’est amusé avec son équipe à faire un micro-trottoir pour demander aux passants s’ils avaient vu Psychose. Le résultat est presque aussi drôle que le micro-trottoir où l’on demande aux passants qui a gagné la guerre du Vietnam. Gus Van Sant voulait simplement savoir, par une sorte de curiosité intellectuelle, si refaire Psychose plan par plan ferait le même film ou non. Est-ce que ce serait encore Psychose ? La réponse est évidemment non. Ce n’est plus le même film. À la manière d’une pièce de théâtre qu’on remettrait en scène, Gus Van Sant voulait re réaliser le film d’Hitchcock. Et ce faisant, il parvient même à définir ce qui fait une œuvre de génie ou non. Avec la même histoire, les mêmes plans, le même montage, Gus Van Sant ne réalise qu’une sorte de pâle copie de l’original. On peut imaginer que le génie est ce qui se cache entre les plans. Pour Gus Van Sant, ce qui manque à son film se situe dans des tensions sombres et cachées. Comme quelque chose qui ne correspond pas vraiment à ce qu’est Psychose. Il a conscience d’avoir prouvé pourquoi et comment on ne peut jamais vraiment copier une œuvre d’art.
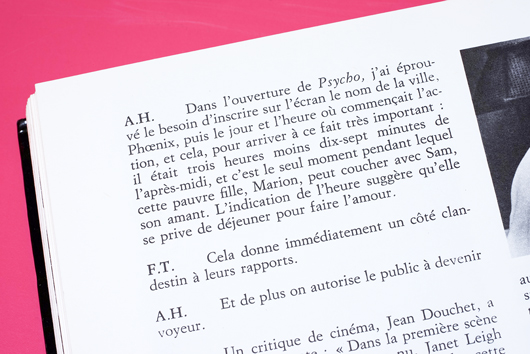

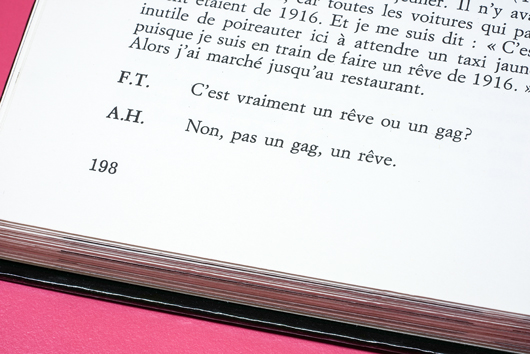
Pourquoi refait-on des films alors que la majorité des remakes sont très souvent détestés par rapport à l’original ? Peut-être parce que les réalisateurs ne peuvent simplement pas s’en empêcher. Même Hitchcock avait tourné des remakes de ses propres films. Notamment L’Homme qui en savait trop, réalisé en 1934 en Angleterre puis en 1956 pour les studios hollywoodiens. Et il a déclenché chez d’autres réalisateurs cette envie d’aborder cet exercice de style particulier qu’est le remake. Martin Scorsese, dans son désir de conservation des films, a retrouvé trois pages d’un scénario jamais tourné du maitre du suspense. Ni une ni deux, le voilà qui réalise ces pages de scénario « à la manière d’Hitchcock ». Et plus encore, dans les mêmes conditions techniques auxquelles il aurait eu accès pour tourner ce film. Le résultat est poignant puisque ces quelques minutes rassemblent toutes les scènes clefs de l’œuvre d’Hitchcock, un sosie d’Eva Marie Saint, et des effets spéciaux folkloriques. Bertrand Bonelloaussi aurait eu le projet de s’essayer à l’exercice avec « Madeleine d’entre les morts », une variation surVertigo. Aussi grande que soit son œuvre, Hitchcock réalisait des films dont les matériaux de base étaient sans doute assez classiques pour laisser de la place à une interprétation extérieure. Notre réalisateur bien aimé était l’un des grands théoriciens du « ce n’est pas ce que l’on raconte mais comment on le raconte ».
Et puis la course au méta-discours n’est pas terminée. Depuis 2013, la série de télévision américaine Bates Motel propose aux spectateurs une sorte de prequel contemporain. Une temporalité à perdre la tête puisque le jeune Norman Bates vit avec sa mère Norma dans un monde plus proche du notre que des années 40 où le Norman Bates d’Hitchcock aurait du grandir. Et en 2014, Steven Soderbergh boucle la boucle en mettant en ligne sur son site internet un montage parallèle des deux versions de Psychose. Une scène commence chez Hitchcock pour se terminer chez Van Sant. Pour nepas brusquer la vision, le film de 1998 a été transposé en noir et blanc. Lors des moments les plus violents, ce montage opère une surimpression entre les deux versions et apporte une sorte de contenu supplémentaire, un pont entre les deux films qui ne font plus qu’un l’espace de quelques secondes.
Comment s’est porté notre Gus après toutes ces folles aventures au pays du remake interdit ? Ma foi très bien. Au début des années 2000, il enchaîne les films à succès critique comme Gerry ou Elephant puis Last Days et Harvey Milk. Gus Van Sant profite d’une sorte de statut privilégié du réalisateur indépendant et respecté qui est aussi capable de faire des films disons mainstream et à succès. Et personne ne semble se souvenir de sa bourde de la fin des années 1990. Plus encore, si il avait tenté l’expérience Psychose maintenant, fort de sa Palme d’or, on aurait sans doute unanimement crié au génie. Mais peut-être que ce n’est pas trop tard. Il pensait déjà à l’époque du tournage de Psychose en 1998 que ce serait drôle de faire un second remake. Une sorte de version punk rock, « parce que Viggo connaît beaucoup de personnes de la scène punk rock, et qu’il avait des idées sur ce qu’on pourrait faire ».