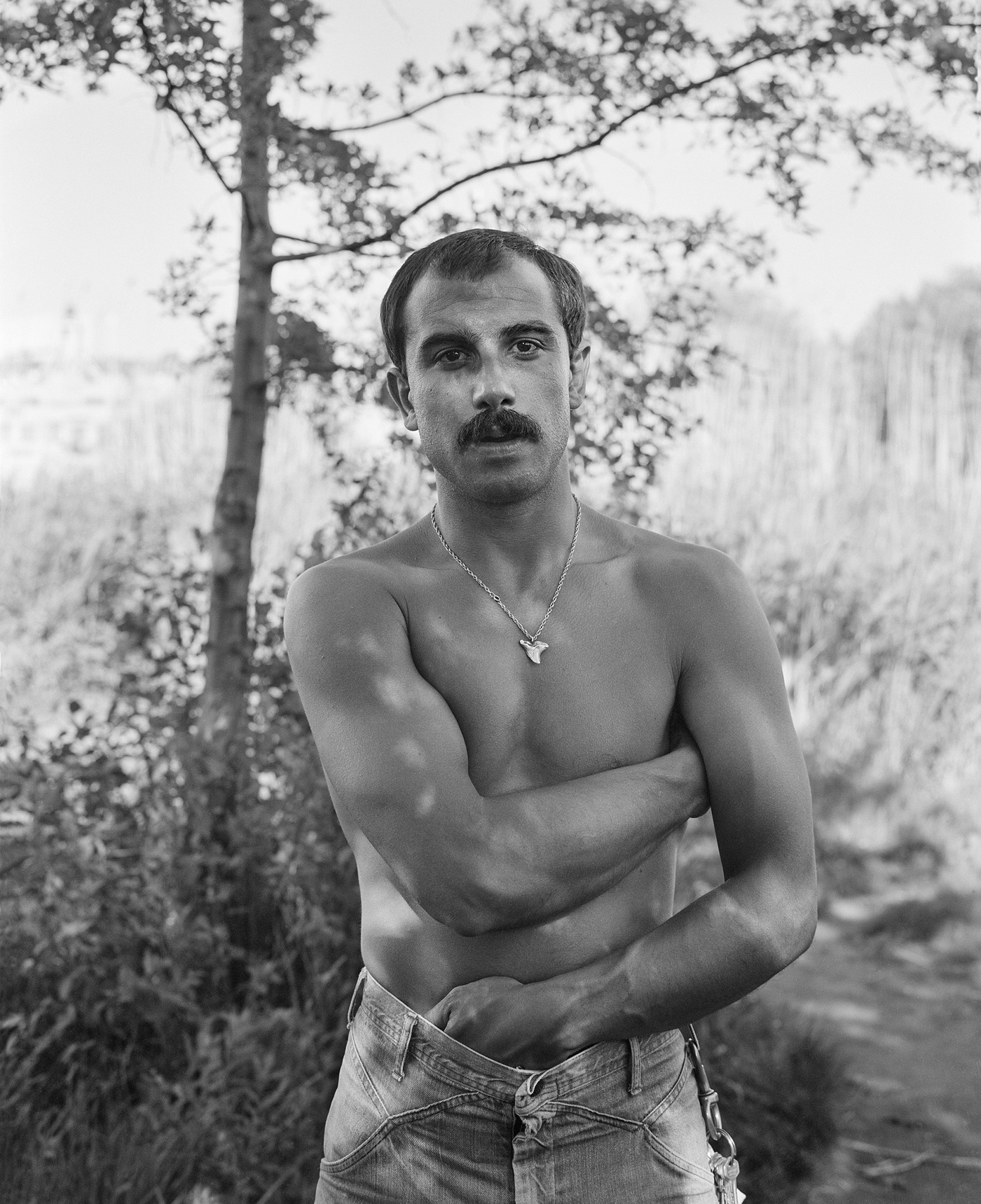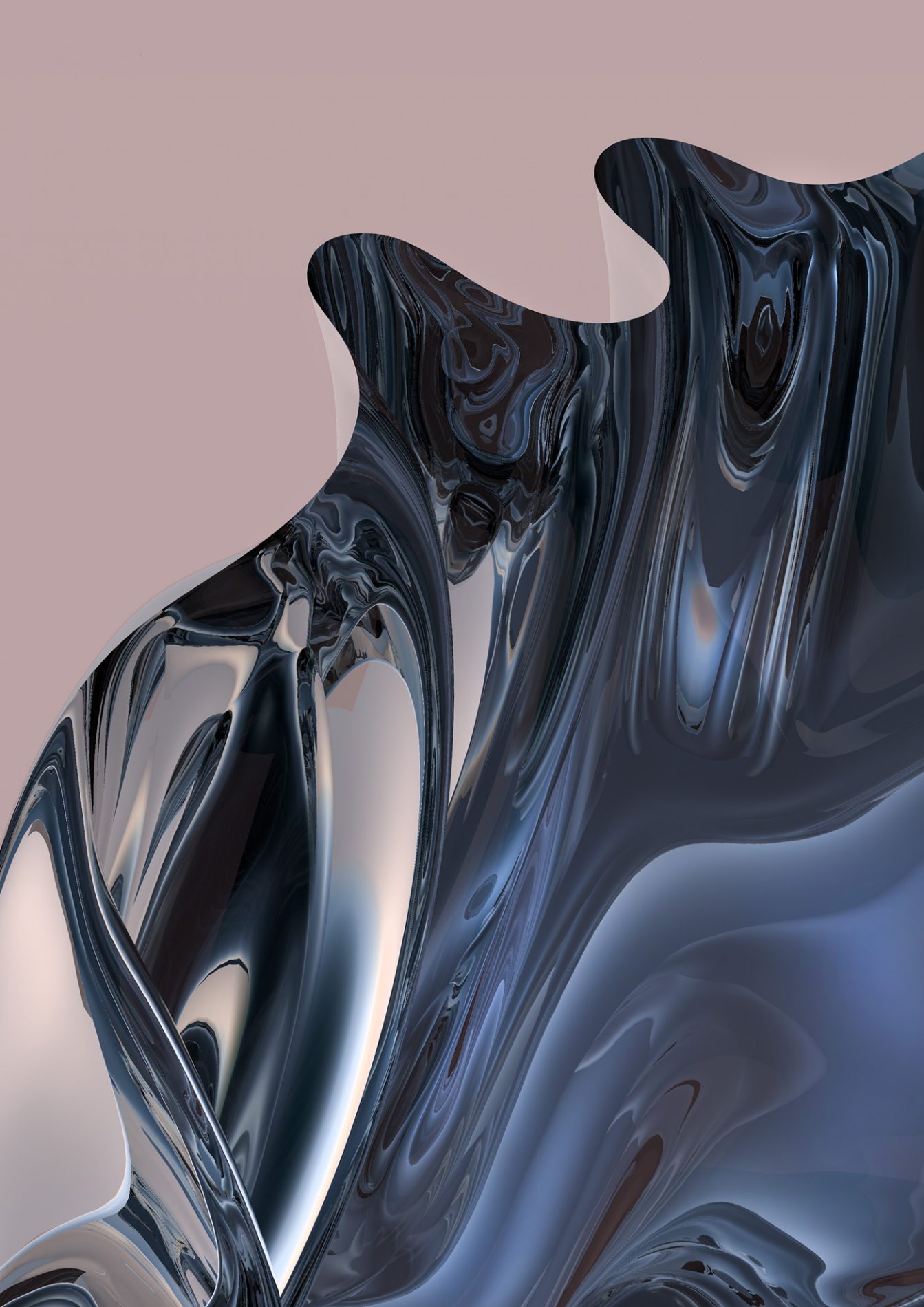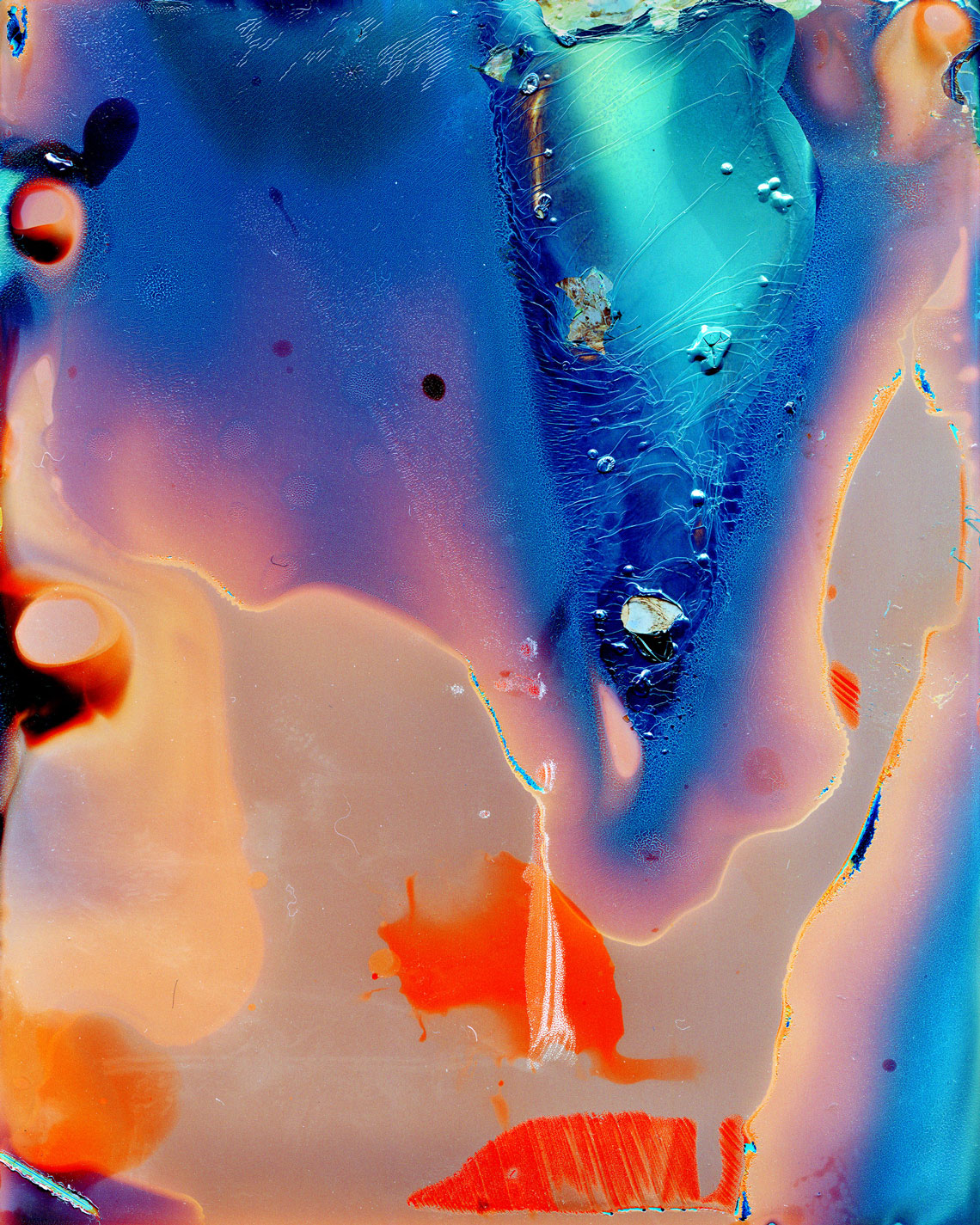Autel particulier
Nicole Wermers
Puisant dans l’esthétique domestique, Nicole Wermers interroge les relations sociales que nous dictent les objets du quotidien. À travers ses installations et sculptures, l’artiste pointe les contradictions qui séparent la sphère du privé et celle du public, et comment ses frontières produisent des situations parfois absurdes, parfois poétiques. Puisant autant dans l’esthétique moderniste que dans le ready-made, son travail s’intéresse plus spécifiquement depuis plusieurs années aux hiérarchies sociales et politiques de genre. Des formes d’interactions sociales invisibles mais dont les échos sont bel et bien présents dans nos vies. En discussion avec Muriel Stevenson, Nicole Wermers revient sur les fondements de sa pratique, la place de l’humour dans son œuvre et imagine une scénographie pour Fidelio.
Muriel Stevenson
J’ai découvert votre travail avec vos Vertical Awnings. Ces « auvents verticaux » m’ont attirée par leurs motifs et leurs formes épurées et m’ont rappelé les Colonnes sans fin de Brancusi. Dans cette série qui fêtera bientôt son dixième anniversaire, on retrouve la plupart des éléments qui constituent votre expression artistique : un goût pour l’objet fabriqué en série mais aussi pour la customisation, des références à l’histoire de l’art, un intérêt pour l’espace domestique et, plus précisément, pour ce qui se joue à l’extérieur et à l’intérieur de cet espace. Je profite de cette brève introduction pour vous demander dans quel type de demeure vous avez grandi et si votre enfance donne des clés de lecture de votre œuvre.
Nicole Wermers
Les Vertical Awnings combinent un mécanisme d’auvent fabriqué en série, qui a été modifié, et des supports que j’ai conçus pour que le rouleau de tissu se dresse à la verticale. Ces sculptures prolongent une réflexion sur la place des textiles et des matières douces dans l’espace public, qui a débuté avec les Untitled Chairs [« chaises sans titre »]. Le tissu enroulé, rétractable de chaque auvent peut couvrir 20 m2 mais il est systématiquement présenté en rouleau, comme un espace potentiel abstrait. Les étoffes ont été fabriquées spécialement pour ces sculptures. C’est drôle que vous m’interrogiez sur ma maison d’enfance car elle se trouve à Emsdetten, la petite ville où je suis née et où ont été produites ces étoffes, par un fabricant de tissus d’extérieur ; cette entreprise internationale se trouve à deux pas de la maison de mes parents.
Je m’intéresse beaucoup à la façon dont les tissus sont utilisés dans les lieux publics, par exemple pour séparer des espaces mais aussi pour les affecter à un usage, les privatiser, les ombrager, les domestiquer, les protéger et, d’abord et surtout, les créer. Le fait que les textiles conviennent à ces usages tient à leurs propriétés : ils sont souples, perméables, extensibles. Cela tient aussi à la perception que nous avons de ce matériau comme inoffensif et non menaçant. Une frontière textile paraît toujours franchissable.
Ma maison d’enfance était un petit pavillon cubique que mes parents louaient à l’employeur de mon père, une société de matériel de toiture, propriétaire du terrain où se trouvait notre habitation. Les échantillons de tuiles étaient présentés sur des pans inclinés de toits miniatures devant chez nous, perchés sur des structures en bois à hauteur d’épaule disséminées partout sur la petite pelouse le long de la rue. Comme pour compenser l’absence de tuiles sur notre toit plat.

Nicole Wermers, Reclining Female #6, 2024. Plâtre, pigment, polystyrène, tissu, métal, bois, chariot de ménage et matériaux divers. Photo : Ruth Clark. Avec l’aimable autorisation de l’artiste, de Jessica Silverman, San Francisco, et Herald St, Londres.
J’ai donc grandi dans une exposition de matériaux de construction. La notion d’exposition comme la question de l’environnement bâti participent de mon travail depuis toujours. Mon grand-père, que je n’ai jamais connu, et mon oncle, aujourd’hui décédé, dont j’étais très proche, étaient tous deux tailleurs pour homme, d’où peut-être mon intérêt pour la mode et les tissus.
Muriel Stevenson
L’humour est très présent dans votre démarche. Votre récente série intitulée Proposal for a Monument to a Reclining Female, ou « proposition de monument pour une femme allongée », se compose d’esquisses de sculptures représentant de languides corps féminins, dans la grande tradition des odalisques, posées en équilibre sur des empilements d’objets du quotidien relevant aussi bien d’une iconographie pop que d’une représentation de la charge mentale spécifique aux femmes. Dans l’exposition Day Care, présentée à Glasgow en 2024, vos œuvres prennent des dimensions plus grandes et les corps reposent sur des chariots. Ces sculptures sont créées à partir de matériaux pauvres et non pas de bronze. Pouvez-vous nous dire comment sont nées ces pièces ? Ont-elles mis longtemps à mûrir dans votre atelier ? Je voudrais savoir aussi si certains artistes vous inspirent par leur sens de l’humour.
Nicole Wermers
J’espère que l’humour est perceptible même si cette série, comme l’essentiel de mon travail, comporte aussi des aspects sérieux. En ce qui concerne les exemples que vous mentionnez, les grandes sculptures intitulées Reclining Females qui constituent la majeure partie de l’exposition Day Care à la Common Guild de Glasgow sont le résultat d’une réflexion sur la figure récurrente dans l’histoire de l’art du nu de femme allongée, généralement exécuté par des hommes. J’ai beaucoup travaillé sur les personnages allongés pendant la pandémie, non pas en relation avec l’idée de maladie mais parce que je m’intéressais à l’horizontalité comme état actif. Bien que représentant en apparence la passivité féminine, ce genre a toujours été lié au travail au sens où les modèles, en peinture comme en sculpture, étaient des prostituées ou des modèles rémunérés. Je voulais faire des sculptures reliant cette notion au travail invisible effectué par les femmes d’entretien dans d’innombrables bâtiments et hôtels, je voulais contribuer à la reconnaissance et à l’élévation de ces corps au travail, montrer la nécessité de leur donner un répit en monumentalisant ce moment de repos.
Les chariots de service ou de ménage, sur lesquels reposent ces figures en plâtre un peu plus grandes que nature, comme sur un socle d’où elles nous regardent de haut, sont les outils qui connectent le corps en travail du personnel d’entretien au bâtiment dont il a la charge. J’ai photographié des chariots, en l’absence de personnel, dans des hôtels, des musées et des aéroports pendant presque dix ans avant qu’ils trouvent une place dans mon œuvre. Je trouve fascinante la façon dont ils concentrent une multiplicité de fonctions, de matériel et de produits de nettoyage de différentes couleurs.
La série Proposal for a Monument to a Reclining Female, les œuvres de plus petites dimensions que vous avez mentionnées, sont faites en terre renforcée séchée à l’air libre. Il s’agissait au départ de simples études pour tester ma capacité à faire de la sculpture figurative, chose entièrement nouvelle pour moi. Mais je les aimais beaucoup et, évidemment, je ne voulais pas les placer sur des chariots miniatures. Pour moi, elles ont une fonction de modèle, comme le suggère le titre. J’ai fini par les mettre sur de petits socles composés d’un empilement de boîtes de différents produits de consommation. Les grandes Reclining Females reposent sur leurs « outils », remettant le travail à plus tard. La notion de travail invisible participe également de ces propositions au sens où, dans une certaine mesure, la consommation a remplacé le travail dans le système capitaliste tardif. Les piles de boîtes – vides – de chocolats, anti-inflammatoires, DVD de séries télé, lait d’amande, gels hormonaux, etc. représentent les bases de la vie quotidienne mais aussi la façon dont le corps féminin est relié au capitalisme mais également épuisé par ce système. Les effets des produits ainsi représentés sont souvent antagonistes, stimulants ou calmants, qu’il s’agisse de café et de comprimés de caféine, de cigarettes et de chocolats mais aussi de dentifrice, de cachets amaigrissants ou de produits de bien-être, qui reflètent nos comportements irrationnels de consommateurs.

Nicole Wermers, Proposal for a Monument to a Reclining Female #14, 2024. Argile renforcé de nylon, boîtes en carton, bois, mousse.
Photo : Phillip Maisel. Avec l’aimable autorisation de l’artiste, de Jessica Silverman, San Francisco, et Herald St, Londres.
Le genre d’humour où l’on éclate d’un grand rire et que l’on oublie deux secondes après n’est pas celui que j’apprécie.
J’aime l’humour noir de Robert Gober, ou de Sigmar Polke qui a été mon professeur dans mon école d’art à Hambourg. Il adorait plaisanter sur ses peintures qui, à l’époque, contenaient pas mal de produits toxiques. Il imaginait des familles bourgeoises admirant ses œuvres le dimanche matin au cours de leur visite hebdomadaire au musée, puis s’asseyant autour de la table pour le traditionnel repas dominical et perdant soudain tous leurs cheveux.
Muriel Stevenson
Les chaises de la série Untitled Chairs rappellent votre goût pour l’esthétique moderniste et son utilisation de structures tubulaires en acier chromé dont vous vous étiez déjà emparée avec votre Wasserwandregal. Vous avez cousu des manteaux de fourrure au dos de chaises, transformant les formes épurées de Breuer en objet décoratif hybride. Ce vêtement symbolique du féminin devient lui-même un élément décoratif. Quelques années plus tard, à l’invitation de Balenciaga, vous avez revisité ces œuvres. Comment avez-vous abordé ce projet ?
Nicole Wermers
Les Untitled Chairs modifient l’espace temporaire, le geste de l’appropriation temporaire d’une chaise, dans un lieu public, au dos de laquelle on suspend une veste : ces œuvres le transforment en objet, le vêtement devient partie intégrante et permanente du siège, il est cousu à la chaise et ne forme qu’un seul et même objet avec elle. J’ai utilisé des manteaux en fourrure vintage car ils ont une présence particulière, ils sont souvent customisés voire créés pour une cliente, et, plus important encore, leur doublure permet de masquer le dossier. J’ai choisi la chaise Cesca de Breuer pour son esthétique mais aussi parce que j’aime le geste qui consiste à s’approprier, grâce à des manteaux de femme, une chaise créée par un homme. Grand architecte et designer moderniste, Breuer tout comme Mies van der Rohe ou Le Corbusier collaborait avec des femmes, des créatrices dont le travail fut à peine reconnu de leur vivant.
En 2019, j’ai été contactée par Balenciaga pour une intervention autour de pièces de leur collection. La marque, tout particulièrement à ce moment-là, s’intéressait comme moi à la condition urbaine, aux hiérarchies matérialisées, aux phénotypes. Le projet m’a paru intéressant. J’ai réalisé une série de sculptures servant de mannequins de présentation aux doudounes oversize de Balenciaga et à un manteau en cuir verni. Plutôt que des chaises isolées, j’ai travaillé avec des chaises empilables qui condensent parfaitement l’espace – potentiel – pour s’asseoir, formant des tours une fois superposées. J’ai mis au point, pour chaque modèle de siège, une technique permettant de fusionner les éléments séparés en une pile que l’on ne peut plus désolidariser. Les chaises empilables meublent des espaces publics ou de travail, elles révèlent une utilisation de l’espace comme marchandise flexible. L’espace que pourraient occuper les chaises de Untitled Stacks si elles étaient disposées pour s’y asseoir est ainsi irrémédiablement concentré en structures verticales seyant à la longueur et aux formes de chaque manteau.
Muriel Stevenson
Le collage joue un rôle important dans votre œuvre. Le fait de fixer deux éléments l’un sur l’autre ou côte à côte engage un dialogue. Le collage est comparable à une cohabitation : il rapproche dans le même espace des composantes diverses ou incongrues, comme le montrent vos installations Mischung et II Dehors.
Nicole Wermers
J’ai commencé à créer des collages de papiers à l’ancienne, à partir de magazines de mode et de décoration intérieure, en 1997. Cela m’intriguait de substituer des images aux tissus et aux décors bien réels. La part de rêve si évidente dans ce type de magazines m’intéressait tout autant.
Les collages déconstruisent et reconstruisent l’espace et les décors imaginés pour la photographie de mode et publicitaire. J’étais particulièrement attirée par la gradation de couleurs obtenue en studio grâce à des arrière-plans courbes éclairés avec soin, par ces non-lieux sans fin, aux surfaces dépourvues de leurs propriétés, où les produits semblent flotter mais projettent néanmoins un semblant d’ombre. Je choisis en priorité la partie des photos où l’on voit les décors et les accessoires plutôt que le produit lui-même, autrement dit les éléments qui servent à rendre désirable ce dernier.

Nicole Wermers, Dishwashing Sculpture #16, 2024. Divers articles en porcelaine, céramique et verrerie, ustensiles de cuisine, panier de lave-vaisselle modifié, socle.
Photo : Phillip Maisel. Avec l’aimable autorisation de l’artiste, de Jessica Silverman, San Francisco, et Herald St, Londres.
Quand on élimine le produit, ces espaces, déjà fictifs, achèvent de perdre toute forme de gravité ou d’échelle. Les matières représentent une bonne part des fragments que je choisis, bois ou métal aux surfaces lustrées, béton, écrans réfléchissants, détails de mobilier en surimpression : même découpés, ils continuent de véhiculer une impression de luxe et de vastes espaces intérieurs associés à la modernité.
Si les collages finaux se composent d’éléments multiples provenant de différentes revues, le résultat doit former une image homogène. Je travaille à partir d’importantes archives de pages classées par catégories telles que des nuances de coloris, des reproductions de bois, béton, métal, etc. Parfois cela prend du temps pour réunir assez de photos similaires d’un même matériau afin d’associer certains fonds et composantes jusqu’à créer une image qui donne l’impression de ne jamais avoir été autre.
La relation entre volume et surface constitue une interrogation récurrente dans les collages avec un premier plan et un arrière-plan : ils se distinguent parfois mal l’un de l’autre, le sens de l’espace en est troublé. Les collages paraissent abstraits mais la présence de matières reconnaissables, la reproduction de qualités de surfaces et d’éclairages suggèrent des objets concrets, presque des photos de décors en trois dimensions.
Je dois dire cependant que je n’ai pas fait beaucoup de collages ces dernières années, ce qui tient sans doute en partie au développement de la représentation numérique de l’espace. Les magazines papier et la publicité imprimée existent toujours mais je me concentre plus sur la sculpture, la création d’œuvres physiques, palpables.
Muriel Stevenson
Dans le même registre, quantité de vos œuvres ont pour point de départ l’architecture et le mobilier urbains et soulignent l’absurdité ou la poésie de certaines réalisations. Vous avez grandi en Allemagne, vous vivez en Angleterre et vous voyagez beaucoup pour vos expositions. Y a-t-il un pays dont nos urbanistes devraient s’inspirer ?
Nicole Wermers
Je dois dire que j’apprécie vraiment les différences de mobilier urbain d’une ville à l’autre et les spécificités locales, les strates historiques de Londres, Paris et particulièrement Rome où j’ai vécu un certain temps, y compris ce qui ne fonctionne pas très bien. Le cadre urbain, cependant, se métamorphose radicalement. Les centres-villes commencent à se ressembler partout, je n’ai plus envie de transférer des choses d’un endroit à l’autre.
De façon générale, je m’intéresse aux structures les moins visibles de l’environnement bâti dont le dessein est d’influencer nos comportements et de produire ou reproduire des hiérarchies (spatiales) qui vont de pair avec des possibilités de création architecturale et plastique.

Nicole Wermers, Moodboard #7, 2017. Terrazzo coulé dans une table à langer. Avec l’aimable autorisation de l’artiste, de Jessica Silverman, San Francisco, et Herald St, Londres.
Un grand nombre de personnes font désormais l’expérience de la vie en société par l’intermédiaire d’un écran, à la maison, tandis qu’un livreur sous-payé de Deliveroo leur apporte leurs repas : l’éventualité de rencontres d’ordre personnel ou liées à la fréquentation d’un même espace public est ainsi réduite au minimum en dehors de leur propre classe sociale et de leur bulle de filtrage.
Une bonne partie de mes sculptures s’intéresse aux aspects structurels de l’espace public concret qui, d’une certaine façon, tend à disparaître. Gares, aéroports, halls d’hôtel, etc., ces espaces de transition définis comme non-lieux par l’anthropologue Marc Augé, étaient auparavant des sites où, au moins, des individus de milieux variés se croisaient. Aujourd’hui ces espaces sont fragmentés, avec des salons, des halls ou des ressources techniques accessibles à quelques priviliégiés seulement.
Plus que jamais, le mode de vie des nantis est visible en ligne mais dissimulé et hors d’atteinte dans la vie réelle.
Muriel Stevenson
Pourriez-vous nous décrire votre atelier ?
Nicole Wermers
Je vis et travaille depuis 2005 dans un atelier situé à Hackney. C’est un bâtiment industriel, un volume ouvert avec une vue extraordinaire, mais assez basique par ailleurs. Pas mal de bricolages ont été improvisés pour répondre à des besoins domestiques ; c’était à titre temporaire mais je m’y suis habituée. Il y a une sculpture, Kusine, que j’ai faite en 2006, un canapé en velours bleu, des dessins et des toiles d’amis au mur. Vivre dans le lieu où je crée a influencé mon travail, très nettement.
Depuis trois ans environ, j’ai aussi un atelier ailleurs, à Angel, dans une coopérative d’artistes baptisée Cubitt qui existe depuis trente ans. Après la pandémie, j’ai commencé à utiliser plus souvent la terre et le plâtre : il devenait impossible de faire ça chez moi.
Muriel Stevenson
Ce numéro de Revue a pour sujet central le seul opéra composé par Beethoven, Fidelio, dans lequel une femme se travestit en homme afin de pénétrer dans une prison et sauver son mari qui y est détenu. Si vous aviez à concevoir une scénographie pour cette œuvre, quelles images aimeriez-vous convoquer sur scène ?
Nicole Wermers
J’élargirais le travestissement au décor, unique et qui figurerait à la fois la cuisine de Rocco, la cour de la prison, le donjon, etc. Je jouerais sur l’éclairage pour souligner différentes zones du décor et en cacher d’autres afin que la maison de Rocco devienne aussi prison ou donjon.

Nicole Wermers, Untitled Stack (brown Robin Day chairs/pink coat), 2019. Manteau Balenciaga, chaises empilables, quincaillerie, tissu, fil.
Avec l’aimable autorisation de l’artiste, de Jessica Silverman, San Francisco, et Herald St, Londres.
La mécanique
des fluides
Daniel Dewar & Grégory Gicquel
Couper, modeler, tailler, polir, extruder, ciseler, creuser, l’art de Daniel Dewar et Grégory Gicquel convoque les gestes ancestraux liés à la pratique de la sculpture. Des actions qui passent par autant d’années d’apprentissage pour maîtriser des techniques changeantes au gré des matériaux, que les mains s’affairent sur du bois ou de la pierre. Si ce cycle de production lent semble logique, il est paradoxalement de moins en moins fréquent, les savoir-faire et techniques étant de plus en plus morcelés et industrialisés. À contre-courant, les deux camarades dessinent une œuvre qui multiplie, non sans humour, les clins d’œil à l’histoire de l’art. Ici, ils s’entretiennent avec Justin Morin sur la physicalité de la sculpture mais aussi sur la signification des toilettes, motif récurrent de leur œuvre.
JUSTIN MORIN
Dans le catalogue de La jeune sculpture, projet réalisé en 2014 au Musée Rodin à Paris, vous évoquez à propos du principe d’édition que vous réalisez peu de multiples car cela touche à une question de désir. Vous dites notamment : « Ce qui motive la production d’une forme, c’est le désir ; ce qui l’arrête, c’est l’ennui. » Dix ans après cette déclaration, et alors que vous travaillez ensemble depuis plus de vingt ans, est-ce que le désir est toujours un moteur pour réaliser vos œuvres?
DEWAR & GICQUEL
C’est une grande question. Effectivement, dix ans plus tard, nous trouvons toujours un intérêt à produire des occurrences uniques d’objets. Ces dix dernières années, nous avons choisi d’approfondir certaines techniques qui font que, peut-être, l’on répète de plus en plus des motifs ou la manière dont les figures sont construites et prennent corps dans la composition d’un objet. Mais le désir reste primordial.
JUSTIN MORIN
Dans ce même entretien, vous évoquiez l’envie d’explorer d’autres champs, comme la mode, la décoration d’intérieur ou même l’agriculture. Et effectivement, on a pu voir émerger depuis de nouvelles formes dans votre production, notamment des sculptures fonctionnelles comme des bancs ou des commodes. Mais elles restent des œuvres uniques, et leur fonctionnalité est potentielle, dans la mesure où il semble peu probable d’utiliser ces pièces si impressionnantes. Que se passerait-il si un éditeur de tissus ou de carrelage vous proposait une collaboration? Produire selon des procédés industriels vous intéresserait-il?
DEWAR & GICQUEL
C’est drôle car cette phrase à l’époque était complètement spéculative, nous citions des centres d’intérêt parmi d’autres, c’était quelque chose de l’ordre du rêve, mais c’est effectivement devenu une réalité aujourd’hui. Pas encore avec la mode,parce que c’est un domaine assez spécifique, mais l’agriculture est présente en tant que sujet, et la décoration d’intérieur nous sert de support à la sculpture. Un meuble, c’est à la fois une image – qui donne une idée d’un mobilier, d’un décor pour l’intérieur – mais c’est aussi un support structurel que l’on va transformer en sculpture. C’est comme un châssis et une toile. Mais le rapport au mobilier dans notre pratique n’est pas celui de la réalité de la décoration d’intérieur ou du design. Nous nous situons dans le monde des images, d’un décor imaginaire.
Si on venait nous proposer une collaboration, alors se poserait toute une série de questionnements. Nous avons toujours été intéressés par la possession de nos moyens de production, et donc appliquer notre travail à une échelle plus industrielle nous enlèverait nos moyens de production des mains. Et si nous décidions malgré cela de le faire, ces objets deviendraient une réalité, ce qui remettrait en cause le rapport que nous venons d’évoquer entre imaginaire et réalité.

Daniel Dewar & Grégory Gicquel, Oak relief with man, udders, and vase (detail), 2017. Bois de chêne, 73 × 260 × 24 cm. Photo : Diana Pfammatter.
Toutes les œuvres sont reproduites ici avec l’aimabe autorisation des artistes, Antenna Space, Shanghai ; C L E A R I N G, New York/Los Angeles ; Jan Kaps, Cologne ; Loevenbruck, Paris.
Aujourd’hui,les bancs ou les meubles sont utilisables, mais ce sont avant tout des fabriques dans le sens « folie architecturale » du terme, des images ambiguës, qui permettent d’affirmer que l’art est partout.
JUSTIN MORIN
Vous travaillez en duo, pouvez-vous nous dire quelle est votre dynamique à l’atelier? Vous vivez dans deux villes différentes. Avez-vous deux ateliers distincts?
DEWAR & GICQUEL
Cela fait longtemps que nous travaillons ensemble. La première partie de notre vie d’artiste a été extrêmement fusionnelle et expérimentale dans notre rapport à la pratique. Nous tentions au quotidien des choses avec souvent très peu de réussite dans les réalisations, tout au moins d’un point de vue technique ! Depuis dix ans, nous vivons dans deux villes séparées avec un atelier en Bretagne et un atelier à Bruxelles. Chacun a ses spécificités. Par exemple, la pierre est taillée dans un atelier, le textile brodé et cousu dans l’autre. C’est dans l’atelier en Bretagne que se trouve le four à bois pour la cuisson des céramiques. On pourrait dire qu’il y a un atelier de campagne et un atelier de ville. Les travaux en bois, eux, sont réalisés dans les deux espaces et permettent donc une interchangeabilité. Et sinon, nous nous appelons tous les jours après le déjeuner!
JUSTIN MORIN
Pour revenir à cette idée du désir de produire des formes que nous évoquions en introduction, il est important de dire qu’il y a également chez vous un plaisir à apprendre de nouvelles techniques. Quelles sont les techniques à travers lesquelles vous vous épanouissez le plus en tant que sculpteurs?
DEWAR & GICQUEL
La phase d’apprentissage et de découverte d’une technique est passionnante. Cet apprentissage passe par la pratique et peut durer plusieurs années durant lesquelles on essaie de contourner les règles. Et souvent on se rend compte qu’elles sont incontournables… Mais cette phase d’apprentissage est intéressante car elle envisage la technique comme une chose communicante. Au moment où l’on apprend une technique et qu’on la « propose » sous la forme d’une œuvre réalisée, on matérialise de fait un échange, une communication entre le passé et le futur. Alors qu’aujourd’hui la société occidentale se débarrasse volontairement de ses moyens de production et savoir-faire, nous avons une forte croyance que les techniques et leur diversité, de par leur aspect communicant, sont fondamentales d’un point de vue culturel.
JUSTIN MORIN
Qu’est-ce qui vous a amené à travailler le textile? Était-ce une volonté de vous confronter à un matériau plus léger? Ou étiez-vous attirés par les traditions Arts & Crafts des pratiques textiles?
DEWAR & GICQUEL
Nos toutes premières œuvres en textile étaient réalisées en tissage. Nous avons tissé des tapisseries assez monumentales, représentant des images agrandies et jouant avec l’idée de la basse définition et du pixel. Nous avons toujours eu un intérêt pour le textile car c’est évidemment une technique que l’on peut maîtriser dans nos ateliers. Il y a quelques années, c’est en explorant la broderie que nous nous sommes équipés de machines à broder industrielles, généralement utilisées pour réaliser des logos sur des casquettes ou des tee-shirts. Au lieu de broder des petits sigles, nous avons décidé de pousser ces machines dans leurs limites et de leur faire broder des surfaces entières, pour réaliser des coussins et des quilts. Historiquement, le quilt est un ouvrage très sophistiqué qui était réalisé en communauté et en guise de cadeau pour célébrer des évènements comme des mariages et les motifs représentés racontaient une histoire. Cette idée du travail en communauté nous intéressait, et c’est pour cela que nous avons choisi de représenter dans ces quilts brodés les écosystèmes et les principes de la permaculture dans les jardins potagers, en association avec des représentations des machines à coudre, broder et surjeter dont nous nous servons pour réaliser ces ouvrages.
JUSTIN MORIN
L’humour est très présent dans votre travail. Doit-on interpréter le choix du bidet, un motif récurrent dans votre production, comme un clin d’œil malicieux à l’urinoir de Duchamp, et à toutes les questions relatives au statut de la sculpture que cette œuvre a soulevées?
DEWAR & GICQUEL
C’est une longue histoire ! Autour des années 2010, nous expérimentions autour de la céramique, en faisant fondre des objets trouvés en céramique. Nous amassions dans des fours toutes sortes de choses, des théières,des lavabos, des pots de fleurs, des briques, des plats à escargots, que nous faisions cuire à haute température. Les objets en faïence fondant à basse température, on pouvait créer des amalgames d’objets plus ou moins reconnaissables. Cette expérimentation s’est poursuivie pendant quelques années et nous a amenés à concevoir un plus gros four pour réaliser des fontes plus importantes. Nous avons fait acheminer des grands blocs de roche volcanique depuis l’Ardèche, que nous avons fait fondre dans ce four mais malheureusement en raison des contraintes techniques, liées notamment au refroidissement, ces recherches en sont restées là.
Nous nous sommes donc retrouvés avec ce grand four à bois et un questionnement sur ce que nous pouvions y cuire. Nous avons pensé «manufacture», puis «sanitaires». C’est ainsi que nous avons poursuivi notre exploration de la céramique en fabriquant des lavabos, des baignoires, des bidets, des toilettes… À la différence que cette fois-ci, ils n’étaient pas moulés comme ceux que l’on trouve dans le commerce, mais modelés à la main et émaillés d’engobes. Pour chaque cuisson, on pouvait fabriquer une quinzaine d’objets sanitaires sur un principe de série, mais qui finalement étaient tous uniques puisque tous modelés et placés dans une position différente dans le four, avec des effets de cuisson différents… Ce que l’on a tendance à oublier, c’est que dans l’industrie, les prototypes sont aussi modelés à la main. Les urinoirs de Duchamp ont aussi été modelés à la main.
En réalisant ces objets – qui ont une tuyauterie dedans, qui ont des creux, des courbes – , nous nous sommes rendu compte qu’il y avait un lien fort avec l’idée du plein et du vide en sculpture. Ce n’est que par la suite, lors d’une baignade dans les rochers en bord de mer, que nous avons fait le rapport entre la baignade, le minéral et la salle de bains, et que nous avons choisi de sculpter ces mêmes sujets dans le marbre rose. L’intimité, la nudité dans la salle de bains nous intéressent, comme une expérience contemporaine qu’ont les humains avec les éléments ; l’eau est amenée chez nous par les tuyaux pour nous offrir l’expérience quotidienne de la baignade…
JUSTIN MORIN
Effectivement, la salle de bains convoque l’intimité. D’ailleurs, on retrouve des corps nus dans vos œuvres. Mais la nudité chez vous n’est pas érotique, elle est plutôt anatomique, que vous montriez un pénis ou un intestin. L’idée de fluide est aussi essentielle dans votre travail, que ce soit l’urine, l’eau, la bave des escargots qui sont des prolongations des sujets que vous sculptez. Et même si ça n’est pas une incarnation littérale, il y a une certaine dimension sensuelle dans certaines de vos œuvres. Et toujours dans ces analogies qui se mettent en place dans votre travail, on peut ajouter que dans l’atelier, on utilise aussi l’eau pour couper les pierres, l’huile pour graisser les chaines des machines. La sculpture est une pratique physique, qui mobilise tout le corps et ses muscles, et on a tendance à l’oublier.
DEWAR & GICQUEL
Oui les fluides, les éléments et les espèces se mélangent dans le travail, sous la forme de rencontres et d’analogies qui mêlent l’eau, l’huile, les peaux ou les machines par exemple.

Daniel Dewar & Grégory Gicquel, Nudes n°7, 2018. Marbre Rosa Aurora, 120 × 270 × 129 cm. Photo : Stan Narten.

Daniel Dewar & Grégory Gicquel, Stoneware toilet and bidet, 2012. Céramique en grès cuite au feu de bois, 38 × 49 × 50 cm. Photo : Mareike Tocha.

Daniel Dewar & Grégory Gicquel, Nudes n°3 (detail), 2017. Marbre Rosa Aurora, 210 × 110 × 50 cm. Photo : Stan Narten.
Nous pensons qu’il est dans notre intérêt d’être au contact avec les éléments, avec la matière, ne serait-ce que pour des questions d’humilité et pour se sentir en vie. Et il est vrai qu’on lira difficilement le labeur, les gestes, ou la mécanique qu’implique la facture d’une œuvre, tant les processus sont considérés aujourd’hui sous l’angle de la robotisation et de l’automatisation… Notre travail incarne une forme de lutte contre l’automatisation…
JUSTIN MORIN
Quels sont les artistes, qu’ils soient sculpteurs, peintres, musiciens ou cinéastes, qui vous inspirent?
DEWAR & GICQUEL
C’est une vaste question… Les granits noirs de l’Égypte antique, le compositeur et claveciniste Domenico Scarlatti, les poteries de Betty Woodman, les sculptures de Robert Gober, le livre L’homme et la charrue à travers le monde d’André G. Haudincourt et Mariel J.-Bruhnes Delamarre, le mobilier Breton… Et tous les jeunes artistes en général…
JUSTIN MORIN
Quels sont vos projets à venir?
DEWAR & GICQUEL
Nous préparons actuellement une exposition personnelle à Z33 en Belgique, qui ouvrira au printemps 2025.

Daniel Dewar & Grégory Gicquel, Stone marquetry with body, soap dispenser, and taps n°3, 2017. Marbre, calcaire et granit, 80 × 100 × 2 cm. Photo : Margot Montigny .
Toutes les œuvres sont reproduites ici avec l’aimabe autorisation des artistes, Antenna Space, Shanghai ; C L E A R I N G, New York/Los Angeles ; Jan Kaps, Cologne ; Loevenbruck, Paris.
Le chant
d’un cygne
Édouard LouisGus Van Sant
Alors que l’on attendait impatiemment le retour de Gus Van Sant au cinéma après son dernier film, Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot, sorti en 2018, le réalisateur américaina surpris ses admirateurs en réalisant la quasi-totalité de la seconde saison de la série anthologique Feud. Consacré à la dispute opposant l’écrivain Truman Capote à sesriches amies, le récitrevient sur les blessures des différents protagonistes, et l’impact qu’un simple texte peut avoir sur le réel. Une réflexion sur le pouvoir de la littérature qui pouvait difficilement laisser Édouard Louis insensible. L’auteur français, qui vient de publier son sixième livre, intitulé Moniques’évade, a dévoré les épisodes consacrés à l’inénarrable Capote. Il s’entretient ici avec le réalisateur autour de cette figure disparue il y a tout juste quarante ans et qui pourtant ne cesse de fasciner.
Édouard Louis
Gus, je viens de terminer la série Feud – Capote vs the Swans, que tu as réalisé autour de Truman Capote. C’est une série incroyablement puissante, qui aborde les questions de l’homosexualité, de l’amitié, du pardon, de la littérature, dont j’aimerais qu’on parle aujourd’hui. Mais avant cela, je voulais te demander simplement quel avait été le point de départ de ce projet ?
Gus Van Sant
Il y a deux ans, lors d’un diner, mon ami Robin Baitz m’a raconté qu’il était en train d’écrire autour de cette histoire entre Truman Capote et ses « cygnes », le surnom que Truman avait donné à ses riches amies. Il se trouve que je connaissais plutôt bien le sujet puisque j’avais lu l’article intitulé La Côte Basque, publié en 1965 dans le magazine Esquire. Ce texte a causé une rupture entre Capote et ces femmes. De Truman, je connaissais également les trois ou quatre chapitres de Answered Prayers, son roman inachevé. Le fait qu’il n’ait jamais réussi à terminer son livre, mais aussi son rapport avec Andy Warhol – dans les années 50, Truman a essayé de garder Andy à distance, car il le trouvait trop insistant… Quelques années plus tard, il a accepté son invitation et s’est mis à écrire pour son magazine Interview… –, la période du Studio 54, j’étais familier avec tous ces éléments. Quant à Ryan Murphy, qui a produit et imaginé la série, je connaissais une partie de son travail, notamment la série Hollywood, inspirée du livre Full Service de Scotty Bowers. J’ai demandé à Robin Baitz s’il pensait que Ryan accepterait qu’un réalisateur extérieur vienne travailler sur ce projet… Il lui a demandé, sa réponse était positive : « Si c’est ce que Gus souhaite, il peut le faire ». C’est seulement ensuite que j’ai réalisé que je devais vraiment le faire ! (rires). Ryan a écrit le contour de l’histoire, Robin l’a rempli et j’ai réalisé six épisodes sur les huit de cette saison.
Édouard Louis
Que pensais-tu de Truman Capote et de son œuvre littéraire avant de travailler sur cette série ?
Gus Van Sant
Je crois que j’ai lu In Cold Blood [De sang froid] lorsque j’avais 13 ans. Le livre appartenait à la mère d’un ami, il était placé sur la table de la cuisine, c’était plutôt un gros livre. Rien que le titre semblait menaçant. Cette femme m’a dit que c’était un très bon livre. In Cold Blood a eu beaucoup de succès, notamment auprès des femmes au foyer, sans doute car il permettait à ses lectrices, vivant dans des coins reculés comme le Connecticut, de lire la même chose que les femmes de l’aristocratie new-yorkaise.

Truman Capote tenant sa couverture du magazine Interview à La Factory. COuverture réalisée par Richard Bernstein, janvier 1979. Photo: George Rose. Extrait du livre Richard Bernstein Starmaker: Andy Warhol’s Cover Artist de Roger Padilha & Mauricio Padilha, publié par Rizzoli, New York, 2018.
C’est comme ça que je l’ai découvert. À cette période, il faisait quelques interventions à la télévision pour présenter son livre. Ma mère disait qu’elle l’aimait car il parlait avec une drôle de voix mais aussi parce que la manière dont il disait les choses était précise et belle. Elle se sentait bien en l’écoutant.
Récemment, j’ai relu ses livres. Pour moi, il est l’un de ces auteurs comme Norman Mailer qui maitrisait parfaitement la description avec subtilité et nuance. Son écriture était poétique. Et c’est quelque chose qu’il a perdu dans Answered Prayers.
Édouard Louis
Dans Feud, nous sommes témoins de la fascination que Truman exerce sur les femmes de son entourage, ses cygnes. C’est intéressant car il semblerait que cette fascination s’étendait à bien plus de monde, comme à ta mère… Est-ce que tu étais conscient de ce parallèle pendant la réalisation de la série ? À quel point ton rapport biographique à Capote a-t-il joué ? Est-ce que la fascination de ta mère pour Capote par exemple t’a inspiré en filmant les actrices qui jouent les Cygnes de Capote ? Tu les filmes d’une façon si sensible, si généreuse en un sens…
Gus Van Sant
Pas directement, mais j’ai fait des parallèles à d’autres niveaux entre la vie de Truman et la mienne car Truman est né dans une toute petite ville de La Nouvelle-Orléans. Mes parents sont aussi nés dans une petite ville du Sud, du Kentucky. Ma mère était plutôt réservée, mais elle avait une sœur par exemple qui avait une voiture noire, une Jaguar convertible, un choix vraiment excentrique. Ses goûts étaient marqués par sa situation… Et pour en revenir à Capote, j’ai pensé à sa mère lors du tournage, cette mère assez excentrique elle aussi, la mère de cet homme gay. Elle l’a pratiquement abandonné en le laissant à sa propre mère… Truman a vécu avec sa grand-mère. Il y a une photo célèbre de lui, habillé d’un costume blanc alors qu’il avait cinq ans. La mère de Truman voulait être une femme du monde, elle voulait vivre à New York sur Park avenue. Elle s’est mariée avec un homme plutôt riche, elle voulait vraiment intégrer cette aristocratie mais n’a jamais réussi à atteindre les cercles les plus prestigieux.
Édouard Louis
Et Truman en intégrant ces cercles a offert à sa mère une forme de revanche. C’est ce que tu montres dans la série.
Gus Van Sant
Oui, une forme de revanche contre cette société dans laquelle sa mère n’avait pas été acceptée. Truman est allé au lycée à Greenwich, dans le Connecticut, pas très loin de Darien, où j’ai moi-même grandi. Ce sont des petites villes en périphérie de New York, beaucoup d’hommes prenaient le train le matin pour aller y travailler et rentraient le soir. Je crois qu’il est resté une année ou deux à Greenwich. Il se rendait aussi à New York avec les filles qu’il avait rencontré au lycée, ils essayaient d’aller dans des clubs huppés ou de jazz, tous ces endroits dans lesquels tout le monde à l’époque voulait rentrer. Truman était déjà en train de s’évertuer à monter l’échelle sociale, dès le lycée, et il n’a cessé de vouloir le faire tout au long de sa vie… Et toi Édouard, comment est-ce que tu as découvert l’œuvre de Truman Capote ?
Édouard Louis
Assez tardivement. C’est assez étrange car je me pose des questions depuis longtemps sur la place de la fictionet du réel dans l’écriture, je m’interroge sur la façon dont le réel peut permettre de subvertir les formes littéraires canoniques, et les livres de Capote participent à cette réflexion, mais pour des raisons qui me sont inconnues, j’ai mis du temps à les lire. Je crois avoir commencé il y a deux ans, avec De sang Froid. Et cette lecture a été extrêmement forte. C’est un livre immense.

Photogramme extrait de l’épisode 1 de la série Feud : Les Trahisons de Truman Capote, créée en 2023 pour FX par Ryan Murphy, réalisée par Gus Van Sant.
Je connaissais Capote et sa personnalité à travers les photo-graphies que j’avais vues de lui, à travers des entretiens. Et je me souviens comment, en lisant De Sang Froid, je me demandais à quel point ce « corps gay », avec sa petite voix fluette qui fascinait ta mère, Gus, comment ce corps-là, aussi délicat, aussi vulnérable et haut en couleur à la fois, avait pu écrire une histoire sombre, violente et aussi terrible. Il y a un mystère, une contradiction, comme si Proust ou Barthes avaient écrit les livres de Faulkner.
Truman Capote le disait lui aussi : il était comme sorti de lui-même pour écrire ce livre, et cet écartèlement l’a laissé sans forces, épuisé, ce qui expliquait en partie, selon lui, son incapacité à écrire après De sang Froid. D’ailleurs, je voulais te poser une question par rapport à Feud et à ce roman. Dans De sang Froid, deux hommes entrent dans une maison et massacrent la famille qui y vit. Capote raconte ce fait divers, mais aussi ce qui a amené à son exécution, l’histoire de ces meurtriers, leur passé, leur enfance, les humiliations qu’ils ont vécues. Et en faisant ça, il rend l’histoire de ces hommes qui ont commis ce crime horrible plus complexe, et on ressent même une forme d’empathie pour eux. On perçoit que le crime qu’ils ont commis a une histoire, qui dépasse ces deux individus. Évidemment ça ne rend pas le crime moins horrible, et Capote n’essaye pas de le rendre moins horrible, mais il y a cette tentative de comprendre pourquoi ils l’ont fait. Et pour moi, il y a quelque chose de similaire qui se joue dans Truman vs the Swans. Le crime n’est pas aussi terrible évidemment, et même beaucoup moins, mais la série commence également avec un (plus petit) crime : Truman trahit ces femmes new-yorkaises, les Cygnes. Le crime n’est pas si petit d’ailleurs car une femme s’est suicidée en partie à cause de cette trahison. Truman Capote trahit ses amies les plus proches, ces femmes qu’il voit tous les jours,il les expose, il raconte leurs secrets dans ce texte que tu mentionnais, La Côte Basque. Et au fur et à mesure que l’histoire se dévoile, on découvre des éléments qui expliquent pourquoi l’écrivain a fait cela à ses amies. Sa mère a été humiliée socialement, et il a voulu prendre sa revanche. Il a été humilié en tant qu’homme gay par une de ces femmes de la très grande bourgeoisie, qui l’a traité de « tapette ». On voit aussi que Capote fait des mauvais choix parce qu’il est tétanisé par l’angoisse de ne pas réitérer le succès qu’il a rencontré avec In Cold Blood. Tous ces éléments qui se cumulent dissolvent en quelque sorte sa responsabilité, la complexifient, exactement comme Truman lui-même a complexifié le crime des meurtriers dans son roman. Plus on avance dans ta série, et moins on en veut à Truman, ou en tout cas on comprend ce qui s’est passé. Est-ce que c’était ton intention Gus ? Est-ce que tu as fait une série pour pardonner Truman ? Est-ce qu’il y a selon toi un rapport entre l’art et le pardon ?
Gus Van Sant
Je ne sais pas. Dans tous les films que j’ai pu faire, je m’investis à travers ce qu’on pourrait appeler des « incantations » : rappeler les réalités auquel le récit fait référence. C’est ce que fait le cinéma : on a une histoire, et dès qu’on commence à la filmer, des acteurs jouent des actions, des mouvements, des moments, et rendent cette histoire vivante, et donc plus complexe. Pour ma part, quand je réalise un film ou une série, j’essaye d’interpréter ce qui est écrit dans le scénario. Pour Feud, la construction des scènes venait de Ryan Murphy. Mais je crois qu’il aurait pu écrire presque n’importe quoi, je l’aurais quand même compris et interprété comme l’histoire que je connaissais, avec ma propre perception de la situation. La structure de Ryan a été extrêmement utile pour comprendre ce qu’il fallait mettre en avant parmi toutes les pièces de ce puzzle, et quand les dévoiler. Robin, en tant que scénariste, est connu pour ses longs dialogues. Il a inventé Truman dans ces situations, car il n’y avait pas nécessairement de retranscriptions de ce qu’il a dit à ces femmes. Capote en a parlé en interviews, mais il fallait d’une certaine manière remplir les vides. Robin avec ses dialogues explique beaucoup de choses. Et je dois ajouter que Tom Hollander, qui interprète Truman, a été très fort pour rendre ces raisonnements essentiels, car à la lecture des scénarios, j’ai parfois pensé qu’il fallait en couper certains. J’avais peur que ça soit trop long, que ça manque de rythme. Et au final, ça n’a pas été le cas grâce à Tom qui a toujours compris l’intérêt de ces mots, ce qui a rendu son interprétation encore plus juste. Moi je ne pouvais que réagir à la réalité du tournage : tout était très rapide. On a commencé à tourner le premier épisode sans que l’intégralité de scénario ait été écrit. Tant qu’on est pas sur le plateau, les choses ne sont pas concrètes. Donc avant que le tournage ne commence, je me suis contenté de réfléchir au placement des caméras, c’est tout, car il y avait trop de paramètres que je ne pouvais pas maîtriser. Au final, mon travail a été de filmer la rencontre de ces différents talents, ceux de Ryan, de Robin, Tom Hollander, de Naomi Watts. J’ai filmé tout cela et j’ai en fait ma propre interprétation.
Édouard Louis
Oui, justement, en parlant du placement des caméras et de cette question du pardon que j’évoquais, j’ai justement trouvé que tout, dans la manière dont tu réalisais la série, l’angle, les mouvements de caméras, les zooms, j’ai trouvé que tous ces éléments allaient dans le sens du pardon, ou au moins, du refus de condamner. Comme s’il existait une manière purement formelle de pardonner, en dehors du discours. Comme si un mouvement de caméra pouvait représenter une forme de pardon.

Couverture du magazine Interview, réalisée par Richard Bernstein, janvier 1979. Extrait du livre Richard Bernstein Starmaker: Andy Warhol’s Cover Artist de Roger Padilha & Mauricio Padilha, publié par Rizzoli, New York, 2018.
Je trouve que tu es très délicat avec tes personnages. Que ta caméra à la fois les caresse, les accompagne comme une amie, à d’autres moments les replace dans une situation plus grande.
Cela m’a fait penser à Kafka, et à cette idée Kafkaïenne sur laquelle Geoffroy de Lagasnerie a écrit, selon laquelle, enfin de compte, tout le monde est innocent de tout. Kafka dans la lettre au père énumère les excès de son père, mais il lui dit qu’au fond, il sait qu’il est innocent – que le problème se trouve ailleurs. Au fond, j’ai ressenti ça dans la manière dont tu as filmé Truman et son amie Babe Paley. Peut-être cela n’était pas conscient, car comme tu viens de le mentionner, quand tu crées, tu te laisses porter par une intuition, plus que par un discours. Tu m’as dit un jour que parfois le corps sait mieux que la tête ce qu’il faut faire…
Gus Van Sant
Oui !
Édouard Louis
J’ai aussi trouvé que la série dépeignait de manière très juste l’homosexualité. Comme si cette série était aussi un Portrait de l’homosexuel – un des plus beaux que j’ai vu depuis longtemps : qu’il s’agisse d’homophobie, de désir, de fascination pour la masculinité, de l’amitié avec les femmes,aussi compliquée puisse-t-elle être, de la relation à la mère ou encore des rêves de gloire, qui sont certainement une forme de revanche face aux enfances souvent difficiles que les gays peuvent avoir vécus… Ce désir d’évasion, comme Jean Genet qui s’évadait sur les toits… Pour moi, la série parle vraiment d’homosexualité en général, pas uniquement celle de Truman… C’était ton intention ?
Gus Van Sant
J’ai lu quelques romans de Jean Genet ! De Jean-Paul Sartre également, quand j’étais au lycée…En tout cas, ces récits font partie de mon histoire et ressortent consciemment ou non. Quand j’étais enfant, de mes 11 à 14 ans – à peu près au moment où Truman terminait In Cold Blood –, j’ai eu un professeur d’art à l’école qui était homosexuel. Il portait une cravate noire fine avec un costume parfaitement taillé, il était Canadien francophone. Il nous a appris l’art nouveau, à faire des mobiles à la manière de Calder, il peignait également dans notre salle de classe. Il partageait avec nous ce qu’il faisait durant ses week-ends, on venait dans sa classe juste pour l’écouter. Pour moi, il a été une sorte de connexion avec la vie homosexuelle new-yorkaise du début des années 1960. Ce sont aussi ces souvenirs, en plus des livres lus, que j’ai sans doute, inconsciemment, déployé dans la série. Donc je crois que les choses se transmettent, d’une manière ou d’une autre.
Édouard Louis
Dans le cinquième épisode, que tu n’as pas réalisé, intervient James Baldwin. L’auteur vient pour aider son camarade. Et à travers les moments qu’ils partagent ensemble, tu pointes l’importance des communautés, de la communauté gay et du soutient qu’elle peut apporter. Je suis curieux de savoir combien cette dimension compte pour toi. Est-ce que tu es plutôt entouré ou solitaire dans la création ?
Gus Van Sant
Je suis plutôt seul ! Je me bats seul. Et toi ?
Édouard Louis
Pour moi il y a un lien important entre amitié et création. Évidemment, dès que l’on essaie de faire quelque chose de nouveau, ou au moins de différent, on doit faire face à des réactions violentes, qu’elles soient d’ordre artistique ou politique. Et je crois que l’amitié m’a permis de ne pas avoir peur de ça. J’ai été si souvent insulté pour mes livres, par des journalistes, des critiques littéraires ou des universitaires… L’amitié permet de se donner une légitimé propre, et de ne pas être autant heurté par les critiques. Si Thomas Ostermeier, ou mes amis Didier Eribon ou Nan Goldin aiment ce que j’écris, alors le reste n’a plus vraiment d’importance.
C’est d’ailleurs ce qu’on voit dans Feud. Truman, pour pouvoir écrire, a besoin d’avoir des personnes autour de lui. À partir du moment où il perd l’amitié de ses femmes, il ne peut plus rien faire. On voit bien comment l’absence d’amitié affecte sa capacité à créer. Évidemment, il y a des artistes qui travaillent dans la solitude, je pense à Thomas Bernhard, mais c’est un mystère pour moi. C’est cette même solitude que tu cultives dans la création ?
Gus Van Sant
Je croyais que la question concernait le combat, pas l’écriture !
Édouard Louis
On peut considérer les deux termes comme synonyme ! (rires)
Gus Van Sant
Oui, dans ce cas, je crois que l’on a besoin d’immunité pour créer. L’écriture est une forme d’amitié sociale, un tournage l’est aussi. Il y a toujours un groupe de proches avec qui je partage mes projets, mes convictions et mes doutes. Mais quand il s’agit de se battre, alors oui, je me bats seul.
Édouard Louis
Une amitié, pour qu’elle dure, doit aussi savoir pardonner – désolé, c’est un sujet qui m’obsède et sur lequel je veux t’entendre (rires). Si Truman était ton ami et écrivait sur toi comme il l’a fait dans La Côte Basque sur les Cygnes, est-ce que tu lui aurais pardonné ?
Gus Van Sant
Peut-être ! Je ne suis pas sûr ! (rires) Cela dit, j’ai quelques amis qui ne parlent plus à leur famille, et je trouve ça toujours surprenant, voire choquant. C’est dur pour moi de voir certaines personnes couper définitivement les liens avec les autres. Je crois que je serais dans le pardon. Je ne comprends pas qu’on puisse arrêter de se parler. Peut-être que c’est différent en France ! (rires)

Photogramme extrait de l’épisode 1 de la série Feud : Les Trahisons de Truman Capote, créée en 2023 pour FX par Ryan Murphy, réalisée par Gus Van Sant.
Je constate par contre qu’il y a des personnes qui ne me parlent pas, non pas à cause de moi, mais à cause de mon art. Ils ont entendu parler de moi, n’ont jamais vraiment rien vu mais ont décidé qu’il valait mieux ne pas me parler. Je suis parfois confronté à ces personnes. Quand je les rencontre, ils se tournent et s’en vont !
Édouard Louis
Quoi ? Mais qui sont ces gens ? Des catholiques radicaux qui t’en veulent de parler d’homosexualité ?! (rires)
Gus Van Sant
C’est peut-être ça ! Ou alors, peut-être à cause de Drugstore Cowboy, mon second film qui parlait d’addiction aux drogues. Je me souviens qu’à l’époque de sa sortie, j’étais à une fête et j’ai entendu quelqu’un qui ne savait pas qui j’étais dire « C’est absurde, c’est stupide, c’est ridicule ». Et quand j’ai essayé de parler à cette personne, elle a simplement répondu qu’elle ne voulait pas me parler.
Édouard Louis
C’est tellement grotesque que c’est hilarant ! Bon, il est vrai aussi que produire des oppositions, quand on est un artiste, c’est une chose saine. Truman a lui aussi produit des lignes de fracture, tu montres dans ta série que certaines personnes le haïssaient, comme Gore Vidal notamment…
Gus Van Sant
Oui, mais ce qui est aussi fou avec Capote, c’est qu’il n’a plus été capable de créer à un certain moment. Il n’a jamais fini Answered Prayers. Il a traversé presque deux décennies pendant lesquelles il n’a pas été capable de terminer ce livre, alors qu’il n’arrêtait pas de dire qu’il écrivait. Il était devenu une célébrité qui faisait un peu trop la fête et ne travaillait plus vraiment. Je vois parfois ça à Hollywood, avec certaines personnes qui atteignent une certaine notoriété et validation, et qui ensuite n’arrivent plus à écrire ou réaliser.
Édouard Louis
Et pourtant l’incapacité de Capote à terminer ce livre a contribué à sa légende. Un peu comme Rimbaud, qui a renoncé subitement à la littérature. C’est aussi l’une des raisons pour laquelle on l’aime autant, non ? Beaucoup de gens disparaissent mais peu disparaissent d’une façon aussi légendaire que Rimbaud ou Capote. Et d’ailleurs, peut-être qu’inconsciemment Truman a compris que son blocage allait couronner son œuvre, peut-être plus qu’Answered Prayers l’aurait fait s’il l’avait terminé.
Gus Van Sant
Oui c’est vrai. Et puis il y a aussi un côté chasse au trésor avec ce dernier livre achevé. « Où est-ce que ce roman est passé ?! ». A-t-il été détruit ? Peut-on le retrouver ? Beaucoup de personnes pensent qu’il est entreposé dans un dépôt oublié. D’autres pensent qu’il est disséminé dans ses correspondances. Je ne pense pas que ça soit le cas car cela a déjà beaucoup été étudié… Et pour d’autres, il n’a jamais été écrit, donc il n’existe pas ! Le mystère reste entier et participe à la fascination pour Truman Capote…
Sex(y)
Isamaya Ffrench
Respectée depuis plus de dix ans dans l’industrie cosmétologique en tant que makeup artist, l’Anglaise Isamaya Ffrench a lancé en 2022 sa propre ligne de maquillage sobrement intitulée Isamaya. Dans un élan d’anticonformisme, cette gamme de produits qualitatifs célèbre l’expression de soi. C’est d’ailleurs ce qui motive le design explicite de Lips, rouge à lèvres qui se loge dans une reproduction chromée de pénis. L’allégorie phallique du bâton de rouge est ici entièrement assumée. Mais pour autant, l’objet n’est pas à prendre comme une provocation, puisque ses proportions le rapprochent plus du croquis coquin – que l’on retrouve d’ailleurs sur l’emballage, comme une invitation à ne pas trop se prendre au sérieux – que de la planche anatomique.
Mais ce qui nous interpelle dans cet objet de collection, c’est sa filiation avec une sculpture polémique de Constantin Brancusi, figure emblématique de l’art du XXe siècle, mort à Paris en 1957. On peut d’ailleurs voir une passionnante reconstitution de son atelier sur le parvis du Centre Pompidou. De son œuvre, on retient sa maîtrise de l’épure, de la légèreté et de l’élévation, tant d’un point de vue matériel que spirituel. Parmi ses pièces maîtresses, on cite fréquemment son portrait de la poétesse et baronne Renée Frachon qui, au fil des variations, sera de plus en plus minimaliste pour atteindre sa quintessence : une forme ovale semblable à un œuf. En 1916, il réalise la fameuse pièce controversée : Princesse X, une sculpture en bronze poli se voulant être un portrait de la princesse Marie Bonaparte, mais suggérant pour beaucoup la forme d’un phallus. Il est bon de rappeler que l’ultime descendante de Napoléon était une amie de Freud et contribua à faire émerger la psychanalyse en France. Et c’est d’ailleurs en 1951, soit 35 ans après la naissance de Princesse X, qu’elle publiera l’ouvrage De la Sexualité de la femme, sujet qui fut au cœur de ses recherches et de sa vie. La sculpture, dont il existe une version en marbre conservée au Sheldon Museum of Art (dans le Nebraska, aux États-Unis), reprend les fameuses formes ovales tant appréciées par l’artiste. Deux œufs forment le buste de la princesse, et un troisième représente son visage qui repose sur un long cou. Mais ces volumes suggestifs ne sont pas au goût de tous et la sculpture se voit refuser l’accès au Salon d’Antin en 1916. Elle est exposée l’année suivante à New York, puis fait scandale au Salon des indépendants en 1920. Face aux critiques, l’artiste déclara : « Ma statue, c’est la synthèse de la femme, l’Éternel féminin de Goethe, réduit à son essence. » Malice ou vision sincère et taoïste du masculin et du féminin, Princesse X est avant tout une sculpture qui questionne.
En choisissant cette surface chromée et miroitante, les « lèvres » d’Isamaya Ffrench font un clin d’œil appuyé à l’histoire de l’art. Soulignons que l’objet est rechargeable, ce qui explique en partie son poids.

Photographe Romain Roucoules
Décoratrice Justine Ponthieux
Beaucoup plus espiègle que provocateur, ce sex(y) rouge à lèvres ne cesse de surprendre par les mouvements qu’il implique. Car une fois le capuchon enlevé, pour l’appliquer sur les lèvres, il faut littéralement le tenir par les testicules. Une manière de jouer avec les clichés phallocrates, avec style !
texte de Muriel Stevenson
Übermensch
Ebecho Muslimova
Depuis quelques années, le monde de l’art a vu apparaître un personnage hors norme. Nue, grosse et douée pour se mettre dans les situations les plus incongrues, Fatebe est l’alter-ego d’Ebecho Muslimova. Originaire du Daghestan russe, installée à New Yorkdepuis son enfance, l’artiste met en scène à travers dessins, peintures et installations cette héroïne loufoque, extrapolation de sa personnalité et témoin de ses affres. Chaque nouvelle apparition de Fatebe (contractionde Fat et Ebecho) renforce son caractère extraordinaire, puisqu’elle ne cesse de survivre aux anecdotes masochistes qui se succèdent. C’est dans cet oxymore, entre légèreté et cruauté, affirmation et résignation, que se joue la force des œuvres de Muslimova. Le corps quasi liquide de Fatebe lui permet de tout accepter et rien ne semble finalement si grave. L’artiste répond à nos questions avec l’humour qui la caractérise et revient sur la relation atypique qu’elle entretient avec sa création.
JUSTIN MORIN
Quelle a été votre première rencontre avec l’art ?
EBECHO MUSLIMOVA
Enfant, je n’arrivais pas à faire caca. En fait, j’avais tellement d’énergie que j’avais du mal à rester assise suffisamment longtemps pour ça. Mes parents ont fini par me mettre sur les toilettes, avec un crayon et du papier, et m’ont dit de canaliser cette hyperactivité sur la page. Mes rencontres avec l’art sont nées de cette constipation. Je pense que c’est encore le cas aujourd’hui.
JUSTIN MORIN
En une seule image,vous développez une narration complète grâce aux poses de votre personnage, son expression, ses interactions avec son environnement. Comment développez-vous vos idées ? Faites-vous beaucoup de croquis ?
EBECHO MUSLIMOVA
Les chemins sont multiples. Parfois c’est une révélation soudaine, d’autres fois c’est un travail exigeant d’affinage. Par certaines journées miraculeuses, une image claire m’apparaît : la pose et l’intention de Fatebe, juste là – dans la rue, sous la douche, dans le studio.Lorsque cela se produit,le dessin est presque une jubilation. D’autres fois, l’image de départ est vague et je passe mon temps à la réduire, la clarifier et la mettre au point. Dans tous les cas, mon processus est moins une construction ou une déduction qu’une longue recherche, j’avance à coup d’essais et d’erreurs en exploitant la moindre idée, pour voir où le personnage lui-même me mènera.
JUSTIN MORIN
Quels sont les artistes qui vous inspirent ?
EBECHO MUSLIMOVA
En général, je suis attirée par les artistes qui saisissent l’importance de l’humour – les artistes qui peuvent en jouer, insouciants et irrévérencieux, sans distraire de l’œuvre, ni proposer une dimension ultérieure, mais qui en font le matériau de l’œuvre elle-même.
JUSTIN MORIN
Lorsque vous proposez une peinture murale, comme celle que vous avez réalisée à la Renaissance Society de Chicago, vous aimez utiliser l’architecture du lieu et son espace. Cette exploration du volume pourrait-elle vous donner envie de développer une approche plus sculpturale de Fatebe ?
EBECHO MUSLIMOVA
Oui, mais avec un bémol. Les œuvres murales me permettent de m’amuser avec les dimensions de Fatebe, en m’approchant du langage sculptural. Mais je m’intéresse à la tension entre l’espace plat et imaginé du monde de Fatebe et l’espace d’installation, physiquement tridimensionnel.

Ebecho Muslimova, Fatebe Inner Peace, 2017. Encre japonaise Sumi, 23 × 30 cm. Avec l’aimable autorisation de l’artiste et de la galerie Maria Bernheim, Zurich.
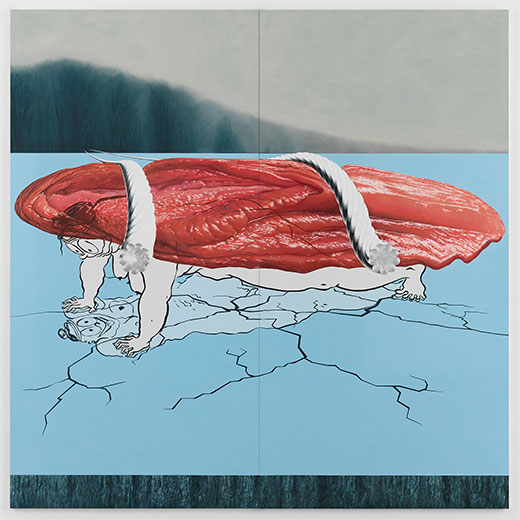
Ebecho Muslimova, Fatebe Thin Slab, 2022. Email et peinture à l’huile sur aluminium Dibond, 243 × 243 cm. Avec l’aimable autorisation de l’artiste, de la galerie Maria Bernheim, Zurich et de Magenta Plains, New York.
C’est un effet Roger Rabbit : elle peut exister dans les deux réalités, dans les deux espaces dimensionnels. Récemment, j’ai ajouté des objets à mes installations, et j’interviens dans la troisième dimension. J’aime ce suintement vers la sculpture : des étapes dans ma pratique qui conduisent lentement Fatebe vers la troisième dimension.
JUSTIN MORIN
Fatebe a évolué avec les années. Vous avez ajouté des touches de couleurs dans vos dessins en noir et blanc. Vous jouez avec les échelles et les techniques de peinture. Cette notion de jeu – mais aussi d’évolution – est très présente dans votre travail. Quelle que soit la situation dans laquelle se trouve Fatebe, elle est positive.
EBECHO MUSLIMOVA
Oui. C’est son rôle !
JUSTIN MORIN
Peut-on voir en Fatebe une réflexion sur la pression exercée par les normes de beauté de notre société ?
EBECHO MUSLIMOVA
Non, elle ne questionne aucune norme de beauté particulière. Son grand talent, c’est sa capacité à régurgiter la pression.
JUSTIN MORIN
Le corps de Fatebe semble presque magique, un peu comme le sac de Mary Poppins. En fait, dans toute sa nudité, son corps ressemble vraiment à sa maison. Quelque chose qui n’est pas parfait mais qui l’accueille.
EBECHO MUSLIMOVA
Fatebe est ce qu’elle semble être. C’est ce qui la rend magique : elle existe dans un monde imaginaire où ce qu’elle a est tout ce dont elle a besoin.
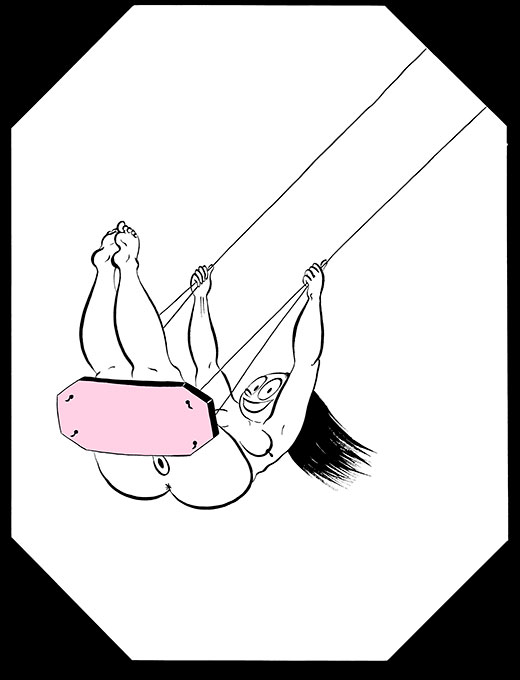
Ebecho Muslimova, Drawing 20, 2018. Encre japonaise Sumi et gouache sur papier, 49,8 × 42,2 cm. Avec l’aimable autorisation de l’artiste et de la galerie Maria Bernheim, Zurich.

Ebecho Muslimova, Fatebe Fenced, 2021. Encre japonaise Sumi sur papier, 30,5 × 22,9 cm.
Le maximum
du minimum
Niko Romito
On se demande pourquoi, lorsque l’on entend le terme « maximalisme », on pense immédiatement à quelque chose de spectaculaire à voir. Spontanément, nous pourrions dire que Jeff Koons représente dignement le maximalisme dans l’art contemporain, Steven Spielberg au cinéma et Gianni Versace dans la mode. De même, le « minimalisme » évoque immédiatement des lignes pures, des espaces vides, l’absence de couleur, beaucoup de blanc, beaucoup de gris, et au pire un peu de noir. Ludwig Mies van der Rohe est évidemment perçu comme un architecte minimaliste, tandis qu’Ingmar Bergman pourrait être son équivalent dans le cinéma et Yohji Yamamoto dans la mode.
Cependant, il ne faut pas oublier que le sens de ces concepts évolue avec la société qui les utilise. Dans le monde contemporain, où l’on fétichise « l’expérience » et la « sensorialité » dans tous les domaines de la vie, la « sensation » est le Graal ultime. Ce n’est pas un hasard si, au cours des dix dernières années, le monde de la gastronomie a atteint des sommets de popularité jamais atteints auparavant dans l’histoire.
La culture contemporaine de la nourriture, avec sa vision revisitée des équilibres entre quantité et qualité, est le terrain idéal pour explorer de nouvelles combinaisons entre « maximum » et « minimum ». À l’époque de Van der Rohe, la devise du moment était « less is more », mais dans les restaurants prestigieux de nos jours, on réalise fréquemment que « moins » et « plus » peuvent tout simplement coexister, non pas tellement dans l’assiette, mais certainement dans la bouche.
La cuisine de l’Italien Niko Romito est l’incarnation d’une culture gastronomique émergente qui recherche l’excellence dans la plénitude perceptive qu’offre la simplicité. Peu de temps après avoir obtenu sa troisième étoile Michelin pour son restaurant Reale à Castel di Sangro, dans les Abruzzes, Romito a publié son premier livre intitulé Apparentemente Semplice (Apparemment Simple). (N. Romito, L. Gasbarro, Apparentemente Semplice. La mia Cucina Ritrovata, Sperling & Kupfer, 2015.)
Pourquoi « apparemment » ? Parce que, bien sûr, les apparences sont trompeuses. On s’en rend compte par exemple lorsque, incrédules, on trouve au menu de son restaurant parisien à l’hôtel cinq étoiles Bulgari un plat basique et populaire comme des spaghettis à la tomate. Où est l’opulence que l’on pourrait attendre d’un palace luxueux portant ce nom ? Elle n’est pas là, au moins pour ceux qui recherchent l’ingrédient précieux, l’accumulation aromatique ou une mise-en-plat baroque.

Niko Romito, Scarole rôtie, restaurant Reale. Photo : Andrea Straccini.
Au lieu de cela, elle s’ouvre progressivement dès la première bouchée, à commencer par le parfum, étonnamment intense pour un nid de pâtes servies tièdes. Tout comme l’intensité olfactive, celle du goût et de l’arôme est immédiatement spectaculaire. Même les pâtes semblent imprégnées de l’essence de la tomate et la sauce (il sugo), dense et satinée, à la concentration simultanément douce et acide d’une crème végétale. Aucun ingrédient secret pour obtenir ce résultat, aucun secret tout court, car la recette est révélée sous forme de leçon dans le second volume publié par le Chef 10 Lezioni di Cucina (10 Leçons de Cuisine) (2 Giunti, 2015.)
Au chapitre cinq, intitulé «Archétype», le processus de préparation lent et séquentiel est expliqué en détail comme une mise à jour d’un archétype gustatif de la tradition italienne. Il implique d’abord une matière première exceptionnelle, les tomates datterini produites sur ses terres à Castel di Sangro (Abruzzes, Italie), cuites au four avec sel et thym, une fois pelées. Juste après la cuisson elles sont congelées, moulinées et la crème passée au tamis. Quant aux spaghettis, ils sont cuits normalement, mais dans de l’eau de tomates crues, puis mantecati (remués dans une préparation fluide jusqu’à obtenir une consistance presque confite) à la poêle dans leur propre jus de cuisson riche en amidon. « Spaghetti e pomodoro » peut être considérés comme le manifeste de la vision culinaire quintessentielle du chef Romito. Dépourvue d’extravagances et d’exotismes, c’est avant tout une cuisine du ressenti, dérivée d’une vision gastronomique guidée par l’intensification (par le biais de réductions, d’extractions, de macérations, de fermentations…) plutôt que par la multiplication ou l’addition.
Comme un statement philosophique maximaliste, la cuisine de Romito installe la sensibilité comme la base même du « goût », recherchant le maximum du spectre gustatif et aromatique avec un minimum d’ingrédients. La seule forme de complexité admise est entièrement immatérielle et concerne tous les processus de production, de la terre à la table.
Dans le domaine de la viticulture, on utilise beaucoup la notion de « vin vertical » pour exprimer la recherche par les vignerons naturels d’une connexion directe entre le caractère climatique atmosphérique et le caractère géo-biologique d’un terroir spécifique. La cuisine de Niko Romito répond pleinement à une telle notionde verticalité, à la fois pour le respect de la connexion entre l’environnement et les matières premières, et pour la recherche de techniques d’intensification de l’ingrédient qui permettent, à la dégustation, de plonger dans le goût.
Il s’agit d’un voyage intérieur qui n’est pas sans lien avec une tendance esthétique de ces dernières années qui considère l’acte de goûter et de manger comme une forme de connaissance, au même titre que les arts. En effet, c’est une activité qui en dit long sur la manière dont nous accueillons l’extérieur, c’est-à-dire le monde, et sur la manière dont celui-ci nous transforme. Le philosophe compatriote de Romito, Nicola Perullo, parle même d’un « savoir endocorporel » (Il Gusto come Esperienza: Saggio di Filosofia ed Estetica del Cibo,
Slow Food, 2016, p.92.), acquis en prêtant attention à ce qui se passe en nous. Ce n’est pas une idée si excentrique, d’autant plus que «savoir» et «saveur» ont une origine commune dans leur ancêtre latin sapere.
Dans ce sens, on comprend mieux que le maximalisme gastronomique n’est pas nécessairement celui qui propose le spectacle comme expérience, mais son contraire, une pratique culinaire vouée à une expérience spectaculaire, même si celle-ci peut s’avérer plus contemplative que visuelle.
La vision est une expérience immédiate, tandis que la contemplation conjugue intensité et durée. Peut-être qu’un jour, nous reconnaîtrons dans le maximalisme gastronomique la formule d’une nouvelle culture alimentaire réellement durable, non pas parce qu’elle est « propre », mais parce qu’elle sera conçue pour « durer » et nous accompagner dans le temps.

Niko Romito, Feuille de brocolis et anis, restaurant Reale. Photo : Andrea Straccini.
texte de Luca Marchetti
Rock Lobster
John M Armleder
Figure incontournable de l’art contemporain, le Suisse John M Armleder a construit une œuvre qui se joue des antipodes. Rigoureuse tout en laissant place à l’improvisation, picturalement pop, mais nourriede raisonnements conceptuels, elle témoigne d’une érudition et surtout d’un humour directement hérité du groupe Fluxus, mouvement artistique né dans les années 1960 auquel Armleder est rattaché. Peintures, dessins, sculptures, performances, mais aussi commissariat d’expositions et collaborations avec d’autres plasticiens, son appétit pour l’art semble sans limites. Parmi ses séries phares, les furniture sculptures (littéralement « sculptures d’ameublement ») font référence à la musique d’ameublement. Elles sont la rencontre d’une peinture et d’un élément de mobilier dans un télescopage formel, pictural et sémantique. L’équation est simple, mais les résultats tendent vers l’infini. Du minimalisme à l’ornement, de l’anecdote à la spiritualité, l’art d’Armleder ne se prive d’aucune richesse.
Justin Morin
Merci de me recevoir dans votre atelier. Quel est votre relation à cet espace ? Est-ce un point d’ancrage ? Y venez-vous quotidiennement ?
John M Armleder
Oui. C’est un espace que je partage avec Mai-Thu Perret. C’est la réunion de différents dépôts que j’avais à gauche et à droite. On y trouve notamment beaucoup de publications car je suis un fanatique de livres. En 1969, nous avons fondé avec des amis le groupe Ecart, puis une galerie en 1972 dans laquelle nous vendions également des livres. Inconsciemment, quand nous avons fermé, j’ai continué à en commander. Depuis, Ecart continue d’exister sur Internet – www.ecart-books.ch – et nous vendons en ligne. Donc dans cette première zone, on retrouve une multitude de livres. À l’arrière, il y a nos espaces de travail à Mai-Thu et à moi où nous préparons tout un tas de choses.
Justin Morin
Effectivement, les personnes qui suivent votre travail connaissent votre passion pour les livres. On a cependant rarement l’occasion de vous entendre vous exprimer sur la littérature. Y a-t-il des auteurs qui vous inspirent dans votre pratique ?
John M Armleder
Je ne sais pas s’ils m’inspirent, mais j’ai toujours été proche de cela. Les livres de littérature sont chez moi, ils ne sont pas ici.
J’ai beaucoup lu. Le souci, qui est amusant, est qu’il y a une douzaine d’années, j’ai eu ce problème de santé, assez grave. On ne me donnait aucune chance de vivre… J’ai raté ma sortie puisque je suis toujours là ! Mais depuis, j’ai de la peine à lire.C’est amusant car lorsque je lis, il semble souvent que je connais ce passage et je réalise que j’ai lu trois fois de suite la même page ! Je lis donc beaucoup moins, mais plus jeune, j’étais un grand lecteur. J’ai lu beaucoup de philosophie, j’étais aussi beaucoup intéressé par la linguistique. J’ai été voir beaucoup d’écrivains au Collège de France, mais aussi en Allemagne ou en Italie.
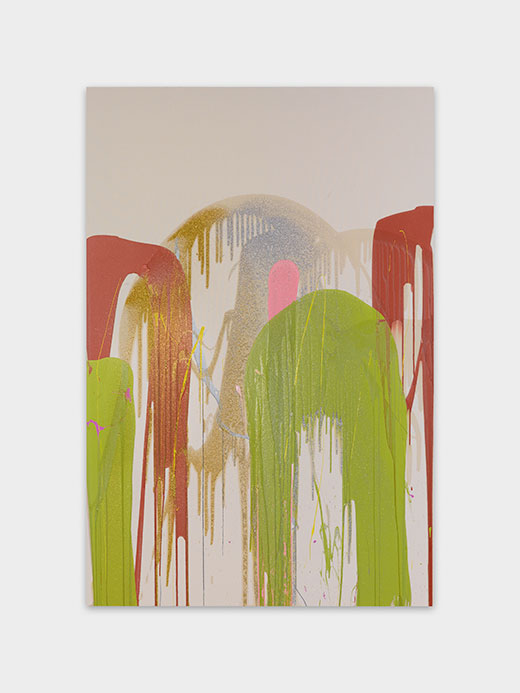
John M Armleder, Fruit du lotus, 2018. Technique mixte sur toile, 225 × 150 cm. Avec l’aimable autorisation de l’artiste et d’Almine Rech. Photo : Annik Wetter.
J’ai notamment cotoyé William Burroughs que nous avons invité à Ecart lors d’une rencontre que nous avions appelée Le colloque de Tanger . C’est toute une génération. Mais au fond, mes goûts sont très larges. Je peux autant lire de la littérature dite sérieuse que Alphonse Allais, je ne fais pas de hiérarchie. J’ai une tendance, comme dans l’art, à faire des équivalences. Une chose en vaut une autre.
Justin Morin
Vous faites souvent référence à l’œuvre de Fra Angelico que vous avez découvert à trois ans et qui a été une révélation, mais aussi aux peintures de Malevich que vous avez vues pour la première fois à l’âge de huit ans. Vous avez rencontré énormément d’artistes, collaboré avec certains d’entre eux. Je sais que c’est un exercice que vous n’aimez pas forcément, car il est compliqué d’être exhaustif, mais y a-t-il des artistes qui vous surprennent aujourd’hui ? Est-il possible de garder une forme d’enthousiasme pour la nouveauté ?
John M Armleder
Absolument ! Je ne fais pas de hiérarchie entre une époque et une autre. J’ai été impressionné très jeune par John Cage, qui lui même a été très influent chez beaucoup d’artistes. C’est sans doute par ce biais-là que j’ai rencontré tous les gens du groupe Fluxus. Je continue à faire cela, à m’intéresser à d’autres artistes, notamment avec Ecart puisque nous avons un tout petit stand à la foire de Bâle où nous montrons généralement un artiste que l’on a un peu oublié pour une raison ou une autre et simultanément un jeune artiste que l’on ne connaît pas. Et là aussi, il n’y a pas de hiérarchie. Il y a trois ans, j’ai fait une grande exposition intitulée It never ends à Kanal-Centre Pompidou, à Bruxelles où j’ai invité un certain nombre d’artistes à faire des installations. Le catalogue ne devrait plus tarder à sortir. On a notamment reconstruit certaines expositions que j’avais faites auparavant, seul ou avec les gens d’Ecart, mais dans des versions nouvelles. Il y a avait donc énormément d’artistes, nouveaux, mis en discussion avec ceux avec lesquels j’avais travaillé dans les années 70.
Justin Morin
Vous avez aussi enseigné à l’École cantonale d’art de Lausanne et à l’université d’art de Braunschweig.
John M Armleder
Tout à fait. À Lausanne, c’était sur l’invitation de Pierre Keller qui était un ami de toujours. La section arts visuels était plus petite que les autres, on voisinait donc avec tous les étudiants. À Braunschweig, j’ai fait une chose à la Joseph Beuys, c’est à dire que j’ai accepté tout le monde. Normalement, dans les académies allemandes, le professeur choisit trois, quatre ou cinq étudiants,qui le plus souvent ont une pratique proche de la sienne. Je suis rentré dans une classe d’un professeur qui venait de décéder, il n’y avait que trois élèves. Après deux ans, ils étaient soixante ! Il y en a que je n’ai jamais vus ! L’enseignement se considère généralement comme une transmission de savoirs, mais je ne sais pas si je sais quoi que ce soit. Je suggérais à mes élèves des méthodes d’investigation. À Braunschweig, les étudiants venaient d’un peu partout dans le monde. Je leur ai toujours dit que s’ils connaissaient un endroit où nous pourrions faire une exposition dans leurs pays, il fallait l’entreprendre. Ils devaient trouver les moyens pour la réaliser car évidemment l’école ne les avait pas. Braunschweig est une petite ville donc tout le monde était content de les aider, nous faisions le tour des magasins et des entreprises pour avoir des financements.
Les étudiants trouvaient des espaces dans leurs villes, et ils proposaient à d’autres artistes de les rejoindre, généralement en produisant les œuvres de ces invités selon leurs instructions. Nous avons fait une quinzaine d’expositions sur ce mode, que ce soit à Séoul, à Tokyo, à Shanghai, à Bâle ou à New York. D’une certaine manière, cela faisait miroir avec ce que nous faisions avec mes amis d’Ecart, qui à l’origine n’étaient pas des artistes. Nous nous sommes rencontrés au Collège de Genève, qui s’appelait encore Calvin, nous faisions de l’aviron d’un côté – de manière très sérieuse puisque nous avons fait des régates un peu partout en Europe – , et des manifestations artistiques non déclarées de l’autre. Et tout à coup, nous avons décidé de faire une programmation, c’était en 1969 avec le festival d’Ecart, où nous avions organisé une série de happenings. Le soir nous discutions et organisions le programme du lendemain. C’étaient les prémices de ce qu’allait devenir la galerie Ecart. C’était une autre époque, tout était plus petit, il y avait moins de tout. À Genève, il y avait peu de galeries. Ce qui fait qu’Ecart est devenu un lieu repéré, les gens qui voyageaient et passaient par Genève venaient nous voir. C’est comme ça que nous nous sommes retrouvés à faire des expositions avec des gens aujourd’hui oubliés ou des artistes comme Beuys ou encore Warhol. C’était possible. Aujourd’hui, ça n’est pas mieux ou moins bien, c’est juste différent.
Justin Morin
Vous êtes basé à Genève, vous y avez grandi. Est-ce que vous vous êtes posé à un moment la question d’une autre ville ?
John M Armleder
Non jamais. Mais en réalité, à partir d’un certain âge, j’étais plus souvent ailleurs qu’à Genève. J’ai beaucoup de chance car ma famille m’a soutenu, mon frère surtout. Je viens d’une famille d’hôteliers, tout ça a disparu depuis. À mes débuts, je n’étais pas particulièrement sociable, je ne courrais pas les événements mondains malgré le fait d’avoir croisé beaucoup de célébrités à l’hôtel. Pour moi, les gens importants, c’étaient le garçon d’ascenseur ou le concierge, ceux que je considérais comme ma famille.

John M Armleder, Hibiki, 2021. Patères et peintures sur toile. Toiles : 70 × 225 cm, 125 × 125 cm. Patères: 300 × 8 × 10 cm, 150 × 8 × 10 cm, Avec l’aimable autorisation de l’artiste et d’Almine Rech. Photo : Alessandro Wang.

John M Armleder, Premières oies, 2018. Technique mixte sur toile, 225 × 150 cm. Avec l’aimable autorisation de l’artiste et d’Almine Rech. Photo : Annik Wetter.
Le hasard a voulu qu’au moment où tout ça s’est écroulé financièrement, j’ai commencé à vivre de mon travail. Je ne sais pas comment, car je n’ai jamais eu l’ambition d’être un artiste qui réussisse. Dès que j’ai eu la chance de faire ces choses-là, j’ai tout de suite essayé de partager ça avec d’autres gens. J’ai eu la chance de vivre avec d’autres artistes toute ma vie. Daisy Lorétan, qui est malheureusement décédée très jeune. Sylvie Fleury. Et depuis, Mai-Thu Perret. J’ai collaboré avec de nombreux artistes. Ça a toujours été fondamental dans mon travail, je vois peu de différence entre la production du travail de quelqu’un d’autre et la mienne.
Justin Morin
Puisque vous évoquez Sylvie Fleury, je voulais vous interroger sur votre rapport à la mode. Vous avez d’ailleurs été photographié par Collier Schorr dans le cadre d’une campagne pour Brioni. Avez-vous déjà considéré le vêtement comme potentiel objet pour votre pratique artistique, au même titre que le mobilier que vous utilisez pour les Furnitures Sculptures ?
John M Armleder
Je crois que la relation qu’entretient Sylvie avec la mode est beaucoup plus intense et pensée que la mienne. On a fait des choses ensemble. Les premiers tableaux d’après Mondrian avec la fausse fourrure, qui étaient un peu mal fichus d’ailleurs, c’est moi qui les ai conçus pour elle! Après elle a fait ça beaucoup mieux que moi. Pour en revenir à la mode, je n’ai pas un terrain électif. Un peu à la Picabia, je fais un peu de tout. Je viens de réaliser la doublure d’un habit pour la maison de tissus Scabal. Il n’y a pas de terrain exclusif, ou l’idée que je pourrais faire ou ne pas faire. J’ai fait des parapluies aussi, récemment, avec la maison parisienne We do not work alone…
Justin Morin
Mais aussi des cravates !
John M Armleder
Tout à fait. De la vaisselle aussi… D’ailleurs, je travaille à un projet qui va présenter tous ces sous-produits. Je n’en ai pas autant que Jeff Koons ou Damien Hirst, mais il y a de tout, et ça m’amuse beaucoup. J’ai fait une exposition à Shanghai que je n’ai pas pu voir à cause du Covid. Le musée a produit un certain nombres d’objets d’après mon travail, et je trouve ça fantastique. Il y a une écuelle à chat, des chaussettes, tout un tas d’objets que j’ai découverts avec excitation. On va les montrer, aux côtés d’autres objets, dans un magasin à Genève l’année prochaine car le MAMCO va bientôt être en travaux. Dans les cultures occidentales, on va considérer le sous-produit comme inférieur. Mais personnellement je n’en suis pas sûr.
Justin Morin
Sur Internet, on peut vous voir réaliser vos Pour Paintings. Vous allez utiliser la totalité des peintures que vous avez achetées, et une fois les pots vides, votre intervention se termine. Je me demandais si vous opériez ensuite un processus de sélection. Y a-t-il des toiles qui ne reçoivent pas votre validation ?
John M Armleder
Quand j’ai fini de produire ces peintures, elles continuent elles-mêmes à évoluer et on ne peut pas vraiment prévoir comment.

John M Armleder, Smoothie II (furniture sculpture), 2019. Acrylique sur toile et deux canapés par Ubald Klug & Ueli Berger, 1972. Toile : 150 × 280 cm. Canapé: 180 × 140 × 100 cm (chacun). Avec l’aimable autorisation de l’artiste et d’Almine Rech. Photo : © Fondation Cab & Lola Pertsowsky.
Les peintures que je mélange ne sont pas miscibles, donc il peut y avoir des réactions chimiques totalement imprévisibles. Souvent dans les magasins, lorsque j’achète les peintures, on me dit : « Faites attention, il ne faut surtout pas mélanger ces produits ! » Je me souviens le cas d’une boutique à New York où on m’a dit : « Ah, vous devez être un artiste !» L’imprévisibilité est dans la partition de manière très claire. Je ne cherche pas à imposer une lecture de mon travail.
J’ai des amis qui étaient furieux qu’on lise leur travail autrement que eux le pensaient. Alors que moi, plus ça m’arrive, plus je suis content. Peut-être aussi parce que j’ai commencé très jeune, et que j’ai oublié quelles étaient mes idées de l’époque. Je suis très content d’avoir oublié ! La légende du sujet m’échappe totalement, ce qui me permet de le voir d’une autre manière. Étant un artiste suisse, j’ai été influencé par Paul Klee qui numérotait tous ses travaux. J’ai des vieux dessins où je faisais la même chose. Puis j’ai arrêté et tout est devenu « sans titre ». Mais c’est devenu compliqué à gérer, donc j’ai commencé à mettre des titres. Mais comme, hormis ces questions d’organisation, il n’y avait pas de raisons pour ces titres, je les choisissais dans les livres que je lisais. Donc on en trouve d’assez colorés, ce qui amuse beaucoup les gens qui sont persuadés que l’œuvre a un rapport avec son nom ! Au final, c’est Klee qui avait raison, les chiffres c’est plus simple ! Quand on me demande d’expliquer ces titres, je ne me souviens plus du tout de quoi il s’agissait. Dans le fond, cela peut paraître arrogant, mais ça m’est égal. Pour moi, il y a toujours eu ce principe très (John) « cagien » d’équivalence. C’est pour ça que je continue à faire des tableaux très structurés, d’autres avec des objets – ou pas – ou des peintures avec des coulées.
Justin Morin
Ce numéro de Revue a pour thème « maximalisme ». Quelle est votre définition de ce terme ?
John M Armleder
C’est un mot hybride, je ne pense pas qu’il ait une définition propre. Comme on le connaît dans notre culture, il représenterait une tendance à être tout inclusif, à ne pas afficher les limites. C’est hors cadre. C’est exactement le contraire du cadre qui voudrait éviter que la peinture aille plus loin que son encadrement. Comment définir autrement le maximalisme ? On pourrait aussi dire que d’un petit objet, on peut en faire un très grand. Ce qui est intéressant avec beaucoup de termes génériques comme celui-ci, c’est que ça peut dire tout et son contraire. C’est quelque chose qui me plaît.
Justin Morin
Pour conclure, puis-je vous demander sur quoi vous travaillez en ce moment ?
John M Armleder
Si je le savais ! Je pense ne jamais avoir eu l’idée que je travaillais sur une chose plutôt que sur une autre. Concrètement, avec Ludovic Bourrilly, avec qui je collabore et que nous avons exposé à Bâle cette année, nous faisons des pour et puddle paintings. On fait des objets avec des meubles ou des objets mis en scène avec des socles, pour toutes sortes d’expositions, ou sans destination prévue. J’ai été invité ici à Genève au musée Barbier-Mueller, qui a une collection d’arts des cultures du monde, à montrer mon travail en dialogue avec leurs œuvres. Il n’y aura que des pièces en verre, que j’ai notamment réalisées à Murano. Je prépare également un projet pour la Kunsthalle Marcel Duchamp, un minuscule espace à Cully, en Suisse, à peine plus grand qu’une boîte aux lettres ! Et puis il y a aura des choses à venir ici ou là…
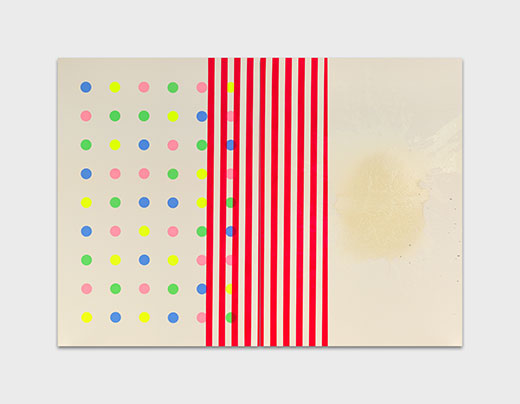
John M Armleder, Cast Iron, 2016. Diptyque : à gauche, acrylique sur toile, 215 × 150 × 4 cm ; à droite, vernis sur toile, 215 × 300 × 15 cm. Avec l’aimable autorisation de l’artiste et d’Almine Rech. Photo : Annik Wetter.
ROCK LOBSTER — john M armleder — entretien avec justin morin
Bewitched
Genesis Belanger
Avec leurs couleurs pastel surannées et ses formes arrondies, les œuvres de Genesis Belanger trouvent leurs inspirations formelles dans l’Amérique des années 1950, plus particulièrement dans l’esthétique publicitaire, mais aussi dans le pop art et le surréalisme. Ses sculptures et ses peintures composent un théâtre domestique où se rejouent les rapports de force et les disparités de nos sociétés contemporaines. Alors que son travail se concrétise dans le champ des arts visuels, Belanger met en place un univers avec la minutie d’un écrivain. Ses installations s’appréhendent comme la page d’un livre fourmillant de détails sur la vie d’un protagoniste absent. En entretien avec Syra Schenk et à l’occasion de sa récente exposition personnelle parisienne au sein de la galerie Perrotin, l’artiste américaine revient sur les multiples interprétations qu’offre son travail.
Syra Schenk
Je voudrais commencer par une question indiscrète : d’où vient votre prénom ?
Genesis Belanger
Mes parents étaient hippies, à l’époque c’était la mode de donner à ses enfants des prénoms qui sortent de l’ordinaire, et j’étais la première née. Le mot signifie l’origine, mais aussi le commencement, et j’étais leur premier enfant.
Syra Schenk
Vous avez travaillé dans la publicité et la mode, quelle activité exerciez-vous dans l’industrie de la mode ?
Genesis Belanger
J’ai obtenu un diplôme de design de mode à la fin de mes études, et j’ai travaillé pour une petite marque contemporaine en tant que designer dès la sortie de l’école. J’ai ensuite été l’assistante d’un décorateur pour la publicité dans le domaine de la mode, pour des shootings et des tournages.
Syra Schenk
Vous vous êtes très vite aperçue que vous vouliez vous investir de manière plus concrète ?
Genesis Belanger
Dès le début mes tâches étaient très concrètes, je dessinais toujours les modèles, je prenais les mesures et je réalisais les modèles. Mais je n’avais pas le dernier mot sur le résultat final.
Syra Schenk
Votre travail est régulièrement assimilé au pop art, au surréalisme. J’ai trouvé cette citation : « Elle compose des espaces où le temps est suspendu. », qui traduit ce que je ressens spontanément face à votre travail qui rappellerait Edward Hopper, bien qu’il interpelle davantage par son côté kafkaïen que surréaliste. Un soupçon de mélancolie mêlé à un fort cynisme, alors que le pop art est peut-être plus naïf et direct.
Genesis Belanger
Mon travail est lié au surréalisme parce que je m’intéresse à la psychologie humaine, et c’est pour cette raison qu’il est également lié au pop art. Il y a certainement un diagramme de Venn. Dans le pop art, les artistes abordaient la publicité d’un point de vue purement formel. Je m’intéresse à la manière dont elle utilise notre psychologie contre nous, ou l’utilise à des fins consuméristes, et cette relation est peut-être intrinsèquement un peu cynique – être capable de comprendre aussi bien l’individu pour le manipuler et en faire le consommateur idéal. Je pense que ce sujet, en tant qu’enveloppe, ouvre beaucoup de pistes sur le plan artistique.

Genesis Belanger, Gatekeeper, 2019. Avec l’aimable autorisation de de l’artiste et de la galerie François Ghebaly, Los Angeles.
Ce qui m’intéresse, c’est de donner à voir l’être humain en son absence, tout ce qu’il a utilisé, ou les vestiges d’une expérience, et le spectateur, en entrant dans l’espace, assemble les pièces et crée presque la narration, un peu comme un détective, mais pas de manière aussi littérale. Je choisis des symboles universellement compris, afin qu’il accède aux sujets qui me tiennent à cœur.
Syra Schenk
Vous laissez donc la porte ouverte au spectateur pour qu’il interprète la scène à sa façon ?
Genesis Belanger
L’interprétation n’est pas exactement ouverte, mais il est assez irréaliste de penser que l’on peut contrôler une narration. Nous nous y intéressons de par notre culture, nous sommes tous des avatars dans nos vies en ligne, nous essayons de contrôler le récit que nous livrons de nous-mêmes – ce n’est pas vraiment possible. Il est donc intéressant de voir combien d’éléments sont nécessaires dans une scène, très peu ou au contraire beaucoup, pour produire la narration que l’on souhaite tout en la laissant très ouverte.
Syra Schenk
On considère que dans Blow out la pièce Healthy Living se moque de l’érection masculine. Les cactus, les ballons dégonflés font-ils référence aux hommes ?
Genesis Belanger
Ce n’est pas exactement l’intention, mais cela ne me dérange pas dans le sens où je m’intéresse aux dynamiques de pouvoir et à la suprématie de l’homme, même de manière simple comme dans la prédominance de l’obélisque. Je pense qu’il est possible de créer un monolithe mou pour critiquer subtilement cette structure de pouvoir. Seulement en le proposant dans un contexte où il est associé à d’autres éléments, pour étoffer une critique possible, sans critiquer directement – dans ce cas alors cet angle d’approche m’intéresse.
Syra Schenk
Les hommes semblent totalement absents de vos œuvres.
Genesis Belanger
Je m’intéresse aux structures de pouvoir, et la personne que l’on peut artificiellement empêcher de le détenir sera le personnage qui m’est le plus sympathique. Souvent, je crois que s’il y avait un personnage dans l’œuvre, il serait féminin, mais ce ne serait pas forcément une femme. Cela traduit seulement mon point de vue sur les structures de pouvoir et le déséquilibre plus généralement. Je pense que les hommes ont occupé la scène assez longtemps.
Syra Schenk
Vous avez déclaré que : « L’industrie de la publicité utilise des parties du corps des femmes pour vendre des produits, une main bien manucurée peut vendre à peu près n’importe quoi. » Dans votre travail, vous montrez des parties isolées du corps féminin, mais qui ne semblent cependant jamais morbides, juste précisément – soignées. Est-ce cela que vous exposez ?
Genesis Belanger
C’était exactement mon intention : utiliser ces compétences que l’on transforme en armes contre nous pour générer un dialogue complétement différent. Regarder la structure non pas en ce qu’elle cherche à nous vendre, ou nous demande d’acheter, mais en se demandant comment cela a pu arriver. Que pouvons-nous faire à ce sujet ? Pour générer des dialogues complexes.
Syra Schenk
Vous établissez de manière récurrente des ponts entre la pauvreté émotionnelle provoquée par le capitalisme et les béquilles classiques du monde d’aujourd’hui – médicaments, caféine, alcool, cigarettes. Ne sont-elles pas les « exutoires » d’aujourd’hui, tout comme vous avez observé à juste titre que dans les années 1950 et 1960 cuisiner des plats élaborés était l’exutoire des femmes aux libertés restreintes ?
Genesis Belanger
C’est à 100 % ce que je pense. Tant de gens consomment ces produits pour survivre à l’inégalité d’aujourd’hui…
Syra Schenk
Vous dites les gens –vous voulez dire les individus dans leur ensemble ou essentiellement les femmes ?
Genesis Belanger
Cela s’applique à beaucoup de monde. Quand on a un système aussi injuste, il est difficile pour presque tous ceux qui y sont confrontés, certains plus que d’autres. Je parle plus facilement des femmes, mais, je pense, sans exclure qui que ce soit.
Syra Schenk
Tous ceux qui souffrent de la lutte pour le pouvoir ?
Genesis Belanger
Oui, exactement. Je crois vraiment que dans notre culture les femmes font l’objet d’une pression particulière.
Syra Schenk
Peut-être parce qu’elles tiennent aussi le rôle de reproductrices ?
Genesis Belanger
Oui certainement.
Syra Schenk
Vous avez observé que les possibilités limitées des femmes sur le marché du travail et le fait qu’on attend d’elles qu’elles restent à la maison pour s’occuper de la famille pourraient rendre folle une personne intelligente. Votre œuvre Minor procedure interroge le besoin que ressentent les femmes d’aujourd’hui de modifier leur apparence, peut-être aussi comme une forme d’exutoire ?
Genesis Belanger
Dans notre culture, la beauté est synonyme de pouvoir, et la pression exercée sur les femmes pour qu’elles modifient leur apparence et répondent à certaines attentes, indépendamment de facteurs intrinsèquement humains comme le vieillissement, est immense. Et leur donne peut-être aussi du pouvoir. Lorsque l’on se sent impuissant face à quelque chose d’aussi biologique que le vieillissement, peut-être que modifier son apparence confère vraiment du pouvoir.
Syra Schenk
Pour reprendre le contrôle sur ce qui est théoriquement incontrôlable ?
Genesis Belanger
Oui, précisément.
Syra Schenk
L’une des œuvres montre une main serrant un miroir brisé, entourée de médicaments, de ballons dégonflés et de bonbons colorés. Est-ce une analogie avec le vide émotionnel que vous mentionnez souvent ?
Genesis Belanger
Dans ce vide nous faisons des choses qui, nous l’espérons, nous combleront, qui rendront les choses tolérables, et puis par moment nous le regrettons.
Avec cette œuvre, j’ai beaucoup pensé à la honte, au regret et à la culpabilité, et à la façon dont cela nous renvoie à la responsabilité de nos actes, même si ces actes nous ont été imposées par une structure extérieure.
Syra Schenk
À quoi la honte, le regret et la culpabilité se rapportent-ils ? La vie en général ou quelque chose de plus spécifique ?
Genesis Belanger
Ils se rapportent à toutes les choses que nous faisons pour nous sentir mieux – prendre des médicaments délivrés sur ordonnance, consommer de l’alcool ou de la nourriture dans des proportions excessives –, mais qui sont à double tranchant. Il y a là un cycle qui consiste à adopter certains comportements pour se rendre la vie supportable, mais ils provoquent aussi un mal-être, et ensuite nous devons les reproduire encore et encore pour le supporter. Et cela devient un cercle vicieux.
Syra Schenk
Comment s’en sortir ? Évidemment en provoquant la réflexion. C’est peut-être un thème pour votre prochaine exposition ?
Genesis Belanger
(rires) Je ne sais pas, c’est là toute la question, n’est-ce pas ?
Syra Schenk
Vous avez déclaré : « La beauté et l’imagerie complexe peuvent traduire des idées vraiment complexes, même si le spectateur n’en est pas conscient. » On pourrait dire que cela s’applique à votre travail – il semble troublant de perfection et de linéarité, toujours lisse, parfaitement soigné, dans une palette de couleurs qui rappelle beaucoup une certaine époque. Les niveaux de lecture ne sont-ils pas multiples ?
Genesis Belanger
En rendant mon travail aussi beau que possible – parfois les gens le trouvent effrayant – j’espère qu’il envoie subtilement des messages auxquels les spectateurs peuvent choisir d’adhérer ou non. Il n’est pas rebutant et j’espère qu’il opère dans un espace plus subconscient.
Syra Schenk
L’une de mes pièces préférées est checks and balances – malbouffe, médicaments, caféine, cosmétiques. Un polaroïd du monde d’aujourd’hui. Tout le maquillage en essence ?
Genesis Belanger
Oui, absolument !
Syra Schenk
Comment travaillez-vous ? Êtes-vous plutôt organisée, avez-vous une équipe ? Travaillez-vous sur plusieurs pièces à la fois ?
Genesis Belanger
Je suis très organisée, j’ai deux assistants et chacun de nous travaille un matériau spécifique. Je réalise toute la céramique, un de mes assistants travaille le métal, un autre s’occupe de toute la couture et de la tapisserie. Nous travaillons tous également d’autres matériaux, mais nous nous concentrons surtout sur notre sujet, et les sculptures sont le fruit d’un travail d’équipe. Je travaille sur toutes les choses à la fois, d’une manière un peu folle. Vous pouvez venir dans mon studio au milieu de l’exposition et ne pas voir une seule œuvre terminée, et les pièces ne sont assemblées qu’à la toute fin. C’est extrêmement stressant, mais avec la nature des matériaux et le temps que prend la réalisation de certaines parties, c’est finalement la manière la plus efficace de travailler.
Syra Schenk
Vous avez connu une ascension fulgurante. Ressentez-vous une certaine pression aujourd’hui ?
Genesis Belanger
Je n’ai pas ressenti de contrainte dans mon travail, mais c’était vraiment déroutant au début. Chaque exposition m’offre une opportunité plus excitante que la précédente. J’ai créé toute ma vie dans l’obscurité la plus totale, et je me suis soudain retrouvée sous les feux de la rampe.

Genesis Belanger, Flicker in the Ether, 2022 ; I Don’t Believe in Ghosts, 2022, [vue d’exposition]. Avec l’aimable autorisation de l’artiste et de la galerie Perrotin, Paris.

Genesis Belanger, Inner Beauty, (détail), 2020. Avec l’aimable autorisation de l’artiste et de la galerie Perrotin, Paris.

Genesis Belanger, Not one single regret, 2022. Avec l’aimable autorisation de l’artiste et de la galerie Perrotin, Paris.
C’est comme si j’avais été un peu populaire et que tout d’un coup j’étais radicalement différente, cela me semble vraiment étranger. C’est plus un malaise personnel. J’ai surtout envisagé toutes les opportunités comme des paramètres à repousser. J’essaie d’évoluer autant et aussi sincèrement que je peux, et de ne pas trop penser aux attentes du marché et aux choses de ce genre. Un peu comme si les designers considéraient toutes les contraintes comme des paramètres de conception et essayaient de trouver des moyens astucieux d’aboutir au résultat que je recherche, malgré certaines limitations.
Genesis Belanger
Fastidieuse bactérie
Jean-Marc Caimi Valentina Piccini
Compte-rendu de plusieurs années d’investigation, l’ouvrage Fastidiosa s’appréhende comme un récit basculant d’un genre à l’autre, du documentaire au thriller écologique. Mais ici, point de fiction puisqu’il témoigne de la triste réalité d’une maladie, la Xylella Fastidiosa, qui touche les oliviers du sud de l’Italie, et de ses répercussions écologiques et sociales. En enquêtant auprès des cultivateurs, les photographes Jean-Marc Caimi et Valentina Piccini dressent un portrait de cette Italie agricole, riche de traditions et de croyances, et fragilisée par l’épuisement de la nature.
Justin Morin
Comment avez-vous entendu parler de la Xylella fastidiosa ?
Jean-Marc Caimi & Valentina Piccini
La bactérie Xylella est un problèmemajeur pour les oliveraies du sud de l’Italie et a récemment menacé d’autres pays et régions d’Europe telles que la Grèce, l’Espagne et le sud de la France. Elle est propagée par un insecte de la famille des cigales et s’attaque aux oliviers en provoquant une dessiccation rapide qui entraîne des dommages considérables sur le paysage, l’économie, le patrimoine et l’identité d’une population qui a vécu pendant des siècles dans une sorte de symbiose avec la terre et les arbres. Lorsque nous avons commencé à travailler sur le sujet il y a sept ans, au début de l’épidémie, nous voulions proposer un compte-rendu approfondi, personnel et artistique d’une question que les médias traitent souvent de manière superficielle. De plus, Valentina étant originaire de Bari, dans les Pouilles, nous avons bénéficié d’un accès privilégié à la vie des gens, des agriculteurs, des scientifiques, des agronomes et de toutes les personnes que nous avons rencontrées au fil des ans pour réaliser le livre.
Justin Morin
Le livre s’ouvre sur les paysages des Pouilles, puis sur une reproduction religieuse, mettant en place le contexte très religieux du Sud de l’Italie. Pour ceux qui ne connaissent pas cette région, pouvez-vous nous la décrire ?
Jean-Marc Caimi & Valentina Piccini
Dans les Pouilles, comme dans une grande partie du sud, les gens reçoivent une éducation religieuse et sont croyants, en particulier les personnes âgées, comme certains des cultivateurs de notre histoire. Mais au-delà de cela, il existe une sorte de lien intime avec la terre, une approche animiste, où les arbres sont des êtres vivants qui renferment des histoires et des secrets ancrés dans le passé. Les images auxquelles vous faites référence, ainsi que l’ensemble de l’œuvre, sont ouvertes à l’interprétation. Il n’y a pas de message didactique univoque. Nous avons souhaité construire un récit visuel évocateur qui touche à la sphère intime des lecteurs. Nous essayons de les amener à entrer dans l’histoire en suscitant des émotions, plutôt que de leur fournir un compte-rendu descriptif qui s’explique de lui-même. Bien que le livre soit en grande partie documentaire et scientifique, il laisse au lecteur la possibilité de créer son propre panorama des sentiments et des sensations que les images déclenchent en lui.
Justin Morin
À la manière d’une enquête, le livre alterne les styles de photographie, du paysage au portrait en passant par des planches botaniques ou des images tirées d’observations au microscope. Il se construit une narration complexe, un peu à la manière d’un film qui passerait du récit intime au thriller. Cette approche s’est-elle imposée à vous pour rendre compte de la complexité de la situation, à la fois sociale, biologique et scientifique ?
Jean-Marc Caimi & Valentina Piccini
L’épidémie de Xylella ne se contente pas de ravager les cultures. Elle a complètement ébranlé la vie des gens, le tissu social,humain et, bien sûr, économique de toute une région. Nous pensons que cette histoire symbolise notre époque, dans laquelle des événements souvent anthropogéniques, du changement climatique à la gentrification urbaine massive, altèrent notre histoire de façon dramatique, souvent avec la perte de particularités locales spécifiques et de l’héritage culturel, en faveur d’un nouvel ordre plus efficace économiquement et plus mondialisé. L’histoire est basée et construite sur notre relation avec les personnes dont nous parlons, qui nous ont permis de découvrir leur monde, leur vie, leur lutte pour maintenir un lien avec leur culture et leur histoire, et l’amour de leur terre. Du paysan vivant une vie rurale simple dans les champs jusqu’à la communauté scientifique en quête d’une solution à l’épidémie d’arbres. Le livre, comme le sujet lui-même, est en effet à plusieurs niveaux.


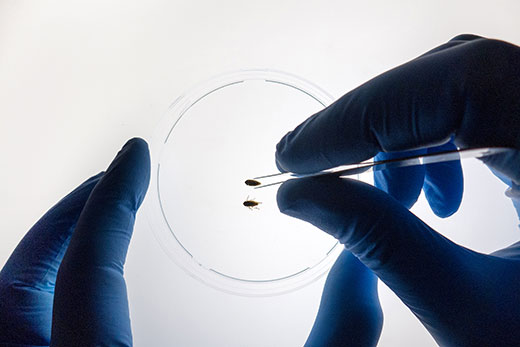
Nous nous sommes délibérément abstenus d’imposer un style visuel unique, pour être plus libres d’expérimenter et d’approfondir chacune des sections qui le composent. Par conséquent, nous avons sélectionné pour chaque section les moyens photographiques que nous considérons les plus fonctionnels afin d’aborder chaque sujet avec le plus de précision possible, qu’il s’agisse de transmettre une émotion ou de reproduire une preuve scientifique.
Justin Morin
Questa terra e la mia terra est le titre d’un carnet de photographies annotées que l’on retrouve reproduit au cœur du livre. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce carnet ?
Jean-Marc Caimi & Valentina Piccini
Nous emportons toujours avec nous un carnet dans lequel nous prenons des notes, collons des polaroïds et demandons parfois aux gens de rédiger leurs propres notes. C’est un petit rituel que nous avons et qui nous donne souvent l’occasion de nous rapprocher de nos sujets, d’interagir, de nous souvenir. Parfois, comme dans cet ouvrage, les pages du journal intime s’introduisent dans l’histoire visuelle et en font partie intégrante. Ce que nous avons recueilli au cours de notre longue relation avec les personnes que nous avons rencontrées pendant la réalisation de Fastidiosa nous a tellement inspirés et a été si révélateur de l’histoire que nous avons commencé à sortir notre carnet plus régulièrement avec l’intention claire de construire des pièces visuelles. Nous avons demandé aux agriculteurs de prendre le temps d’écrire et nous leur avons également demandé quel objet représentait leur relation avec leur terre, pour que les lecteurs saisissent le sens de « questa terra e la mia terra », cette terre est ma terre. Un livre dans le livre est né.
Justin Morin
Beaucoup de fantasmes entourent l’arrivée de la bactérie en Italie, qui pour certains aurait été introduite par le biais de plantes exotiques en provenance du Costa Rica, ou qui serait une arme dans une guerre de marché entre producteurs d’huile, ou encore une tactique de promoteur immobiliers pour récupérer des terres. Est-ce que ces histoires vous ont été racontées par les personnes que vous avez rencontrées ?
Jean-Marc Caimi & Valentina Piccini
En effet, toutes sortes de scénarios ont circulé au fil des ans, certains de ceux que vous mentionnez étant plausibles. Mais il y en a eu beaucoup d’autres, souvent alimentés par des défenseurs de la théorie du complot sur les réseaux sociaux, tout comme pendant l’épidémie de Covid. Ainsi, nous avons eu des drones répandant la bactérie, des personnes circulant la nuit avec des camions d’épandage dans le cadre d’un rituel religieux, la pollution de l’usine sidérurgique ILVA, et bien d’autres encore. C’est tout à fait compréhensible : lorsqu’un terrible fléau frappe en si peu de temps et sans explication officielle, les gens commencent à se raccrocher à des informations non vérifiées pour parvenir à une explication. C’est un terrain idéal pour les vantards et les personnes sans scrupules qui veulent profiter de la situation.
Justin Morin
Combien de temps avez-vous passé sur place ? Et combien de temps a été nécessaire pour réaliser le livre ? Comment se partage le travail dans votre duo ?
Jean-Marc Caimi & Valentina Piccini
Nous travaillons sur cette histoire depuis six ans, depuis que le premier foyer de Xylella a été détecté près de Gallipoli, aux cours desquels nous nous sommes établis dans la région pendant de longues périodes. Nous avons vécu dans les locaux d’un moulin à huile à Gemini, où nous avons installé notre chambre noire et commencé à développer nos photos. C’était magique, nous nous sentions complètement connectés à l’histoire que nous étions en train de documenter. Tiffany, notre éditrice chez Overlapse, travaille avec nous depuis deux ans et nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises pour discuter et peaufiner les détails des nombreux chapitres de l’ouvrage. La collaboration a été très importante. Elle a ensuite réalisé un travail extraordinaire en éditant le matériel et en concevant le livre dont nous sommes évidemment fiers, tant sur le plan du contenu que de la forme. Nous fonctionnons en équipe, à deux photographes, depuis neuf ans et nous couvrons des sujets variés, de la guerre à la religion en passant par l’environnement. Nous photographions, éditons et écrivons tous les deux. Nous réalisons également des travaux multimédias et composons des bandes sonores. Nous formons un duo créatif pluridisciplinaire. Le fait que notre équipe soit composée d’une femme et d’un homme nous permet de gagner la confiance des protagonistes de notre histoire et d’entrer dans leur intimité, toujours essentielle. Une confiance qui est réciproque.



Toutes les photographies sont extraites du livre Fastidiosa de Jean-Marc Caimi et Valentina Piccinni, édité par Tiffany Jones chez Overlapse, en janvier 2022, à Londres. Avec l’aimable autorisation des artistes et de leur éditeur. © Overlapse
Planète sauvage
Tania Pérez Córdova
C’est dans une certaine économie d’effets et de formes que la poésie des sculptures de Tania Pérez Córdova opère. En associant des éléments disparates, parfois en opposition, l’artiste mexicaine met en place des images mentales aux multiples strates. Les techniques qu’elle utilise, qu’il s’agisse de la fonte et du moulage d’aluminium ou du verre soufflé, portent en eux l’idée d’une transformation dont la valeur symbolique n’est jamais exclue. Les cycles de production, de vie et de circulation des objets qu’elle convoque se superposent dans une grâce naturelle. Les formes géométriques et organiques sont au service de narrations aux échelles variables. Une élasticité qui fait toute la richesse du travail de l’artiste. À l’occasion de sa récente exposition personnelle à la Galerie Tina Kim (New York), Tania Pérez Córdova s’entretient avec Justin Morin et revient sur son processus de création.
Justin Morin
On pourrait définir votre travail comme une poésie visuelle, un assemblage de divers éléments, la plupart du temps considérés comme un tout, mais d’une façon très délicate et sculpturale. Pouvez-vous décrire votre processus de création ? Rassemblez-vous ces éléments dans votre atelier et cherchez-vous différentes façons de les associer pour qu’ils correspondent aux idées que vous voulez exprimer ?
Tania Pérez Córdova
Je commence souvent par faire des recherches sur un objet qui m’intéresse. Je réfléchis à sa valeur culturelle, à l’histoire de sa production, à ses propriétés physiques. Je veux simplement m’en approcher et apprendre comment il est fabriqué, comment il peut être modifié, d’où il vient. Parfois, cela suppose que je commence à travailler dans des ateliers. Puis je me concentre davantage sur le comportement de l’objet, ses interactions avec l’environnement ou les situations sociales dans lesquelles on le trouve.
J’essaie de l’envisager comme un contexte à part entière plutôt que comme une chose. Enfin, une rencontre fortuite, une découverte accidentelle viennent généralement compléter l’œuvre. Comme si je devais attendre qu’un incident imprévu se produise.
JM
Vous utilisez souvent des éléments naturels (perle, feuille),parfois dans leur forme organique originelle, parfois par le biais de répliques. La nature est-elle une notion importante pour vous?
TPC
La nature, en tant que principe, est importante dans le sens où elle me permet de considérer les matériaux comme des événements inscrits dans le temps, en suivant leur croissance, leur transformation et leur décomposition au sein d’un écosystème. L’idée de réplique est liée à une réponse à la nature transmise culturellement et aux rapports que nous entretenons avec elle, à la valeur que nous lui accordons.
JM
En poursuivant sur le thème de la nature, nous pourrions dire que vous utilisez ces éléments en tant qu’organismes vivants qui renvoient à une représentation physique du temps. Par exemple, les feuilles trouées et les chaînes pourraient évoquer l’idée de pluie, comme un arrêt sur image.
TPC
Pour la série de plantes que j’ai exposée dans Precipitation à la galerie Tina Kim à New York, j’ai voulu envisager la sculpture comme une reconstitution de processus naturels ; ainsi, au lieu de produire un objet fixe, j’ai tenté de suggérer la mise en scène de pluie qui tombe, de respiration ou de décomposition des plantes.

Tania Pérez Córdova, Aspidistra Elatior 2022. Plante artificielle, chaîne en or plaqué 14 carats, structure d’acier, 92,1 × 10,2 × 31,8 cm. Avec l’aimable autorisation de l’artiste et Tina Kim Gallery. Photo : Hyunjung Rhee.
Il s’agissait de la nature, mais aussi de la création d’une image, d’une image mentale qui renvoie à un état psychologique particulier.
JM
Dans votre pratique, la météorologie – depuis les œuvres trouées précédemment évoquées, intitulées en fonction de l’origine de la feuille et du cumul de pluie, jusqu’à la sculpture Iron Rain – devient un outil de narration. Quand avez-vous commencé à vous y intéresser ?
TPC
Plus qu’à la météorologie, je dirais que je m’intéresse aux qualités narratives des matériaux. Je recherche particulièrement les rapports possibles entre leur comportement et les histoires qui les entourent. La pluie de fer m’a été inspirée par un article scientifique qui décrivait des événements météorologiques possibles dans des planètes lointaines en dehors de notre système solaire. L’auteur parlait de pluie de métaux fondus. L’histoire m’est restée et, alors que je travaillais dans une fonderie, je n’ai cessé de penser à cette image de métal fluorescent tombant du ciel. Le creuset, récipient en graphite, est un outil utilisé dans les fonderies pour recueillir le liquide en fusion. Il y avait un très vieux creuset qu’on allait jeter, alors j’ai décidé de le remplir en me rappelant les pots qu’on place dans la maison quand il y a des fuites pendant la saison des pluies chez nous. Et c’était une sorte de mise en scène de l’article que je venais de lire.
Quand je parle de raconter des histoires, ce à quoi je fais référence, c’est vraiment à la création d’une image parallèle à celle de l’existence formelle d’une œuvre, qui est une image mentale des histoires incomplètes qui circulent autour d’elle.
Pour l’exposition à Tina Kim, j’ai pensé à des précipitations plus ou moins fortes pour que l’exposition soit dotée d’une temporalité unique ; pour l’imaginer comme une occurrence particulière de pluie où il y aurait quelques gouttes dans la première salle et où, en arrivant dans une deuxième, on rencontrerait une pluie torrentielle. Cela permettait de concevoir l’exposition comme un moment dans le temps, pour la penser comme un script.
JM
L’improvisation, les accidents, les rencontres font partie de votre vocabulaire. Par exemple, la forme de vos cadres en bronze n’est pas totalement contrôlée. Des performances très simples interviennent, par exemple des personnes dont les vêtements reprennent un motif visible dans l’exposition qui apparaissent sans programmation préalable. J’admire vraiment cette liberté et cette légèreté et je m’interrogeais sur votre démarche créative. Vous rendez vous tous les jours à votre atelier ? Est-il proche de votre domicile ? Empruntez-vous toujours le même chemin ou changez-vous d’itinéraire ?
TPC
Quand j’étais plus jeune, j’évitais à tout prix la routine. Je pensais qu’il n’était pas nécessaire de se rendre au studio tous les jours, que le travail pouvait se faire n’importe où et à n’importe quel moment. C’est une idée romantique commune.

Tania Pérez Córdova, Una reja en una reja 5/A fence into a fence 5, 2022. Aluminium, plumes d’oiseaux, argile, 100 × 78 × 5 cm. Avec l’aimable autorisation de l’artiste et Tina Kim Gallery. Photo : Dario Lasagni.
En général, j’ai du mal à suivre les routines, je ne suis pas très méthodique et la répétition me rend claustrophobe.
Cependant, maintenant que je suis mère, je dois organiser mon temps différemment. Ma vie est plus compartimentée et je dois être aussi efficace que possible lorsque j’ai la possibilité de travailler. J’ai mis en place une routine quotidienne au studio et des horaires de travail plus précis. Ç’a été important pour moi d’apprendre à habiter mon studio, car ça ne m’était pas naturel, j’ai dû apprendre. Pour être honnête, je ne pense pas que cela ait changé l’esprit de mon travail. Mon approche est la même aujourd’hui qu’hier. Peut-être suis-je plus productive actuellement. Pour être honnête, je ne pense pas que cela ait changé l’esprit de mon travail. Mon approche est la même aujourd’hui qu’hier. Peut-être suis-je plus productive actuellement.
JM
Y a-t-il des créateurs, dans les arts visuels ou pas, qui influencent votre travail ?
TPC
Il y a évidemment beaucoup de gens qui m’ont inspirée, souvent les personnes les plus proches de moi : mon partenaire, mes amis. Cependant, il me serait difficile de dresser une liste de noms. La plupart du temps, je vois plutôt l’influence comme une inspiration. Qui peut venir de partout. Parfois, l’énergie de quelqu’un, un détail dans sa pratique ou son utilisation du langage peut suffire à déclencher quelque chose, même si son travail est complètement différent du mien. Certains livres m’ont marquée au fil des ans. Je pense que ce qui est intéressant dans l’influence, c’est qu’elle peut provenir d’un aspect de l’œuvre que l’auteur n’avait pas soupçonné. Pour donner un exemple, j’ai récemment pensé à un recueil de poésie d’Ann Carson intitulé Short Talks que j’ai lu il y a quelques années et qui m’a vraiment marquée.
JM
Si vous n’étiez pas artiste, quelle activité exerceriez-vous ?
TPC
À un moment, j’ai envisagé d’étudier les mathématiques. Je m’intéresse aux mathématiques lorsqu’elles atteignent leur forme la plus abstraite, le genre de mathématiques qui sont loin de toute utilisation pratique et restent un discours hypothétique. J’aurais également aimé étudier la psychologie.
JM
Rêvez-vous d’un projet, en termes de taille ou de processus créatif que vous espérez réaliser à l’avenir ? Seriez-vous intéressée par une installation ou une sculpture en extérieur ?
TPC
J’aimerais utiliser l’éclairage naturel dans un espace conçu comme un cadre temporel pour différents événements. Imaginer un toit où la lumière frappe différents objets à différents moments de la journée et où des choses se produisent autour d’eux à certaines heures. Je ne sais pas à quoi ressemblerait cet espace…

Tania Pérez Córdova, Breathe in 2, 2022. Pierre ponce, respiration d’une personne, verre soufflé, 30 × 38 × 25,5 cm. Avec l’aimable autorisation de l’artiste et Tina Kim Gallery. Photo : Charles Roussel.
Un certain
refus des normes
Satomi Nihongi
Née en 1947 à Yokosuka, ville portuaire de la baie de Tokyo,Satomi Nihongi a développé sa pratique photographique en publiant ses premières séries dans des revues indépendantes célébrant les cultures alternatives nippones des années 70. La scène musicale et le monde de la nuit deviennent ses sujets de prédilection. Repérée par Nobuyoshi Araki, la jeune femme ne tarde pas à quitter le Japon et s’installe notamment en Angleterre où elle photographiera la scène punk, donnant naissance au livre Punk Rock in London (Buronzu-sha, 1979). Elle délaisse par la suite peu à peu son appareil photographique, laissant derrière elle une impressionnante archive capturant une jeunesse éprise de liberté. Aujourd’hui, son travail est redécouvert, notamment avec la publication de l’ouvrage ‘70s Tokyo Transgender (Komiyama, 2021) qui montre l’intemporalité de son regard et ses talents de portraitiste.
Comment avez-vous découvert les clubs gays, sachant que ces endroits sont assez confidentiels – encore aujourd’hui – en ville ? Vous rappelez-vous la première fois où vous y êtes entrée ?
SATOMI NIHONGI
C’était à Shinjuku. Après la séance de photos pour « Long Hair », que vous pouvez trouver dans le livre 70’s Tokyo LONG HAIR INVERTED (publié également par Komiyama Tokyo). J’avais besoin de créer un impact, d’un nouveau sujet à l’essence un peu pernicieuse. Parce que les personnes aux cheveux longs, en particulier les jeunes hommes (quand j’avais un peu plus de vingt ans) étaient très amicaux et gentils, contrairement à ce qu’aurait pu suggérer leur style vestimentaire. À cette époque, il y avait dans leur communauté une symbolique forte, une espèce de résistance ou d’affirmation, une sorte de revendication de leur mode de vie. Et puis je me promenais dans Shinjuku et je l’ai remarquée.
Je n’avais aucun lien avec cette communauté et je n’avais jamais eu l’occasion de rencontrer des personnes transgenre.

Toutes les photographies sont extraites du livre ‘70s Tokyo Transgender de Satomi Nihongi, publié en 2021 par Komiyama Tokyo. Avec l’aimable autorisation de l’artiste et de l’éditeur.
Toute la culture underground était complètement cachée. Et je n’avais pas particulièrement essayé de les contacter ni eu l’occasion de les photographier. Peut-être parce que j’ai fréquenté une école pour filles au règlement très strict. En fait, mes amies de l’école n’ont jamais vu mes photos, et pas même ma sœur, ou mon enseignante. Je peux facilement imaginer qu’elle s’évanouirait si elle était au courant.
Pour revenir à votre question, la première fois que j’ai rencontré des personnes transgenre, j’ai ressenti un mélange de surprise et d’émerveillement. Au début je leur ai demandé si je pouvais les photographier et ils ont accepté de bon cœur. Ensuite, j’ai commencé à photographier des personnes transgenre. Mais je n’envisageais pas d’aller dans des clubs et des bars gays des quartiers où ils évoluaient, comme Shinjuku, Akasaka ou Aoyama. Alors j’étais toujours accompagnée par mon garde du corps qui entrait le premier, et jetait un coup d’œil. Ce n’était pas facile pour moi en tant que jeune femme (ha ha) de me rendre dans ce genre d’endroit. Heureusement, il était toujours derrière moi.
Vous avez aussi photographié d’autres groupes de personnes, dans la scène rock londonienne par exemple. Ses membres partagent avec la communauté transgenre un certain rejet des normes. Diriez-vous que vous êtes attirée par des sujets qui se battent pour leur liberté ?
SATOMI NIHONGI
En fait, je n’ai pas vu ces personnes comme porteuses d’une revendication particulière. C’est simplement ma curiosité et l’attrait qu’elles exerçaient sur moi qui m’ont poussée à les photographier.
J’ai aussi eu l’opportunité de travailler pour Rock Hebdo, le mensuel de Rock en Stock quand j’étais à Londres de 1970 à 1979. Pendant ces années, les journalistes m’ont amenée dans de nombreux festivals de rock, des concerts et même des pubs où les gens étaient très alcoolisés. À cette époque, j’ai pris beaucoup de photos. Vous pouvez en trouver certaines dans le livre Punk Rock in London. Mais je ne sais pas si mon nom est cité pour les photos de Rock Hebdo. C’était évidemment une expérience extraordinaire, mais il n’y avait aucune garantie quand je travaillais dans ce contexte. Tout était rude dans cette culture à l’époque. Même si je n’avais pas de raison particulière de photographier ces personnes, je dirais que tout le monde doit vivre sa vie sans crainte et sans subir de préjugés, et ce même dans la scène punk ou les communautés transgenre.
Ces photos ont été prises il y a presque cinquante ans. Avez-vous été surprise quand vous les avez redécouvertes en travaillant sur la publication avec Komiyama ?
SATOMI NIHONGI
J’ai été ravie de pouvoir publier mon travail avec Komiyama, mais je n’ai pas été surprise parce que je sais que ces photos renvoient suffisamment d’énergie pour parler à ceux qui les regardent. Et je suis très heureuse de partager ces superbes images avec des gens partout dans le monde, grâce au livre, et d’en parler dans cette interview.
Comment travailliez-vous à l’époque ? Donniez-vous des indications à vos modèles ou preniez-vous les photos de manière spontanée ?
SATOMI NIHONGI
Je travaillais de manière absolument spontanée. Parce qu’ils s’étaient déjà façonné une personnalité attirante et qu’ils savaient la présenter. C’était une incroyable expérience de passer du temps au sein de leur communauté très fermée. Chaque fois que j’allais dans leurs bars (ou clubs ou pubs gay, je ne sais pas comment définir cette atmosphère) ils portaient des superbes tenues, par exemple des robes bouffantes ou des kimonos, parfois des jupes serrées et des collants comme des employées de bureau et ils se mettaient à danser sous la lumière violette ou rose des projecteurs. Tout était poussé à l’extrême, mais il y a une esthétique dans cette communauté, surtout en ce qui concerne la mode. Des coiffures, des costumes, des ongles vernis et des maquillages extraordinaires. J’ai passé des très bons moments.
PROPOS
RECUEILLIS
PAR
JUSTIN
MORIN
&
MUGI
IDE








Satomi Nihongi, ‘70s Tokyo Transgender, ©︎ Komiyama Tokyo 2022.
Fenêtre sur cour
Hardy Hill
Empreints d’homoérotisme, tout en tension, les dessins de l’artiste américain Hardy Hill questionnent la répresentation. Nus, seuls ou en groupe, ses éphèbes se présentent dans des poses chorégraphiées qui préfigurent des actions suspendues. Cet instant figé, où le désir semble coexister avec la violence, se matérialise sous un trait maîtrisé, puisant autant dans les codes du croquis anatomique qu’architectural. En discussion avec Justin Morin, Hardy Hill revient sur les fondements de sa pratique – de sa méthodologie à ses interprétations psychologiques – et son intérêt pour la mise en scène.
Justin Morin
Où avez-vous grandi ? Quelle a été votre première expérience de l’art ?
Hardy Hill
J’ai grandi dans une petite communauté agricole de l’ouest du Massachusetts, non loin de la tribune autrefois occupée par Jonathan Edwards, célèbre pour avoir composé et prononcé le sermon « Sinners in the Hands of an Angry God ». Dans ses écrits, Edwards est très expansif en ce qui concerne le comportement des araignées volantes ; dans « Sinners », les hommes sont fréquemment décrits comme des araignées. Pour Edwards, le paysage de l’ouest du Massachusetts semblait être un endroit approprié à la création et à la fin du monde. Je rejoins Edwards sur beaucoup de sujets.
Mon grand-père du côté maternel sculptait des nus féminins admirables, à la Riemenschneider, mais qui n’ont pas trouvé de public. Sans acheteurs, ils ont été dispersés dans les bois qui entouraient sa maison dans le Maryland. Ils créaient une présence gentiment maligne, ils étaient expressifs dans leur caractère inanimé. J’ai toujours été convaincu que l’art n’est pas vivant.
Justin Morin
Pouvez-vous nous donner votre définition de l’érotisme ?
Hardy Hill
C’est une question à laquelle il m’est difficile de répondre. J’ai lu un jour un court essai écrit par un membre de la communauté InCel (célibataire involontaire) dans lequel l’auteur soutenait que – depuis l’arrivée de la pornographie photo et vidéo – le rapport sexuel est devenu impossible. Il y affirme que la pornographie instaure un régime de fantasme qui subordonne tous les corps de notre réalité tangible. L’acte sexuel en tant que tel se résume alors à un simple moyen au sein du système fantasmatique, et la virginité devient presque endémique.
Je pense que l’auteur de cet essai doit être très seul et, surtout, qu’il n’a pas vraiment raison. Mais je le rejoins lorsqu’il déclare que l’érotisme doit faire face au fait que « l’érotique » ne transcende pas l’économie de l’image.
Je préfère une lecture klossowskienne de l’érotisme : l’érotique comme principe économique interne de l’échange qui permet à l’image (qu’elle soit vivante ou artéfactuelle) d’« être considérée comme » ou de « se substituer à » l’objet éblouissant et incommunicable de la libido.
L’érotique est ce qui permet au désir d’être flexible et réitérable. C’est à la fois la structure qui oriente l’image aimée en lui conférant un sens que l’on doit chercher et le principe par lequel cette influence se détache de ses objets (c’est pourquoi il pourrait être utile de penser à cela en termes de répétition d’une même erreur, ou au fait de tomber amoureux de la même sorte de personne).

Hardy Hill, 3 Figures in Doorway (Examination 3; Theater 5), 2021.Avec l’aimable autorisation de l’artiste et de 15 Orient, New York.

Hardy Hill, Figure in Vestibule, 2021. Avec l’aimable autorisation de l’artiste et de 15 Orient, New York.
Ainsi, pour moi, l’érotique est fondamentalement figuratif (parce qu’il permet à une chose « d’en représenter » une autre) et c’est aussi un principe d’abstraction (parce qu’il dénature le particulier).
Justin Morin
Avec très peu d’éléments (un décor, une action, un titre), vos pièces fonctionnent comme des énigmes qui incitent le spectateur à déchiffrer votre intention et à élaborer ses propres réponses. Est-ce là votre ambition ?
Hardy Hill
À mon sens, toutes les images sont énigmatiques ; sans un « avant » ou un « après » perceptible, elles sont par nature insaisissables. Ceci dit, lorsque l’on fait référence à l’aspect « énigmatique » de mon travail, je pense qu’il s’agit d’une réaction à la représentation implicite d’une action suspendue ou figée.
Deleuze décrit l’action figée comme la marque du masochisme. Il explique cela en suggérant que ce dernier émerge d’un désaveu primaire de la réalité en faveur de l’idéal, qui remonte au moment où l’absence de phallus maternel a été reconnue. L’ultime moment qui précède cette prise de conscience devient un objet de jouissance voluptueuse, il est prolongé, pétrifié, conservé comme anticipation perpétuelle d’un événement impensable. Le fétiche masochiste est donc un retour et une prolongation du dernier moment où l’on peut penser que réalité et idéalité ne font qu’un. Je pense que c’est ce que les gens remarquent lorsqu’ils font des commentaires sur le caractère énigmatique de mes œuvres : le désaveu du réel en faveur de l’intelligible, la préférence pour la froide inertie des images au détriment de la vie en tant que « vivant », une jouissance voluptueuse du non consommé. Il y a une tension dans mes dessins : les solécismes du geste, la menace omniprésente de la violence, mais je comprends cette tension comme contenue dans l’instant du désaveu ou de la négation, plutôt que comme une tension strictement narrative ou interprétative.
Justin Morin
Vos titres ont-ils une fonction ?
Hardy Hill
Je n’utilise ni photographies ni modèles lorsque je dessine, donc je fais beaucoup appel à mon imagination. Mes titres sont généralement le genre de minima descriptifs que j’utilise lorsque je conceptualise une nouvelle œuvre. En ce sens, je suis une sorte d’Hollywood à l’ancienne : je commence par les titres et je travaille à rebours.
Justin Morin
Vos personnages sont généralement représentés en intérieur, confrontant leur nudité à l’espace domestique, et mettent le spectateur dans une position de voyeur. En peu de traits, vous créez un espace structuré et codifié très clair. Quelle est votrerelation avec l’architecture ?
Hardy Hill
En général, je conçois les intérieurs de mes dessins sous forme de plans.

Hardy Hill, Figures in Studio 2, 2021. Avec l’aimable autorisation de l’artiste et de 15 Orient, New York.
J’aime à dire que la peinture est amoureuse, elle implique des caresses. Les gravures, à l’inverse, doivent être « commises » comme un crime. Les plans font partie de ma préméditation.
Justin Morin
Vos compositions présentent souvent l’action d’un point de vue frontal, comme sur une scène de théâtre. Un de vos dessins montre un homme nu derrière une caméra. Cette idée de mise en scène est omniprésente dans votre travail. On la retrouve dans vos photos qui comportent des poupées de papier. Envisageriez- vous de quitter le papier et de présenter votre travail sur une scène ?
Hardy Hill
Je m’intéresse beaucoup au théâtre. Il est, pour moi, un moyen d’éprouver le réalisme en le confrontant à la dynamique de la représentation en soi. Par exemple, dans Entretiens sur le fils naturel, Denis Diderot ajoute une postface étrange à sa pièce, suggérant que le jeu des acteurs sur scène « remplace » la dernière des interprétations annuelles dans lesquelles la famille de Clairville rejoue les événements qui ont conduit au mariage des quatre personnages principaux. Le public voit ainsi des acteurs qui se font passer pour des personnes qui interprètent elles-mêmes un drame basé sur des événements réels de leur vie. Diderot ajoute un dernier rebondissement lorsqu’il révèle que – dans cette supposée interprétation annuelle –, tous les personnages jouent leur propre rôle, excepté Lysimond qui, mort depuis l’inauguration du rituel, a été remplacé par un acteur.
Tous ces syllogismes et ces moyens termes entament notre perception d’un théâtre qui donnerait à voir un objet réel. Ainsi, la représentation finit par se dédoubler, le réel s’efface, et nous nous retrouvons avec une image et une multitude de symétries et d’asymétries référentielles étranges qui s’entrechoquent autour d’elle. Il devient évident que l’objet théâtral est mélancolique : une chose perdue, mais que nous n’avons peut-être jamais possédée.
C’est une des raisons pour lesquelles j’aime le théâtre, même s’il m’est difficile de dire si je pourrai un jour monter une pièce. Je m’intéresse peut-être trop à l’immobilité.
Justin Morin
Pour compléter la question précédente, je sais que vous êtes également écrivain. Pouvez-vous nous parler un peu de votre pratique ? Est-elle liée à vos recherches en tant qu’artiste ? La théologie tient également un rôle important dans votre pratique.
Hardy Hill
J’écris un peu, bien que moins récemment. J’ai fait de la recherche universitaire en littérature ancienne et j’ai préparé ma thèse sur un théologien des IIe-IIIe siècles, Origène d’Alexandrie. Pendant que je vivais à Los Angeles, j’ai fait de la critique d’art et j’ai écrit un peu de fiction. En ce moment, je travaille sur quelques essais que l’on pourrait qualifier de réflexions théoriques sur l’art.
En ce qui concerne ma pratique, elle passe par très peu de médiums : gravure, photographie, une sorte d’hypnose érotique audiovisuelle que j’ai réalisé en janvier dernier, et enfin écriture.
J’ai lu un jour l’histoire d’un couple qui résolvait ses conflits en jouant les rôles de personnages du Seigneur des anneaux. Je trouvais intéressant qu’ils aient besoin de personnages ; que pouvaient-ils exprimer en tant que Frodon Sacquet qu’ils ne pouvaient pas exprimer autrement ? Mais cela me semblait également logique : l’amour a besoin de ses accessoires, et certaines choses ne peuvent être exprimées qu’en deux dimensions. C’est un peu comme cela que je conçois ces différentes façons de travailler.
Quant à la théologie, elle dépasse peut-être le cadre de cet entretien (ha ha). Je peux peut-être dire brièvement qu’elle est un moyen de contourner les marécages de la référence : le prosôpon (visage ou masque) divin est le visage d’une entité qui n’a pas de visage ; cela abolit la hiérarchie des formes. La relation du temps à l’éternité est une image et toutes les images sont brisées.
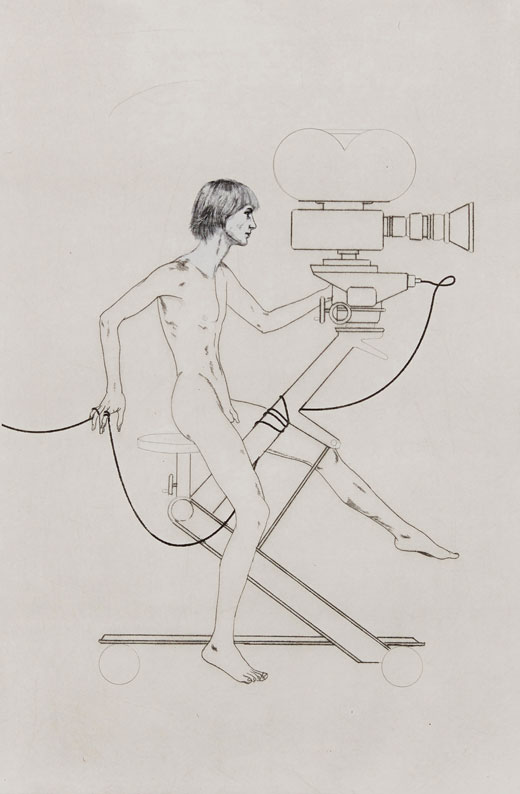
Hardy Hill, Figure on Camera, 2020. Avec l’aimable autorisation de l’artiste et de la galerie Hannah Hoffman, Los Angeles.
Justin Morin
Afin de vous connaître un peu mieux, pouvez-vous nous dire quels sont les artistes qui vous inspirent ?
Hardy Hill
J’adore cette question. Même si je ne peins pas, je suis féru de peinture. Je m’intéresse particulièrement au début de la Renaissance (Piero, Mantegna, Fra Angelico, Masaccio). Dans leurs œuvres, la réalité est toujours défigurée par sa sur-articulation formelle et spirituelle, comme si leurs sujets gémissaient sous le poids de ce qu’ils sont obligés d’exprimer.
Je suis également un grand fan du « long-modernisme » français : Poussin, Courbet, Manet. Ils semblent tous avoir compris la pulsion théâtrale et contre-théâtrale à l’œuvre dans la peinture. J’aime particulièrement Courbet car il montre que la violence peut exister dans l’acte pictural lui-même ; une ombre bien placée peut être une amputation.
Si je devais avoir une idole, ce serait Pierre Klossowski. Sa vie en quatre parties (novice dominicain, philosophe, romancier et artiste « muet ») m’inspire beaucoup. J’accorde une grande importance à l’interdépendance de ses différentes productions, et à sa monomanie.
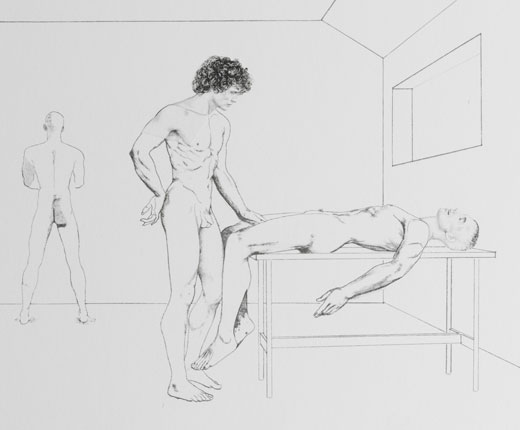
Hardy Hill, 3 Figures, 2 in Diagnostic Posture (examination 2), 2021. Avec l’aimable autorisation de l’artiste et de 15 Orient, New York.
Mais surtout, je trouve charmant que tout son travail soit un peu médiocre parce qu’il croit sincèrement à ce qu’il veut exprimer . Ses romans sont presque illisibles – on peut dire la même chose de ses écrits philosophiques – et ses dessins manquent étrangement de naturel. Il y a là une véritable poétique théologique, la beauté spirituelle ne peut s’exprimer que dans une nature brisée.
Justin Morin
Du dessin à l’écriture, votre pratique peut s’effectuer sur un bureau. Je me demandais si vous aviez un atelier. Si oui, que peut-on y trouver ?
Hardy Hill
Je travaille dans la moitié de mon très petit appartement. J’aime travailler à cette échelle, c’est un peu comme épingler des papillons. Je suis aussi un fantaisiste malin et cela m’aide de travailler dans l’endroit où je dors.
Mon objet préféré dans mon atelier/appartement est une statue fabriquée par mon grand-père. C’est une femme grandeur nature représentée de trois quart et couchée dans une extase indéterminée. Mon ami, l’artiste Henry Belden, m’a aidé à l’accrocher au-dessus de mon lit.
Justin Morin
Enfin, y a-t-il un projet que vous n’avez pas encore réalisé et que vous aimeriez concrétiser ?
Hardy Hill
Une sorte de romance métaphysique sombre : une chasse à l’amour/la beauté/la vérité absolue par la désorganisation systématique de ses incarnations particulières.
La nature des choses
Marcin Rusak
Toutes les choses, organiques et inorganiques, se dégradent naturellement avec le passage du temps. Nature of Things est l’une des nombreuses œuvres de Marcin Rusak, artiste et designer polonais, qui tente d’analyser précisément l’idée exprimée dans son titre : l’impact inévitable du temps sur la vie d’un objet ou d’un être vivant. En utilisant principalement des fleurs fanées pour exprimer sa vision, Marcin Rusak aborde le caractère éphémère de la vie, les questions de durabilité, de mondialisation, les conséquences à venir pour les fleurs et les multiples possibilités qu’elles présentent.
Ilaria Trame
Pour lancer notre discussion, je voulais commencer par votre histoire. Vous êtes issu de cinq générations d’horticulteurs, mais j’ai cru comprendre que l’entreprise familiale a fermé ses portes à votre naissance. Ce passé a-t-il influencé votre méthode de travail en tant qu’artiste ?
Marcin Rusak
Quand j’étais enfant, dans les années 1990, l’économie polonaise vivait une transition pour devenir un marché totalement ouvert, libéral et international. C’est à ce moment-là que l’entreprise de ma famille a connu des turbulences, car il est devenu possible d’importer des fleurs exotiques directement des plus grands marchés des Pays-Bas à des prix plus compétitifs que ceux des fleurs cultivées localement. Par conséquent, mon grand-père maternel a décidé de fermer ses serres à Varsovie et de déménager au bord de la mer Baltique pour y cultiver une espèce de sapin qui ne pouvait survivre que dans le microclimat de cette région. L’activité que ma famille exerçait depuis cinq générations a donc été arrêtée, et les serres qui entouraient la maison familiale ont été abandonnées.
Ilaria Trame
Et quand avez-vous commencé à vous sentir à nouveau attiré par le monde floral ?
Marcin Rusak
Ce n’est qu’à l’âge de 26 ans, pendant mes études au Royal College of Art à Londres, que j’ai pris conscience de l’influence qu’exerçaient sur moi la curiosité et la persévérance de mon grand-père, ainsi que celle de ce paysage post-industriel négligé. L’un de mes professeurs m’a demandé de travailler sur un objet qui suscitait en moi de fortes émotions. Je me suis souvenu d’une énorme armoire, de style baroque du Nord, qui appartenait à mon grand-père. C’était un meuble en bois massif, très lourd et décoratif, orné de motifs floraux. Elle est devenue non seulement une pièce qui m’a permis de renouer avec mon héritage, mais aussi le point de départ de mes recherches sur l’histoire et le potentiel de la décoration botanique. C’est à partir de là que j’ai commencé à fréquenter les marchés aux fleurs de Londres et que j’ai découvert les mécanismes de cette industrie qui mènent au gaspillage.
Dès lors, je me suis intéressé aux valeurs émotionnelles, symboliques et économiques de quelque chose d’aussi éphémère et périssable que les fleurs, et j’ai créé des objets qui tenteraient de saisir leur processus de décomposition, en évoquant le principe d’obsolescence intégrée, courant dans le design industriel produit en masse. Dans un autre ordre d’idées, j’ai également exploré le désir de préserver l’éphémère et de protéger ce à quoi nous accordons de la valeur – en créant des objets qui seront plus tard au centre des séries Flora, Protoplasting Nature ou Tephra.

Marcin Rusak, Perma 07, [détail], 2020. Photo: Mathijs Labadie.
L’équilibre entre la volonté de préserver l’éphémère et d’expérimenter inlassablement de nouvelles formes, de nouveaux processus et de nouveaux matériaux est quelque chose que je crois avoir hérité de la personnalité de mon grand-père. Cela n’aurait pas été possible sans mes origines.
Ilaria Trame
Vos œuvres sont empreintes d’une certaine mélancolie, puisque vous utilisez des fleurs séchées et mourantes, prolongeant ainsi leur durée de vie. Ce processus peut également nous en apprendre beaucoup sur les pratiques durables : avez-vous toujours pris cet aspect en compte lorsque vous avez commencé à développer vos techniques ?
Marcin Rusak
Dès le début, les natures mortes ont joué le rôle de memento mori mélancolique. Utiliser de vraies fleurs et les immortaliser à différents stades de floraison et de décomposition est en effet une démarche romantique aux connotations souvent symboliques. Mais ce qui m’intéresse également, c’est le fait que les fleurs, une fois jetées, acquièrent une nouvelle vie avec les matériaux que je crée : recouvertes de métal ou immergées dans la résine, elles acquièrent de nouvelles significations et de nouvelles fonctions. La durabilité est en effet au cœur du processus : d’abord, parce que nous utilisons des fleurs qui seraient invendables et finiraient dans les bacs à compost, et ensuite, parce que les processus expérimentaux, les matériaux et les objets que nous développons sont mis en œuvre à très petite échelle, toujours sur commande individuelle. C’est comme ça que je perçois le design durable : il s’attaque à la culture consumériste en limitant autant que possible la surproduction.
Je consacre également des efforts considérables à la recherche de méthodes de production durables.
Je souhaiterais préserver mes œuvres pour les générations futures, le propriétaire étant le gardien des objets de valeur,mais je veux aussi voir comment mettre fin à ce cycle en offrant la possibilité de les « retourner à la terre », en les recyclant et en les désintégrant lorsqu’ils ont rempli leur fonction ou se sont cassés. Ce type de réflexion semble naturel quand il s’agit de matériaux entièrement biosourcés tels que le bois ou les bioplastiques de pointe, mais pour moi, il s’agit plutôt d’un projet utopique, même si l’on entrevoit sa réalisation dans un avenir proche.
Ilaria Trame
Comment vos œuvres peuvent-elles informer le public sur l’industrie et les implications du marché floral mondial ? Beaucoup de gens ne connaissent pas les « moyens durables » d’acheter des fleurs.
Marcin Rusak
La plupart des gens ne savent pas que les fleurs sont cultivées et génétiquement modifiées pour répondre à certaines exigences spécifiques du marché. Par exemple, il faut tellement d’énergie à la plante pour produire son parfum que les producteurs ont décidé de renoncer à l’aspect olfactif, pour permettre une meilleure conservation en vase. On cultive par exemple des roses aux tiges longues et droites pour pouvoir en expédier davantage dans un même conteneur. Chaque plante possède également un passeport international qui indique son lieu d’origine. La plupart des fleurs « produites en masse » sont exportées depuis les Pays-Bas, plaque tournante internationale du commerce des fleurs, un empire créé il y a plusieurs siècles. Avec le temps, les fleurs que nous achetons se sont transformées en produits inodores, fabriqués à la chaîne.
Mon projet Monster Flower portait justement sur ce point : il s’agissait de représenter les différentes attentes des producteurs et des vendeurs concernant les fleurs en tant que marchandises. Selon moi le marché mondial des fleurs est un sujet fascinant.
Ilaria Trame
Passons à l’aspect pratique : dans vos œuvres, l’art rencontre souvent la science. Vous êtes même arrivé à développer de nouveaux matériaux pour vos créations. Pouvez-vous nous parler des différentes techniques que vous utilisez (et développez) dans votre atelier ?
Marcin Rusak
Expérimenter de nouvelles applications et créer des matériaux est au cœur de ma pratique. La plupart des matériaux avec lesquels je travaille évoluent et se transforment, comme ç’a été le cas pour les premières versions de la résine Flora. Au départ, je souhaitais que le matériau vieillisse et se transforme avec le temps – j’ai injecté des bactéries qui consommaient les fleurs immergées dedans. La version finale que j’utilise actuellement dans mes projets est cependant entièrement stable.
Comme je l’ai mentionné, les thèmes qui me préoccupent se situent à la croisée de la préservation et de la décomposition. Si la première est représentée par Flora, ainsi que par Protoplasting Nature et Tephra, qui résultent de mes expériences de métallisation de fleurs et de feuilles réelles, j’aborde la seconde dans la série Perishable, et plus loin, dans les recherches que j’appelle Nature of Things. Là, je travaille avec des matériaux biosolubles et solubles comme la gomme-laque, diverses résines naturelles et des liants tels que la farine ou le sucre, ou des bouts de métal que je récupère et que j’incorpore à des sculptures, des objets décoratifs et des installations entières, parfois présentées dans des incubateurs spécialement conçus pour accélérer et observer le processus de décomposition.
Ilaria Trame
Pouvez-vous nous en dire plus sur votre atelier ? Quelle importance accordez-vous au fait de travailler dans un environnement stimulant ?
Marcin Rusak
Mon atelier est situé dans un quartier industriel pas très loin du centre-ville. L’atelier principal est divisé en plusieurs ateliers où nous nous concentrons sur le modelage, le moulage de la résine et le travail du métal. C’est un endroit plutôt bruyant où l’on se salit les mains. Nous écoutons de la musique très fort et nous utilisons des machines bruyantes.
Il y a aussi un bureau à l’étage, où nous exerçons des activités qui demandent du calme et de la concentration : écrire, dessiner, mettre au point des enduits, etc. Au total, dix personnes travaillent dans l’atelier et le bureau, auxquelles s’ajoutent plusieurs proches collaborateurs et entrepreneurs qui travaillent à distance, en free-lance, sur des projets individuels. Il y a aussi deux chiens – très appréciés pour leurs capacités de communication inter-espèces.
Lorsque je travaille, j’écoute généralement de la musique, ce qui m’aide à me concentrer. Je n’aime pas être dérangé lorsque je dessine ou que je modélise. En revanche, j’apprécie les séances de remue-méninges avec mon équipe, qui me donnent l’occasion de remettre mes idées en question. Avec le développement de l’atelier, j’ai commencé à apprécier les aspects collaboratifs de ma pratique.
Ilaria Trame
Sur quels critères choisissez-vous les fleurs à incorporer dans une nouvelle pièce ? Est-ce pour leurs caractéristiques physiques ou les regroupez-vous d’une autre façon ?
Marcin Rusak
Dans la série Flora, je choisis les fleurs avec lesquelles je travaille pour leurs qualités esthétiques : formes sculpturales et couleurs nuancées. Lorsque je travaille sur une nouvelle pièce, je considère plutôt la surface comme une toile de peinture, en réalisant diverses compositions jusqu’à ce que je sois satisfait du résultat. C’est à ce stade que la composition est pétrifiée dans la résine.
Dans les séries Protoplasting Nature et Tephra, les fleurs et les feuilles deviennent le bois de construction de la pièce elle-même – les grandes feuilles de Thaumatococcus Daniellii des objets Protoplasting Nature sont traditionnellement utilisées en Afrique pour recouvrir les toits. Je m’intéresse depuis peu à cet aspect vernaculaire – pour un projet particulier, je pourrais utiliser des fleurs qui proviennent d’une zone ou d’une région spécifique, en réfléchissant au contexte local, au genius loci.
Ilaria Trame
Lorsque l’on parle de fleurs, on pense forcément à leur parfum, ou à leur odeur. Est-ce quelque chose que vous souhaitez développer pour vos pièces ? Vous arrive-t-il de concevoir votre travail de manière synesthésique ?
Marcin Rusak
Je suis heureux que vous le mentionniez. La création de parfums est, après tout, une autre façon de préserver la beauté éphémère des fleurs. Pour mon exposition personnelle à Milan l’année dernière, j’ai développé trois parfums uniques en collaboration avec Barnabé Fillion, un parfumeur talentueux qui a la chance d’être synesthète. Ils ont été présentés comme des interprétations olfactives de mes collections, avec les notes de Decay (qui rappelle la série Perishable), Protoplasting Nature et Flora.
Cet automne, nous lançons une nouvelle collaboration avec la marque de Barnabé : Arpa. L’idée repose sur le principe synesthésique de la fusion de l’architecture (ou de la perception de l’espace), de l’alchimie et de la fiction, inspirée par des personnages parisiens transgressifs moins connus, tant fictifs qu’historiques, et par notre lecture déconstructiviste de l’architecture historique française.
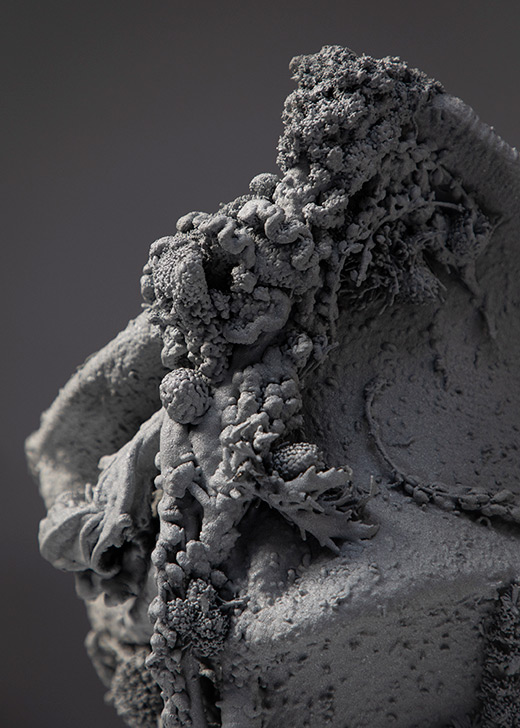
Marcin Rusak, Tephra Vase 001, [détail], 2021. Photo: Marcin Rusak Studio.

Marcin Rusak, Flora, 2014. Une des premières itérations du matériau Flora injecté de bactéries. Photo: Marcin Rusak Studio.
En conséquence, nous avons développé une série de sculptures de forme organique et odorantes, que nous traduisons dans de nouveaux matériaux, dans lesquels nous fusionnons des thermoplastiques biodégradables translucides imprimés en 3D avec la technique de métallisation largement utilisée par le studio dans des projets récents. Le projet sera lancé à Vienne, dans le légendaire magasin de bougies Retti créé par Hans Hollein en 1965-66.
Ilaria Trame
Pour conclure notre entretien, avez-vous un « projet impossible » que vous aimeriez pouvoir réaliser à l’avenir ?
Marcin Rusak
Nous avons travaillé à un schéma directeur pour le vieux manoir de Swidno, situé à une heure de route au sud de Varsovie, que je conçois comme une extension de l’atelier. C’est déjà un lieu où l’on observe et expérimente nos œuvres à long terme, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, sur le terrain, au sens propre. Je rêve de construire un nouveau pôle culturel dans le parc de style anglais qui entoure le bâtiment, un lieu où nous expérimentons nos processus, mais où nous invitons également le public à créer de nouvelles valeurs. J’étudie les possibilités de collaboration avec des fondations locales, axées sur l’art et l’éducation et, à l’avenir, j’aimerais en diriger une moi-même :organiser des ateliers pour les enfants, en présentant à la fois l’artisanat traditionnel et les nouvelles méthodes de production et de recherche ; inviter des designers et des artistes de renommée internationale à donner des conférences et à venir en résidence. Je tiens particulièrement à entretenir le lien souvent négligé entre les modes de pensée conceptuels et commerciaux – je pense que l’on ne s’est pas encore complètement penché sur le sujet en Pologne. J’ai eu la chance de faire l’expérience de différents modèles éducatifs et je rêve de rendre la pareille aux générations futures en accueillant les nouvelles opportunités, en favorisant de nouvelles collaborations et en encourageant de nouveaux talents.

Marcin Rusak, Flora Monolith 190, [détail], 2020. Photo: Marcin Rusak Studio.
entretien avec ilria trame
Faux-semblant
Brice Dellsperger
Se plonger dans l’œuvre de Brice Dellsperger, c’est revisiter un pan de l’histoire du cinéma à travers les films fétiches de l’artiste. S’il a consacré certaines de ses pièces à David Lynch, Gus Van Sant ou encore Paul Verhoeven, son réalisateur de prédilection reste Brian de Palma, cinéaste de l’outrance et de la citation dont la filmographie fait d’incessants allers-retours avec celle d’Alfred Hitchcock. En récréant des scènes qui ont marqué sa mémoire de spectateur, l’artiste français leur rend hommage tout en soulignant les thèmes qui les traversent, dessinant ainsi les contours de sa propre réflexion. Identification, genre, artifice, les sujets de réflexion sont nombreux sans pourtant être convoqués solennellement puisqu’ici, tout s’apprécie à travers le plaisir pop du cinéma.
C’est en 1995 que Brice Dellsperger signe la première vidéo de sa série Body Double. D’une durée de quarante-huit secondes, diffusée en boucle, il y rejoue le rôle de Kate Miller, interprété par Angie Dickinson dans Dressed to Kill (1980) de Brian de Palma. En se travestissant pour se glisser dans la peau de cette femme au foyer, le vidéaste place le je et le jeu au cœur de sa pratique. C’est à la fois sa mémoire de spectateur et ses interprétations qui seront traitées à travers ces re-créations tout aussi rigoureuses dans leur mise en œuvre que ludiques dans leur réception. En 2020, Brice Dellsperger présentait son 37ème Body Double (de nouveau consacré à l’inépuisable Dressed to Kill).Ce nombre conséquent permet d’affirmer une chose : si le principe du remake est la ligne directrice qui sous-tend son travail, Brice Dellsperger ne s’impose aucune règle qui viendrait étouffer sa créativité. Dans Body Double 31, célébrant le Basic Instinct (1992) de Verhoeven, le personnage de Catherine Tramell affirme : « I don’t make any rules, I go with the flow. » (Je ne fixe aucune règle, je prends les choses comme elles viennent.) Une prise de position que l’artiste semble s’approprier. Y aurait-il pourtant quelques éléments qui viendraient contrarier cette liberté ? Brice Dellsperger répond :

Brice Dellsperger, Body Double 5, 1996, 5’40. Acteur : Brice Dellsperger. Production : Brice Dellsperger. Avec l’aimable autorisation de l’artiste et des galeries Air de Paris (Paris) & Team Gallery (New York).
« Le travail se construit sur les relations avec les gens avec qui je collabore, et bizarrement, j’ai parfois plus de retenue envers eux que l’inverse. Mais la limite la plus importante reste matérielle. Dans mes films, je ne construis que ce que l’on voit dans l’image. »
Évoquer l’œuvre de Dellsperger amène à aborder la question de l’interprète. S’il a commencé à jouer lui-même dans ses vidéos pour des raisons pratiques, il a également fait appel à d’autres comédiens, professionnels ou non. On retrouve notamment l’artiste Jean-Luc Verna, connu pour sa pratique décomplexée du dessin : « Il fait partie de mon cercle d’amis. Et puisqu’il est en permanence en train de jouer des personnages,cela me semblait assez naturel de lui demander. Contrairement à moi qui n’avait aucune dextérité, Jean-Luc se maquillait tout le temps, ce qui facilitait les choses ! Nous étions dans une communauté d’esprits ce qui a rendu la collaboration très naturelle. En parallèle, j’ai réalisé quelques castings sauvages en demandant à des personnes rencontrées dans la rue ou dans des clubs s’ils voulaient jouer pour moi. C’est un exercice particulier car contrairement à un casting classique où les gens viennent car ils souhaitent tourner pour toi, il faut là aller vers eux, se présenter et les convaincre. Aujourd’hui, je choisis des personnes qui sont déjà professionnellement engagées, mais je continue parfois de me mettre en scène, car je pense qu’il est toujours bien de revenir aux sources. » Il est pertinent également de s’attarder sur le titre même de la série de Dellsperger. Body Double est un thriller érotique de Brian de Palma sorti en 1984 dont l’intrigue, se déroulant à Hollywood, repose sur l’utilisation d’une doublure, ces acteurs anonymes employés lors de cascades ou autres scènes de nu. Si le vidéaste devient la doublure des personnages qu’il incarne, alors les autres interprètes avec lesquels il collabore sont quant à eux les doublures de l’artiste. Certains Body Double (le 8, d’après Return of the Jedi (1983) de Richard Marquant, ou encore les 9, 10 et 12, de nouveau consacrés au cinéma de Brian de Palma) se présentent sous la forme de triptyque. Les vidéos sont diffusées simultanément et on y voit trois interprètes différents rejouer la même scène. C’est dans cette substitution que se révèlent les singularités de ces acteurs – leur physique, leur gestuelle,mais aussi le caractère commun des personnages qu’ils incarnent, à travers les histoires archétypales qu’offre le cinéma. À propos de cet effet d’écho, Brice Dellsperger commente :
« Je pense que mon travail parle effectivement de cette universalité. Elle est difficile à accepter car elle n’est finalement qu’une banalité. Mais il s’agit aussi de la question de l’identification au cinéma. De quelle manière l’inconscient travaille lorsque l’on s’identifie à un personnage ? Comment se met en place cette possibilité de se reconnaître sans pour autant connaître ? Cependant je ne cherche pas vraiment à livrer une interprétation psychologique de mon travail. J’y vois plutôt une formule mathématique que j’applique et qui produit des effets variables en fonction des individus. Moi-même je ne peux pas voir mes films comme les autres les découvrent. »
Le cinéma célèbre l’artifice, que ce soit par son utilisation du maquillage – le plus rudimentaire des effets spéciaux – ou le principe même de mise en scène. En se travestissant, l’artiste utilise donc l’un des principaux fondamentaux du 7e art. Si la philosophe américaine Judith Butler questionne l’identité à travers le genre depuis les années 1990, la démocratisation et la vulgarisation de sa réflexion, digérée par la culture pop, est plus récente. Lorsqu’on demande à Dellsperger si son travail est politique, il répond : « Mes œuvres n’ont pas cette forme de radicalité qui était caractéristique de l’art politique tel qu’on le concevait lorsque j’ai débuté ma carrière. Ma pratique veut passer pour quelque chose qu’elle n’est pas, elle veut se faire accepter. C’est l’idée d’un rapprochement, de la séduction. Mais puisque cela fait un moment que je développe cette approche, et que tout est politique aujourd’hui, alors je pense que l’on peut dire que mon travail l’est également. Ma manière d’être politique se situe peut-être ailleurs et dépasse la question du genre. Isoler au sein d’un film un élément plutôt qu’un autre me permet d’apporter un éclairage nouveau. »
À travers la série des Body Double, on ressent la passion cinéphile du plasticien. Nous vient forcément l’envie de lui demander quels sont les derniers longs-métrages qu’il a vu. « J’ai apprécié After Blue (2022) de Bertrand Mandico, c’est un objet totalement incroyable. J’ai compris que je l’avais aimé car j’ai envie de le revoir. Dans un autre registre, j’ai revu Buffet Froid (1979) et Tenue de soirée (1986) de Bertrand Blier qui sont extraordinaires. Je ne sais même pas si on pourrait refaire des films comme ça aujourd’hui. Je reste très attaché à la période 1970-80 mais je continue à explorer et à chercher des films qui pourraient faire de nouveaux Body Double. » Les pronostics sont donc ouverts quant à l’inspiration de la 38ème doublure…

Brice Dellsperger, Body Double 12, 1997, 2’18. Acteurs : Alexia, Joy Falquet & Jean-Luc Verna. Images : Brice Dellsperger. Montage & effets spéciaux : Béatrice Marianni. Production : FIACRE. Avec l’aimable autorisation de l’artiste et des galeries Air de Paris (Paris) & Team Gallery (New York).
entretien avec muriel stevenson
De terre et d’or
Daniel Kruger
La sculpture de Daniel Kruger se développe autour de deux pratiques qui peuvent sembler éloignées : la céramique, plus particulièrement l’art de la table, et la joaillerie. Toutes deux fonctionnelles, elles questionnent le rapport à l’ornement et au décoratif. Si les expérimentations menées depuis plus de quarante ans par l’artiste Sud-Africain, aujourd’hui installé à Munich, ont donné naissance à un corpus d’œuvres extrêmement variées, elles témoignent d’un goût prononcé pour l’humour et d’une sensibilité « camp ». En conversation avec Florian Champagne, Daniel Kruger discute de ses idéaux de beauté, et de son rapport aux corps – ceux évoqués, représentés, parfois même moulés dans la céramique, mais aussi les corps de ceux qui entrent en relation avec ses créations.
Florian Champagne
Sur vos céramiques comme sur vos bijoux, on retrouve le corps humain et certaines de ses parties. Considérez-vous que le corps vous sert de simple « motif », ou tient-il aussi un autre rôle ? Certaines formes que vous utilisez dans votre travail font-elles aussi consciemment référence au corps ?
Daniel Kruger
Je fais référence au pénis de manière indirecte, par exemple avec des pommes de pin et d’autres images dans lesquelles on peut voir une référence aux organes génitaux masculins – si on veut les voir de cette manière. Mais j’utilise aussi des moulages de pénis. Les formes phalliques se retrouvent aussi souvent dans mes bijoux, de manière implicite. Les bijoux sont manipulés et flexibles, ce qui leur confère une dimension supplémentaire de sensualité. Il y a aussi une différence entre avoir un objet phallique posé, détaché de soi, sur une table, ou le porter sur soi.
Les ossements font référence à un memento mori. Il s’agit de moulages d’os d’animaux provenant d’articulations prélevées sur de la viande déjà cuite et consommée. Il y a une série d’assiettes qui contiennent, ou présentent, des pierres, des brindilles et des os, comme des collections. Ces objets sont également attachés à des vases de la même forme que ceux présentant des images de garçons, de sportifs enlacés, de produits de la nature ou de la civilisation.
Florian Champagne
Les parties du corps que nous voyons sur votre céramique racontent-elles une histoire particulière ?
Daniel Kruger
Les moulages sont bien sûr réalisés sur des personnes, mais les céramiques ne racontent pas l’expérience vécue avec les modèles ou celle de la réalisation des moulages.

Daniel Kruger, Vase Sponges, 2005. Biscuit de porcelaine et dorure, 30 × 21 × 21 cm. Collection D.K. Photographie d’Udo W. Beier. Avec l’aimable autorisation de la galerie Caroline Van Hoek.
J’utilise les moulages de façon très littérale : quand c’est un pénis, c’est un pénis et quand c’est une pomme de pin, c’est une pomme de pin. Si vous voulez voir un pénis dans la pomme de pin, je le comprends parfaitement parce que je le fais aussi.
Ils racontent une histoire intemporelle, si ce n’est que de nos jours nous attachons moins d’importance à la fertilité et davantage au plaisir, à la séduction et aux prouesses. Exhiber ses organes génitaux est considéré comme un acte obscène : ça ne se fait pas. C’est donc aussi une provocation.
Florian Champagne
Il y a parfois quelque chose de presque répugnant dans votre façon de faire référence au corps – avec la série d’assiettes Manneken Pis, ou la table d’appoint d’où jaillissent des pénis bleus… Ces pièces contrastent beaucoup avec celles à l’imagerie plus classique. Voulez-vous montrer comment le corps peut être à la fois charmant et dégoûtant ou s’agit-il d’humour ?
Daniel Kruger
Un dicton veut que lorsque quelque chose a très bon goût, c’est comme si un ange vous pissait sur la langue. Le Manneken est un petit garçon dans lequel on pourrait voir un ange, mais aussi un vilain petit garçon qui pisse dans la soupe. Pour moi, ces assiettes relèvent de l’humour et de la provocation. Elles sont destinées à être utilisées, par les moins impressionnables d’entre nous.
Florian Champagne
En regardant des photos de votre atelier, on remarque quelques statues d’hommes, classiques de l’époque gréco-romaine. Les objets en céramique – l’un des deux principaux médiums avec lesquels vous travaillez – font partie des productions artistiques antiques les plus célèbres. Votre travail fait-il référence à ces normes de beauté antique, ou s’agit-il d’inspirations plus abstraites ?
Daniel Kruger
Pour un de mes services de table, j’ai peint un athlète au corps magnifique dans des poses qui rappellent des sculptures gréco-romaines disposées dans un paysage. C’est une référence à l’Arcadie, avec un personnage idéalisé se déplaçant dans une nature idéalisée. Les nuages dorés et le ruban bleu sous-tendent une idée de beauté et de sérénité.

Daniel Kruger, Desserte, 1992. Argile et vernis, 30 × 30 × 32 cm. Collection D.K. Photographie d’Udo W. Beier.
J’utilise également des représentations d’hommes à l’apparence très banale qui ne reflètent en aucun cas un idéal mais plutôt l’« homme ordinaire ». Il y a une série de vases avec des motifs de garçons, un maigrichon ou un gros, un joli garçon etc. qui expriment le charme et la fragilité de la jeunesse.
Florian Champagne
Les motifs figuratifs dans vos céramiques semblent apparaître dans les années 1990. Les avez-vous intégrés dans vos créations pour une raison particulière ?
Daniel Kruger
Quand j’ai commencé à travailler la céramique, j’ai expérimenté des formes décoratives. Je cherchais des formes qui me fourniraient des surfaces sur lesquelles dessiner et peindre. J’ai décidé de travailler sur de la porcelaine produite en Europe : la porcelaine de Dresde. Ce qui m’a attiré et inspiré dans cette première période, c’est la recherche d’une interaction avec des formes et des décors asiatiques, la manière dont ils ont été réinterprétés dans un style européen et le défi technique quand on explore un nouveau support aussi indocile que la porcelaine. C’est ce que je faisais aussi : créer des formes et des décors et, comme dans les exemples historiques que je regarde, utiliser des motifs figuratifs. Dans la phase ultérieure de mon travail avec la céramique, les motifs figuratifs sont des photos ou des moulages d’objets réels.
Florian Champagne
La dimension homoérotique des sculptures et des céramiques antiques est, la plupart du temps, invisible pour le spectateur contemporain ; alors que je dirais qu’on la retrouve souvent lorsque l’on regarde des céramiques plus contemporaines représentant des hommes – qu’il s’agisse de joueurs de football ou de jeunes hommes dénudés. Jouez-vous avec cette idée consciemment ?
Daniel Kruger
L’aspect homoérotique est très présent dans mes céramiques. C’est délibéré. Je suis cependant certain que les hommes et les femmes hétérosexuels peuvent également apprécier la sensualité des corps masculins et apprécier l’humour.
Florian Champagne
Quelle est votre relation avec la masculinité représentée dans vos céramiques ? Est-ce un idéal personnel, ou y voyez-vous l’idéal de la société dans laquelle vous vivez ? Ou bien cela ne se rapporte-il pas à un idéal, mais tente d’aborder un autre aspect ?
Daniel Kruger
Il y a le « féminin », il y a le « masculin » et j’étudie un aspect de cette question de mon point de vue d’homme gay. C’est un point de vue personnel, mais je pense que d’autres le partagent et qu’il reflète des attitudes présentes dans notre société actuelle.
Le contact physique entre hommes est naturel dans certaines sociétés et tabou dans d’autres. Les images de sportifs qui s’étreignent sont de simples instantanés qui s’inscrivent dans un contexte particulier et n’impliquent pas une relation érotique entre eux. C’est là où je veux en venir : représenter le contact physique désinhibé entre hommes en tant qu’expression d’une certaine intimité et de l’amitié, leur sexualité réelle étant secondaire et pas nécessairement figée.
Florian Champagne
Le transfert d’images sur de la céramique pose la question de la mémoire. ces images sont-elles en quelque sorte élevées au rang d’icônes de notre époque ou sont-elles simplement des moments fugaces de la vie de ces hommes, qui cherchent à être préservés et honorés ?
Daniel Kruger
Les figures masculines sont utilisées comme des icônes, certaines héroïques, d’autres non.

Daniel Kruger, Vase Jet Fighters, 2000. Porcelaine, vernis et dorure, 30 × 19 × 19 cm. Collection D.K. Photographie d’Udo W. Beier. Avec l’aimable autorisation de la galerie Caroline Van Hoek.
Les sportifs sont des icônes, les héros de notre temps. Ils sont agiles et rapides, rusés et ingénieux, admirés et enviés pour leur corps, mais aussi pour leur intelligence. On reconnaît certains de ces sportifs, mais ce n’est pas de cela qu’il s’agit. Il s’agit d’une idéalisation de l’époque, mais aussi d’une évocation et d’une réinterprétation du passé.
Puis il y a les photos d’hommes anonymes au physique ordinaire. Elles racontent elles aussi des histoires, ou bien on peut y trouver des échos de sa propre histoire.
Florian Champagne
Bien que peu de vos bijoux soient anthropomorphes, il existe une relation évidente entre un bijou et le corps de celui qui le porte. Cet aspect vous intéresse-t-il et le prenez-vous en compte dans vos créations ?
Daniel Kruger
Je créé principalement des bijoux, mais la céramique me donne l’occasion de travailler à plus grande échelle, d’exprimer des idées différentes, de dessiner et de peindre. Comme pour les bijoux, il est important que les pièces soient utilisées, dans le sens où elles font partie de notre vie et de notre environnement, des choses avec lesquelles on vit et interagit régulièrement : les bijoux portés sur soi, les assiettes dans lesquelles on mange et les vases dans lesquels on peut mettre des fleurs.
Florian Champagne
Même question pour les pièces en céramique : les avez-vous toujours considérées avant tout comme des objets destinés à être utilisés et touchés, ou y a-t-il dès le départ autre chose en jeu lorsque vous les créez ?
Daniel Kruger
Je m’inspire d’idées du passé que l’on observe sur des objets et des images et je les repense en les adaptant au présent.
Je souhaite exprimer la vénération, l’ironie, l’humour, l’enthousiasme, l’amusement, l’envie, le désir. C’est ce qui est sérieux dans tout cela.
Florian Champagne
Votre travail balaie un large spectre de la création. Y a-t-il des artistes dont vous vous sentez proche, qui seraient de la même « famille artistique » que vous ?
Daniel Kruger
Je ne me sens proche d’aucun artiste en particulier, contemporain ou ancien. Mais j’ai beaucoup de petites sources d’inspiration, des œuvres que j’admire et qui m’inspirent. Il m’arrive aussi de voir une œuvre d’art et de l’ « utiliser » à des fins personnelles. Mais ensuite, en réfléchissant à l’objet que je veux créer, puis en le créant, elle change du tout au tout. C’est notamment le cas des pièces qui font référence aux premières porcelaines de Meissen. Je visite le passé et je les repense dans le présent, telles que je les comprends – je me les approprie.
Florian Champagne
Vos céramiques peuvent avoir un côté humoristique, voire irrévérencieux. Avez-vous des anecdotes à ce sujet, des réactions qui vous ont surpris ou amusé ?
Daniel Kruger
Je trouve le côté humoristique très important. Je ne parlerais cependant pas d’irrévérence, à moins qu’il s’agisse d’irrévérence ludique. On peut se moquer de quelqu’un ou de quelque chose tout en lui portant de l’admiration et de l’estime. Je ne méprise ni ne ridiculise rien. Si l’on rit, c’est que l’on prend du plaisir et que l’on s’amuse.
Les goûts et les couleurs
Carolien Niebling
En utilisant la nourriture et la nature pour proposer des perspectives alternatives dans le domaine du design, Carolien Niebling élargit notre approche des pratiques alimentaires en faisant de la saucisse une métaphore de la nécessité de repenser notre attitude vis-à-vis de l’alimentation quotidienne. La saucisse est abordée comme un véritable objet de design, à réimaginer et à conceptualiser. La particularité du travail de Carolien Niebling réside dans l’échange constant entre les domaines de l’alimentation et de la recherche scientifique, équilibrant élégamment innovation et imagerie délicate pour incarner son concept. Grâce à l’utilisation astucieuse de la photographie et des images en mouvement, la nourriture peut être décontextualisée et se présenter comme un produit évocateur dans son essence pure. En étudiant ses apparences et ses formes diverses, Carolien Niebling évoque des perspectives visionnaires pour l’avenir de l’alimentation et du design de produits.
Ilaria Trame
Sur votre site web vous vous définissez comme une « Food Futurist ». Pouvez-vous nous expliquer ce que vous entendez par là ?
Carolien Niebling
« Food Futurist » est simplement une formule pour manifester mon intention de travailler sur l’alimentation sans perdre de vue l’avenir. J’ai une formation en design de produits et, à ce titre, je réfléchis aussi en tant que designeuse de produits. C’est une sorte de jeu de mots sur le lien entre les deux identités.
Ilaria Trame
Votre ouvrage The Sausage of the Future [la saucisse du futur] est votre œuvre la plus connue. La saucisse y est considérée comme une métaphore de la multitude de possibilités qui s’offrent à nous en matière de nutrition si nous voulons réduire notre consommation de viande. J’aimerais connaître votre méthodologie de travail lors de l’étape de réflexion et lorsque vous envisagez les différents ingrédients qui pourraient se présenter et nourrir votre concept. Avez-vous voyagé, vous êtes-vous inspirée de différents lieux et cultures, avez-vous expérimenté différentes alternatives alimentaires ?
Carolien Niebling
Pour être tout à fait honnête, lorsque j’ai commencé le projet, je n’étais pas une mangeuse incroyablement « téméraire ». J’aimais simplement essayer de nouveaux plats par curiosité. Avec ce projet j’ai vraiment réussi à réunir ma passion pour le design et mon intérêt pour la nourriture.
J’ai commencé à faire des recherches sur la saucisse parce que j’ai toujours pensé qu’elle était, en un sens, un aliment incompris. Les gens disent souvent : « Je n’en mange pas parce que je ne sais pas ce qu’il y a dedans. » Mais cette crainte est injuste car les bouchers ne cherchent pas à cacher les ingrédients qu’ils utilisent. Il s’agit simplement d’utiliser les restes de viande et d’en faire quelque chose de bon. Si vous avez peur de la saucisse, vous devriez avoir peur de son producteur et de tous les autres aliments qu’il confectionne. En menant des recherches, j’ai acquis un grand respect pour cet aliment.

Carolien Niebling, The Sausage of the Future, 2017. Projet soutenu par l’ECAL et publié par Lars Müller Publishers. Collage d’Emile Barret.
La saucisse a en fait été créée il y a 5 000 ans grâce à une maîtrise efficace de la boucherie, à une époque où il ne fallait gaspiller aucun aliment. On mettait dans une peau les restes de la production de viande et on les assaisonnait de sel pour qu’ils se conservent mieux. Par conséquent, elle a réussi à changer un mode de vie, car à l’époque, elle permettait d’emballer les sources de nourriture, de voyager plus loin et de rester à l’étranger beaucoup plus longtemps, pour l’exploration.
Au départ, j’ai commencé par m’intéresser à différentes saucisses venues du monde entier. Chaque région du monde a la sienne ; cela me fascine et m’inspire. En même temps, je me suis promis d’essayer tous les types de saucisses que je trouverais au cours de mes voyages ; le résultat a été très surprenant. La forme est la même, mais l’expérience est à chaque fois complètement différente. En ce sens, elle s’apparente pour moi à un élément de design ; elle est fabriquée comme une chaise ou une lampe. Il faut qu’elle ait un look, qu’elle soit constituée d’éléments qui répondent à une certaine logique et qu’elle ait une durée de vie, tout comme un produit.
Ilaria Trame
Comment le public a-t-il réagi à votre projet ? A-t-il compris les différentes possibilités que peut offrir la saucisse ?
Carolien Niebling
Les réactions ont été très différentes selon les publics. À New York, par exemple, l’accueil a été incroyablement impressionnant, pour ne pas dire hostile. D’un côté, il y avait des gens qui venaient directement me parler pour remettre en question ma théorie, comme si je leur proposais une réponse unique à un problème. D’autres, en revanche, étaient beaucoup plus enthousiastes à l’idée de voir le projet évoluer. En Europe, c’était assez différent. En Allemagne et aux Pays-Bas, au départ, le public était un peu méfiant, il ne comprenait pas l’intérêt de ma recherche. En revanche, en Italie, en Suisse, en France, en Espagne et au Royaume-Uni, il s’est montré très enthousiaste. En Nouvelle-Zélande, il a vu en moi une visionnaire. Je ne sais pas pourquoi mon travail a suscité des réactions aussi diverses. Pour moi, c’est presque naturel, puisque de toute façon il existe des saucisses différentes de par le monde. J’ajoute simplement davantage de légumes et je propose des modifications de la recette.
Ilaria Trame
Je suis également curieuse de savoir, compte tenu de votre formation de designer de produits, comment votre langage visuel a évolué du design de produits à l’alimentation.
Carolien Niebling
J’ai réalisé à quel point il est important de présenter une alternative aux aliments existants. Lorsque vous concevez un produit, vous effectuez d’abord quelques tests, puis vous présentez les différentes étapes de réalisation. En revanche, lorsque vous concevez des aliments, vos tests se perdent. Une fois qu’ils ont disparu, il vous reste seulement des images ou des recettes. C’est pourquoi dans l’ouvrage sur les saucisses j’ai tenté de prendre la partie visuelle très au sérieux. J’ai apporté une grande attention à ce sur quoi je voulais que le public se concentre, dans la photographie comme dans le dessin.
Mais à l’origine, c’est par la saucisse que s’est opéré le passage du design de produit à l’alimentation. Dès le début de mes études à l’ECAL, mes projets ont tous été liés à l’alimentation, malgré moi. C’est seulement lorsque j’ai conçu mon portfolio que je me suis aperçue que tous mes projets étaient d’une manière ou d’une autre liés à la nourriture. J’ai mis au point des ustensiles pour manger des insectes, une machine à fumer les aliments et une boîte à lunch. C’est seulement quand j’ai obtenu mon diplôme que j’ai réalisé que je voulais créer des objets plus explicites. C’est à ce moment-là que j’ai envisagé d’inclure la nourriture dans le processus de création. Et mon approche a également changé. J’envisageais de concevoir des systèmes et des nouvelles façons de penser plutôt que des objets.

Carolien Niebling, The Sausage of the Future, 2017. Projet soutenu par l’ECAL et publié par Lars Müller Publishers.
Pour cela, j’ai travaillé avec un boucher et un chef spécialisé en cuisine moléculaire. Le premier m’a aidée dans le processus de fabrication des saucisses, qui a pris la forme d’un échange constant d’idées et d’expériences multiples. Le second m’a plutôt aidée à comprendre les processus chimiques à l’œuvre dans la transformation de la viande et m’a montré par quoi la remplacer en l’absence de protéines animales.
Ilaria Trame
Aviez-vous des connaissances en biologie avant de vous pencher sur votre sujet ou les avez-vous développées au fil de votre travail ?
Carolien Niebling
Aussi stupide que cela puisse paraître, j’ai toujours voulu étudier les sciences au lycée, mais je pense que j’aurais été trop jeune pour cela à l’époque. Je ne les comprenais pas encore. Mais maintenant, j’adore ça. Apprendre ce qu’est une protéine, par exemple, la raison pour laquelle nous en avons besoin et en quelle quantité, et pourquoi il existe des protéines qui permettent de remplacer la viande (et d’autres qui ne le permettent pas). Je voulais étudier le sujet et être capable de l’expliquer en une seule page, car les explications scientifiques sont souvent très longues et le lecteur se déconcentre facilement. Il est important de rendre le sujet accessible à un large public, c’est le plus pertinent selon moi.
Ilaria Trame
Ce qui est fascinant dans votre travail, c’est qu’il ne propose pas seulement un produit, mais aussi une vision alternative et un mode de pensée innovant. Avec The Sausage of the Future, vous faites la lumière sur une solution à la surproduction de viande. Mais ce faisant, vous présentez aussi votre projet sous une forme incroyablement esthétique, en accord avec l’expression créative d’un designer.
Carolien Niebling
J’aime les livres, même si cela peut sembler démodé de nos jours. En créant le mien, je me suis rendu compte de ce qui me plaît tant chez eux : le fait que, dans leurs pages, un concept est saisi dans un cadre temporel spécifique. Lorsque vous lisez des articles en ligne sur le sujet auquel je m’intéresse – par exemple l’avenir de l’industrie alimentaire – vous ne pouvez jamais savoir à quel moment ils ont été écrits, les choses ont pu évoluer depuis. En revanche, dans les livres, un concept est formulé à un moment précis, et les photos sont éternelles. Ce sont des images que vous pouvez saisir. Et en faisant cela, vous créez un autre objet de design.
Ilaria Trame
Beaucoup de vos œuvres s’intitulent « The Beauty of… » – par exemple le film The Beauty of Edible Things et les vases que vous avez conçus pour The Beauty of Water Plants – comme si votre travail de designer ne consistait pas à produire des objets nouveaux, mais essentiellement à mettre en valeur et à accentuer la beauté naturelle de vos sujets. Quel rôle la nature a-t-elle joué dans votre processus de création ?
Carolien Niebling
Elle a été déterminante. Avec The Beauty of Water Plants, j’avais pour objectif d’exposer un problème réel en conservant une note positive.

Carolien Niebling, The Sausage of the Future, 2017. Projet soutenu par l’ECAL et publié par Lars Müller Publishers. Collage d’Emile Barret.
Par exemple, la culture des plantes et des fleurs est aussi peu naturelle que certaines productions alimentaires. Nous ne nous rendons pas compte que les fleurs que nous achetons viennent de loin alors qu’elles pourraient être cultivées localement. Ou que les fleurs ne fleurissent que pendant de courtes périodes et ne devraient pas être disponibles toute l’année. C’est devenu un commerce, tout tourne autour de l’industrie, puisque de nos jours on assiste à une surproduction et à une surconsommation des produits de la nature.
Pour le projet The Beauty of Edible Seaweeds, j’ai réfléchi à l’importance des algues dans l’avenir de l’industrie alimentaire et je me suis demandé pourquoi on ne généralisait pas leur utilisation. Pour moi, les algues sont des plantes incroyables qui poussent de manière improbable sans substrat et flottent généralement dans l’eau, tout en étant robustes et résistantes pour pouvoir supporter les courants forts et les marées. Pour moi, c’est ce qui les rend vraiment fascinantes. Mais comment se fait-il que cette beauté ne se traduise pas dans l’assiette ? J’ai eu l’idée de sonder la beauté de ces plantes comestibles en me concentrant sur des algues disponibles en supermarché. Je les ai réhydratées, puis je les ai projetées sur une assiette de manière à ce qu’elles ressemblent exactement à ce qu’on pourrait manger. Le concept sous-jacent consistait vraiment à prendre un moment pour observer les aliments qu’on pourrait manger et s’émerveiller de leur beauté.
Ilaria Trame
Comment pensez-vous que votre vision du design, bien plus axée sur le lien qui existe entre la nature et la beauté, pourrait s’appliquer aux secteurs de la mode et des cosmétiques ?
Carolien Niebling
C’est une question à laquelle il est difficile de répondre. Lorsqu’on s’inspire directement de la nature, par exemple de la façon dont les végétaux ont poussé, et qu’on crée des structures à partir de là, que ce soit dans le domaine du design, de l’architecture ou de la mode, j’ai l’impression que c’est un peu forcé. On peut assurément s’en inspirer, mais je préfère la prendre simplement telle qu’elle est. Les plus belles choses sont aussi simples que cela. Je préfère prendre de bonnes photos et zoomer, sortir la nourriture du contexte de la cuisine ou du supermarché et la placer dans un univers où l’on peut apprécier la beauté essentielle du sujet, sans essayer de le reproduire. En la décontextualisant, nous pouvons la contempler.
Ed cetera
Ed Atkins
Présentées sous forme d’installation déployée dans l’espace, les vidéos d’Ed Atkins sont immédiatement identifiables. On y retrouve le plus souvent un avatar dont l’aspect joue avec les limites de l’hyper-réalisme des images générées par ordinateur. Les errances de ses personnages sont l’occasion pour l’auteur de questionner le sens de la vie, et plus particulièrement de l’inévitable déclin. Ses monologues révèlent un sens du rythme singulier, à la fois à travers l’écriture textuelle – Ed Atkins a publié deux recueils de textes, A Primer for Cadavers (2016) et Old Food (2018) – et cinématographique. Cadrages et montages montrent une maîtrise du langage du cinéma et de ses effets. L’artiste britannique, né en 1982, développe donc depuis plusieurs années une œuvre complexe et fascinante, alternant entre ombre et lumière. En discussion avec le critique Piero Bisello, il revient sur les interprétations de son travail et ses productions les plus récentes.
Piero Bisello
Une de vos œuvres de 2017 (en collaboration avec Contemporary Art Writing Daily), du bois découpé au laser, indique : « Le terme de nourriture périmée [Old food] est bien sûr impropre. Il n’y a pas de périmé dans le numérique. Pas de négligence de réfrigération. On décide de lui donner cette apparence. » Old food est aussi le titre d’un de vos poèmes en prose, « un rien épique » selon vos mots. On peut y lire : « … un tas de mouches l’ont dégradé avec leurs vomissures répétées et il s’est presque liquéfié sur son support. Même s’il était devenu marron et avait fait des flaques de latex dans les poubelles, nous l’aurions sans doute quand même mangé… » Ces deux passages me rappellent que quand on y réfléchit bien la nourriture est dégoûtante, peu importe à quel point on la rend attrayante. Même le pain n’est qu’une chose morte transformée, sans parler des saucisses et du caviar. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre intérêt récurrent pour la nourriture périmée ? Y a-t-il une volonté de repousser le lecteur/spectateur avec un produit censé être désirable ?
Ed Atkins
Une grande partie de mon travail est liée aux limites de la représentation du médium ; une grande partie de mon travail traite plus ou moins de lui-même – même et surtout si ce qu’il pourrait hypothétiquement comprendre de lui-même est en conflit assez évident avec sa vraie nature. Il s’agit souvent d’un type particulier d’anthropomorphisme délirant, qui suppose, d’une manière ou d’une autre – et cela demande d’opérer un raccourci – que l’œuvre d’art est une personne qui s’inquiète de son identité. Ou s’inquiète de savoir si elle est convaincante en tant que personne. Pour les autres et pour elle-même. Ce qui constitue un autre type de spécificité du médium, je suppose. Tout ceci n’est qu’une expérience imaginative, mais elle engendre un type particulier de relation avec le média, qui détermine la capacité à approcher un niveau élevé de fidélité dans sa représentation, quel qu’il soit. La nourriture a sûrement quelque chose de grotesque, mais en réalité, il s’agit là des processus de la vie et du numérique, de la vie et de la mort ou de la non-mort, de la rémanence et de la mortalité ; de l’aspect immortel du numérique, par opposition à sa réalité physique et à ses conséquences, ainsi qu’à l’existence mortelle et sensationnelle des individus. La nourriture est fondamentale. Il n’est pas vraiment question de désir et de répulsion, mais dans la mesure où je ne m’intéresse ni à l’apparence lisse des images ni à la cohérence lisse des phrases et de la grammaire – ou à la perte facile de toute sorte de certitude – les approches du grotesque, de l’immonde et de l’abject en tout genre font partie intégrante de mon travail.
Piero Bisello
Dans une interview de 2014, une table ronde sur l’art et le cinéma organisée par le magazine Mousse, vous avez déclaré que vous adhérez à « l’idée d’un anti-illusionnisme structurel/matérialiste, jusqu’à ce que nous ne puissions plus distinguer l’illusion de la réalité. » Pendant de nombreuses années, j’ai vu dans cette déclaration un résumé de votre philosophie de l’art, notamment celle appliquée dans vos vidéos et vos textes. Cependant, vos dessins les plus récents, que je reçois chaque jour par e-mail, semblent moins rigoureux quant à cette velléité anti-illusionniste. Pour moi, il s’agit davantage de dessins en tant que tels plutôt que de dessins sur le dessin. Pour moi, ils invoquent plus directement les émotions. Par leur biais, avez-vous tempéré votre « appel à révéler le médium », comme l’écrit Hal Foster dans son récent essai sur votre travail ?
Ed Atkins
Tout d’abord, je clarifierais cette première citation et je soulignerais le fait que mon intérêt pour le cinéma structurel/matérialiste s’oppose assez clairement à celui que je vois dans le fait de ne plus pouvoir distinguer l’illusion de la réalité. J’entends par là que le cinéma anti-illusionniste part du postulat que l’illusion est politique et éthique. Ainsi, bannir l’illusion reviendrait à bannir la possibilité de voir la vérité au-delà de l’illusion. Je pense que ce que je voulais dire, c’est que les aspirations de la technologie, et de ceux qui propagent son avenir, semblent tendre vers un point de convergence entre l’illusion et la réalité. Ce qui est intéressant en soi. Cependant, ce qui m’intéresse en premier lieu, c’est d’exposer le médium. Ce qui implique souvent d’utiliser délibérément des médias contemporains qui manifestent ouvertement leur volonté d’aboutir à une sorte de transcendance technologique, et de leur demander d’accomplir des prouesses qu’ils ne peuvent évidemment réaliser qu’imparfaitement, divulguant ainsi leur essence – ou du moins leurs aspirations. Les dessins sont une toute autre chose. Je trouve important de souligner que mes théories sur les médias et autres ne sont qu’un pan de ce que j’essaie de créer.
Piero Bisello
Vous participez à la gestion du site Web Contemporary Art Writing Daily, qui vient de publier un ouvrage intitulé Anti-Ligature Rooms. C’est une plongée dans la critique. Par exemple, le chapitre consacré au surréalisme débute par un commentaire sur une installation de Chris Burden, et se poursuit par des commentaires sur le surréalisme, le capitalisme, la société, la peinture, l’image, etc. Pouvez-vous préciser les conditions de votre participation au site Web et au livre ? J’ai entendu dire que vous écriviez plus que vous ne lisiez. Comment avez-vous abordé l’écriture d’Anti-Ligature Rooms par rapport à d’autres projets d’écriture ?
Ed Atkins
En fait, je n’ai rien à voir avec les créateurs de CAWD. J’ai travaillé avec eux à plusieurs reprises et j’ai également publié leur livre, Anti-Ligature Rooms. Mais je ne sais pas qui ils sont, et je ne suis l’auteur de rien de ce qu’ils publient. Je partage des informations et des idées avec eux, à peu près en toute impunité, et ils écrivent ce qu’ils veulent, plus ou moins. Je vous recommande cependant de les contacter. Ils sont bien meilleurs correspondants que moi.
Piero Bisello
Deux de vos projets récents ont pour sujet la famille. Dans la vidéo The Worm une femme converse avec son fils, ou disons plutôt qu’il l’écoute. Elle y parle de son passé, de sa mère en particulier. Le second projet est un ouvrage réunissant vos dessins pour enfants, dédié à votre fille – vous y mentionnez que vous avez réalisé des dessins chaque matin et les avez cachés dans sa lunch box. Comment avez-vous commencé à intégrer le thème de la famille dans votre travail ? N’est-il pas parfois gênant d’inclure des sujets personnels dans une œuvre destinée à un large public ? La fiction permet-elle de surmonter cette gêne, le cas échéant ? Dans The Worm, le fils déclare à un moment donné que « la réalité ou le réalisme est triste ».
Ed Atkins
Dans ce passage – à moitié retenu –, ce dont parle le fils c’est de la tendance de sa mère à affirmer que la réalité est triste. Que la vie est triste, que l’expérience est par essence déjà appauvrie. Et qu’il a hérité de cette tendance, mais qu’il se rebelle contre elle. L’œuvre aborde les questions d’hérédité, les traumatismes, la façon dont on se perçoit ou dont on imagine que les autres nous perçoivent, et des dégâts que cela peut causer. J’ai toujours inclus ma famille dans mon travail. De manière moins ostensible, mais elle est présente depuis le début. Tout comme l’effet de la présomption familiale, la répulsion de l’intimité, la distance, la perte, le détachement, tout cela. Il n’y a donc là rien de nouveau. Le livre de dessins rend compte d’un processus entamé sans aucune aspiration artistique, si ce n’est le processus en lui-même, et de l’existence d’un public aimant. J’ai la quasi-certitude que je ne ferai jamais mieux que les dessins. Il y a une idée d’excès, sans doute. Une intimité détournée ? Une impression de se conformer à une définition indisponible ? Une sorte de machine qui se construit chaque jour ? Imaginez-en des dizaines de milliers ; il y en a déjà quelques milliers.
Piero Bisello
Pour des raisons familiales, je n’ai pas pu assister à votre performance, Mutes, à Knokke, il y a quelques mois, mais j’ai appris que vous aviez tenté de proposer une lecture pertinente du poème The Morning Roundup de Gilbert Sorrentino. Je suppose que votre but n’était pas de parvenir à le lire correctement. Qu’est-ce qui vous a attiré vers ce poème?
Ed Atkins
Le fait est qu’il n’y a aucun moyen de l’appréhender correctement : le poème en lui-même traduit son incapacité à évoquer quoi que ce soit de vaguement réparateur qui pourrait exprimer « correctement » les sujets qu’il aborde. Quelque chose dans le langage, le ton exclamatif et la mention de la parole et des radios, m’a évoqué un mantra pour la fragilité qui s’extériorise après le deuil. J’ai utilisé le poème comme refrain d’une vidéo que j’ai réalisée il y a longtemps, Warm, Warm, Warm Spring Mouths.
Piero Bisello
Vous avez récemment écrit et mis en scène une pièce de théâtre (en collaboration avec Steven Zultanski). Elle s’intitule Sorcerer, et traite de l’amitié. Le rapport entre l’amitié et la sorcellerie me laisse perplexe. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur la pièce et cette étrange juxtaposition qui apparaît dans son sujet et son titre ? Dans votre ouvrage A Seer Reader, « un recueil de prophéties écrites au futur » comme vous l’avez défini dans une interview pour Frieze, vous mettez également en scène un personnage magique et surnaturel. Dans quelle mesure le Seer Reader est-il un précurseur du Sorcerer ?
Ed Atkins
Il ne l’est pas encore. Le Sorcerer, je veux dire. Il n’y a pas de mystère à résoudre dans le titre en tant que descripteur. Je ne pense pas avoir jamais créé une œuvre qui soit une énigme à résoudre. Il n’y a pas de sujet, non plus. Il y a de la magie, mais aussi du réalisme, de l’onanisme spécifique au médium et bien d’autres choses encore. En ce qui concerne A Seer Reader, il exprime une sorte de fascination de longue date pour l’aspect magique du langage. Ou pour la magie en tant que langage. Crowley a dit : « La magie est une maladie du langage. » Mais peu importe.

Ed Atkins, Refuse.exe, (still), 2019-2020.
Simulation 3D en temps réel sur 2 écrans avec son — boucle de 15 minutes.
Avec l’aimable autorisation de l’artiste, de Galerie Isabella Bortolozzi (Berlin),de Cabinet Gallery (Londres), de dépendance (Bruxelles) et de Gladstone Gallery (New York).

Ed Atkins, Refuse.exe, (still), 2019-2020.
Simulation 3D en temps réel sur 2 écrans avec son — boucle de 15 minutes.
Avec l’aimable autorisation de l’artiste, de Galerie Isabella Bortolozzi (Berlin),de Cabinet Gallery (Londres), de dépendance (Bruxelles) et de Gladstone Gallery (New York).

Ed Atkins, Untitled, (still), 2018.
Vidéo avec son, boucle de 5 minutes et 30 secondes.
Avec l’aimable autorisation de l’artiste, de Galerie Isabella Bortolozzi (Berlin),de Cabinet Gallery (Londres), de dépendance (Bruxelles) et de Gladstone Gallery (New York).

Ed Atkins, Good smoke, (still), 2017.
Vidéo avec son surround, boucle de 16 minutes et 40 secondes.
Avec l’aimable autorisation de l’artiste, de Galerie Isabella Bortolozzi (Berlin),de Cabinet Gallery (Londres), de dépendance (Bruxelles) et de Gladstone Gallery (New York).

Ed Atkins, The worm, (still), 2021.
Vidéo avec son, boucle de 12 minutes et 40 secondes.
Avec l’aimable autorisation de l’artiste, de Galerie Isabella Bortolozzi (Berlin),de Cabinet Gallery (Londres), de dépendance (Bruxelles) et de Gladstone Gallery (New York).
Je voulais écrire quelque chose qui pointe directement vers le futur. Donc tout a été rédigé au futur simple. Tout y est une promesse inébranlable. Sorcerer aurait pu s’intituler autrement. Mais ce n’est pas le cas. Il s’intitule Sorcerer, et si vous avez besoin d’une baguette magique, c’est d’une baguette fantastique à tenir en regardant la pièce.
Rose poussière
Karla Black
Décrire les sculptures de Karla Black est un exercice proche de la poésie, tant leurs qualités s’épanouissent dans les contrastes. Délicates et pourtant brutes, matérielles et néanmoins évanescentes, puisant dans l’intime autant que dans l’abstrait, elles se lisent comme de sublimes énigmes. Couleurs pures, formes froissées et transparences composent le vocabulaire esthétique de l’artiste écossaise, nominée en 2011 au Turner Prize et à l’honneur de son pavillon national lors de la Biennale de Venise cette même année. Son universchromatique se décline dans de douces gammes pastel. Pour ce faire, elle utilise divers éléments : matériaux de construction – comme l’enduit ou le plâtre – ou produits de beauté – talc et autres fards à paupières –, sans pour autant les hiérarchiser ou les conceptualiser. Début 2022, lors de sa quatrième exposition personnelle à la galerie londonienne Modern Art, Karla Black a présenté un ensemble de nouvelles pièces. Sculptures de papiers imbibées d’encres, elles signent un retour vers une forme d’absolu, témoignage de ses deux dernières décennies de pratique, mais aussi conséquence de la pandémie. En discussion avec Justin Morin, l’artiste évoque ici les coulisses de son travail, sa relation avec le monde de la cosmétologie et les limites du marché de l’art.
Justin Morin
Ma première question porte sur l’aspect matériel de votre travail. Vos pièces dépendent du monde physique, du poids ou de la légèreté des matériaux que vous utilisez et de la lumière qui va révéler toutes les nuances de leurs couleurs. Je n’ai jamais assisté à la réalisation de vos pièces, mais je suppose qu’elle est liée à votre corps, comme pour une chorégraphie. J’imagine que vous devez vous rapprocher du sol ou tourner autour des pièces suspendues. Je me demandais si cet aspect de performance, bien que non documenté, vous intéresse.
Karla Black
C’est une bonne question, car mon travail est aux antipodes de la performance. Ce qui m’intéresse, c’est la forme finie que je donne à regarder. J’ai le sentiment que si je savais que quelqu’un m’observe ou me photographie pendant que je réalise une pièce, je serais paralysée et incapable de travailler, ou du moins de bien travailler. En fait, cela s’est déjà produit et j’ai eu l’impression d’être complètement paralysée. J’aime tout simplement travailler, bouger, créer et utiliser les matériaux, je n’aime pas réfléchir pendant que je réalise une pièce car ça gâche le moment de la création.
Justin Morin
Votre gamme de couleurs s’inspire des cosmétiques au sens large, du maquillage aux articles pour bébés… Mais beaucoup de couleurs sont absentes de vos sculptures. Par exemple, le bleu Klein, un ton très séduisant, mais référencé… Au cours des dix dernières années, l’industrie du maquillage a créé de nombreux produits aux couleurs vives et pop. Êtes-vous attirée par ces teintes et leurs vibrations ? Ou ne sont-elles pas appropriées à votre travail ?
Karla Black
J’utilise la couleur comme j’utilise la forme. D’une certaine manière, je la considère comme un matériau. C’est vraiment la teinte qui m’importe.

Karla Black, Apart From Itself, 2022. Papier à dessin, encre d’aquarelle, 47 × 56 × 29 cm. Avec l’aimable autorisation de Modern Art, London & Capitain Petzel, Berlin. Photo : Tom Carter.
Tout comme les sculptures ne sont presque que des objets ou seulement des objets, la couleur n’est que de la couleur. Je n’utilise jamais de couleurs primaires parce que j’essaie avant tout de ne me rapprocher de rien d’existant, ou de tendre vers le blanc.
Justin Morin
J’ai découvert avec plaisir votre installation à Dhondt-Dhaenens en 2017. Pourriez-vous partager avec nous votre processus de création pour ce type d’exposition destinée à un site spécifique ? Travaillez-vous à partir d’une maquette de la galerie ? Ou employez-vous un vocabulaire préexistant une fois sur place ? Combien de jours consacrez-vous à l’installation d’une exposition comme celle-ci ?
Karla Black
Une grande partie de la préparation sedéroule dans l’atelier, mais l’œuvre est seulement « terminée » sur place. J’adapte les sculptures, certaines plus que d’autres – parfois elles sont même réalisées in situ – pendant que je travaille dans la galerie. De nombreux paramètres physiques participent à leur création : ma réalité physique, mes limites, mon énergie, etc., les matériaux et l’environnement – l’action de la gravité, en particulier – et enfin la taille, la forme, l’accès et les différents points de vue possibles dans la galerie. Je travaille généralement entre quatre et sept jours pour réaliser ce genre d’exposition.
Justin Morin
Une autre question très pragmatique concerne les coulisses de votre travail. Vous avez parfois utilisé de grandes quantités d’un même produit. Lorsqu’un produit vous intéresse, qu’il s’agisse d’un type de revêtement particulier ou d’un papier toilette pastel, l’achetez-vous en grande quantité en prévision des travaux à venir ?
Karla Black
J’achète juste la quantité de matériel nécessaire à la réalisation de l’exposition sur laquelle je travaille, je ne fais pas de stock à l’avance. Souvent, l’institution ou la galerie finance les matériaux et fait en sorte qu’ils soient expédiés directement sur place, car cela peut représenter un budget conséquent et s’avérer compliqué sur le plan logistique.
Justin Morin
Je sais que cet aspect ne fait pas partie de vos priorités, mais je suis curieux de connaître les instructions que vous fournissez aux acquéreurs de vos pièces. Ce protocole est bien connu quand il concerne des artistes de performance, mais il est moins courant pour la sculpture (bien que vos créations se situent quelque part entre sculpture, performance et peinture). Je voulais vous demander si vous aviez senti une certaine réticence dans le monde de l’art (qu’il s’agisse de collectionneurs, de conservateurs ou de galeristes) concernant l’aspect « vivant » de votre travail ?
Karla Black
Oh oui, bien sûr. La sculpture est plus excitante pour moi lorsqu’elle reste proche de la réalité physique qui fait de l’objet une illusion. J’aime penser à la façon dont tout dans le monde physique s’assemble ou se sépare, comme si la masse devenait de l’énergie, puis redevenait masse avant de redevenir énergie. Notre perception limitée du temps ne nous permet pas de voir ce qui se passe, mais cela ne change rien au fait que les choses se passent. J’aime que le matériau conserve le plus longtemps possible son énergie et sa capacité de transformation.
Plus précisément, cela signifie qu’il faut en quelque sorte permettre aux matériaux de conserver leur capacité de transformation à une très grande échelle. C’est l’ambition que j’ai pour mon travail en général : forcer l’institution à présenter la fonction première de l’art : donner à voir l’aspect difficile, désordonné, chaotique du comportement humain, qu’il faut absolument permettre et préserver. J’espère atteindre cet objectif avec mon travail – il oblige cette fonction première de l’art à apparaître dans l’arène de l’institution et dans les canons historiques, car c’est quelque chose qui a beaucoup manqué ces derniers temps, avec les foires d’art et les galeries, qui proposent des objets transférables.

Karla Black, Turner Prize, Baltic Centre for Contemporary Art, 21 octobre 2011 — 8 janvier 2012. Avec l’aimable autorisation de Modern Art, London & Capitain Petzel, Berlin. Photo : Colin Davison.
Le public devrait être confronté à des objets réels. Je veux créer un objet réel, pas seulement une sorte d’objet historique, mort et immuable.
Justin Morin
Vous est-il facile de donner un titre à vos œuvres ?
Karla Black
Une fois l’œuvre terminée, j’y réfléchis davantage et je lui donne un titre. Je la considère d’un point de vue psychanalytique et le processus de création est un peu comme un « jeu » de passage à l’acte, comme lorsqu’on agit et qu’on se demande ensuite « Qu’est-ce que j’ai fait ? ». J’agis, puis j’y pense après coup et j’essaie de traduire en titre mon comportement.
Justin Morin
Pour finir, j’aimerais conclure avec quelque chose que j’ai lu dans votre entretien avec Veronica Simpson pour le site de Studio International. Vous avez expliqué qu’à un moment de votre vie, les cosmétiques vous ont apporté un sentiment de paix (je fais référence à votre anecdote concernant les produits Clinique que vous aligniez chez vous). Il est assez rare que des artistes soient à l’aise avec quelque chose qui est considéré comme superficiel. C’est ce qui me plaît vraiment dans votre travail. Dans son minimalisme, il comporte une couche complexe de références à l’histoire de l’art, à la sensorialité, à l’expérimentation, aux questions de hiérarchie et aux interprétations personnelles. Aussi vaste soit-elle, quelle serait votre définition de la beauté ?
Karla Black
Je n’ai jamais considéré que les cosmétiques, les produits de toilette ou les « produits de beauté » étaient superficiels. On peut aspirer à les utiliser, ils peuvent représenter un signe de réussite sociale, tant pour soi qu’aux yeux des autres.Pour moi, il n’y a pas de hiérarchie de matériaux. Dans un magasin, des pigments en poudre sont vendus en tant que « matériel d’art » et dans un autre, des pigments en poudre sont vendus pour être étalés sur la peau. Tout vient de la terre. Tout ce que je peux dire, c’est que je fais ce que je veux faire. C’est le plus important pour moi. Pour moi, créer est une question de liberté. J’ai décidé très tôt de m’autoriser à être libre quand je crée. En pratique, cela signifie que si une couleur me plaît, je l’utilise, et que si j’ai envie de travailler avec un matériau particulier, je le fais. Créer est déjà assez difficile, alors autant m’amuser le plus possible en faisant ce que j’aime. Quand je travaille, je ne réfléchis pas trop au processus de création, sinon je me paralyserais. Si je me focalisais dessus, ça me tuerait, surtout au début.
Malheureusement, je ne peux pas vous donner ma définition de la beauté, je n’ai pas les mots pour cela. Je crois que tout ce que je peux dire, c’est que pour savoir comment j’essaie de la définir, il faut regarder mes sculptures.

Karla Black, Museum Dhondt-Dhaenens Deurle, Belgique, 23 avril — 18 juin 2017. Avec l’aimable autorisation de Modern Art, London & Capitain Petzel, Berlin. Photo : Rik Vannevel.
Faux-semblant
Gaetano Pesce
Artiste prolifique, tour à tour designer, architecte ou sculpteur, Gaetano Pesce est l’auteur d’une œuvre éclectique et engagée. Depuis ses premières créations, réalisées dans les années 1960, jusqu’à ses objets édités par les plus prestigieuses des maisons, son style est toujours surprenant. Questionnant les émotions humaines, la perception et les modes de production, son approche déjoue les standards et les conventions. Anthropomorphique, s’inspirant du corps humain, de la faune et de la flore, son travail est aussi ludique que militant. À l’occasion de l’exposition Different Tendencies, Italian Design 1960-1980, organisée par la galerie new-yorkaise Superhouse, la curatrice Kristen de la Vallière, fondatrice de la plateforme Say Hi To, s’est entretenue avec cet iconoclaste.
KRISTEN DE LA VALLIÈRE
Vous faites partie des rares designers qui prennent vraiment position par leur pratique. On peut affirmer que vous êtes féministe. Si je ne me trompe pas, vous êtes allé dans une école pour filles quand vous étiez enfant ?
GAETANO PESCE
C’est vrai. Je crois que j’avais sept ans. À ce moment-là, j’ai eu un problème avec un instituteur qui était vraiment stupide. J’ai été renvoyé de cette école publique. Le seul établissement qui m’a accepté a été cette école privée pour jeunes filles. J’étais le seul garçon, j’observais mes camarades. J’ai commencé à comprendre comment les femmes pensent. Elles ont un esprit élastique, il n’est pas rigide comme celui des hommes.
KRISTEN DE LA VALLIÈRE
Vous deviez être une attraction pour ces petites filles ! J’imagine que vous étiez populaire.
GAETANO PESCE
En un sens, oui. C’était une école religieuse, il y avait une petite ferme avec toutes sortes d’animaux. Ma joie était de pouvoir m’occuper d’eux au petit matin. Plus particulièrement des vaches. Je me souviens que lorsque l’on m’a demandé ce que je voulais faire comme métier, j’ai répondu « bovaro ». En italien, ce mot désigne la personne qui prend soin des vaches. Ces animaux ont une douceur particulière qui me touche énormément. Je suppose que tous ces paramètres m’ont formé en tant que personne. Enfant, entouré de femmes et d’animaux, j’ai commencé à être sensible aux problèmes. J’ai toujours considéré mon travail comme une expression qui peut aider. Je déteste faire les choses pour rien. La plupart de mes collègues travaillent sans but, ils ne font que de la décoration. Il m’est difficile de comprendre ce genre d’approche. Je crois que le monde a besoin de gens créatifs qui peuvent prendre position contre certains problèmes, ou au moins, qui peuvent déclarer que les problèmes existent, les rendre visibles. Je pense que le design aujourd’hui est une forme de non-expression coincée dans une répétition. Rien ne semble authentique. Peu de personnes font des recherches, il y a beaucoup de copies du passé. Il m’est douloureux de voir ça. Lorsque l’on crée une chaise, cela ne devrait pas être un simple objet sur lequel on s’assoit mais une chaise qui exprime un point de vue.

Gaetano Pesce, UP 7 (Il Piede), 1969. Prototype unique produit par C&B Italia. Avec l’aimable autorisation de Superhouse & Gaetano Pesce. Visuel de Duyi Han.

Gaetano Pesce, Prototype no. 000-F pour la lampe Moloch. Produit par Bracciodiferro, Italie, 1971.
Avec l’aimable autorisation de Superhouse & Friedman Benda Gallery. Visuel de Duyi Han.
KRISTEN DE LA VALLIÈRE
Au fil de votre carrière, vous avez travaillé dans plusieurs disciplines, du design à l’architecture en passant l’aménagement urbain. Peut-on dire que le cœur de votre pratique repose sur l’exploration de différentes idées à travers différents médiums ?
GAETANO PESCE
J’ai l’habitude de dire que mon travail provient de l’observation de la réalité. Il peut s’agir d’une situation qui me rend heureux ou triste. J’essaie d’exprimer ce que je pense à travers mon travail. La réalité n’est jamais la même, elle est en constant changement. À l’âge de dix-sept ans, j’ai exposé des dessins dans une galerie à Padoue, en Italie. Et depuis je garde cette idée de liberté. Je suis libre d’utiliser tous les médiums que je souhaite. Si demain je veux faire de la musique, écrire un poème, développer une architecture politique, je suis libre de le faire. Les objets doivent parler de l’individualité de leur auteur. Ceci devrait être l’objectif de toute école : former une personne qui pense plutôt que quelqu’un qui réalise des choses plus ou moins banales.
KRISTEN DE LA VALLIÈRE
Si les écoles ne remplissent pas cette mission, quelles questions les jeunes designers doivent-ils se poser afin de développer leur pratique ?
GAETANO PESCE
Lorsque j’enseignais l’architecture, qui est plus ou moins équivalent à l’enseignement du design, je demandais à mes étudiants de dessiner le palais de justice de Moscou au temps de Staline. Par cet exercice, ils devaient prendre position : «Je suis pour ou contre Staline. » Cette provocation est une manière de dévoiler ce qu’ils ont à l’intérieur d’eux-mêmes et de le traduire sous une forme architecturale. Les professeurs ont une énorme responsabilité. La plupart d’entre eux transmettent ce qu’ils ont appris lorsqu’ils étaient jeunes. Mais s’ils ne suivent pas leur temps, ce qu’ils transmettent risque d’être obsolète.
KRISTEN DE LA VALLIÈRE
Comment cette évolution constante a impacté votre travail au fil du temps ?
GAETANO PESCE
Depuis trois ans, j’ai découvert que je ne peux pas définir mon travail. Je n’ai pas de style à proprement parler et j’imagine que c’est ce qui arrive lorsque l’on suit son temps.
KRISTEN DE LA VALLIÈRE
Que conseillez-vous aux designers pour qu’ils puissent cultiver ce goût de la liberté ?
GAETANO PESCE
La curiosité est très importante, ils doivent être curieux ! Pas de ce qui s’est passé hier mais de qui se passera demain.
KRISTEN DE LA VALLIÈRE
Vous êtes devenu un maître dans l’expérimentation des matières. Comment avez-vous commencé à jouer avec elles ?
GAETANO PESCE
J’ai passé tellement de temps et dépensé beaucoup d’argent dans des choses qui ne fonctionnaient pas ! Mais grâce à cette manière de faire, j’en ai aussi découvert d’autres qui semblaient vraiment intéressantes. Quand cela arrive, j’appelle quelqu’un de l’industrie et j’explique que j’ai trouvé une idée à développer. Lorsque vous commencez un projet, vous ne devez pas être rigide et vous cramponner à votre idée de départ. Vous commencez avec une feuille de papier et un crayon. Puis vous faites une maquette, et en faisant cela, vos mains découvrent quelque chose qui est directement communiqué au cerveau. La discussion entre la main et le cerveau va changer votre projet. Ce n’est jamais nécessaire d’être rigide. Il faut être ouvert aux signes et aux suggestions de la matière. La nature des matériaux nous dit ce qui est le mieux pour le projet.
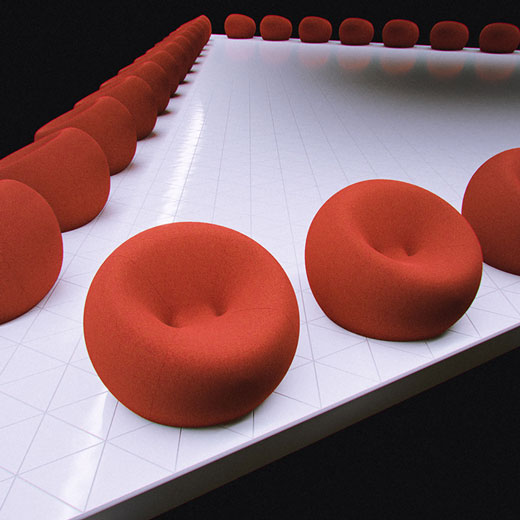
Gaetano Pesce, UP 2, fauteuil. Produit par C&B Italia (B&B Italia), 1969.
Avec l’aimable autorisation de Superhouse & Nilufar Gallery Digital. Visuel de Duyi Han.
KRISTEN DE LA VALLIÈRE
Comment avez-vous expérimenté dernièrement ?
GAETANO PESCE
J’ai fait une table qui représente un homme qui perd son énergie. Je crois que les hommes ont fait beaucoup de belles choses dans le passé. Mais de nos jours, ils sont fatigués et sont principalement à l’origine de nombreux problèmes à travers le monde. C’est ce que cette table exprime. C’est une pièce impressionnante car elle est translucide. C’est difficile de la décrire avec des mots mais elle est très belle. Elle est actuellement dans mon atelier. J’ai une une équipe fantastique qui comprend immédiatement mes idées. Mon atelier peut être perçu comme un endroit étrange car il est composé de personnes qui viennent de pays différents, avec des compétences et des personnalités très différentes. Mais j’adore ce mélange.
KRISTEN DE LA VALLIÈRE
Quel est votre position par rapport à la fonctionnalité du design ?
Le design devrait toujours être fonctionnel. Les radicaux, mes vieux amis, pensaient différemment : « Oh, ça n’est pas très important si une lampe ne donne pas de lumière ou si un canapé n’est pas confortable ». Si, c’est important ! Mais nous devons aussi ajouter autre chose. L’objet ne doit pas simplement être fonctionnel. Comme je l’ai dit précédemment, nous devons prendre position et exprimer un point de vue.
KRISTEN DE LA VALLIÈRE
Qu’est-ce que vous pensez des problèmes liés à la durabilité ?
GAETANO PESCE
La destruction de la nature et de ses ressources est à reprocher à l’être humain et de son manque de respect pour la planète. En même temps, nous ne pouvons pas attendre que la planète soit identique à ce qu’elle était il y a des millions d’années. La situation a changé. Je crois fermement que nous devons éduquer les gens. Ne jetez pas de plastique dans l’océan. Ne jetez pas d’acide dans l’évier. Les messages sont simples. Par le passé, il m’est arrivé de réutiliser des morceaux de tissus qu’une entreprise jetait. J’en ai fait de très belles chaises. C’est une bonne chose évidemment mais je crois aussi qu’il est important de ne pas freiner le progrès. Beaucoup considèrent le plastique comme quelque chose de négatif, mais ça ne l’est pas ! Le plastique est une découverte importante. Les tubes que l’on utilise pour les transfusions sanguines dans les hôpitaux en sont faits !
KRISTEN DE LA VALLIÈRE
Y a-t-il un projet inachevé que vous souhaiteriez terminer ?
GAETANO PESCE
Lorsque j’ai une idée, je la concrétise généralement en quelques heures ! J’ai été très chanceux dans ma vie car je l’ai passée à combler mes désirs. Je n’ai jamais été riche mais j’ai eu de l’argent. Et je l’ai dépensé, car l’argent est parfois nécessaire pour satisfaire sa curiosité.
Rêve américain?
Buck Ellison
Avec ses fresques photographiques, le Californien Buck Ellison dresse un portrait de l’Amérique blanche et fortunée et questionne la structure du privilège. Ses mises en scènes, nourries autant de la facticité des images de stock que du symbolisme des portraits de famille des peintures flamandes du XVIIe siècle, produisent un effet de trouble. Lors d’un entretien avec Hamid Amini, l’artiste dévoile les enjeux de sa pratique et sa méthodologie de travail.
HAMID AMINI
Ce que je constate, c’est qu’il y a une tension dans vos photos. Elles ont l’air sereines et paisibles, elles dégagent une crispation de choix entre hyper-visibilité et discrétion . Ces gens ne veulent ni n’ont besoin d’être vus. Vous ne vous moquez pas de votre sujet. Vous avez d’ailleurs dit que vous ne voulez pas porter de jugement. Il se dégage cependant un certain malaise, un sentiment étrange qui semble être le résultat de votre intervention. Ce trouble est à la fois surprenant et dérangeant.
BUCK ELLISON
Si le travail m’emmène dans des endroits étranges, inconfortables ou – je déteste ce mot– problématiques, cela signifie probablement que je fais quelque chose de bien. L’ambivalence, au sens d’être intensément attiré et repoussé par un même sujet, motive tout mon travail. J’entends souvent dire que cela se ressent dans le travail.

Buck Ellison, Only the horse knows how the saddle fits, 53 × 66 cm, 2013. Avec l’aimable autorisation de l’artiste.
HAMID AMINI
Il est également intéressant de voir comment vos sujets aspirent à l’authenticité. Est-ce une illusion que vous vouliez transmettre ?
BUCK ELLISON
Comme vous l’avez dit, je n’ai jamais voulu pointer du doigt les individus. Je veux examiner les manières, les gestes et les comportements qui perpétuent les inégalités. Avec un tel effort concerté pour être aussi modeste ou inoffensif que possible, une certaine partie de l’Amérique blanche semble très investie pour couvrir ses traces. Le défi de représenter ce sujet qui s’efface lui-même me fascine, je me suis donc tourné vers la mise en scène pour les rendre visibles, en empruntant le modèle d’une séance photo commerciale – en sélectionnant acteurs, vêtements, accessoires, lieux.

Buck Ellison, Sierra, Gymnastics Routine, 122 × 140 cm, 2015. Avec l’aimable autorisation de l’artiste.
HAMID AMINI
La notion de classe moyenne est assez biaisée dans le monde, et la richesse est également un concept très flou. Est-ce quelque chose dont vous voulez parler dans vos images ?
Je veux voir comment, en tant qu’Américains vivant dans une société démocratique, nous ignorons les inégalités. Lorsque nous jugeons les riches parce qu’ils travaillent dur ou sont paresseux, qu’ils donnent de l’argent ou le gardent, nous passons à côté de l’essentiel. Dire que quelqu’un habite l’inégalité à tort implique qu’il pourrait être possible de l’habiter correctement, ce qui n’est pas possible. C’est un terme frustrant, car il détourne l’attention des processus sociaux dont nous pourrions parler.
HAMID AMINI
Certaines de vos références me rappellent les peintures des cours royales des familles européennes, est-ce quelque chose que vous avez étudié de très près et exploré ?
BUCK ELLISON
Je ne suis pas un érudit, mais j’ai passé beaucoup de temps à les regarder, oui.
HAMID AMINI
Vous engagez souvent des acteurs locaux pour faire partie de vos photos, je suis curieux de connaître votre processus de casting, de tournage et de repérage ?
BUCK ELLISON
Bien sûr. Parlons de l’image Sunset (2015). Les autocollants pour pare-chocs étaient très populaires au lycée ; ils offraient un moyen de se différencier au sein d’un environnement homogène. Je voulais faire une photo à ce sujet. J’étais attiré par le sacrilège de ruiner la peinture d’une voiture chère avec des autocollants bon marché. Mais j’aime aussi la tendresse de ce moment où l’autocollant était collé pour la première fois, de l’identité littéralement en train de construire.
J’ai donc recherché l’emplacement, choisi les modèles, payé pour que le modèle se fasse couper les cheveux, et j’ai passé beaucoup de temps à chercher des autocollants (Patagonia, The North Face et Save Tibet) et des vêtements (une chemise Ralph Lauren, un débardeur Red Stripe, une bague de Thaïlande). Ces choix d’accessoires et de style étaient importants parce que je voulais suggérer qu’une série de décisions avaient précédé le moment que nous voyons. Ces choix semblent insignifiants, mais dans le microcosme de ce monde, où la richesse et le progressisme sont si proches, où les enfants détestent le capitalisme mais ne savent pas encore ce qu’il implique, ces affiliations ont un poids énorme. Un débardeur de la marque de bière Red Stripe est un débardeur, mais ce n’est pas un débardeur Budweiser. Il y a donc quelque chose d’un peu mondain là-dedans, ce vêtement provient peut-être de vacances en Jamaïque, une possibilité soulignée par la bague du mannequin, qui vient de Thaïlande.
La prise de vue a duré environ deux heures. Je prends tellement de photographies que cela en devient routinier ; les modèles mettent vraiment les autocollants sur la voiture, ils ne font pas semblant. La décision de photographier au coucher du soleil a été initialement inspirée par le drapeau sur l’autocollant «Save Tibet», qui présente un coucher de soleil. Mais j’aime que cela donne une lumière héroïque à ce moment banal.

Buck Ellison, Strenuous Life, 55 × 44 cm, 2013. Avec l’aimable autorisation de l’artiste.

Buck Ellison, Sunset, 102 × 127 cm, 2015. Avec l’aimable autorisation de l’artiste.
Body double
Alexandra Bachzetsis
Questionnant autant l’intimité que la surexposition, le rapport au langage ou encore la mise en scène de soi, le travail chorégraphique d’Alexandra Bachzetsis multiplie les axes de réflexion. Sa danse se traduit aussi bien dans un espace nu qu’investi par des accessoires sculpturaux, comme autant de prothèses à même de transformer le corps. Puisant autant dans l’histoire de l’art que dans la culture pop, et s’appuyant sur les gender studies, ses pièces passent d’un registre à l’autre, en rupture rythmique ou en harmonie. Une gymnastique à la fois conceptuelle, plastique et en constant mouvement.
MS Votre travail explore de nombreux thèmes, les mélangeant de manière très libre et inattendue, afin de créer des collisions aussi théoriques qu’esthétiques. Par rapport à la scène, vous arrive-t-il de vous contraindre ? Y a-t-il des lignes que vous ne souhaitez pas traverser ?
AB La scène dans sa meilleure version est un espace non censuré, une anthologie d’inspirations, d’expressions, d’histoires et de fictions. Ce n’est pas un simple cadre spatial, mais une analogie ou un moyen de transposer notre construction du désir dans le domaine des sens, juste devant nous. Je crois fermement dans le besoin de repousser les frontières à l’intérieur et à l’extérieur de la structure du théâtre et de ses conventions. J’aime traverser les frontières d’un genre. Ne pas respecter les conventions du théâtre quand je fais une pièce de théâtre, mais plutôt travailler d’une manière cinématographique. Lorsqu’il s’agit de réaliser un film, penser à la composition et à l’aspect théâtral de la mise en scène des corps pour la caméra,
Je repousse les limites de la pensée binaire et tente de les révéler à travers des gestes précis d’échange entre le masculin et le féminin vers un corps qui change constamment de genre. Je travaille avec la perception sociale de la différence de genre et la débarasse de sa connotation conventionnelle, la mets en mouvement à travers un travail chorégraphique.
Par exemple, dans Chasing a Ghost (2020), je me concentre sur la structure et le thème du double et du duo – entre toutes les constellations de genre. J’essaie de formuler une étude physique du comportement de l’étrange à travers l’« échangeabilité » des gestes en répétition et l’irrésistibilité des corps. Le corps, considéré dans sa pleine physicalité, est mon matériau autant que la mémoire du corps et de ses représentations à travers les cultures et les histoires. Je suis intéressée par la nature liquide du corps humain, ses multiples passages à travers les rôles de genre, les différences d’âge et la manifestation factuelle de chaque moment singulier dans le temps à travers sa propre présence.
MS Vos performers ont une place très importante dans votre processus de création. Quels sont les qualités que vous recherchez chez eux lorsque vous écrivez une pièce ?
AB La capacité à retranscrire le réel est une qualité importante que je recherche. La capacité à être réaliste est une qualité importante que je recherche. Je pense que c’est artistiquement la façon la plus aboutie de travailler sur la construction de l’identité. Je pense qu’il est important de laisser les interprètes explorer leur interprétation individuelle lors de l’engagement dans mon processus artistique, ce qui nécessite bien sûr une définition et une clarté de la recherche dès le départ, afin d’entrer dans un processus chorégraphique qui engage toutes les parties impliquées. Il y a une fine ligne à parcourir entre la liberté et le contrôle, mais une ligne très importante à conserver et à redéfinir dans le processus de collaboration. Les concepts performatifs ne sont jamais statiques – ils bougent et changent dans le temps et doivent être réexaminés à tout moment.
Je m’intéresse à la présence subversive d’une personne – et je recherche donc des interprètes capables de s’engager dans la tâche complexe d’être à la fois eux-mêmes tout en étant dans le fantasme de quelqu’un d’autre.
MS Les nouvelles technologies, des smartphones aux réalités augmentées, introduisent de nouvelles habitudes et de nouvelles formes de mouvement. Selon vous, comment cela se traduit-il dans notre relation à nos corps et à la manière dont les percevons ?
AB L’utilisation intensive des technologies à travers lesquelles nous expérimentons, produisons et transmettons constamment des représentations du corps se traduit par un sentiment de platitude, de stagnation, de paresse, de projection du corps, d’être hors du corps. Des désirs multiples et parallèles d’expériences corporelles finissent par être totalement enfermés et piégés dans l’idée du corps à l’écran, et non dans l’expérience du corps. La politique de l’anxiété traite de la gestion de ces projections. Les applications de rencontre et les plateformes de communication sur les réseaux sociaux deviennent une extension et un remplacement des expériences physiques. La construction du fantasme et du désir en tant qu’analogues visuels distants, virtuels – au-delà de l’idée de corps dans l’espace qui peuvent se rencontrer de manière aléatoire, fortuite, urgente et dangereuse – est devenue très dominante dans nos habitudes et routines de la vie quotidienne. La pornographie permet aux utilisateurs de regarder sans engagement, juste pour suivre, fantasmer, exploser, observer. Je perçois notre époque comme un gros plan majeur, une réalité zoomée au-delà de la notion de rencontre intime avec l’autre, mais plutôt avec l’idée ou la projection de notre imaginaire sur les autres ou avec les autres.
MS Votre collaboration avec Paul B. Preciado prend plusieurs formes. Pouvez-vous nous dire comment vous vous êtes rencontrés et comment se passe votre travail ?
AB Nous nous sommes rencontrés en 2015 lors de notre participation à la Documenta 14, à Athènes. En raison de notre intérêt commun à questionner l’identité de genre à travers la performance, nous avons commencé à travailler ensemble – Paul en tant que curateur de recherches et moi en tant qu’artiste – sur l’ensemble intitulé Private (2017) que j’ai conçu à l’occasion de la Documenta 14. Plus tard, nous avons continué à travailler ensemble sur ma pièce Escape Act, pour laquelle Paul a offert le poème intitulé « Love is a Drone » comme matériel d’instruction et partition de la pièce. Nous avons utilisé le texte comme paroles pour les chansons qui ont été faites et interprétées dans Escape Act. Notre collaboration est un dialogue artistique à travers différentes pratiques au point de rencontre du langage et du geste – finalement, le corps.
MS On peut faire l’expérience de votre travail à travers des pièces dansées mais aussi dans des expositions. Comment concevez-vous le dialogue entre la scène et la galerie ?
AB Pour moi, les deux contextes sont des environnements de travail. Ils ont des besoins différents, des publics divers et demandent des approches individuelles. J’ai l’impression de les aborder comme des espaces singuliers de représentation. L’héritage de leurs différents langages est important quant à la manière de façonner le processus chorégraphique en un choix esthétique formel.
Je prends plaisir à réinventer l’idée de forme et de support par rapport à son hôte.
Le cinéma et la vidéo, l’installation ou la photographie ont un rayonnement différent de celui du spectacle vivant. Ils exigent chacun une approche particulière en matière de mise en scène d’intimité.

Alexandra Bachzetsis, Gold by Alexandra Bachzetsis. © Alexandra Bachzetsis

Alexandra Bachzetsis, Anne Pajunen & Gabriel Schenker, From A to B via C, © Alexandra Bachzetsis en collaboration avec Julia Born et Gina Folly. Photo: Arion Doerr. Avec l’aimable autorisation de l’artiste et de Performance Space 122.
Les expositions et les chorégraphies ont leur propre vie. elles fonctionnent ponctuellement ou de manière suspendue selon leur chronologie. Je pense qu’une exposition est une installation permanente pour une rencontre avec un public, en mouvement, sur une plus longue période, tandis qu’une chorégraphiesur scène est une apparitionponctuelle et une confrontation avec un public majoritairement immobile sur une courte durée. En tant qu’artiste de performance, il m’est plus facile de m’adresser au public tout en perfomant avec mon propre corps une partition ou une de mes œuvres, plutôt que de me tenir à côté de mon œuvre d’art dans une de mes expositions et de devoir engager une conversation avec des spectateurs.
MS Revue est à la fois un magazine d’art et de mode, ce qui m’amène à m’interroger sur votre relation avec l’imagerie de mode. Vous avez notamment travaillé avec les photographes Blommers & Schumm pour une série d’images qui présentent plusieurs de vos pièces. Pouvez-vous me dire comment vous percevez les photographies de mode ?
AB Je pense que les images créent un récit, ce sont des moments figés dans le temps et il émane d’elles une ambiance. La plupart des images que vous avez mentionnées ont été produites comme matériel promotionnel pour mon travail de performance.
Au fil du temps, j’ai travaillé avec un certain nombre de grands photographes, parmi lesquels Blommers & Schumm, Mathilde Agius, Melanie Hoffman, Derek Stierli, Melanie Bonajo,mettant en scène le corps pour des séances photo. La photographie de mode en tant que genre apparaît en fait assez peu dans ce processus. Ce qui reste, ce sont des corps, des vêtements et un ensemble d’instructions pour les mettre en scène en fonction de projets individuels.
Ma longue et importante collaboration avec la graphiste Julia Born transcende la présence spatiale du corps sur scène, dans le musée, la galerie ou dans la photographie, car elle est structurée et remise en scène dans des imprimés, des flyers aux livres, dans l’espace d’une page.
Nous aimons distiller l’essence d’un projet dans un ensemble de photographies qui fonctionnent comme une présence énigmatique, créant un monde parallèle de perception de l’œuvre. Souvent, nous créons des objets imprimés qui accompagnent les performances comme des recueils de chansons, des manuels de désir ou des livrets d’instructions.
Mon regard sur la mode est sincère. Je m’intéresse aux expressions de notre temps. Je travaille avec les modes de traduction des langues, l’interprétation des corps et la marchandisation du désir et j’examine comment ceux-ci trouvent leurs apparitions matérielles dans la musique, la littérature, les vêtements, la mise en forme du corps – et le langage du mouvement qui accompagne ces formats.
J’aime travailler avec des designers tels que Cosima Gadient d’Ottolinger, Christian Hersche de Christoph Lemaire pour Uniqlo, Léa Dickely et Hung La de Kwaidan Editions, Ulla Ludwig, Priska Morger, Eva Bühler et Patrizia Jaeger.
Porter des vêtements est une transformation.
Les vêtements sont des éléments de performance qui demandent une approche autoérotique quand on joue avec eux. Ce sont des outils pour reformuler le vocabulaire d’une convention dans une nouvelle langue.
MS Cette dernière question est très large, mais pouvez-vous nous dire quelle est votre conception du beau ?
AB Dans mon travail, je ne suis pas concernée par la beauté mais plutôt par la réalité. La beauté apparaît et périt. Ce n’est pas que je pense que nous pouvons l’atteindre, l’acheter, la former ou la préserver de quelque manière que ce soit. C’est plutôt un sentiment exprimé par des gestes, des actions, des mouvements et un sentiment d’appartenance qui finit par se rapprocher de l’idée même de beauté lorsqu’on pense à la performance.


Alexandra Bachzetsis & Sotiris Vasiliou, Chasing
a Ghost by Alexandra Bachzetsis, © Mathilde Agius
Je travaille avec des conventions, des archétypes et des formes esthétiques établies comme éléments de performance, mais pas dans le but de créer un langage conséquent d’une doctrine esthétique. Plutôt pour discuter de manière critique des tendances de notre temps qui nous entourent et nous informent, et qui finalement provoquent et façonnent nos corps.
Ma méthodologie est celle d’utiliser des codes existants afin d’atteindre une nouvelle liberté – une réalité.
Propos recueillis par Muriel Stevenson
Vertigo
Philippe Decrauzat
Jeu graphique de lignes ondulantes ou strictement parallèles, en noir et blanc ou dégradé de couleurs, l’œuvre de l’artiste Suisse Philippe Decrauzat décline des formes simples mais produit des effets saisissants. Elle s’inscrit dans une lecture critique de l’abstraction géométrique. Ses recherches convoquent donc plusieurs courants : l’art optique évidemment, mais aussi l’art minimal, conceptuel et pop. Questionnant l’image en mouvement, mais aussi sa circulation, sa pratique se nourrit autant de l’histoire de la peinture que de celles du cinéma ou de la musique. Dans son atelier parisien, au milieu de nouvelles toiles qui s’apprêtent à être présentées à l’occasion d’une exposition personnelle au Portique, au Havre, Philippe Decrauzat revient sur les différents éléments qui composent son travail.
Justin Morin
Comment s’est développé votre langage visuel ? Durant vos études, avez-vous toujours été attiré par ces formes minimales ou avez-vous traversé d’autres courants esthétiques ?
Philippe Decrauzat
Je suis arrivé à ce répertoire de formes abstraites à la fin de mes études. Certaines peuvent être lues en écho à des œuvres de l’art cinétique et de l’art optique. Les premiers moments de mes recherches ont été liés à des questions de rapport aux images et à leur circulation. Celles-ci peuvent provenir de sources très différentes, elles ne se limitent pas au champ des pratiques picturales. Je pense par exemple aux films ou aux pochettes de disque. Avec le temps, j’ai fini par m’intéresser à certaines formes qui s’inscrivent dans des questions de perception et plus spécifiquement dans l’histoire de l’abstraction et de ses origines. Ce qui me permettait de réfléchir au statut de l’auteur, au rapport du spectateur à l’œuvre et de sa réception… Dans mon environnement ces questions étaient très commentées à la fin des années 1990 / début 2000, au moment de l’émergence de l’esthétique relationnelle et d’un retour d’intérêt pour l’abstraction. Pour ma part, je découvrais La mort de l’auteur (1967) de Roland Barthes ou encore L’œuvre ouverte (1962) d’Umberto Ecco.
Justin Morin
La musique est un domaine très présent et référencé au sein d’une certaine frange de la « peinture suisse ». Pouvez-vous nous citer quelques pochettes de disques qui vous ont marqué ?
Philippe Decrauzat
À l’époque, nous allions encore découvrir et acheter dans les magasins de disques. Cela participait à une manière d’être formé visuellement par des objets. Je pense qu’on le fait toujours aujourd’hui, très différemment et de manière peut-être plus dirigée. J’ai donc découvert des groupes issus des scènes expérimentales électroniques – notamment à travers les signatures du label Mille Plateaux – autant que des choses plus anciennes comme tout le travail de Peter Saville pour Factory Records, je pense notamment aux pochettes de Section 25 et bien évidemment celles de Joy Division et New Order. Ces visuels avaient cette capacité de transmettre une part du projet artistique, sonore, et culturel, de ces musiciens en y ajoutant une nouvelle dimension. Tout cela s’est fait sous l’influence de Francis Baudevin, professeur et artiste génial avec qui nous parlions plus de ces objets que de peinture. Mais ce que je retiens, c’est que ces pochettes de disques faisaient circuler des histoires de peinture.
Justin Morin
Ce qui est intéressant, c’est que le vinyle est un objet rond contenu dans un carré qui se déploie pour dévoiler une image rectangulaire.
Philippe Decrauzat
J’ai également le souvenir des différents supports qui s’offraient à nous : compact disc, mini disc, vinyle, cassette… La standardisation n’avait pas encore eu lieu alors que le MP3 faisait tout juste ses débuts. Il y avait une sorte de richesse de formats qui coexistaient avec une tension où l’on se disait « cela va disparaître » puisque l’on se demandait quel support allait prendre le dessus. À l’époque, cela semblait très clair et on voit que vingt ans après, ça ne l’était pas ! S’il m’arrivait d’acheter des vinyles, je n’aurais certainement pas misé sur une telle résistance ! Idem pour la cassette, je n’aurais pas pensé que certains albums seraient publiés, aujourd’hui encore, sur ce format.
Justin Morin
Votre peinture développe une relation à l’espace et au volume qui est très singulière. Cela passe notamment par vos châssis qui peuvent prendre des formes très variées et sculpturales.
Philippe Decrauzat
En ce qui concerne le support de peinture, il s’agit de s’inscrire dans une histoire et de travailler à partir de cette histoire. Les choix que j’entreprends – comme travailler à partir d’une toile de coton et non de lin ou de développer des formes découpées – sont liés au désir de se rapprocher d’une histoire de la peinture qui raconte un rapport à l’espace, à l’objet et à la surface. Une peinture qui s’inscrit dans des questions de perception.
Justin Morin
Vous déployez votre travail à travers une variété de formes mais dans une certaine économie de la couleur, en travaillant notamment le noir et le blanc.
Philippe Decrauzat
Je peux travailler sur des rapports d’opposition, de contraste qui sont les plus productifs en termes de vibrations et de persistance rétinienne, d’où mon choix fréquent du noir et du blanc. Ce qui me permet aussi de convoquer la relation au positif/négatif et d’une certaine manière à la retranscription (signal) et au texte (tracé noir sur fond blanc).
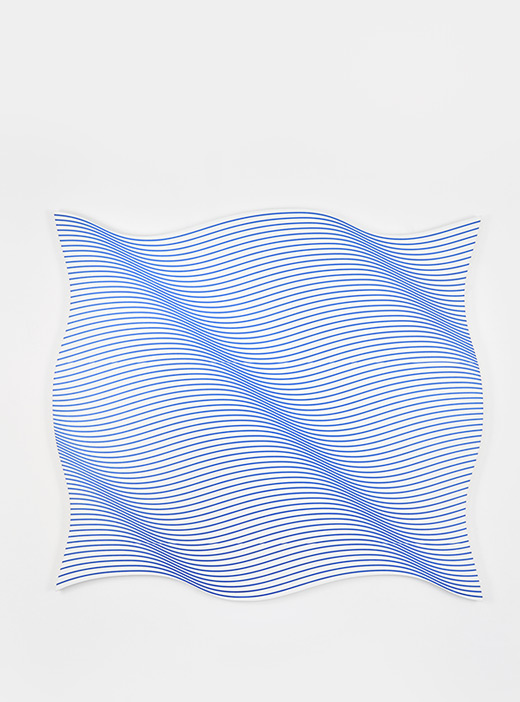
Philippe Decrauzat, Only Too Insidious, (flag wave half speed blue iridescent), 2019. Acrylique sur toile, 115 × 126 cm.

Philippe Decrauzat, Pause I, 2019-2020. Acrylique sur toile, 211 × 150 cm. Avec l’aimable autorisation de l’artiste.
La couleur ou les couleurs c’est par le dégradé que j’en fais l’expérience, qu’il soit traité de manière continue ou à l’inverse par une succession régulière de nuances discontinues. Mais avec l’idée d’une transition, du passage d’un état à un autre, du multiple.
J’emploie aussi souvent des couleurs métalliques ou iridescentes qui n’offrent jamais une teinte stable, puisqu’elles vont fluctuer en fonction de l’espace, être sensibles à la luminosité ambiante ou encore se moduler au moment de leur reproduction photographique. Cette question de la reproduction m’intéresse énormément. Je viens d’une génération qui a beaucoup regardé de catalogues et de magazines. L’histoire des expositions et des œuvres qui circulent dans leur état reproduit crée ce rapport très spécifique aux couleurs, aux ombres, aux espaces, aux corrections d’images. Pour en revenir à la couleur, on peut donc penser à une forme d’économie, mais je ne pense pas que cela soit le cas. Sur les pièces présentes derrière nous, les teintes de noir sont nombreuses et différentes. Ça n’est pas forcément perceptible au premier abord, mais cela le devient progressivement et par comparaison.
Justin Morin
Justement, comment travaillez-vous ces effets d’optique qui se jouent dans vos tableaux ? Est-ce quelque chose que vous avez étudié ou qui résulte d’expérimentations ?
Philippe Decrauzat
La persistance rétinienne est un phénomène qui me fascine car elle concerne la peinture, mais aussi l’image en mouvement. Certains parlent d’illusions, je préfère dire que ce sont des images physiologiques, produites par le corps. C’est comme une réponse du corps à son environnement. Elle fait partie de ces domaines sur lesquels on peut lire énormément – souvent la même chose – et donc penser que tout est résolu alors que ça n’est pas le cas. Ça m’intéresse de revenir sur des questions qui semblent résolues et qui ne le sont pas. Une des dimensions de la perception, c’est bien qu’il n’y a rien d’arrêté et de définitif, puisque tout est lié aux outils d’observation, aux méthodes, aux expériences et à nos constructions culturelles. L’art cinétique a connu un moment très fort dans les années 1960. Nous avons eu l’impression que ces artistes avaient résolu ces questions, réduisant ce mouvement à un moment anecdotique, parfois même dénigré par la suite, passant ainsi à d’autres questions. C’est aussi toute cette histoire qui m’intéresse. Pourquoi une forme serait plus simple qu’une autre et plus assimilable ? Pourquoi un rapport noir/blanc serait plus facilement résolu qu’une palette extrêmement diversifiée ? Pourquoi la délimitation d’une ligne nette serait moins expressive qu’un coup de pinceau jeté sur la toile ?
Justin Morin
Pour en revenir au rapport sculptural de vos châssis, comment aboutissez-vous à de telles formes ?
Philippe Decrauzat
Il y a autant des dessins préparatoires sur ordinateur que des croquis dans mon carnet. Je travaille avec des découpes réalisées sur du bois. Il faut ensuite trouver le moyen de détacher la toile du support, puisque rien n’est contrecollé sur le châssis. Je travaille dans les limites de l’objet, dans la mesureoù chaque décision est liée à des contraintes techniques. La logique vient dicter la forme. Les formats, les épaisseurs des tracés et des formes sont liés à ses limites, c’est une partition qui se joue. Les tableaux finissent par raconter leur propre histoire. Il arrive que l’on me demande si je ne peux pas faire telle ou telle pièce en plus petit, ce qui n’est évidemment pas possible. Une fois l’intention définie, le reste ne fait que suivre.
Justin Morin
Vous auriez pu faire le choix d’abuser du « sans titre » pour titrer vos œuvres, et pourtant, ce n’est pas le cas.
Philippe Decrauzat
J’essaie de titrer mes peintures, mais c’est vrai que ça n’est pas simple. Je travaille sur une nouvelle publication – publiée chez Verlag der Buchhandlung Walther und Franz König – qui se concentre sur les quinze dernières années de ma pratique et rassemble beaucoup de matières autour de mon travail de peinture, d’installations et aussi sur les films que j’ai réalisés, et qui sont plus difficilement accessibles, visibles en dehors des expositions. On trouve un ensemble de textes qui viennent parler du travail de manière directe et certaines fois de manière indirecte, voire périphérique, ce qui apporte un autre point de vue sur le travail et l’emporte comme s’il s’agissait d’un point de départ. En faisant ce livre, il m’est arrivé de trouver et donc de titrer des œuvres plusieurs années après leur réalisation et leur exposition. Ça embêtera peut-être beaucoup de monde, mais je suis devenu assez décomplexé vis-à-vis de cela. Il y a des artistes qui m’intéressent beaucoup, et depuis longtemps, comme Kenneth Anger. Certains réalisateurs de films expérimentaux n’hésitent pas à remonter leur film, repenser leur bande son ou changer le titre, car la plasticité du médium permet de donner plusieurs formes au projet. Il n’y a pas de stratégies très claires.

Philippe Decrauzat, Untitled (subdued laugh), 2011. Acrylique sur toile, 180 × 160 cm.
Au contraire, cela produit de la confusion et j’aime bien cet aspect. Le titre permet ce jeu, il peut se changer, se modifier. Il reste compliqué à trouver car je veux toujours rajouter un élément de lecture possible. C’est pour moi un espace supplémentaire pour raconter une part de l’histoire qui ne sera pas forcément visible.
La peinture comme interface, c’est aussi ce projet-là : fondamentalement, nous n’avons peut-être pas besoin de parler de la peinture, mais si on décide d’en parler, alors elle peut raconter autre chose et nous permettre d’aller ailleurs.
Still (Times Stand), du 30 octobre 2021 au 9 janvier 2022, au Portique, Le Havre.
Palettes
Sylvie Fleury
À son origine, le mot poudrier désignait un godet à couvercle percé de trous, rempli de poudre destinée à sécher l’écriture. Il disparaît avec l’usage du papier buvard, avant de se réinventer en accessoire de mode.
Avant la Révolution, la poudre est l’apanage des aristocrates et des bourgeois. Les pratiques changent peu au XIXe siècle : la mode reste au teint blanchâtre et l’acte de se poudrer se fait dans l’intimité du cabinet de toilette. Ce qu’on appelle alors poudrier n’est qu’un contenant en carton qui sert avant tout à aller acheter de la poudre en vrac. Au début du XXe siècle, l’esthétique et les matériaux du poudrier évoluent pour arriver au summum de la modernité du moment grâce au savoir-faire de la joaillerie. Les premiers poudriers Art nouveau en métal apparaissent. Ils abritent une palette de couleurs, parfois complétée par un miroir et des accessoires, allant de la houppette à poudre aux pinceaux. Objets de luxe, ils se déclinent à l’infini et peuvent être décorés de pierres précieuses, de nacre ou de laque. Avec l’avènement du maquillage industriel suivront les modèles en plastique permettant une diffusion de masse. Cette production en série est le reflet de l’évolution sociétale, tant dans l’évolution des mœurs que dans l’émancipation féminine. Glissé dans un sac à main, le poudrier accompagne la femme moderne. Le maquillage devient un geste d’affirmation.
Sylvie Fleury présente en 2018 l’exposition Palettes of Shadows dans l’espace parisien de la galerie Thaddeus Roppac. L’artiste suisse est connue pour sa pratique pluridisciplinaire revisitant l’histoire de l’art sous un prisme pop. Résolument postmoderne dans ses appropriations, elle combine mode, industrie du luxe et art contemporain pour mieux déboulonner les stéréotypes de genre, explorant autant la culture du shopping que l’univers mécanique de l’automobile. De fait, elle détourne le concept de tuning et l’applique à ses productions, n’hésitant pas à jouer avec les peintures métallisées, les fourrures ou les motifs de flamme.
Jubilatoire, son art fait de la séduction une arme politique.

Sylvie Fleury, Road Movie, 2018. Peinture acrylique sur toile sur bois, 12 kgs. 120 × 120 × 11 cm. Avec l’aimable autorisation de la Galerie Thaddaeus Ropac, Paris. Photo: Charles Duprat © Sylvie Fleury

Sylvie Fleury, Bronzed SPF 30, 2018. Peinture acrylique sur toile sur bois, 10 kgs. 125 × 125 × 6 cm. Avec l’aimable autorisation de la Galerie Thaddaeus Ropac, Paris. Photo: Charles Duprat © Sylvie Fleury

Sylvie Fleury, Couture Palette-Ballets Russes, 2018. Peinture acrylique sur toile sur bois, 10 kgs. 143 × 106 × 6 cm. Avec l’aimable autorisation de la Galerie Thaddaeus Ropac, Paris. Photo: Charles Duprat © Sylvie Fleury

Sylvie Fleury, Pink Explosion, 2018. Peinture acrylique sur toile sur bois, 15 kgs. 120 × 120 × 12,2 cm. Avec l’aimable autorisation de la Galerie Thaddaeus Ropac, Paris. Photo: Charles Duprat © Sylvie Fleury
Sur le fil
Gisèle Vienne
S’il est infiniment plastique, et donc séduisant, le travail de Gisèle Vienne est avant tout traversé de combats politiques et de réflexions philosophiques. Ainsi les formes qu’elle met en scène fascinent autant qu’elles troublent. En témoigne son utilisation singulière de la marionnette, bien loin des clichés associés à cet objet aux richesses méconnues. Au-delà de l’incarnation, c’est la question de la perception qui se joue et qui, se faisant, amène à revoir tout un système de pensée. Dans son vaste corpus d’œuvres – allant de la chorégraphie à la photographie, en passant par le commissariat d’expositions – l’artiste cultive les amitiés créatives. Elle collabore ainsi fréquemment avec l’auteur Dennis Cooper. Affiliée au mouvement queercore, son écriture, entre humour cinglant et poésie crue, résonne avec les tourments contemporains. Un spectre sensible et riche qui fait écho aux histoires racontées par Gisèle Vienne.
JM Ma première question peut sembler anecdotique, mais puisque l’adolescence est un sujet qui revient fréquemment dans votre travail, je me demandais comment vous aviez vécu cette période ? Étiez-vous une enfant solitaire ou plutôt entourée ?
GV J’ai passé une partie de mon enfance et de mon adolescence en banlieue de Grenoble, à Saint-Martin-d’Hères. J’ai également vécu à Fribourg, dans la Forêt-Noire, pendant mes années de collège de 6ème et 3ème, et j’ai passé mon année de terminale à Berlin. J’ai baigné dans les deux cultures, en réalité les trois, puisque ma mère est autrichienne, et que donc la moitié de ma famille vivait là-bas. Je n’étais pas une enfant solitaire, j’aimais beaucoup la compagnie des autres. J’ai énormément joué avec d’autres enfants, et fait la fête à l’adolescence puis après. Mon désir d’art, de corps, de mouvements, vient aussi évidemment de ces longues sessions de jeus, de déguisements, de grimages et de toutes ces fêtes, de ces concerts où l’on danse et l’on aime, au son d’Eternal Flame à 12 ans, puis The Cure et jusqu’à Jeff Mills et MMM. Ma mère est plasticienne et grâce à elle, j’ai passé beaucoup de temps à sculpter, à dessiner, à faire toutes sortes d’activités manuelles. La créativité était présente dans mes temps en dehors de l’école. J’ai aussi appris la musique et la danse. J’étais dans un délire de pratique artistique fort avec un désir immense d’apprentissage, qui perdure. D’être à la fois en France et en Allemagne m’a permis de rencontrer des adolescences qui n’étaient pas les mêmes, et des structures de société et de langues qui étaient différentes. Ces expériences m’ont permis de vivre ce que voulait dire le déplacement culturel, et de comprendre tout ce qu’il rend possible, le déplacement du regard, des sociétés qui peuvent être autres. En Allemagne, j’ai découvert une culture alternative passionnante avec des mouvements punk plus forts qu’à Grenoble où la scène électronique était plus présente. Très rapidement, vers l’âge de treize ans, j’ai traîné dans ces milieux alternatifs, que ce soit dans des lieux autonomes dédiés aux jeunes ou dans des fêtes. J’étais entourée de personnes très contestataires, je l’étais moi-même et je le suis toujours, et je comprends cette contestation chaque fois plus précisément. J’ai aussi toujours adoré la lecture, de textes littéraires et théoriques, qui m’a offert et m’offre toujours de grands et beaux moments solitaires.
Ce qui me passionne dans le changement sociétal que nous traversons, c’est qu’il apporte enfin des perspectives passionnantes et justes qui répondent aux questionnements que j’ai rencontrés dès l’adolescence, et qui traversent ma vie. Ce changement sociétal permet d’être appréhendé grâce aux penseurs qui ont écrit des années 1990 à nos jours (et qui ont lu, entre autres, Gabrielle Suchon, Michel Foucault, Monique Wittig, Angela Davis), leurs textes me permettent de comprendre plus précisément ce qui me révolte et comment imaginer un déplacement sociétal. Ces milieux alternatifs – que ce soit la new wave, la techno, la musique expérimentale, le gothique ou le punk – dans lesquels j’ai baigné très tôt portent en eux le désir d’un autre monde, d’une autre société, et permettent des espaces pour le penser. On pouvait durant mon adolescence déjà y voir des filles qui ressemblaient à des camionneurs et des garçons aux allures de princesses des ténèbres et tout le monde qui voulait ressembler à tout autre chose, sauf au père, à sa famille et aux modèles imposés. Il y avait cette fluidité de genre qui n’était pas articulée ou formulée comme elle l’est maintenant. Je trouve magnifique que toute cette pensée qui s’est développée de manière instinctive infuse la société, soit désormais pensée, théorisée. Dans l’espoir que ces prises de conscience etces réflexions soient en mesure de nous aider à modifier la société dans sa structure même et en nous permettant de déplacer nos cadres perceptifs. La philosophie, l’art, la politique et la sociologie me permettent de penser cette lutte, cette colère, cette joie et cette créativité vitales qui ont explosé dès l’adolescence, au moment où la société patriarcale m’avait donné une injonction, celle de me détruire, et où j’ai décidé de vivre, de créer, de penser, d’inventer et de la détruire.


Photographies d’Estelle Hanania
JM Justement, vous avez étudié la philosophie avant d’aborder les arts scéniques et visuels. Est-ce pour vous une manière de compléter vos réflexions par quelque chose de plus tangible ? Qu’est-ce qui vous a donné envie de vous orienter vers la mise en scène ?
GV Lorsque j’ai étudié la philosophie,il me manquait la conscience de l’expérience des corps et des sens dans le processus philosophique même. J’avais besoin de passer par l’art pour pouvoir mieux penser le monde à partir des sens et du corps, le mien mais aussi celui des autres. Évidemment, il y a un enjeu politique derrière ces hiérarchies des savoirs qui dénigrent et/ou invisibilisent la place majeure de l’expérience sensible du monde dans le développement de la pensée. Qui sont les personnes et ces philosophes qui peuvent se permettre d’oublier leur corps ? De faire comme si elles ne pensaient pas à partir de leur corps, et inversement définir celui des autres,en les réduisant à des identités qui en feront des êtres structurellement dominés dans leur système de pensée. Les corps sont tous situés, donc la pensée l’est aussi, ce qui est absolument passionnant. L’expérience sensible du monde a un rôle majeur dans le processus du développement des connaissances. Pour moi, l’expérience artistique s’articule avec, et complète l’expérience philosophique. C’est pour cela aussi que des personnes comme Georges Bataille, Michel Foucault, Monique Wittig, Angela Davis, Judith Butler et Elsa Dorlin, notamment, me passionnent. Ils sont des penseurs essentiels, aussi parce qu’ils pensent la philosophie à travers le rapport du corps au monde. C’est pour cela que le champ chorégraphique, en ce qu’il pense le geste jusqu’à la danse, est un espace possible de recherche et de création d’une force extraordinaire.
JM Vos œuvres présentent différents types de marionnettes (celle du ventriloque dans The Ventriloquits Convention ou encore la marionnette humaine dans Showroomdummies). D’où vous vient votre intérêt pour cet instrument si particulier ?
GV Les premiers travaux liés à la marionnette sont ceux que j’ai pu découvrir à l’adolescence à travers le champ de l’art contemporain avec des artistes comme Cindy Sherman, Paul McCarthy ou encore Mike Kelley. Plus tôt, j’ai découvert les marionnettes à la télévision avec le « Muppet Show » ou encore « Télé Chat ».Ma mère étant autrichienne, j’ai passé une partie de mes vacances dans ce pays où j’ai vu, toujours à la télévision, des films d’animation tchèques et polonais qui mettaient en scène des marionnettes… Il y a quelques années j’ai assisté à la semaine sainte de Séville. Cette procession où l’on voit ces représentations de Jésus ou de Marie marchant sur les foules ressemble beaucoup aux premiers spectacles de l’histoire de la marionnette, tels qu’ils ont été décrits chez les égyptiens et les grecs. La marionnette est un art qui va de l’art sacré jusqu’aux expressions les plus déconsidérées. Je suis très sensible à l’aspect transgressif et à l’humour qui sont inhérents aux marionnettes. Je pense que la plus grande des transgressions peut passer par l’humour. Alors, il est vrai que je n’ai pas bâti ma réputation sur des œuvres comiques, mais pourtant, il me semble qu’il y a une forme d’humour dans ce que je fais. Étudier la marionnette, c’est moins chic que de se former au cinéma ou l’art contemporain, et pourtant, le bon goût, je trouve ça ennuyeux, et conventionnel. J’aime travailler la dissonance artistique, la contradiction qui sont des stimuli sensibles et théoriques très puissants. À partir d’une contradiction, on est obligé de penser.
Les poupées avec lesquelles je travaille représentent à une majorité écrasante des adolescents surtout, et des femmes. Principalement de taille humaine, principalement silencieuses et immobiles. J’essaie de comprendre davantage à travers mes travaux, à partir de ces expériences physiques, cette violence du regard désincarnant, qui provoque la présence ou l’absence d’un être à son corps. Ce sont autant de tentatives de perturber, pourquestionner les regards que nouspouvons porter sur notre corps et ceux des autres, ainsi que sur leur rapport à leur contexte. Il s’agit de questionner nos regards, dans leur capacité à participer ou à renverser la structure des rapports de pouvoir. Il s’agit de s’emparer de nos représentations pour nous définir autrement.
JM Ce numéro de Revue a pour thème l’illusion. Que ce soit à travers vos spectacles, mais aussi vos installations ou votre travail photographique, la question de la perception est primordiale.
GV Les questions liées aux cadres perceptifs sont au cœur de mon travail. Il s’agit de comprendre notre perception culturellement construite,c’est à dire ce langage que la culture va construire afin que nous puissions décoder le monde et échanger à travers un langage perceptif commun. Cette perception n’est toujours qu’une hypothèse, ce qui veut dire qu’il peut y en avoir d’autres. À partir du moment où on est capable d’en prendre conscience et de les décoder, on peut être proactif dans les déplacements perceptifs, et toucher ainsi aux problèmes que nous souhaitons résoudre, d’un point de vue structurel, c’est pour moi le cœur même des déplacements sociétaux.


Photographies d’Estelle Hanania
Pour en revenir à la marionnette, mais aussi au jeu d’acteur et des danseurs, les notions d’incarnation et de désincarnation posent la question de la manière dont on va percevoir son propre corps, celui des autres, et ceux anthropomorphes. Et par exemple, si l’idéal normatif tente de rendre invisible les mécanismes sociaux d’intériorisation des identités en les naturalisant, on peut ambitionner que l’acte théâtral, par sa théâtralité même, puisse en révéler l’artifice.
JM Si c’était de l’amour, D’après Crowd de Gisèle Vienne, film documentaire réalisé en 2020 par Patric Chiha, repose sur Crowd, dont la question de la perception est au centre. Il montre à la fois ce qui se joue sur le plateau et ce qui se passe en coulisses, c’est à dire les fictions inventées en collaboration avec Dennis Copper pour construire la pièce. Comment est né ce projet ? Avez-vous été surprise par les témoignages de vos interprètes?
GV Ce film est un documentaire sur ma pièce Crowd et sa tournée. Ayant trouvé une partie des fonds nécessaires pour le réaliser, j’ai proposé ce projet à Patric Chiha et à sa productrice.
Patric connaissait en partie les coulisses de mon travail, et le travail fictionnel et autobiographique réalisé pour la pièce. Par exemple, pour Crowd, nous avons développé avec Dennis Cooper une histoire spécifique pour chaque interprète. Depuis le public, nous ne les entendons pas parler, mais ces récits sont là. Ces histoires, pensées en collaboration avec les danseurs, sont plus ou moins fictionnelles, en ce qu’elles articulent, différemment pour chaque interprète le rapport du réel à la fiction. Ce rapport pose la question de savoir comment est-ce qu’on se révèle en parlant directement de soi, mais aussi à travers ce que l’on a envie de jouer, ou à travers le mensonge ou la fiction que l’on choisit. Je ne suis pas surprise par la plupart des témoignages des interprètes puisqu’ils déploient dans ce documentaire, la plupart du temps, ces fictions que nous avons inventées en collaboration avec Dennis Cooper. Ce qui est curieux, c’est que les pièces parlent de mon intimité, et tout autant de l’intimité des artistes qui y participent. Crowd est une œuvre très personnelle pour chacun des artistes qui y participent pour des raisons différentes. C’est notre œuvre à chacun. Une des comédiennes que l’on voit dans ce film, Kerstin Daley-Baradel, dont j’étais très proche et avec qui je travaillais depuis des années, est décédée à l’été 2019. Cela a été dramatique et dévastateur, et c’est beau qu’il reste ces traces. Son petit ami, au moment des funérailles me disait : « C’est une comédienne, lorsqu’elle est sur scène, ça n’est pas elle », ce à quoi j’ai répondu que ce n’était pas vrai. Elle n’était pas une autre personne sur le plateau, c’était elle, autrement. Un interprète, même s’il joue un rôle, n’est pas une autre personne, c’est une personne qui choisit de s’exprimer autrement, et il faut apprendre à écouter les personnes qui parlent aux travers d’autres langues.
JM Vous venez de finir le tournage d’un film au printemps dernier. Pouvez-vous nous en dire plus ?
GV Il s’agit de l’adaptation de ma mise en scène de Jerk, d’après une nouvelle de Dennis Cooper. On y retrouve le même comédien, Jonathan Capdevielle. La pièce est extrêmement performative, physique et technique. Il me semblait faire sens de filmer ce combat entre le comédien et ce personnage, et cette histoire d’une grande violence, semblable à un match de boxe, à travers un long plan séquence que l’on traverse de manière viscérale.
Ce film est aussi un chemin qui va du théâtre au cinéma. Où chacun de ces médiums, à travers cette histoire, permet d’interroger l’autre, dans le rôle qu’il a, en tant que médium même, dans la construction et la naturalisation des rapports de pouvoir. En rappelant fortement le film de genre, et le film d’horreur, c’est la fascination pour l’ultra-violence qui est explorée à travers des questions de rapports de domination, d’incarnation et de désincarnation des corps.
JM Beaucoup de personnes évoquent David Lynch en parlant de votre travail, une référence dont on abuse trop souvent pour évoquer l’étrange, mais qui a l’avantage de parler à un grand nombre. Pour aller plus loin, pouvez-vous nous dire quels sont les cinéastes qui vous inspirent ?
GV Ils sont nombreux, j’aime le cinéma d’Andreï Tarkosvki, et plus spécialement Solaris (1972), qui est un film auquel je pense très souvent. Dans mon travail, la lumière est très importante, pour beaucoup de raisons. C’est une matière qui est vraiment celle du temps. Jusqu’à maintenant, je l’ai beaucoup travaillée en faisant référence à des qualités de lumière naturelle, avec une grande passion pour les HMI. Pour L’étang, ma nouvelle création, j’ai utilisé des leds, et notamment un projecteur Ayrton. La lumière n’est plus celle du soleil, de la nuit et des nuages, mais celle des façades des centres commerciaux. Et là j’ai beaucoup pensé à Apichatpong Weerasethakul, notamment au magnifique Cemetery of Splendor (2015). Je travaille la lumière en faisant référence à celle que j’explore dans mon expérience du monde, je travaille sur la perception émotionnelle du temps tout comme celle de la lumière. Dans un registre très différent, j’aime beaucoup le travail de Bob Fosse, surtout parce que c’est l’un des grands chorégraphes de la fin du XXe siècle. Il a inspiré autant la danse contemporaine que la danse commerciale, de Michael Jackson à Beyonce qui l’ont plagié. J’aime beaucoup son dernier film, Star 80 (1983). J’adore le cinéma de Brian de Palma. Il y a des actrices qui me bouleversent, modifient mon regard sur le cinéma qu’elles interprètent et créent, comme Sissy Spacek, que l’on retrouve justement dans Carrie (1976) ou 3 Women (1977) de Robert Altman ou Delphine Seyrig. Jeanne Dielman, 23 quai du commerce, 1080 Bruxelles de Chantal Akerman est le film numéro 1 de mon top 50. Je pense souvent à Paris is Burning (1990), le documentaire culte de Jennie Livingston, dans lequel Dorian Corey dit, en parlant à la caméra, tout en se maquillant : « À partir du moment où tu peux passer auprès du regard lambda, ou même du regard aguerri, sans qu’ils décèlent que tu es gay, c’est là que c’est réel […] L’idée de réel, c’est de ressembler le plus possible à ton alter ego hétéro. C’est pas une imitation ou une parodie. Non, c’est être capable d’être vraiment cette femme. » Dorian Corey soulève là un sujet central: les images, en ce sens, ne nous représentent pas, c’est à nous d’imiter ces images qui définissent nos identités.
J’ai récemment trouvé magnifique Atlantique (2019), le film de Mati Diop. Autour de l’adolescence, j’ai adoré Naissance des pieuvres (2007) de Celine Sciamma, dont j’aime le cinéma et grâce à qui j’ai découvert Adèle Haenel, une rencontre artistique importante pour moi. J’ai aussi été très tourmentée par les films de Lukas Moodysson comme Fucking Amal (1998), qui est l’histoire d’une jeune romance lesbienne dans la province suédoise, et ensuite Lilya 4-ever (2002). D’un point de vue formel, Playtime (1967) de Jacques Tati ou L’année dernière à Marienbad (1961) d’Alain Resnais sur un scénario d’Alain Robbe-Grillet m’influencent beaucoup.
Pour en revenir à Lynch, ce que je trouve intéressant dans son cinéma, c’est que c’est celui du doute.

Un doute qui crée de la jubilation. Nous sommes dans une culture où la résolution, le sentiment de vérité, doivent apporter de la satisfaction. Où le cinéma est bien souvent au service d’un ordre en place et naturalise une perception culturellement construite pour maintenir un ordre, et avec lui les rapports de pouvoir en place.
Alors que les personnes qui rendent l’interrogation et le doute excitant et ludique nous font avancer intellectuellement et sensiblement dans notre compréhension et nos connaissances du monde. Et pour moi l’une des grande qualités de David Lynch est celle de tous les artistes qui endossent cette responsabilité majeure qui est de participer du questionnement et du déplacement perceptif.
JM Après avoir été maintes fois repoussée, L’étang est une pièce que l’on peut enfin découvrir. Qu’est-ce qui vous a motivée à adapter ce texte de Robert Walser ?
GV Nous avons commencé ce travail en 2016 avec la comédienne Kerstin Daley, ma proche collaboratrice de longue date. En 2018, Adèle Haenel nous a rejointes, avec une évidence qui semble magique, tellement elle est extraordinairement évidente. Il aurait dû être présenté en 2019 mais suite au décès de Kerstin Daley, tout a été remis en cause. Puis il devait être joué en décembre 2020 lors du Festival d’Automne, avec Adèle Haenel et Ruth Vega Fernandez qui nous a rejointes, mais il a été repoussé à cause de la pandémie. La première a finalement eu lieu en mai 2021 à Lausanne. Robert Walser, qui est un auteur suisse que j’adore, est l’un des premiers à avoir mis au cœur de sa littérature un personnage subalterne et des corps dominés. L’aspect subversif et politique de son travail rappelle celui que développe Deleuze dans Le froid et le cruel au sujet de Sacher-Masoch. « Nous connaissons tous des manières de tourner la loi par excès de zèle : c’est par une scrupuleuse application qu’on prétend alors en montrer l’absurdité, et en attendre précisément ce désordre qu’elle est censée interdire et conjurer. » L’absurdité en montre l’absence d’un projet juste, qui ambitionne de traiter tous les humains de manière égale, basé sur une logique qui démontre l’égalité des humains, et en révèle le projet injuste et autoritaire. Et c’est l’enjeu politique de ces lois injustes, qui peut en être révélé. L’étang est un texte qui correspond très bien au romantisme de la fin du XIXe siècle et qui résonne avec la culture romantique adolescente contemporaine qui s’exprime à travers la désespérance et le besoin vital de changement de société et des désirs de destruction.
Je suis extrêmement sensible à ces conflits, à ces douleurs, et à la créativité qui va autour. Quand on est dans ce type de désespoir, la créativité qui peut en découler, c’est le désir de vie.
Dans ce texte de Walser, il y a un espace immense accordé au silence. Avec L’étang, j’ai cherché à montrer ce que disent les corps à travers les immobilités et les silences. Ces silences, on nous apprend à ne pas les écouter, et nous nous devons de l’apprendre. Et je crois que le champ de l’art a son rôle à jouer dans le développement de notre acuité perceptive, pour enfin écouter ce que disent les corps mutiques et les corps empêchés, ceux qui parlent ou hurlent et que notre culture ne veut pas nous permettre d’entendre.
Maître du jeu
Iida Kazutoshi
Alors que le contexte actuel limite les déplacements de chacun, réduisant ainsi les moments de convivialité et de découverte, le jeu vidéo offre une alternative réjouissante. Si le succès de certains titres a permis aux consoles de s’intégrer dans de nombreux foyers et de dépasser – enfin ! – le discours infantilisant sur les dangers des mondes virtuels, il faut saluer le travail de créateurs qui ont fait du jeu vidéo un medium à part entière, nourri d’arts visuels, de sons et de narration. Iida Kazutoshi est de ceux-là. Rencontre avec un auteur aussi discret qu’inventif.
S’il est une figure respectée et connue des amateurs, il est pourtant peu probable que vous ayez déjà joué aux jeux d’Iida Kazutoshi. Toutefois, son approche innovante a permis de redéfinir les contours de l’expérience vidéoludique contemporaine. Né en 1968, Iida voit son adolescence marquée par l’arrivée de la borne d’arcade Space Invaders, les débuts de la saga Star Wars au Japon et de l’éclosion du punk rock. Ces trois cultures l’ont profondément marqué et ont nourri son esprit iconoclaste, avide de mondes nouveaux. À la fin de son adolescence, il décide de suivre une formation dans une école d’art où, grâce à l’arrivée des premiers ordinateurs, il se forme aux logiciels de dessin, subjugué par la liberté qu’ils offrent et leur rapidité d’exécution. Ce goût pour l’infographie amène ensuite à intégrer le monde du jeu vidéo.
Première particularité d’Iida, il n’a créé que trois jeux ; une parcimonie qui en dit long sur sa position face à la relation qu’entretient l’industrie du jeu vidéo avec la créativité et la surproduction. Sorti en 1995 sur PS1, la première console de Sony, Aquanaut’s Holiday nous met dans la peau d’un plongeur qui parcourt les profondeurs de l’océan pour le cartographier et échanger avec la vie sauvage, et ce, sans aucune limite de temps ou d’ennemis à affronter. Dans cette étendue bleue, sans repères ni actions claires à effectuer, les joueurs habitués aux quêtes linéaires sont décontenancés. À nos collègues du média Archipel, Iida Kazutoshi déclare : « Être face à un jeu que l’on ne comprend pas, mais au final apprendre à se connaître en jouant, voilà le type de jeu contemplatif que je voulais faire. » Suivra en 1996, et toujours sur PS1, Tail of the Sun. Alors que les critiques avaient qualifié son premier jeu d’élégant et de minimal, le concepteur décide de prendre le contrepied et met en scène un homme des cavernes qui lutte pour sa survie. Là aussi, la variété des actions que peut effectuer le joueur prime sur une narration autoguidée. Enfin, c’est en 1999 que paraît Doshin the Giant, sur la console N64 de Nintendo. Le joueur y incarne Doshin, le Géant de l’Amour dont la taille varie en fonction de ses actions et de l’affection que lui portent les villageois qu’il protège. À l’occasion de notre rencontre, Iida pointe le trait commun de ces trois titres aux univers très différents :

Iida Kazutoshi, Doshin the Giant, croquis préparatoires, 1998. Avec l’aimable autorisation d’Iida Kazutoshi. © Iida Kazutoshi
« Je pense que les jeux vidéo sont l’art de l’élaboration des règles. Avec mes propositions, l’idée était de minimiser les restrictions ressenties par les joueurs. »
Et il est vrai qu’un vent de liberté souffle sur ses jeux. De manière indéniable, ils ont ouvert la voie à de nombreux jeux au succès incontestable, d’Animal Crossing à la quête en « monde ouvert » Breath of the Wild, récente variation de la licence Zelda. On peut également citer Death Stranding, création d’Hideo Kojima sortie en 2019 sur PS4, proposition hybride entre jeu expérimental et blockbuster au casting hollywoodien (Léa Seydoux, Norman Reedus, Mads Mikkelsen ou encore Guillermo del Toro incarnent les différents protagonistes). La complexité de son scénario est équilibrée par les actions limitées du héros, que l’on pourrait résumer, non sans malice, à une « randonnée musclée ». Que pense Iida de ces variations autour du concept d’exploration libre ? « Si Aquanaut’s Holiday explorait le point de vue à la première personne en nous mettant dans la peau d’un océanographe, Tail of the Sun est directement lié au monde ouvert tel qu’on l’entend aujourd’hui puisqu’il met en scène des personnages avec qui on peut réellement interagir. À l’époque, la notion de ‹ monde ouvert › n’existait pas mais j’étais convaincu que les jeux vidéo allaient évoluer dans cette direction. Depuis, de nombreuses œuvres sont apparues et ont confirmé mon intuition, je me sens rassuré ! »
Aujourd’hui enseignant dans le département vidéo de l’Université Ritsumeikan de Kyoto, Kazutoshi Iida partage sa connaissance du milieu du jeu vidéo. Dans son cours intitulé « Game Making Practice », il fait intervenir des professionnels du kamishibai, terme que l’on peut traduire par « pièce de théâtre sur papier », un style narratif japonais qui prend la forme d’une scène miniature et ambulante, proche du théâtre de Guignol, mais où les marionnettes sont remplacées par des images. Contrairement à la page tournée d’un livre, chaque nouvelle séquence du kamishibai apparaît en s’intégrant dans la précédente. On comprend aisément l’intérêt de ces techniques narratives rudimentaires mais ingénieuses dans la construction d’un récit. Iida demande ensuite à ses élèves de développer une histoire, de dessiner les images correspondantes, puis d’imaginer un contenu interactif. Il est également en charge d’un cours intitulé « Exercices de base du dessin ». Il y est question d’aiguiser son sens de l’observation afin de traduire au mieux les attitudes et expressions visuelles des différents composants d’un jeu, qu’il s’agisse des décors ou des personnages. Une fois ces éléments maîtrisés, que faut-il pour rendre une œuvre unique ? À cette question, Kazutoshi Iida développe :« Les jeux vidéo sont à la fois un art visuel et une expérience. Aujourd’hui, l’expérience est biaisée par le display, c’est à dire l’écran et les interfaces qui nous permettent de jouer. Je pense que les dix prochaines années vont vraiment être consacrées à repenser ces dispositifs. Récemment, de nombreux sujets importants ont fait leur apparition dans le jeu vidéo. Si le parallèle n’est pas évident, le titre Detroit: Become Human prédit l’intensification du mouvement Black Lives Matter. Red Dead Redemption 2 a pour personnage principal un hors la loi, en 1899, qui a conscience des règles morales et dont les actions, qu’elles soient bonnes ou mauvaises, ont un impact sur le déroulé du récit. The Last of Us 2 est un autre très bon exemple. En fusionnant de grands sujets sociétaux, quasi littéraires, aux interactions qu’offrent le médium du jeu vidéo, une nouvelle forme d’expression artistique est en train d’émerger. » Évidemment curieux, Iida aime autant jouer aux titres issus des premières générations de console qu’aux récentes grosses productions. À ceux qui n’ont pas la culture du jeu, il recommande ceux précédemment cités, mais également le très populaire Grand Theft Auto V (sorti en 2013 sur PS3 et Xbox 360) :



Extraits du jeu Doshin the Giant (Kyojin no Doshin), développé par Param et Nintendo, sorti au Japon le 1er décembre 1999. Designer : Kazutoshi Iida.
« Il est fantastique ! Dans ce jeu à monde ouvert, vous pouvez avoir le sentiment de devenir une ville plutôt qu’une personne, et c’est assez incroyable. » Devant les écrans, puisque tout est permis, évadons-nous !
TEXTE DE JUSTIN MORIN
Henky Dunky
Herr Seele
Fruit de l’imagination 100 % belge du duo Herr Seele et Kamagurka, Cowboy Henk est un personnage désarmant. Sa logique toute personnelle l’amène à vivre des aventures hilarantes, tenant autant de l’humour surréaliste que de la poésie absurde. Né il y a quarante ans, Henk affiche une silhouette musclée, une chevelure blonde ainsi qu’un sourire ultra-blanc mais déjoue tous les stéréotypes. En quelques cases, ses auteurs parviennent toujours à créer la surprise. Publiées sous forme d’album reliés, auréolées de plusieurs prix, les aventures de Cowboy Henk semblent pourtant réservées à un public d’initiés. Cette rencontre avec Herr Seele, dont les pinceaux donnent vie à Henk, permettra certainement de partager l’un des plus excitants secrets de la culture belge.
JUSTIN MORIN
J’ai découvert votre travail en 2014, grâce au prix du patrimoine que vous avez obtenu au prestigieux Festival d’Angoulême. J’ai été séduit par la couverture de vos albums, et à la lecture, j’ai aimé votre sens du découpage, les attitudes décalées de Cowboy Henk et bien évidemment, cet humour absurde. Il y a autre chose que j’ai adoré, et qui est pourtant presque invisible. Il s’agit du motif qui sépare la couverture de la première page, et qui reprend le profil de votre personnage en le multipliant à l’infini, dans une alternance de bleu et de rouge. On dirait une peinture d’art optique, un peu comme si Bridget Riley faisait un rêve psychédélique ! Je me demandais donc quel était votre rapport à l’art.
HERR SEELE
Ma mère a étudié la céramique et la peinture, c’était une artiste professionnelle. Enfant, j’allais dans son atelier, c’est un environnement avec lequel j’étais familier. J’ai fait des études à l’École des Beaux-Arts de Gand. C’était une pleine période conceptuelle, c’était pas mal ! Je me souviens que nous avions visité la Documenta 6, en 1977, où j’ai pu découvrir le travail de Joseph Beuys que j’ai trouvé génial. D’ailleurs, l’album qui s’intitule L’humour Vache a été traduit en allemand par Jeder Mensch ist ein Cowboy (Chaque homme est un cowboy), en référence à sa fameuse citation « Chaque homme est un artiste ! » J’adore son œuvre, c’est un grand penseur et je trouve qu’il y a aussi beaucoup d’humour dans son travail. Mais c’est certainement l’un des rares artistes conceptuels que j’apprécie vraiment. Je suis plus attiré par le surréalisme !
JUSTIN MORIN
Je crois que vous avez eu un parcours professionnel atypique.
HERR SEELE
Tout à fait. Comme je l’ai dit plus tôt, je ne me reconnaissais pas dans l’art conceptuel qui était en vogue à l’époque. Pour moi, c’est un courant qui consistait plus à réfléchir à l’art qu’à en faire. Dans cette optique, pendant mes études, j’ai eu envie de pratiquer un métier concret, comme menuisier ou boulanger. Et puis je suis tombé sur une annonce qui disait : « Devenez luthier au pays de Galles. » J’y suis allé ! C’était pendant l’été 1978, en pleine période punk anglaise, ça m’intéressait beaucoup. Mais la formation de luthier était déjà pleine, donc on m’a proposé de devenir accordeur de piano ! Le cursus était prêt, deux professeurs étaient venus spécialement de Londres, mais il n’y avait pas d’élève. Je suis devenu accordeur de piano, une profession absurde, par des circonstances encore plus absurdes ! Tout cela m’a amené à avoir une grande connaissance de cet instrument, je suis aujourd’hui organologue. Je suis aussi devenu collectionneur de piano, je possède plus de 250 pièces.
JUSTIN MORIN
Cowboy Henk va fêter ses quarante ans d’existence en septembre prochain. Comment expliquez-vous sa longévité ?
HERR SEELE
C’est presque autant que la longueur de vie de Tintin, qui fait son apparition à la fin des années 1920 et dont la dernière aventure, Tintin et les Picaros, date de 1976. Cowboy Henk a commencé comme une sorte d’anti-bande dessinée. Il a tout d’abord été publié en 1981 dans le journal néerlandophone Vooruit, devenu par la suite De Morgen. À partir de 1983, il a été publié chaque semaine dans l’hebdomadaire flamand Humo, jusqu’en 2011 car la rédaction voulait du changement. Mais deux ans plus tard, il a fait son retour !

Herr Seele, Cowboy Henk Nature.
Huile sur toile, 80 × 100 cm, 2015, propriété de l’artiste.

Publié dans l’hebdomadaire Humo — n˚3394, 20 septembre 2005.
Tout ça pour dire que c’était vraiment un humour particulier, comme un humour « pas drôle ». Au début, le public détestait notre travail mais ça ne nous a pas empêché de continuer. Je crois que c’est ce qui explique pourquoi Cowboy Henk est toujours là !
Nous avons aussi créé quelques histoires longues que l’on peut retrouver aujourd’hui sous forme d’albums. En France, à nos débuts, nous avons notamment collaboré avec le journal Hara-Kiri. Nous allions de Gand à Paris dans une petite voiture 2 CV que Kamagurka conduisait pendant que je jouais du violon ! C’était fascinant et excitant car cela nous a permis de côtoyer des auteurs que nous adorions, comme Wolinski ou Cabu, mais aussi les gens qui les entouraient, comme Serge Gainsbourg ou Coluche. Ces rencontres sortaient vraiment de l’ordinaire, j’ai eu beaucoup de chance. De la même manière que j’ai eu beaucoup de chance de rencontrer Kama.
JUSTIN MORIN
Justement, pouvez-vous revenir sur votre collaboration ?
HERR SEELE
Notre rencontre a quelque chose d’une aventure religieuse, un peu comme la vie de saint François d’Assise : tu rencontres quelqu’un et tu travailles toute ta vie avec ! Nous sommes un duo d’artistes, nous avons fait de la télévision, du théâtre, des bandes dessinées, de l’art aussi.Nous travaillons ensemble depuis plus de quarante ans, et je pense que cela s’explique en partie car nous n’avons jamais eu un énorme succès commercial. Nous avons toujours été dans l’underground, et nous aimons ça ! Nous nous sommes rencontrés pendant nos études. Il était dans la même école, dans le département animation, mais n’y est pas resté longtemps. C’est à la gare que nous avons sympathisé, car il lisait le journal Hara-Kiri justement ! Moi je lisais Kafka et Heidegger, car j’ai toujours aimé la philosophie. Nous avons échangé sur nos lectures.
Nous avons trois ans d’écart, et je me souviens que déjà à l’époque, nous racontions des petites histoires à l’aide des cabines photomaton de la gare et leur planche de quatre photographies !
JUSTIN MORIN
Comment travaillez-vous ensemble ?
HERR SEELE
Kama est à l’écriture et moi au dessin, mais tout se mélange.
JUSTIN MORIN
Pouvez-vous nous en dire plus sur votre manière de travailler ? Vos planches ont-elles la même dimension que vos albums reliés ?
HERR SEELE
Non, ce sont des formats plus grands. Je travaille sur des grandes pages de papier très épais. J’aime l’encre sur le papier. Je ne suis pas fort pour les techniques infographiques. Récemment, nos planches ont été recolorisées à l’ordinateur par Lison d’Andrea et Jean-Louis Capron qui ont fait un superbe travail. Mais pour nous, c’est la blague qui est plus importante que l’esthétisme. C’est sans doute pour cela que nous faisons cela depuis si longtemps et que nous n’avons toujours pas fini ! Nous aimerions aussi faire une nouvelle histoire longue. La difficulté que nous rencontrons, c’est que nous essayons d’être spirituels avec notre art tout en voulant faire rire les gens.
JUSTIN MORIN
Est ce qu’il y a des planches que vous décidez de ne pas publier parce que vous n’êtes pas satisfaits ?
HERR SEELE
Non, une fois que le scénario est fait, on va le faire et le publier. Il faut dès le départ que nous soyons persuadés que c’est une bonne blague, sinon, nous l’abandonnons !
JUSTIN MORIN
Sur quoi travaillez-vous en ce moment ?
HERR SEELE
Je suis actuellement dans mon atelier, à Ostende. De ma fenêtre, je peux presque voir la mer du Nord ! Je suis très inspiré par la nature, j’aime la peindre ! Pour en revenir à votre question, je suis en train de créer une affiche pour une exposition sur la bande dessinée et qui réunira plusieurs auteurs d’avril à septembre prochain et qui s’intitulera Marginalia, dans le secret des collections de bandes dessinées, au Nouveau Musée National de Monaco. Et puis j’ai un grand projet ici : je travaille à l’ouverture d’un musée qui présentera à la fois une partie de ma collection de pianos, notre travail avec Kamagura, et qui pourra aussi accueillir des expositions temporaires d’autres artistes ou collectionneurs. Il y a notamment des collections fantastiques et atypiques, sur des objets du quotidien comme des ciseaux, ou des papiers d’emballage de charcuterie des années 1950, que l’on ne voit jamais et qui sont pourtant incroyables !
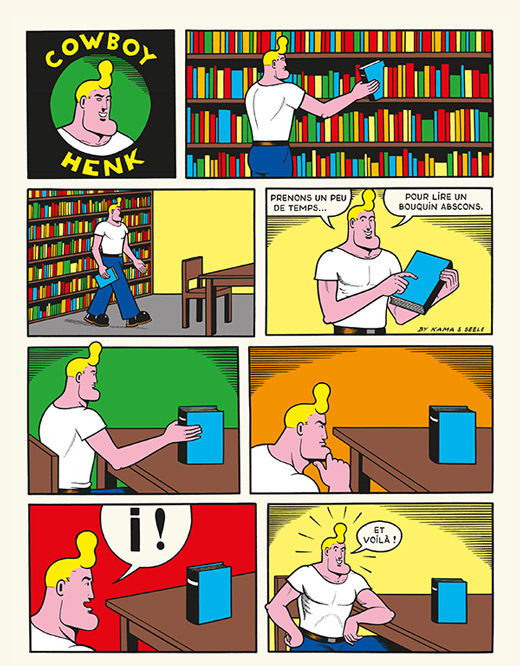
Publié dans l’hebdomadaire Humo — circa 1993.

Publié dans l’hebdomadaire Humo — n˚3901, 9 juin 2015.
Le bon mot
Julia Peker Panayotis Pascot
Quand l’absurdité du quotidien frappe, l’humour reste le meilleur allié pour prendre de la distance. Bienveillant ou caustique, analytique ou grossier, ses innombrables nuances en font un outil rhétorique aussi complexe que fascinant. Révélé à la télévision, l’humoriste Panayotis Pascot s’épanouit désormais sur scène. Entre nonchalance et confidence, son spectacle Presque aborde la question de l’amour en virevoltant d’une anecdote à l’autre, tout en jouant de ruptures entre grave et léger. Dans l’ouvrage Cet Obscur objet du dégoût (Éditions le Bord de l’eau), la philosophe Julia Peker souligne la dimension variable du goût, et par effet de miroir du dégoût. Elle pointe notamment les ressorts comiques de l’obscène. Pour Revue, nos deux invités s’interrogent sur les mécanismes du rire.
Panayotis Pascot
J’ai grandi dans une famille où nous regardions beaucoup la télévision durant le week-end, plus particulièrement les programmes consacrés aux humoristes. C’est là que j’ai découvert Raymond Devos et Pierre Desproges. C’est ce que j’appelle « les humoristes en costume ». C’était une génération qui entretenait un lien assez fort avec la littérature, le mot avait un rôle très important, presque précieux. C’est mon premier rapport avec l’humour.
Julia Peker
Moi, je pense que ma rencontre avec l’humour est plutôt passée par le cinéma lorsque j’étais enfant. Le cinéma burlesque m’a beaucoup fait rire. C’est plus tard que je suis venue à l’humour pur, déconnecté de l’œuvre d’art, dans sa pure jouissance. Et là, je peux également citer Desproges que j’ai aimé pour son jeu avec la langue, cette manière d’être tout le temps sur une ligne de crête. Et je retrouve cette même saveur dans l’humour de Blanche Gardin, où chaque mot est choisi, chaque virgule pesée, mais où tout peut se retourner à tout moment. Un peu comme si l’on marchait au bord d’un précipice.
Panayotis Pascot
Avec ces personnes, on sait qu’en tant que spectateur, on peut les suivre car ils retomberont toujours sur leurs pieds ! On peut marcher le long de la falaise, on est en confiance ! On sent le vide avec eux, à tout moment tout peut basculer et c’est ça qui est agréable.
Julia Peker
Cette sensation du vide, c’est quelque chose qui m’a toujours étonnée dans le dispositif du one man show. L’humoriste seul sur scène. Il est seul avec sa blague, qui est lâchée, hors de tout contexte. Et il y a la possibilité du vide. Du bide même !
Panayotis Pascot
Ça m’est arrivé ! On est tous passés par là ! Je rebondis sur ce que tu dis par rapport au vide. Ce qui m’a attiré dans l’humour, c’est cet aspect.
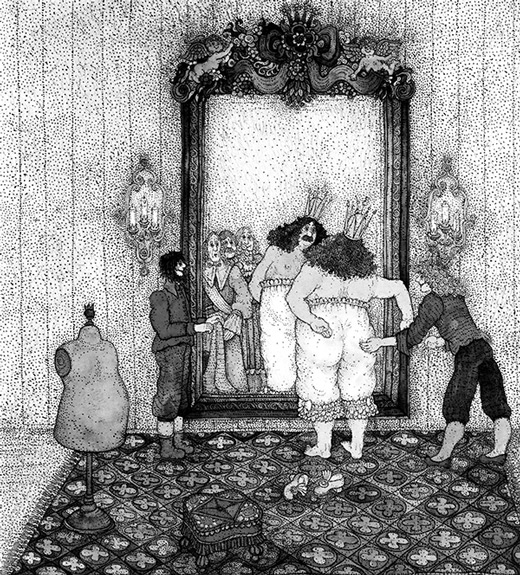
Illustration de Monika Laimgruber, extraite du livre Les Habits Neufs De L’empereur, édité en 1979 par Flammarion.
Avant, je travaillais à la télévision, mais j’ai décidé de me consacrer à la scène. Ça veut dire concrètement qu’il faut passer par des Comedy Club, pour se roder, tous les soirs, parfois plusieurs fois par soirée. C’est très dur car tu peux jouer face à des types qui sont saouls à 23 heures, ou alors face à un public de cinq ou six personnes. L’importance du vide est vraiment très contrastée par rapport à la télévision, où l’on est dans un petit confort.
Julia Peker
Sur scène, il n’y a pas de décor, rien à quoi se raccrocher.
Panayotis Pascot
Il n’y a rien ! On est vecteur de notre fond et pour autant il n’y a pas de forme ! C’est ça qui est très bizarre. C’est ça qui est assez flippant pour autant. Je précise qu’il y a une différence entre un one man show et ce que Blanche ou moi faisons, qui est du stand up. Le stand up casse le quatrième mur, là où le one man show l’utilise, comme au théâtre. Le public est derrière un mur et regarde, un peu comme un voyeur. Alors que le stand up s’adresse directement à la salle, ce qui est encore plus effrayant.
Julia Peker
Cette question de l’adresse n’est pas toujours facile à comprendre pour le spectateur qui n’est pas initié d’ailleurs.
Panayotis Pascot
C’est vrai ! Mon frère a ouvert avec l’humoriste Fary un Comedy Club, à Paris, rue Berger. L’espace a été dessiné par l’artiste JR. Comme lui et Fary sont des personnes très médiatiques, le public qui se rend là-bas ne sait pas toujours ce qu’il va y voir, ni les codes de ce genre de lieu. Parfois ça fonctionne, d’autres fois non. C’est intéressant de voir que pour ceux qui découvrent, il y a souvent une bascule qui opère au milieu de la soirée. Ils comprennent qu’on s’adresse directement à eux sans qu’il y ait de dialogue.
Julia Peker
C’est à dire ?
Panayotis Pascot
On parle directement aux gens dans le public, mais ça reste un dialogue. « Je parle sur scène et vous me répondez par vos rires, et je m’en nourris. » À l’inverse, s’il n’y a pas de rire, je vais m’aligner sur cette énergie. Une fois qu’on comprend ça, c’est quasi sexuel. Quand on sent qu’on a la confiance des spectateurs, on peut aller n’importe où.
Julia Peker
Comment travailles-tu le rythme de tes spectacles ?
Panayotis Pascot
C’est assez compliqué. Il y a quelques temps, j’ai fait une représentation dans une grande salle et je savais que dans le public se trouvaient des personnes qui me sont chères. J’étais très stressé. Tout s’est bien passé, hormis le rythme. Ce spectacle dure normalement une heure et quinze minutes. Ce soir-là, je l’ai fait en une heure et cinq minutes. J’ai tout ratatiné,il n’y avait plus de respiration. Les gens ne pouvaient pas me rejoindre.
Si on en revient à cette analogie un peu étrange du rapport sexuel, c’est un peu comme lorsque ton partenaire est trop rapide. Même si tout est super bien fait, ça ne peut pas fonctionner. Ça fait quatre ans que je fais ce métier et je commence à peine à comprendre ce genre de choses. C’est seul et sur scène que l’on se forme.
Julia Peker
La scène humoristique a un statut très particulier. C’est à la fois un lieu de sociabilité, où un humoriste s’adresse à un public, dans un univers culturel avec des références, et c’est en même temps le lieu de transgression. C’est le lieu de l’expression de l’agressivité comme nulle part ailleurs. Je ne pense pas qu’il y ait beaucoup d’autres occasions de transgresser à ce point la bien-pensance et de faire valoir la dimension d’agressivité, cette donnée constitutive presque anthropologique qui a été mise en évidence par la psychanalyse, et qui est le rapport de l’homme à l’homme.
Panayotis Pascot
Je pense que l’humour a pour vocation de relancer les dés sur des sujets qui ont déjà été traités, quels que soit ces sujets, qu’ils soient transgressifs ou non. Les regarder sous un autre angle.
Julia Peker
Ce que tu dis me fait penser à ce conte d’Hans Christian Andersen, Les Habits Neufs de l’Empereur. Un empereur souhaite se faire tisser la plus belle parure du monde. Un beau jour, deux escrocs arrivent dans la ville de l’empereur et prétendent savoir tisser une étoffe que seuls les sots ne peuvent pas voir. Ils proposent au souverain de lui confectionner un habit. L’empereur accepte et les brigands se mettent au travail. Quelques jours plus tard, il vient pour constater l’avancée du travail mais ne voit rien, car il n’y a évidemment rien ! Il décide de n’en parler à personne, car personne ne voudrait d’un empereur idiot. Il envoie des ministres qui eux aussi ne voient rien, mais n’osent pas le dire. Tout le monde parle de cette étoffe merveilleuse. Le jour où les deux escrocs décident que l’habit est terminé, ils aident l’empereur à s’habiller pour une parade auprès de la foule… Personne n’ose rien dire, tout le monde s’exclame devant ces vêtements invisibles, sauf un petit garçon qui lâche la vérité : « Le Roi est nu ! » Et ça rejoint ce que tu disais par rapport à l’intimité ! On est dans quelque chose de très fort qui est de l’ordre de la mise à nu.
Panayotis Pascot
Si j’y crois, vous y croirez.
Julia Peker
Il se joue un décalage des points de vue. Il y a quelque chose aussi sur le semblant qui est très fort dans le stand up, c’est qu’on a l’impression que tout est improvisé alors que l’on sait tous très bien que c’est un texte méticuleusement écrit. C’est comme une sorte de pacte.

Illustration de Monika Laimgruber, extraite du livre Les Habits Neufs De L’empereur, édité en 1979 par Flammarion.
Revue
Qu’est-ce qui vous fait rire ?
Panayotis Pascot
En ce moment, les annonces gouvernementales me font rire à chaque fois.
Julia Peker
C’est vrai que de faire une attestation sur l’honneur pour pouvoir sortir acheter sa baguette de pain…
Panayotis Pascot
Ou avoir la possibilité d’aller au ski mais ne pas avoir le droit d’utiliser les remontées mécaniques… Je sais aussi que c’est horrible, mais Donald Trump m’a aussi beaucoup fait rire. Ce qui me fait penser à ce qu’on appelle « la maladie de l’humoriste ». Il y a un excellent documentaire qui s’intitule Laughing Matters – visible en ligne – qui montre que les humoristes sont parmi les catégories socio-professionnelles les plus sujettes à la dépression et au suicide. Un humoriste a une sorte de recul ; puisqu’il doit trouver des blagues, il est toujours en train d’analyser ce qui se passe.
Julia Peker
C’est là où il y a aussi cette frontière qui est très ténue entre l’obscène et ce qui peut être sur scène. On en revient à ce voile du semblant : tout l’enjeu est de donner à voir une mise à nu des semblants, et de rétablir quand même un voile. C’est là où c’est une forme d’art : il s’agit de trouver ce point où l’on peut basculer d’un côté ou de l’autre – soit l’obscénité, soit le conventionnel.
On en revient à ce voile du semblant: tout l’enjeu est de donner à voir une mise à nu des semblants, et de rétablir quand même un voile. C’est là où c’est une forme d’art : il s’agit de trouver ce point où l’on peut basculer d’un côté ou de l’autre – soit l’obscénité, soit le conventionnel.
Revue
Panayotis, comment se passe l’écriture de vos spectacles ?
Panayotis Pascot
Pour le coup, je n’écris pas ! Je monte sur scène avec une idée et je me lance devant les gens. Bien évidemment ensuite je rode les choses, mais je n’écris jamais avant de monter sur scène. En fait, je fonctionne beaucoup au pistolet sur la tempe : j’arrive à trouver des blagues quand je dois me forcer à en trouver.Je suis devant les gens et si je ne suis pas marrant, ils vont vouloir me tuer avec des fourches donc il faut absolument que je sois marrant. C’est très instinctif au final.
Julia Peker
Est-ce que tu peux me raconter le fil narratif de ton spectacle, Presque, puisqu’avec ces confinements et ces couvre-feux, il est difficile de le voir !
Panayotis Pascot
Ah oui c’est vrai ce spectacle a une drôle de vie ! Presque est lié à ma vie intime car il concerne une question que je me suis posée pendant un moment. J’étais très amoureux d’une fille et je n’arrivais pas à l’embrasser. Même si je voyais qu’elle en avait envie et que tout allait bien, je n’y arrivais pas. J’explique que depuis tout petit, embrasser est une action qui me terrifie et qui m’effraie. J’ouvre le spectacle là-dessus. Ma première phrase est : « Je ne sais pas embrasser les filles et je ne sais pas pourquoi. » J’y réponds en abordant plusieurs points, notamment mon éducation et mon rapport à mon père. Premier volet ? Mais tout ça, ce sont des vraies questions que j’ai eues dans ma vie et que j’ai eu envie de raconter sur scène. J’ai détricoté ! Ça m’a aidé à avancer et à progresser. Maintenant, tout va bien !
Julia Peker
J’évoquais plus tôt le cinéma burlesque. Et toi, quel genre de cinéaste te faire rire ?
Panayotis Pascot
J’aime Wes Anderson, plus particulièrement Fantastic Mr Fox. Je pense aussi aux Monty Python, qui m’ont toujours beaucoup fait rire. Dans un registre moins visuel, j’aime aussi Judd Apatow. Il aborde souvent des choses très intimes ou des questionnements existentiels quasi métaphysiques, mais avec un regard très singulier. Et puis des fois, des films qui ne sont pas censés faire rire ont l’effet inverse sur moi, comme le cinéma de Lars Von Trier. The House that Jack Built, j’ai trouvé ça extrêmement marrant. Et toi, quels films te font rire ?
Julia Peker
Dernièrement j’ai revu Fais moi plaisir d’Emmanuel Mouret. J’ai beaucoup aimé! C’est vraiment un film qui va de situations burlesques en situations burlesques. Ici, un homme découvre par l’intermédiaire d’un ami le pouvoir d’une phrase notée sur un morceau de papier… Grâce à elle, il va séduire malgré lui une femme, ce qui va l’amener à se retrouver dans des situations rocambolesques ! Je te le conseille si tu as envie de légèreté !
Corps à cœur
Regina DeminaFrançois Chaignaud
Naviguant entre plusieurs champs artistiques, au croisement de la danse, du chant et de la performance, les pratiques de François Chaignaud et de Regina Demina hybrident joyeusement les formes pour mieux faire valser les étiquettes. Habitué des collaborations, interprète caméléon, le chorégraphe François Chaignaud se réinvente à chaque nouvelle proposition en puisant dans l’Histoire, qu’il s’agisse de celle de la danse, de la musique ou du féminisme. Regina Demina dessine quant à elle une mythologie personnelle, déployant ses récits à travers des vidéos, des installations et la scène, dans un captivant jeu de miroirs où tout semble se répondre. Pour Revue, les deux artistes reviennent sur leurs parcours et leur conception du beau.
Regina Demina
Je t’ai vu pour la première fois dans Radio Vinci Park, ta collaboration avec l’artiste Théo Mercier. Ce spectacle m’avait subjuguée. Ce que tu es capable de faire, ce que tu dégages, ça m’a vraiment marquée. Un peu plus tard, je t’ai revu sur la scène du Cabaret de Madame Arthur, et là aussi, j’ai été impressionnée par ta présence scénique.Je n’ai pas fait le rapprochement immédiatement tant les deux personnages que tu incarnais étaient différents. Ça n’est qu’après que j’ai compris que c’était la même personne qui m’avait procuré toutes ces émotions !
François Chaignaud
Je crois que nous avons échangé pour la première fois à l’occasion du spectacle d’Aymeric Bergada, chez Madame Arthur, où tu avais un rôle de policière ! On s’est ensuite écrit sur les réseaux sociaux ce qui m’a permis de découvrir ton travail musical, même si je n’ai jamais eu le plaisir de te voir en live. Ça nous a amené à discuter sur la méditation, une pratique qui peut sembler éloignée des contextes très extravertis dans lesquels on s’est rencontrées !
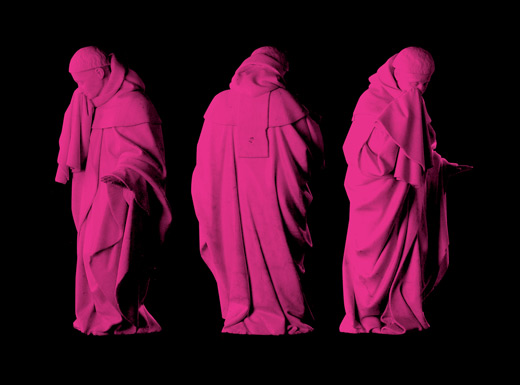
Sophie Jugie, The Mourners: Tomb Sculpture from the Court of Burgundy, Yale University Press, FRAME, Musée des Beaux-Arts de Dijon, 2010. Photographies de François Jay.
Ça m’a amusé de pressentir qu’on partageait ce goût à la fois pour ce qui scintille et ce qui discipline, ce qui élève et ce qui maquille !
Il n’y a d’ailleurs pas nécessairement d’opposition entre ces mondes, entre ces intentions : il s’agit toujours d’explorer, de dévoiler différentes dimensions, différentes versions de soi ! Je crois que tu fais beaucoup de yoga aussi, n’est-ce pas ?
Regina Demina
Oui. Et de la méditation alliée au chant. Parfois je chante en méditant et d’autres fois je médite en écoutant des chants. Même si ça peut paraître ridicule, le principe d’alignement des chakras fonctionne très bien pour moi ! Je suis quelqu’un d’assez dispersé, et dès que je visualise ces formes symboliques, ça m’aide à me concentrer et à m’apaiser !
François Chaignaud
Es-tu nerveuse avant de monter sur scène ?
Regina Demina
Juste avant, oui. Mais je suis nerveuse de nature ! Je sais que le temps de préparation est important, mais il ne faut pas qu’il soit trop long car plus j’attends, et plus je suis impatiente. J’ai juste envie d’être sur scène. Et toi?
François Chaignaud
Je ressens de la nervosité surtout avant d’entrer en répétition ou en création : le moment de fabrication, avant qu’un spectacle n’existe, est la phase la plus déstabilisante, un miroitement inconfortable. Mais avant d’entrer en scène et surtout si c’est un spectacle déjà créé et joué, je ne me sens pas nerveuse, plutôt concentré et éparpillée à la fois, excité aussi car c’est en jouant, en étant sur scène que mon art s’active, s’accomplit. Je me sens comme avant un date avec un.e amant.e que je connais : il y a de l’inconnu, et de la promesse, du focus et de la légèreté, la visualisation d’un script détaillé et l’ouverture à ce qui peut arriver !
Regina Demina
Je comprends ! J’aime les formes perfectibles car elles me rassurent, elles permettent de se rôder tout en laissant une place à l’improvisation, une liberté de se réinventer sans tomber dans quelque chose de mécanique. Moi je viens de la performance. J’ai commencé par faire une école de théâtre et de danse et pour me payer cette formation, je travaillais en tant que go-go. Même si ça n’est pas un public classique, ça reste une audience qu’il faut appréhender. J’ai ensuite été acceptée au Fresnoy, une École Nationale qui est axée sur la production audiovisuelle et numérique. Et toi, quelle a été ta formation ?
François Chaignaud
Pour moi, c’est un peu différent car j’ai eu un parcours très académique. J’ai commencé la danse à l’âge de sept ans au Conservatoire à Rennes. À quatorze ans, je suis monté à Paris au Conservatoire supérieur et j’en suis sorti alors que j’avais à peine vingt ans. J’ai tout de suite travaillé avec les chorégraphes de la génération 2000, comme Alain Buffard, Boris Charmatz, Emmanuelle Huynh ou encore Gilles Jobin. Ma pratique a été sculptée par cet aspect à la fois académique et institutionnel qui est lié à la façon dont la danse « professionnelle » s’est structurée historiquement en France. J’ai vite eu conscience qu’accéder à ces lieux (conservatoire, centres chorégraphiques, institutions) est une sorte de privilège : ce sont des studios, des moyens, de la visibilité. Mais qu’il y a aussi le risque de se laisser aveugler par ces contextes, d’oublier qu’il existe plein d’autres manières et de raisons de danser ou de faire de l’art qui n’ont rien à voir avec les conservatoires et les scènes nationales ! Je trouve très important d’essayer de se connecter à d’autres motivations qui peuvent passer par des aspects différents, des motivations plus spirituelles, plus festives, plus rituelles ou plus intimes. Tu parlais de go-go ; à l’époque, quand j’ai commencé à travailler avec Cecilia Bengolea, elle faisait beaucoup de strip-tease et moi un peu d’escorting. Ça me paraissait très important de retisser les proximités entre la danse, la mise en scène de soi et le travail du sexe ! J’aime beaucoup confronter mes pratiques à d’autres types d’expressions, qui ne sont pas issues du monde un peu spéculatif de la danse contemporaine ! En ce moment, je suis très attirée par la collision entre des motifs très réels, très performatifs et des langages, des références, des évocations issues d’archives très anciennes, du haut moyen âge !
Et toi, tu reviens de Poitiers je crois. Qu’est-ce que tu y présentais ?
Regina Demina
C’est à la fois une exposition personnelle et un spectacle qui ont lieu au centre d’art le Confort Moderne. Dans ma pratique, tout est lié. Mes installations ou mes sculptures sont souvent des traces de performance ou de scénographie. Le projet s’intitule CRAUSH, c’est la contraction des mots « Crush » et « Crash ». J’y développe sous une nouvelle forme Alma et Crush for Crash, deux pièces existantes, ainsi que Phaeton, en les liant par le film et l’installation ASMR-Sick of Love et Rdoll-AsMR. Tout se complète, il y a des allers-retours entre les formes et les propositions. Pour résumer ce projet, je dirais qu’il s’agit d’un cycle de pièces qui questionne l’origine de la violence.
François Chaignaud
Est-ce que la matière sonore de ces pièces va devenir un album ?
Regina Demina
L’album que j’ai sorti en juin 2020 est né de cette manière. C’est un mélange de morceaux que j’avais réalisés pour différentes pièces et qui ont été retravaillés. Je pense que je procéderai différemment pour le prochain, sur lequel je réfléchis déjà. Il y aura certainement un ou deux titres qui arriveront avant, en introduction.
REVUE
Quelles images sont pour vous synonymes de beauté ?
François Chaignaud
Ah ah ! C’est une question piège, non ? Évidemment il n’y a pas d’art qui ne problématise pas cette notion de beauté ! Et la danse moderne puis contemporaine a beaucoup mis en crise cet aspect décoratif, ornemental, superficiel… Pourtant avec cette période de théâtres fermés, et de débat sur l’art essentiel, je rêve de plonger profondément dans l’ornementation, comme promesse d’une abstraction et d’un au-delà ! J’adore ce mot « ornementation » qui évoque d’ailleurs la souveraineté de l’interprète dans la musique baroque ou jazz. Je pense aussi aux phrasés : quel que soit le geste, le phrasé rééquilibre la tension entre maîtrise et abandon, et peut produire une forme de beauté, quelle que soit la forme !
Regina Demina
Ça serait des gestes qui ont une grâce.
François Chaignaud
Oui, à propos de grâce, j’ai récemment commandé plein de livres sur les pleurants des tombeaux des ducs de Bourgogne – un ensemble de statuettes réalisées au cours du XVe siècle. On y voit des pleurants tout petits, dans toutes sortes d’attitudes de déploration, avec des drapés de marbre, des grosses ceintures, des accessoires magnifiques. Il y a de très beaux gestes, comme la manière de détourner les yeux ou d’épauler la tête. Je regarde aussi beaucoup les représentations des résurrections de Lazare, j’aime scruter les personnages qui se pincent le nez.
Regina Demina
Pourquoi se pincent-ils ?
François Chaignaud
Car Lazare ressuscite et pue ! J’adore cette présence organique de la charogne, de la puanteur dans ces images de grande beauté !
Regina Demina
Je pense qu’on se rejoint car je suis très attirée par le romantisme morbide.
Je suis touchée par une forme de beauté souffrante. Je pense que c’est lié à mon enfance. Je suis russe, fille d’immigrés, j’ai grandi en banlieue. Si ce terme ne dit pas grand-chose, je me retrouve malgré tout dans ce que l’on appelle le « white trash », même si c’est souvent décrit comme une esthétique du moche. J’aime les choses que l’on qualifie de mauvais goût.
Pour autant, j’aime la joliesse pour la joliesse. J’aime par exemple les photographies de Guy Bourdin, où les femmes sont comme des sublimes poupées. Quand je suis émue ou troublée par quelque chose, c’est souvent parce que je trouve ça beau.
François Chaignaud
Ce qui me plaît dans la danse, c’est lorsque l’on peut produire une image de grâce tout en ne masquant pas l’effort qui est nécessaire à sa construction. J’aime beaucoup ce type de beauté où l’effort nécessaire à son avènement est aussi partagé.
Regina Demina
Je suis d’accord.
François Chaignaud
Dans Radio Vinci Park, il y a plein de moments où, quand je suis à bout de souffle, je laisse ce temps exister. Je ne masque pas la difficulté. Je me sens moins proche de l’idéal classique – ou capitaliste on pourrait dire – de la facilité, de la fluidité : comme lorsqu’on achète un iPhone, on ne voit pas la fabrication, efforts et injustices… beaucoup de formes d’art plus classiques gomment le labeur, la difficulté : il faut que les choses aient l’air faciles, effortless… Ne pas masquer l’effort, c’est ouvrir la promesse de plus d’empathie avec le public…
Sinon y a-t-il des artistes avec qui tu aimerais collaborer ?
Regina Demina
Ma liste est loin d’être exhaustive mais en chorégraphe, je suis admirative de Gisele Vienne qui a une approche totale. J’adorerais aussi rencontrer Kim Petras et faire de la musique avec elle ! Je suis fan également du cinéma d’Abel Ferrara et de celui de Dario Argento. Côté musique, j’aime les artistes du label PC Music, comme Hannah Diamond. Et toi ?
François Chaignaud
En t’entendant, je réalise que si la collaboration est au cœur de ma pratique, elle ne naît jamais d’un désir strictement personnel, mais d’une rencontre. Mais j’admire cette démarche qui est d’aller chercher les gens ! J’adore la danse et le spectacle vivant, qui sont des pratiques de la consumation, mais j’ai souvent aussi le rêve de tresser mon art à des médiums moins fugaces ! D’ailleurs cet été, j’ai enregistré la musique de mes deux derniers spectacles pour en sortir des disques ! Mais ce sont des musiques très anciennes, médiévales ou baroques ! J’ai aimé cette dynamique de l’enregistrement, comme j’aime celle du film. Je vais bientôt tourner pour la réalisatrice Marie Losier, et c’est aussi quelque chose qui m’excite. J’ai envie de faire plus d’images, de cinéma, de films. Pour en revenir au son, je trouve génial la manière dont tu articules ton travail de performance avec la musique.
Regina Demina
Tu sais, je t’ai entendu chanter une version de « Mwaka Moon », le titre de Kalash avec Damso, et il faudrait que tu l’enregistres car je l’ai adorée, j’en parlais encore récemment ! Elle est mieux que l’originale !
François Chaignaud
Pourquoi pas ! J’adorerais faire une chanson pop, mais pas forcément une reprise.
J’ai toujours utilisé la musique dans un rapport historique, pour véhiculer quelque chose de fantomatique. J’ai hâte d’écrire mes propres musiques, je sens que c’est sur le bout de ma langue !
Enfant, j’écrivais beaucoup ! J’ai écrit et enregistré cinq albums!
Regina Demina
Comment ça?
François Chaignaud
J’avais un petit synthétiseur, je faisais la voix principale et les chœurs, j’enregistrais sur cassette !
Regina Demina
Ça serait bien de faire quelque chose avec si tu les as encore !
François Chaignaud
Ça sonnait un peu comme… du J. LO champenois !
Regina Demina
Mais c’est fantastique, tu attises ma curiosité, j’ai envie d’entendre ces anciens morceaux… et ceux à venir !
Microcosmos
Anicka Yi
Difficile de décrire l’œuvre d’Anicka Yi tant la pratique de l’artiste se déploie à travers des médiums variés et peu conventionnels. Au croisement de la science, de la parfumerie et de l’installation, ses propositions bousculent les sens. Mais au-delà de la surprise qu’elles suscitent, elles donnent surtout à revoir nos conceptions de notions importantes comme le vivant, l’éphémère, le genre ou encore le visible et pointent les paradoxes que suscitent certaines définitions. Si son approche conceptuelle et plastique est célébrée par le monde de l’art depuis plusieurs années, la pandémie actuelle offre un éclairage particulier, plus ample et aigu, à ses recherches. Organismes vivants, mutations, frontières, autant de questionnements artistiques qui se reflètent avec persistance dans notre quotidien bouleversé. Elle s’entretient ici avec Hamid Amini autour des différents axes de son travail.
Vous avez mentionné que vous n’êtes pas « accablée par les paramètres historiques de l’art », et en effet votre travail – et votre trajectoire en tant qu’artiste – est, faute d’un terme mieux adapté, unique. Sachant cela, comment vivez-vous le fait que vos créations soient interprétées et historicisées par les critiques contemporains ?
Quand je donne à voir une de mes créations, j’accepte qu’elle vive sa propre vie, qu’elle devienne un organisme à part entière. Je ne contrôle pas vraiment la façon dont elle sera interprétée ou reçue, donc j’accepte cette part d’incertitude et de mutation dans la création artistique. Un de mes rêves est de proposer mon travail en open-source. N’importe qui pourrait le télécharger, l’ajouter à sa propre création artistique et lui donner une nouvelle vie. Je m’intéresse beaucoup à ce type de pollinisation artistique croisée. Bien que je ne contrôle pas le contexte dans lequel mon art est reçu, il y a selon moi une relation symbiotique entre la réception et la production de l’œuvre artistique. Mon travail répond à un contexte donné et vice versa. Il y a donc une sorte de réciprocité évolutive.
Une grande partie de ce qui définit votre pratique – la collaboration, l’amitié, l’hygiène, le théâtre et l’odeur – a été complètement bouleversée par la pandémie de Covid-19. L’odeur en particulier (ou l’absence d’odeur) est une caractéristique majeure du virus. Certains de vos projets actuels répondent-ils à ce sentiment de privation sensorielle et sociale ? Votre projet pour la salle des machines de la Tate, annoncé en mars 2020, a été mis en suspens. Ressemblera-t-il à ce que vous aviez imaginé avant la pandémie ? Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet ?
Oui, en fait, le projet pour la salle des machines de la Tate s’intéresse directement à l’air en tant que substrat matériel pour la sculpture dans un site vecteur d’un discours politique, social et économique. La pandémie de Covid-19 nous montre comment les molécules présentes dans l’air et les molécules d’odeur transmettent des informations invisibles et microscopiques entre les êtres humains, les autres organismes et l’environnement.

Anicka Yi, -30,000 yr pleistocene park, 2018. Mousse haute densité, résine, peau de serpent et cadre. 129 × 104 × 6,3 cm
Le monde invisible des molécules dans l’air peut exciter notre appétit, déterminer notre choix de partenaire ou nous rendre gravement malades. L’air contient nos tensions et nos angoisses. Nous tenons pour acquise notre capacité olfactive et nous ne comprenons pas comment l’odeur modifie notre perception du monde. L’air qui nous entoure comporte un risque social et un risque biologique. Mais je crois que c’est dans le risque que la création artistique s’épanouit.
Les modifications que nous avons faites dans l’œuvre sont assez subtiles. Nous avons surtout dû adapter notre façon de travailler afin d’être plus flexibles et de nous coordonner à distance. Les idées de départ, pré-pandémiques, peuvent parfaitement s’appliquer, peut-être même davantage aujourd’hui. Mais les thèmes du projet de la Tate sont très pertinents et il est nécessaire de les aborder, avec ou sans pandémie.
J’aimerais en savoir plus sur votre pratique en atelier, êtes-vous confinée dans un espace clos ? Comment naviguez-vous physiquement entre les aspects cliniques et les aspects naturels (l’odeur étant abondante dans la nature) de votre pratique artistique ?
Notre atelier est plus décentralisé maintenant, nous avons une organisation moléculaire plus dispersée. Comme notre équipe de base est très réduite, nous ne pouvons pas prendre le risque que plusieurs membres tombent malades en même temps. Heureusement, j’ai conçu l’atelier de façon à ce qu’il soit très souple et adaptable. Je n’ai jamais été une fan de l’intelligence consanguine ou trop ciblée. Avec les conditions de travail du XXIe siècle, nos compétences sont fragiles et nous devons constamment basculer, passer à des compétences plus vastes et acquérir des connaissances complexes. C’est pourquoi le travail à distance, numérique, la collaboration intime entre continents avec différents fuseaux horaires, est l’une des compétences que nous avons acquises cette année.
Vous avez travaillé comme styliste de mode à Londres. Comment pensez-vous que le temps s’écoule actuellement dans votre création ? Considérez-vous votre ligne de parfum Biography comme une œuvre d’art ? Il est intéressant de savoir comment vous envisagez la fusion des deux…
J’aborde le parfum Biography de la même manière que mes autres projets artistiques. Biography est né de mon questionnement philosophique sur la subjectivité et la féminité. Pendant des années, j’ai été obsédée par Fusako Shigenobu, ce mystérieux personnage historique dont l’identité changeante et le rôle politique défiaient les genres, les frontières nationales et les normes de la moralité. Elle m’a semblé être la métamorphe par excellence, celle qui défiait les frontières le plus radicalement. En développant les idées autour de Biography, j’ai analysé avec de plus en plus de précision la perméabilité des frontières : entre la nature et la culture, entre les espèces, et entre l’individuel et le collectif.
Je n’ai aucun contrôle sur le fait que Biography soit perçu comme de l’art, mais pour moi, il n’y a pas de réelle distinction puisque ce parfum et mes œuvres relèvent du même processus de création. Avec Biography j’espère rendre l’œuvre d’art plus accessible, permettre à des personnes extérieures au milieu des collectionneurs d’en posséder chez elles. Les bouteilles d’eau de parfum sont des sculptures uniques et elles sont proposées en différentes éditions. Nous ne sortirons pas deux fois le même flacon. Chaque nouvelle version sera une sorte de série limitée.
Dans le numéro précédent de Revue, nous avons eu une discussion avec Barnabé Fillion. Pouvez-vous nous expliquer la nature de votre collaboration ? Comment travaillez-vous ensemble ? Pourriez-vous également nous expliquer le concept qui sous-tend votre ouvrage 6 070 430 K of Digital Spit ?
Barnabé et moi avons collaboré à de multiples installations au fil des ans. Nos projets commencent toujours par de longues discussions philosophiques. Nous discutons ensemble de différentes idées comme celles qui précèdent et nous soulevons de nouvelles questions. Quelle est l’odeur de l’apatridie ? Ou quelle est l’odeur du pouvoir des personnes gender fluid ? Nous discutons pendant des heures, puis nous nous efforçons de traduire ces idées sous forme matérielle et moléculaire. Nous échangeons généralement de nouvelles idées, des composés odorants et des prototypes de parfums au cours du processus.
Avec 6 070 430 K of Digital Spit, j’ai voulu proposer un livre « burn after reading » tel que je le conçois. C’était ma première monographie et je n’avais pas envie qu’elle illustre ma pratique artistique comme un processus figé. Cela me semblait trop réducteur. J’ai donc voulu créer une archive éphémère et provisoire. J’ai essayé de saisir l’odeur des sept dernières années de mon travail, qui est libérée lorsqu’on brûle le livre. De cette façon, on peut lire l’œuvre, la sentir et la laisser redevenir immatérielle. Il s’agit de transformer la matière.
PROPOS RECUEILLIS PAR HAMID AMINI

Anicka Yi, Your Face Tomorrow, 2013. Savon glycérine, résine époxy, perles déshydratantes, tube en vinyle, peinture acrylique, tige acrylique, silicate de sodium, crème hydratante Prada, boîte de Petri, cellophane, feuille d’acétate, peinture en aérosol. 116 × 86 × 3,8 cm.

Anicka Yi, Beyond Skin — Volume 3, 2019.Acrylique, parfum et insectes. 12,5 × 5,4 × 2,6 cm

Anicka Yi, Lung Condom, 2015. Savon, peinture, acétate, résine et tube caoutchouc. 45 × 35 × 5 cm
Effet et Optique
Tauba Auerbach
Tauba Auerbach et moi nous connaissons depuis presque 20 ans. Je l’ai rencontrée à l’époque où elle était étudiante à l’université de Stanford, ou peut-être à l’époque où elle travaillait à la galerie Luggage Store à San Francisco. Dans cette conversation, j’ai eu envie de me concentrer sur différents aspects de sa pratique actuelle. Après une formation en peinture et en dessin, le design et l’artisanat ont toujours été essentiels dans ses créations. C’est dans ce contexte qu’est né son intérêt pour la symbologie, les mathématiques, la science et les systèmes de logique en général,et l’expérimentation en atelier. Cette confluence de compétences et de curiosité l’amène à explorer des concepts qui viennent nourrir ses créations empreintes de poésie. En parallèle de son travail en atelier, Tauba Auerbach a fondé Diagonal Press (en 2013), où elle propose des livres, des caractères typographiques inédits, et divers objets. Elle vit et travaille à New York.
Bob Linder
Nous nous sommes rencontrés pour la première fois quand tu vivais dans la région de la baie de San Francisco. Je me souviens avoir vu tes premiers lettrages exposés au Luggage Store, chez Adobe Books, à la Jack Hanley et à Needles and Pens, ainsi que les travaux de ton exposition d’étudiante de premier cycle à l’université de Stanford.
Tauba Auerbach
Je me souviens aussi de toi à cette époque… Je me rappelle avoir vu Total Shutdown à plusieurs reprises, dans trois des quatre endroits que tu as mentionnés, je crois. Je me souviens aussi de ton étonnante vidéo au Luggage Store lorsque j’y travaillais le vendredi.
Bob Linder
Quand on observe tes créations, il est difficile de ne pas y voir un modèle d’abstraction. Je pense en particulier aux œuvres Fold, Grain, et Extended Object sur toile. Je ne pense pas que l’expressionnisme abstrait d’après-guerre soit important pour toi, mais je suis curieux de savoir comment l’abstraction elle-même (au sens phénoménologique ou littéral) se glisse dans l’œuvre, et quel rôle elle joue .
Tauba Auerbach
J’aime l’abstraction parce qu’elle est utile et généreuse. Elle est utile comme l’algèbre – on peut transformer des détails en concepts universels ou en théories. Un nombre est remplacé par x, qui peut représenter n’importe quel nombre, et à partir delà on peut étendre son raisonnement, à partir de tous les nombres possibles à la fois. Je sais qu’il y a là une raison vraiment théorique d’aimer l’abstraction, qui peut sembler un peu froide, mais cela me réchauffe vraiment le cœur de penser que ce processus est applicable dans n’importe quel domaine. Je pense aussi que l’abstraction est féconde, car elle ne nous dit pas ce que nous devons penser, et qu’elle offre de nombreuses possibilités à la fois.

Tauba Auerbach, HA HA 1, 2008. Gouache sur papier. 76,2 × 55,9 cm. © Tauba Auerbach. Avec l’aimable autorisation de Standard (Oslo), Oslo.
Bob Linder
Je crois comprendre que les mathématiques et la science sont une source d’inspiration fondamentale pour toi, mais peux-tu nous parler un peu de la façon dont les événements actuels tels que la pandémie, la naissance du mouvement Black Lives Matter, et la politique en général influencent tes créations artistiques ?
Tauba Auerbach
Je dirais d’abord que la science et les mathématiques sont très présentes dans les questions sociétales dont tu parles. Les données relatives à la pandémie et à l’élection offrent deux exemples de mathématiques extrêmement politisées. Le racisme se manifeste dans la pratique de la médecine, dans les essais de bombes, dans la programmation d’algorithmes prédictifs…
Je ne veux pas mettre la science et les mathématiques de côté quand j’observe ce qui se passe dans le monde sur le plan social.
Mais pour répondre à ta question, je suppose que l’actualité de cette année s’est manifestée dans mon travail sous forme de cartes. Je suis surprise d’avoir une réponse aussi claire à cette question ! Mais il ne s’agit pas d’une trajectoire directe, c’était la convergence de plusieurs directions de mon travail.
Avant la pandémie, je m’intéressais à la projection des sphères, en observant différentes images de sphères représentées à plat. Il existe de nombreuses façons de procéder, toutes cohérentes d’un point de vue mathématique, mais toutes déformées. Il est impossible d’aplatir une sphère sans déformer la direction, l’échelle, la forme ou la distance. Il suffit de choisir. C’est ce qui ressort de la cartographie du globe terrestre.
En parallèle, je voulais mener des recherches sur l’histoire du terrain sur lequel est construit mon atelier – je suis propriétaire du rez-de-chaussée d’un petit bâtiment dans le Lower East Side et j’ai des sentiments partagés quant à la privatisation de l’espaceet à la propriété foncière en général. Je voulais récolter le plus d’informations possibles sur ce lieu et la manière dont il a été utilisé, cultivé et dessiné au fil du temps. Qu’est-ce qui fait sa valeur ? Au début du véritable confinement, j’ai essayé de trouver des activités qui permettraient à mon unique employée à plein temps de travailler à distance, alors j’ai décidé de lui demander d’entamer cette recherche (merci, Allison !). Pendant plusieurs mois nous avons travaillé en « ping-pong » sur un document en le complétant au fur et à mesure de nos découvertes. J’ai bien entendu étudié beaucoup d’anciennes cartes de Manhattan. J’ai appris que le premier propriétaire connu de cette parcelle était un ancien esclave affranchi à qui on avait offert quelques terres pour avoir été un bon « capitaine », en 1647. Une douzaine d’autres personnes réduites en esclavage ont reçu au même moment leur « liberté partielle » et des terres de la part des Hollandais dans une bande de terre qui traversait Manhattan d’est en ouest. Ces fermes et leurs habitants noirs servaient de tampon entre la colonie hollandaise au sud et le peuple Lenape au nord, que les Hollandais avaient repoussé de la pointe de l’île. En effectuant quelques recherches, on comprend le potentiel extrêmement violent de la cartographie – la manière dont elle est utilisée pour déplacer, effacer et voler. J’ai commencé à suivre des conférences sur la cartographie critique et la cartographie queer.
Cet été, j’ai regardé beaucoup de conférences de Ruth Wilson Gilmore et, en tant que géographe, elle aborde souvent la relation entre racisme et localisation dans l’espace. Je dois dire que la notion de « lieu » avait toujours été très vague pour moi, mais quelque chose dans la pandémie – l’expérience du confinement dans un endroit unique, tout en partageant cette expérience à l’échelle mondiale – l’a fait apparaître sous un jour nouveau pour moi.
Je pense que tout cela a changé mon intérêt pour la projection des sphères en intérêt pour la projection du globe terrestre. C’est une des rares fois où je suis passée du général au spécifique, en fait. Nous sommes habitués à un nombre réduit de représentations de l’image de la Terre. La projection la plus courante, celle de Mercator, fausse considérablement l’échelle et donne l’impression que le Groenland a presque la taille de l’Afrique (ce qui est très loin d’être vrai). Mais comme je l’ai dit, aucune projection n’est exempte de distorsion, et chaque cartographe apporte ses priorités et ses préjugés sur la table à dessin, et ceux-ci sont immédiatement traduits dans la géométrie (ainsi que dans la dénomination et tout autre choix opéré au cours de son travail).
Un autre élément important à prendre en compte quand on s’intéresse au globe terrestre, c’est le découpage. On doit découper la surface de cette sphère pour pouvoir l’aplatir, et l’endroit situé de part et d’autre de la section est non seulement fractionné mais aussi poussé vers les bords de la carte, qui sont généralement les plus déformés. La subjectivité d’un cartographe s’exprime à nouveau dans le positionnement de cette coupe.
Au cours de mes recherches, je suis tombée sur le merveilleux travail de l’océanographe et géophysicien Athelstan Spilhaus qui a réalisé des cartes où la priorité était donnée aux océans. Il opérait le découpage le long des frontières naturelles, les littoraux par exemple, plutôt que sur une ligne droite au milieu d’un océan ou d’un continent. Il effectuait plusieurs projections selon différentes rotations, puis les assemblait à des endroits où elles coïncidaient stratégiquement, c’était extrêmement astucieux. Je voulais reconstruire ses cartes pour vraiment comprendre comment les projections étaient orientées et alignées les unes par rapport aux autres sur la carte, puis les assembler, etc. J’ai donc entrepris ce travail tout en réalisant beaucoup de projections inhabituelles, de mon cru, qui brouillent généralement de manière significative le regard qu’on porte sur la Terre. Je l’ai fait à l’aide d’un logiciel que j’ai commandé à un programmeur qui proposait déjà un outil similaire sur son site web (merci Jason Davies !). J’en ai peint une partie à la main pour une exposition à Oslo cet automne, et j’en ai imprimé beaucoup d’autres sur papier, que je livre pliées, à la manière d’une carte, via Diagonal Press.
Je ne pense pas être qualifiée pour réaliser des cartes politiques qui abordent par exemple les questions de frontières de pays contestées, mais je peux peut-être proposer du matériel qui change la façon habituelle (produit d’un endoctrinement ? de la colonisation ?) de voir le monde et aide à percevoir la Terre d’une façon nouvelle.
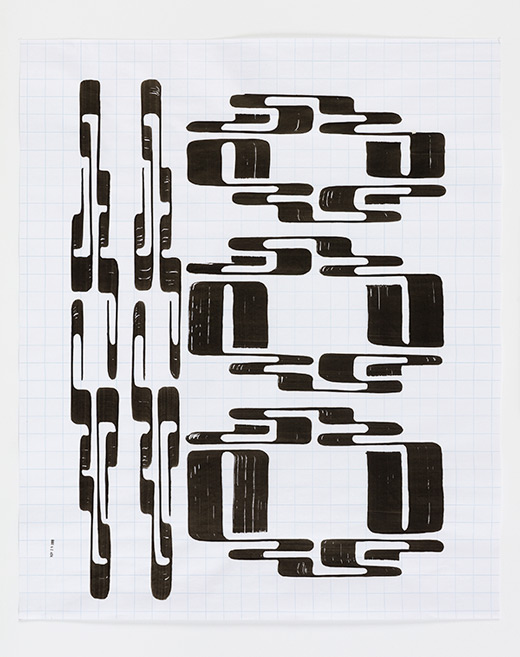
Tauba Auerbach, Ligature Drawing, 24 November 2019, 2019. Encre sur papier avec tampon dateur. 81,3 × 68,6 cm. Photo: Steven Probert. © Tauba Auerbach. Avec l’aimable autorisation de Paula Cooper Gallery, New York.

Tauba Auerbach, Untitled (Fold),, 2010. Acrylique sur toile. 121,9 × 84 cm. © Tauba Auerbach. Avec l’aimable autorisation de Paula Cooper Gallery, New York.
Bob Linder
Le son et la musique s’intègrent dans ton travail de nombreuses façons, à grande comme à petite échelle – dans Auerglass, l’harmonium à deux musiciens créé en collaboration avec Cameron Mesirow, dans The Safety Curtain de l’Opéra d’État de Vienne ou encore dans la composante audio de ton exposition collaborative avec Éliane Radigue au MOCA de Cleveland, ainsi qu’à travers plusieurs pochettes de disques. Je peux même voir un flux musical se glisser, ou s’introduire, dans tes lettrages et certaines séries de tableaux comme Grain works ou Extended Object (mes préférés). Je suis curieux de connaître ta relation avec la musique et avec les musiciens. La musique t’inspire-t-elle ? Écoutes-tu de la musique lorsque tu travailles ? Exerce-t-elle, selon toi, une influence sur ton activité créatrice ? As-tu déjà pensé au son en tant que matériau ?
Tauba Auerbach
La musique me touche plus facilement que les arts visuels. J’ai pratiqué des instruments et chanté quand j’étais enfant, mais je déteste jouer. Je me suis donc progressivement éloignée de la création musicale et je suis maintenant une auditrice heureuse. Je crois que je compte plus de musiciens que d’artistes visuels parmi mes amis. J’aime bien collaborer avec eux ou participer à leurs créations en réalisant des illustrations pour leurs albums. J’ai dessiné des tracts pour la station de radio de mon université… Je suppose que peu de choses ont changé ! Par exemple, depuis mes 14 ans, la plus grande partie de ma vie sociale consiste à assister à des concerts. Cela me manque vraiment dans le contexte de la pandémie. Et je m’inquiète beaucoup pour mes amis qui gagnent leur vie en donnant des concerts ou en travaillant dans des clubs !
J’écoute souvent de la musique pendant que je travaille, mais j’ai parfois besoin d’un silence total, quand j’écris, par exemple. En fait j’aime bien dessiner en musique. Récemment, avec celle d’Ocrilim, Ka Baird ou Mulatu Astatke par exemple. La musique peut vraiment modifier notre état, et une grande partie de la création artistique consiste à se mettre dans un état propice à la réalisation de ses projets. J’ai voulu travailler avec Éliane parce que sa musique m’a beaucoup appris sur l’écoute, la patience, la mise au point et le respect de la matière première.
Cependant, je ne considère pas le son comme un matériau en soi – et je pense que tu donnes à ce mot un sens différent de celui dans lequel je l’ai utilisé tout à l’heure –, mais j’ai l’impression que je perçois le son avec tout mon corps, qu’il passe par ma peau autant que par mes oreilles.
Bob Linder
Qu’écoutes-tu en ce moment ? Que lis-tu ? Est-ce que ce sont des plaisirs coupables ou est-ce qu’ils trouvent leur place dans ton travail ?
Tauba Auerbach
Aujourd’hui, j’ai écouté Phew, Milford Graves, qui vient de décéder récemment, plusieurs cassettes de mon amie Bunny Jr, et un peu d’opéra.
Je suis en train de lire Leonora Carrington et Karen Barad.
Bob Linder
Le magazine Revue, qui publie cette interview, est avant tout un magazine de mode. J’ai toujours su que tu t’intéressais à la manière dont on se présente aux autres. J’aimerais savoir comment la mode peut intervenir dans tes créations, les améliorer ou les parfumer. C’est peut-être un point de rencontre entre l’esthétique, le design et la pratique conceptuelle ?
Tauba Auerbach
En fait, je ne réfléchis pas vraiment à ce que je porte. Mais je crée de manière compulsive et j’ai toujours fabriqué moi-même une grande partie de mes bijoux et de mes vêtements. J’aime les tissus, donc au fil du temps, je me suis constitué une garde-robe(pour l’instant réduite) qui sort de l’ordinaire. Mais j’aime créer des objets que les vêtements permettront de diffuser – ce que j’appelle des « sartorial marginalia » [notes de marge vestimentaires] – pour Diagonal Press : des broches et des objets qui ornent le corps ou qui suivent ses contours. Je viens de créer des chaussettes. Les dessins proviennent d’ornements, de motifs existants ou de concepts mathématiques qui donnent à voir d’autres aspects de mon travail. Ça peut paraître idiot, mais j’ai conçu les chaussettes avec la même sincérité et le même sérieux que quand je crée un tableau. J’ai développé un réel dégoût pour la « mode » entre guillemets, mais j’aime vraiment les vêtements et je pense qu’ils peuvent avoir beaucoup de sens, à bien des égards. J’entends par là que si un rectangle sur un mur peut avoir du sens, une paire de chaussettes le peut aussi. Et que « sous la forme d’une chaussette » (hahaha), je pourrais faire passer le concept de chiralité ou de « main » géométrique directement sur un corps, ce qui me semble encore plus approprié.
Bob Linder
Peux-tu nous parler de ton intérêt pour les archives ? Ton dernier catalogue S v Z (conçu pour accompagner ton exposition rétrospective, reportée, au Musée d’art moderne de San Francisco) couvre 16 ans de ta carrière. Un des aspects fascinants de ce catalogue (en dehors de sa beauté sculpturale et de sa typographie énigmatique), c’est la façon dont tes précédents ouvrages y sont représentés, comme un dossier documentaire, refermé ou aplati, comme si l’objet lui-même était absent et que ce qui reste, pour ainsi dire, ce sont les données.
Tauba Auerbach
Je n’avais jamais fait d’exposition rétrospective auparavant et examiner tous mes anciens travaux pour les organiser s’est avéré être un vrai défi. J’ai beaucoup de mal à ordonner mes idées, en général. Elles semblent toutes se connecter en réseau, de manière détournée. Le processus a été très instructif. Et cette année de réflexion supplémentaire due à la Covid m’a vraiment permis de franchir une nouvelle étape.
Tu as raison de dire que choisir des travaux pour les réunir dans un livre peut être un défi – on doit en quelque sorte les montrer de plusieurs manières – on doit voir à la fois la couverture et une partie du contenu. C’est l’une des raisons qui m’ont incitée à proposer deux sections dans le catalogue qui retrace ces années de travail. Dans la première, tout est présenté de façon très claire et dans l’intégralité de sa conservation. Et dans l’autre, je propose des gros plans, des ouvrages connexes ou du matériel de recherche connexe, et si c’est un livre, on voit quelques pages intérieures et des détails de la reliure.

Tauba Auerbach, Shatter I, 2008. Peinture acrylique et poussière de verre sur panneau, 162.56 × 120.65 cm © Tauba Auerbach.
Bob Linder
Je suis curieux de connaître ta relation avec Internet.
Tauba Auerbach
Une relation amour/haine, probablement assez banale. Je n’ai jamais eu Facebook. J’aime Instagram environ 25 % du temps, mais je ne peux pas non plus me donner la peine de l’utiliser régulièrement, alors je le consulte quand j’en ai envie. Certes je suis connectée toute la journée, je fais des recherches au fur et à mesure que des questions se présentent, mais je n’ai pas pris l’habitude de poser des questions sur Internet avec des phrases complètes.
Bob Linder
Je sais que tu travailles avec des fabricants et des assistants, mais tu es une artiste très manuelle. Ton atelier est-il un lieu d’expérimentation ou crées-tu de manière plus systématique ?
Tauba Auerbach
Pas du tout systématique, probablement à mon détriment. L’atelier comporte beaucoup d’espaces différents entre lesquels je navigue,et il contient beaucoup d’outils, d’équipements et de tables couvertes de piles de livres, de dessins et de boîtes.
J’ai une employée à temps plein qui porte plusieurs casquettes, mais qui m’aide surtout à ne pas me perdre au niveau administratif, et j’ai aussi une employée à temps partiel responsable de la production pour Diagonal Press. Ce sont des personnes merveilleuses et talentueuses (merci Allison et Kathleen !), mais je n’aspire à rien d’autre en tant que « patronne ».
Je ne veux pas « diriger une entreprise » et je veux fabriquer moi-même mes œuvres autant que possible, donc en ce qui concerne la collaboration avec des fabricants, je sous-traite le moins possible.
En général, il s’agit de travail du métal ou de découpes sur une machine à commande numérique (merci Michael DeLucia !). Si je peux apprendre à fabriquer un objet moi-même et faire en sorte de pouvoir le réaliser dans mon studio, je le fais. Après avoir commandé une pièce en verre, j’ai appris à travailler au chalumeau pour pouvoir sculpter le matériau moi-même. Je viens d’installer un four à verre dans mon sous-sol, c’est super !
Je veux surtout être seule dans mon atelier pour pouvoir réfléchir. Je passe beaucoup de temps à faire des recherches et à créer des choses que je ne montrerai jamais à personne ou qui n’ont pas de finalité précise. Je viens de passer des heures à rédiger un document détaillé sur un processus de tissage, que je n’ai envoyé qu’à cinq personnes. Je crois beaucoup à ce genre de travail en tant qu’investissement dans le développement de la pensée, et « être productif » peut signifier beaucoup de choses. De plus une idée mérite-t-elle d’être tenue à une distance critique ?
Bob Linder
Peux-tu donner aux lecteurs une idée de tes projets pour 2021 ?
Tauba Auerbach
Une série d’interviews – dans lesquelles je poserai les questions !
Tout en un
Thomas Bayrle
Figure influente et pionnière, l’artiste allemand Thomas Bayrle (Né en 1937, il vit et travaille à Francfort) s’inscrit comme une référence importante pour plusieurs générations d’artistes, tant par son activité d’enseignant (Il a été professeur à la célèbre Städelschule de 1975 à 2002), que par sa participation à de grandes expositions internationales (Documenta 3, 6 et 13, 50e Biennale de Venise, etc). Au fil des ans, Bayrle a construit une œuvre extrêmement cohérente, qui tend vers l’obsession tout en combinant de manière unique sa fidélité au Pop art, à l’art conceptuel et à l’Op art. Devrim Bayar, curatrice au centre d’art bruxellois Wiels, qui a travaillé avec l’artiste en 2013 et 2014, s’entretient avec lui pour connaître son point de vue sur le « grand bouillon actuel », évoquer ses réalisations passées et recueillir ses conseils pour notre avenir commun.
Devrim Bayar
Notre monde traverse une crise sans précédent avec la pandémie de Covid-19 qui a paralysé la planète et provoqué un effondrement économique et humanitaire mondial, mais aussi, sur le plan sociopolitique, avec le mouvement Black Lives Matter qui enflamme les États-Unis et se répand dans de nombreux autres pays. En tant qu’artiste, mais aussi en tant qu’homme ayant vécu des événements historiques majeurs tels que la Seconde Guerre mondiale, mai 68 et la chute du mur de Berlin, que pensez-vous de la situation mondiale actuelle ?
Thomas Bayrle
Je pars du principe que la vie, ou l’existence, est toujours très complexe. Cette complexité semble souvent cachée, mais elle éclate brutalement en ce moment. La vie est une sorte d’organisme qui a besoin d’être constamment renouvelé. Par les États, par les peuples et par les individus. Cela me rappelle la pompe à miel de Beuys, une installation présentée en 1977 lors de Documenta 6 à Kassel. (Joseph Beuys installe
une pompe actionnée par deux moteurs pour faire circuler deux tonnes de miel liquide dans un tube de dix-sept mètres de haut dans un réseau de distribution qui traverse les pièces du Museum Fridericianum). C’est un miracle que l’on puisse créer cette structure que nous appelons « la vie ».
Devrim Bayar
Oui, en effet. Avez-vous réussi à travailler récemment ? Sur quoi ?
Thomas Bayrle
Sur les machines. Je vois les informations visuelles comme des piles complexes, des sortes de masses de matière plutôt sauvages et boueuses qui vont se mettre en ordre – un peu comme le processus de la peinture à première vue – avant que l’on ne transpose en deux dimensions et que l’on n’ordonne les images et les idées. Cela peut ressembler à des masses mouvantes d’idées et de pensées, comme une moissonneuse-batteuse spirituelle.
Devrim Bayar
Cela me rappelle que, lorsque vous étiez jeune, vous travailliez dans une usine, une expérience inhabituelle pour un artiste. Comment y êtes-vous arrivé et quels souvenirs en gardez-vous ?
Thomas Bayrle
Je voulais d’abord devenir ingénieur textile et pour moi les tissus étaient comme l’architecture : des poutres verticales et horizontales qui pouvaient prendre une telle ampleur qu’elles devenaient des constructions ou se réduire au point de se changer en pièces de tissu. Le sens de la transformation était déterminé par la chaîne et la trame, de sorte que le tissu avait deux dimensions – on pouvait osciller entre le minuscule et le monumental.
Devrim Bayar
Avant de devenir artiste, vous avez travaillé au début des années 60 comme graphiste pour diverses grandes entreprises et également comme éditeur de livres, par l’intermédiaire de votre propre maison d’édition Gulliver Presse. Peu à peu, vous avez commencé à créer des tableaux et des sérigraphies. Comment cette transition s’est-elle faite ? Vouliez-vous devenir «un artiste»?
Thomas Bayrle
Mon activité s’est toujours située à mi-chemin entre celle d’un producteur et celle d’un artiste qui créé et met en œuvre lui-même des idées. Les connaissances que j’ai acquises en exerçant différents métiers étaient à l’image de la ville dans laquelle je vivais. Elles étaient des éléments parmi tant d’autres qui nourrissaient mon travail. Avec Gulliver Press, nous avons publié de très bons livres pour d’autres auteurs.
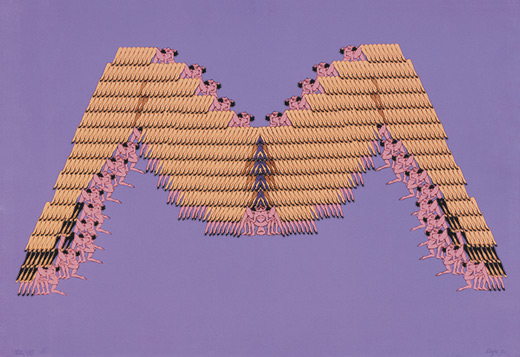
Thomas Bayrle, Fire in the Wheat (Sex Portfolio), M-Formation, 1970. Impression sérigraphique sur papier artisanal. Chaque lé : 47 × 164 cm. Assistant : Johannes Sebastian. Le livre d’artiste éponyme a été publié par MÄRZ Verlag en 1970. Photo : Wolfgang Günzel.
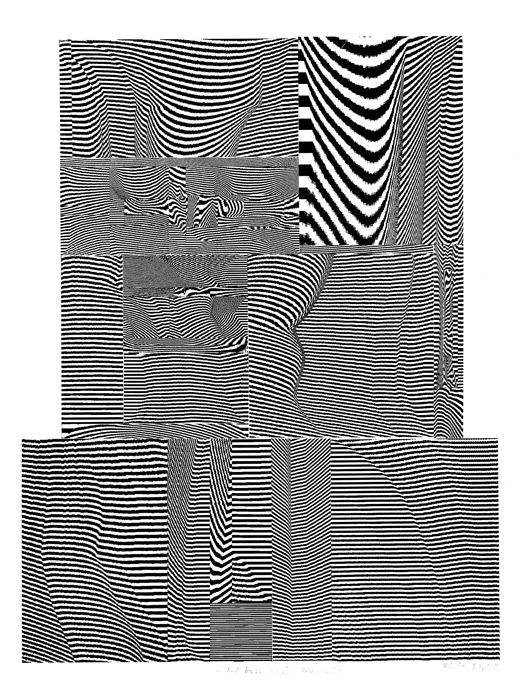
Thomas Bayrle, And Back Again – Masaomi Unagami II, 1991. Impression offset sur papier, 86 × 62 cm. Photo : Wolfgang Günzel.
Grâce à des artistes comme mon ami Peter Röhr, j’ai découvert que nous roulons sur une autoroute, mais qu’en même temps nous sommes une autoroute sur laquelle d’autres roulent. Nous avons roulé pendant des heures sur l’autoroute alors que le terre-plein central (Mittelstreifen) disparaissait en dessous de nous. Finalement, ce fut une aventure plus qu’un projet délibéré.
Devrim Bayar
Vous dites de Francfort qu’elle a été l’un des différents « éléments » qui ont influencé votre pratique. Comment y avez-vous vécu et travaillé ? Quel genre de contexte a-t-elle constitué pour vous ?
Thomas Bayrle
Cette ville est comme beaucoup d’autres lieux – d’un côté, c’est un « univers » à part entière, de l’autre, elle est aussi très provinciale. Bien qu’elle soit petite, elle possède toutes les caractéristiques d’une grande (les banques, les autoroutes, les centres commerciaux, les touristes…) – et c’est pourquoi elle parle aussi au nom de la réalité mondiale. Je trouve ici tout ce que je trouve ailleurs, mais à une autre échelle.
Devrim Bayar
La propagande, la religion, la société de consommation ou même la sexualité ont toujours été des sujets qui vous ont beaucoup intéressé. Vous définissez-vous comme un artiste politique ?
Thomas Bayrle
Non.
Devrim Bayar
Pourquoi ?
Thomas Bayrle
Parce que corps plus âme – et non pas corps ou âme.
Devrim Bayar
Vous avez vécu la transition des outils analogiques aux nouvelles technologies numériques, avec lesquelles vous avez travaillé très tôt. Qu’est-ce que ces nouveaux outils vous ont permis de réaliser ?
Thomas Bayrle
C’était une nouvelle liberté dans laquelle les relations classiques n’étaient plus un obstacle.
Devrim Bayar
Si je me souviens bien, vos premières expérimentations avec des programmes informatiques ont eu lieu à la Städeschule de Francfort où vous avez enseigné pendant de nombreuses années. Quelle était votre pédagogie ? Que vouliez-vous transmettre à vos étudiants ?
Thomas Bayrle
C’était une influence mutuelle, donc vraiment un dialogue entre les deux parties. Les étudiants ont obtenu quelque chose de moi et moi d’eux. C’était un échange émotionnel. Enseignement et apprentissage se nourrissaient mutuellement.
Devrim Bayar
Votre travail s’est souvent révélé visionnaire. Dans les années 60 déjà, vous avez dépeint la société de masse, la surcharge d’informations, l’urbanisation effrénée et l’anonymat des villes dominées par l’industrie automobile et l’introduction des nouvelles technologies dans la psyché humaine. Comment voyez-vous notre avenir ? Et auriez-vous un conseil à donner à la nouvelle génération ?
Thomas Bayrle
La société devient de plus en plus complexe, plus dense et moins tangible. Les autoroutes et la respiration vont de pair. La vie dans les sociétés de masse modernes devient plus abstraite et anonyme.
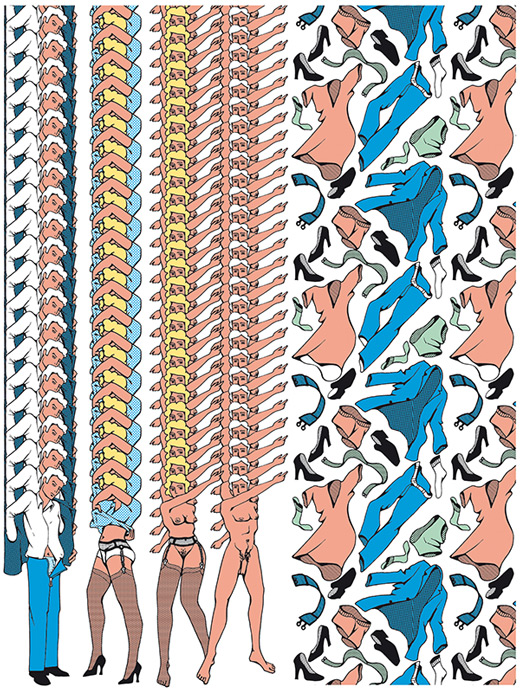
Thomas Bayrle, Fire in the Wheat (Sex Portfolio), Jacke wie Hose, 1970. Impression sérigraphique sur papier artisanal.Chaque lé : 47 × 164 cm. Assistant : Johannes Sebastian. Le livre d’artiste éponyme a été publié par MÄRZ Verlag en 1970. Photo : Wolfgang Günzel.

Thomas Bayrle, Airplane, 1982-1983. Collage photographique sur carton, 790 × 1280 cm. Photo : Gerald Domenig.
Je veux conserver en permanence un esprit perceptif sensible. Même si tout se condense, l’existence doit rester joyeuse. Ne renonçons pas, soyons rock’n’roll !
Transformer(s)
Jouant avec l’histoire de la sculpture, les artistes présentés à travers cet article se distinguent par leur maîtrise du collage formel et de la polysémie. Si quelques affinités se mettent en place entre leurs productions, dessinant les contours d’une certaine famille artistique, leur véritable point commun réside dans cette capacité à renouveler et transformer la matière. Qu’ils emploient des techniques artisanales ou au contraire très élaborées, ils mettent en place un corpus d’œuvres intriguant, oscillant entre opacité et séduction.
ANTHEA HAMILTON
Née en 1978 à Londres, vit et travaille à Londres
Le travail d’Anthea Hamilton réunit une pluralité de disciplines et de médiums : arts plastiques classiques – photographies, sculptures – mais aussi éléments moins traditionnels, venus des arts décoratifs : papier peint, canapés, fauteuils, tapis, vêtements. Cet ensemble posé, on a affaire à un décor qui évoque, sinon un intérieur, au moins une certaine domesticité. Sa particularité est d’être à la fois maniériste et minimaliste. Dans The Prude, une installation à la Thomas Dane Gallery de Londres en 2019, un énorme papillon mou côtoyait un papier peint géométrique parsemé de quelques grosses fleurs, le tout accompagné d’un fauteuil en damier de carrelage blanc et rouge. Jeu d’échelle et de matières, références aux formes organiques, au courant Bauhaus, mais aussi à la force des traits de la bande dessinée, l’univers d’Hamilton réunit tous ces éléments, comme autant de déclencheurs narratifs. D’ailleurs, ces propositions sont parfois également théâtre de performances, comme cela a été le cas à la Tate Britain en 2018 dans The Squash : actions et costumes – signés par Jonathan Anderson, directeur artistique de la marque éponyme et de la maison Loewe – parachèvent alors le tableau.
L’univers d’Anthea Hamilton n’est pas univoque. Les éléments qu’elle choisit de convoquer proviennent de recherches ou d’expériences variées. Il s’agit avant tout de retranscrire certaines choses qui l’ont intriguée, sans chercher à les classer en suivant des hiérarchies conventionnelles. Ainsi, le projet The Squash trouve notamment son origine dans la découverte d’une photographie de Erick Hawkins, chorégraphe américain, présentant une personne « costumée » en légume, au milieu de vignes stylisées. L’exposition est alors une manière de déployer ces inspirations, les faire coexister, se rencontrer. Ainsi, Anthea Hamilton en propose une lecture toute personnelle. Et, même lorsque des acteurs ne viennent pas occuper la scène qu’elle a créée, elle laisse alors une place importante à celui qui vient déambuler, regarder : il est celui qui, in fine, donne sens à l’œuvre, par sa présence même, son ressenti, ses propres interprétations.

Anthea Hamilton, Wrestler Sedan Chair, 2019. 80.5 × 161 × 80 cm © Anthea Hamilton Photo: Andy Keate. Avec l’aimable autorisation de l’artiste et de Thomas Dane Gallery.

Anthea Hamilton, Folded Wing Moth, 2019. 104 × 270 × 6 cm © Anthea Hamilton Photo: Andy Keate. Avec l’aimable autorisation de l’artiste et de Thomas Dane Gallery.
HANNAH LEVY
Née en 1991 à New York, vit et travaille à New York
Est-ce que ce sont des morceaux d’humains, des insectes, des hybrides, ou bien d’inoffensifs objets ? Créatures de cauchemar aux griffes aiguisées, aux très fins pieds : le travail d’Hannah Levy évoque les arts décoratifs anthropomorphes – caryatides, mains soutenant un flambeau, chaise aux pieds de lion… Mais ici, la mutation est allée trop loin, empêchant la fonction. L’objet se rebelle : il est devenu vivant, comme une créature de science-fiction dérangeante, à mi-chemin entre la mollesse, la douceur du silicone – matériau ici travaillé de manière fine, réaliste, à la manière de prothèses de cinéma – et le froid piquant de très fines tiges de métal, évoquant des membres à la fois indestructibles et maladifs, comme ceux d’un insecte génétiquement modifié.
Peu de couleurs composent le répertoire chromatique de l’artiste. Si l’on devait le résumer à un terme, on parlerait sans doute de chair, quoique Hannah Levy questionne cette idée du rose comme représentatif d’une carnation universelle. Il est vrai que les formes en silicone qu’elle réalise évoquent le corps, plus spécialement certaines de ses parties intimes. Il faut y regarder à deux fois avant de comprendre ce qui est représenté… Érotiques et dangereux, il semblerait que ces objets inanimés, lassés de leur statut, de leur usage, prennent vie et se rebellent. On pense à Fantasia et Mickey apprenti sorcier – mais, n’étant mis face qu’au moment de l’histoire où les choses tournent mal, on se demande : « Qu’a-t-on fait pour mériter les créatures d’Hannah Levy ? Quel monde mérite de tels dysfonctionnements ? À qui appartiennent ces chairs esclaves d’un objet qui les structure, les maintient, en dicte la destinée ? » Autant de questions que le travail d’Hannah Levy laisse en suspens, dans un étrange sentiment mélangeant malaise et fascination.

Hannah Levy, Untitled, 2020 (detail). © Hannah Levy Avec l’aimable autorisation de l’artiste et de la galerie Casey Kaplan, New York.
Nicolas Deshayes
Né en 1983 à Nancy, vit et travaille à Londres
Les œuvres de Nicolas Deshayes ont une apparence léchée, maîtrisée. Cet aspect rentre immédiatement en conflit avec la dimension organique que ses pièces dégagent : le contraste est saisissant, d’autant plus lorsque l’on se penche sur les inspirations qui nourrissent son travail. On y trouve pêle-mêle des éléments humains ou organiques. Certains présentent a priori peu d’intérêt – éviers, d’autres évoquent des idées peu ragoûtantes – intestins, voire carrément répugnantes – polypes, amas de graisse et de débris se formant dans les égouts.
Néanmoins, les pièces de Nicolas Deshayes n’évoquent jamais ces inspirations de manière réaliste. Certains éléments de ses travaux s’en éloignent toujours clairement, qu’il s’agisse des couleurs : gammes assez froides, parfois pastel, quelques dégradés ; des matériaux employés : céramique, émail, fonte ; ou bien encore du dispositif dans lequel elles sont présentées : cadres simples aux couleurs neutres, éléments de suspension minimalistes. L’axe majeur de son travail consiste à créer une tension entre aspect désirable – presque celui d’un pop art synthétique et attirant – et éléments auxquels on n’a ni l’habitude, ni l’envie, de prêter attention. Parfait exemple : dans son exposition Thames Water, en 2016 à la galerie Modern Art à Londres, une série de sculptures de fonte gris foncé, aux formes rappelant celles d’un intestin, fait circuler de l’eau chaude à travers la galerie, à la manière d’un système de chauffage. Il s’agit de mettre en scène le mondain : ce qu’il a de solide, structuré, produit par l’Homme ; ou ce qu’il a de plus invisible, de mou, référençant notre propre organisme, machine vivante et tiède dont nous partageons les rouages.
Aline Bouvy
Née en 1974 à Bruxelles, vit et travaille à Bruxelles
Des rats, des chiens, quelques compositions de légumes abstraits, des gros plans de nus masculins, des figures humanoïdes, mais jamais tout à fait humaines. En sculpture, en photographie, en peinture, le travail d’Aline Bouvy invite ces éléments, s’appuyant sur une gamme chromatique restreinte : blanc, gris, noir, bleu marine, chair. Comme dans le travail de Nicolas Deshayes, on retrouve des références organiques appuyées, cette fois mélangeant le scatologique au sexuel. Mais ici, ces sujets, ces références, ne semblent jamais être au cœur même de l’œuvre. On les retrouve notamment dans les titres des œuvres – Urine Mate, Que nous veut la queue –, ou bien encore dans les matériaux employés pour les réaliser. Aline Bouvy explique par exemple avoir mélangé du plâtre à sa propre urine pour la confection de quelques-unes de ses pièces. La provocation est présente, mais se trouve dans les détails, et ne sera pas nécessairement perçue de prime abord.
Provocation, en effet, mais non sans un sens de l’humour absurde, comme dans ces immenses sculptures de pieds, présentées en 2018 chez Baronian Xippas aux côtés de piercings géants ornant les murs de la galerie, et d’une importante série de dessins particulièrement réalistes de brosses à dents. Ainsi, les œuvres d’Aline Bouvy ne cherchent pas nécessairement à exprimer un sens ou une signification, mais plutôt à ouvrir, avec délicatesse, une forme de négociation avec les systèmes de pouvoir établis.

Aline Bouvy, Hora crucis 12, 2018. 40 × 50 cm Photo: Isabelle Arthuis . Avec l’aimable autorisation de l’artiste et de la galerie Baronian Xippas, Bruxelles.
magali reus
Née en 1981 à La Hague, vit et travaille à Londres
Les sculptures de Magali Reus sont à la fois familières et étrangères. En y attardant son attention, on reconnaît un, parfois plusieurs objets quotidiens : chapeaux, serrures, vases, ustensiles de cuisine, etc . Ceux-ci servent de point de départ au travail de l’artiste. Précisément choisis, tantôt recolorés, additionnés, superposés d’éléments abstraits parfaitement usinés, ils font de l’ensemble quelque chose d’inconnu ou d’intrigant. En effet, autour de ces objets connus, Magali Reus réalise un complexe travail abstrait de composition sculpturale. Elle y ajoute également des représentations pictographiques, tout un ensemble de symboles visuels, qui ajoute au mystère de ces œuvres. Il semble alors que les mots ne permettent plus de décrire formellement ce que l’on voit, tant cela est dense et varié – sans pour autant jamais paraître brouillon ni désordonné.
Il y a quelque chose du système de production, tant par la virtuosité technique de ses assemblages, que dans leur raison d’être. Une usine qui ferait naître des objets hautement utilitaires pour un présent que nous ne connaîtrions pas – peut-être l’une de ces réalités parallèles dont on parle de plus en plus. Il pourrait, au contraire, s’agir de vider ces formes familières de leur fonction pour leur permettre, finalement, d’exprimer une simple fonction plastique. Le travail de Magali Reus met en tension le complexe processus du travail artistique manuel avec ces objets manufacturés à la hâte, sans pour autant clairement expliciter si ces derniers la dégoûtent, ou la fascinent.

Magali Reus, Leaves (Peat, March), 2015. 46.5 × 37.5 × 11 cm Photo: Plastiques Photography. Avec l’aimable autorisation de l’artiste et de The Approach, Londres.

Magali Reus, Settings (Plums), 2019 (detail). 71 × 71 × 5 cm Photo: Plastiques Photography. Avec l’aimable autorisation de l’artiste et de The Approach, Londres.
George Henry Longly
Né en 1991 à New York, vit et travaille à New York
On retrouve dans le travail de George Henry Longly, comme dans celui de Magali Reus, l’utilisation d’objetsfamiliers, ainsi qu’un certain aspect industriel et futuriste. Mais, à la différence des travaux de cette dernière,les objets familiers autour desquels George Henry Longly construit son travail semblent pris pour euxmêmes,en tant qu’eux-mêmes et non faire partie d’une machinerie ou d’en ensemble qui les dépasserait.Les règles présidant au choix de ces objets connus sont proches de l’esprit de liberté, de la volonté de mettre toutes sortes d’inspirations au même niveau, que l’on retrouve chez Anthea Hamilton. Au Palais de Tokyo en 2018, George Henry Longly avait ainsi développé une installation prenant pour point de départ des armures de gouverneurs japonais, datées du XIIe au XIXe siècle, prêtées pour l’occasion par le Musée Guimet.
Dans le travail de George Henry Longly, les références au monde connu sont à la fois matérielles et immatérielles : il peut utiliser des polices de caractères découpées dans une plaque, des contenants de gaz dont le contenu ne servira plus, et s’est peut-être même déjà échappé. Cette idée d’insaisissabilité se retrouve également dans une importante partie de son travail : formes, sculptures, motifs, qui cessent simplement de faire référence au réel présent.
Finalement, l’ensemble qu’il déploie, entre réalité et abstraction, offre de nouvelles manières d’envisager le monde réel tel que nous le connaissons, comme un diamant taillé dans la pierre puis monté sur une bague : sans jugement spécifique, simplement pour chercher à en intensifier la perception.
TEXTE DE FLORIAN CHAMPAGNE

George Henry Longly, Promo V, 2019. 82 × 42 × 2 cm Photo: Manuel Carreon Lopez, kunst-documentation.com Avec l’aimable autorisation de l’artiste et de la Galerie Kandlhofer.

George Henry Longly, The Liberator, 2016. 61 × 137 × 69 cm
Photo: Manuel Carreon Lopez, kunst-documentation.com Avec l’aimable autorisation de l’artiste et de la Galerie Kandlhofer.
NATURE PEUT TOUT
ET FAIT TOUT
Roman Moriceau
Représentations instables de nature foisonnante, poussière de cuivre vouée à l’oxydation, fragrance synthétique rejouant l’organique, le travail de Roman Moriceau n’est jamais ce qu’il semble être. Jouant avec les illusions, l’artiste français questionne la temporalité de toute chose. Qu’il détourne des techniques artisanales comme la sérigraphie ou qu’il collabore avec l’industrie du parfum (plus précisément, avec le nez Ilias Ermenidis), sa pratique renouvelle l’exercice classique de la vanité, représentation allégorique du passage du temps et des paradoxes de l’existence.
SYRA SCHENK
En préparant notre discussion, je me suis rendu compte qu’il y a peu d’informations sur toi sur les réseaux, à une époque où tout le monde se précipite pour gagner en visibilité. Est-ce voulu ?
ROMAN MORICEAU
J’ai certainement une forme de désintérêt des médias. Entretenir des réseaux sociaux est également trop chronophage. Mais je devrais m’y atteler plus, car c’est intéressant de pouvoir partager plus précisément son point de vue. Ceci étant dit, j’aime l’idée d’avoir un peu de flou dans une époque où tout est très visible. Ce qui est important dans mon travail, dans un monde où les images sont consommées de manière très rapide, c’est de transmettre le message, d’échanger sur le contenu plus que sur l’image. Sur la toile, beaucoup de choses se ressemblent, la compréhension est restreinte. On pense comprendre les informations de manière immédiate alors qu’elles requièrent du temps.
SYRA SCHENK
Pourrais-tu nous décrire ton approche à la matière ?
ROMAN MORICEAU
Il y a toujours une corrélation entre le fond et la forme, une envie plastique mélangée à une envie technique, que je ne maitrise généralement pas. Le résultat est souvent le projet, l’idée d’une forme, l’idée d’une nouvelle technique, d’une nouvelle matière. J’utilise des matériaux sensibles au temps, fragiles, qui se modifient.

Roman Moriceau, Jasminocereus thouarsii, 2013. Sérigraphie à l’huile de vidange, 68 × 51 cm.
Avec l’aimable autorisation de de l’artiste et de la Galerie Derouillon, Paris.
Ce n’est pas dogmatique, mais ces propriétés reviennent en permanence. Depuis cinq ans, je travaille en associant mes images à des odeurs et du son, en créant une immersion dans l’espace avec l’odeur. L’action de l’odeur sur la mémoire et l’émotion amène à voir les images autrement.
Pour ma dernière exposition personnelle à la Galerie Derouillon, intitulée « Our Exquisite Replica of Eternity », j’ai pris des photos de bouquets de fleurs industrielles, reproduites à la colle sur lesquelles je saupoudrais des super-aliments comme l’acai, la chlorophylle, la spiruline ou encore le matcha. Ils ont tous des propriétés boostantes, mais je les ai choisies pour leur couleur et leur sensibilité aux UV — les couleurs passent de façon non-homogène. Les images vont pâlir et se transformer de manière aléatoire. Les fleurs que j’ai photographiées sont toutes génétiquement modifiées et ne pourraient pas se reproduire sans une intervention extérieure. Elles sont élevées selon un cahier des charges précis : elles doivent être belles, résistantes pour supporter de longs transports, mais elles n’ont pas d’odeur car ce n’est pas requis. Puisqu’elles ne sont pas comestibles, il n’y a pas de limites quant aux produits chimiques — des produits cancérigènes — utilisés sur ces fleurs qui se retrouvent chez les fleuristes, chez nous, dans l’eau… J’ai travaillé avec la société suisse Firmenich pour créer une odeur de « bouquet de fleurs génétiquement modifiées ». Celle-ci était diffusée dans l’espace de la galerie, les visiteurs l’attribuaient au bouquet posé dans l’espace alors qu’aucune de ces fleurs n’était odorante. La composition florale était posée sur un socle qui abritait des capteurs de mouvement qui déclenchaient des sons de manière aléatoire lorsqu’une pétale tombait dessus. Il s’agissait d’extraits de bandes-son de films romantiques et chansons d’amour qui se mélangeaient pour créer une nouvelle matière.
SYRA SCHENK
Est-ce que cette plongée dans l’industrialisation des fleurs coupées a une portée écologique ?
ROMAN MORICEAU
Quand j’ai commencé à travailler sur ce projet, au début de l’été 2018, les médias commençaient à parler davantage d’écologie. C’est un sujet qui me préoccupe depuis mon adolescence. Pour autant, je n’avais pas besoin d’en parler de la même manière. Même moi, et ma conscience aiguë de notre rapport à la nature, je me suis retrouvé face à des paradoxes. J’habite Paris, je m’inscris dans le marché de l’Art pour lequel je produis des formes et des objets qui sont un mélange de narcissisme et de besoin de communication. Cette exposition m’a permis de réfléchir à tout cela.
SYRA SCHENK
Firmenich travaille essentiellement des substances artificielles, comment intègres tu cela dans tes projets ?
ROMAN MORICEAU
C’est leur expertise qui m’intéressait, puisque je voulais développer une odeur. C’est une des plus grosses entreprises de fragrance, ils développent aussi bien des parfums que des odeurs pour l’industrie agro-alimentaire. Le paradoxal a toujours été dans mon travail. Les premières pièces que j’ai faites représentaient des plantes et des fleurs en voie d’extinction sérigraphiées à l’huile de vidange, donc à la fois ultra-toxique tout en ne séchant jamais totalement. L’image reste fragile. Les pièces que je réalise ne sont jamais vraiment figées.
SYRA SCHENK
Certaines de ces pièces ont notamment été intégrées à la collection du Musée d’Art Contemporain du Val-de-Marne. Comment assumer leur transformation?
ROMAN MORICEAU
L’idée du changement d’aspect de ces œuvres est quelque chose qui est arrivé au gré des recherches, et aujourd’hui, je suis convaincu que l’œuvre ne doit pas rester pérenne. Les pièces acquises par le MAC/VAL sont toutes soumises à des formes de transformation, certaines images vont par exemple moisir. J’ai longuement échangé avec l’équipe du musée à propos des protocoles de conservation. Mes pièces disparaissent au bout d’un moment, et cela fait entièrement partie de leur histoire.

Roman Moriceau, Botanische Garten Neu 2 IV, 2018. Poussière de cuivre sur papiere, 134 × 97 cm.
Photo : © Grégory Copitet.
Avec l’aimable autorisation de de l’artiste et de la Galerie Derouillon, Paris.
À ce sujet, un sculpteur de marbre m’a dit qu’il aimait l’idée de pérennité du marbre ; je lui ai répondu que même le marbre n’est pas pérenne. La pierre a une longévité qui nous dépasse, mais c’est illusoire de penser qu’elle ne disparaitra pas. C’est assez mégalomane de penser que notre travail doit nous survivre.
SYRA SCHENK
Nous vivons une période charnière qui offre une vraie opportunité de changer certains des comportements fondamentaux acquis sur les cent dernières années. Le public peut être sensible aujourd’hui à ton choix d’utiliser les super-aliments pour montrer la temporalité des œuvres, qui évoluent dans le temps. Comment vois-tu l’évolution de ton travail?
ROMAN MORICEAU
J’aimerais vivre à la campagne, pouvoir produire mon alimentation mais aussi des aliments qui me fourniraient une forme d’encre, une matière première. En ce moment je fais pousser des plantes, sur ma loggia et mon balcon, pour une exposition à la galerie parisienne Pauline Pavec, dont la commissaire sera Sandra Barré. Ce processus implique un élément de temporalité et d’imprévu. C’est long, lent et aléatoire. Les dates de l’exposition auront un impact avec ce qui est disponible. C’est une forme de production instinctive. Je voulais travailler des plantes pour leur odeur, j’ai mis des graines à germer. Je les ai plantées un mois trop tard par rapport aux recommandations, et maintenant elles stagnent, elles ne poussent plus. Je ne sais pas ce qui sera prêt. J’observe, je m’adapte. J’apprends continuellement du vivant !

Roman Moriceau, Alps, 2012.
Sérigraphie à l’huile de vidange, 148 × 188 cm.
Avec l’aimable autorisation de de l’artiste et de la Galerie Derouillon, Paris.
Revoir Revue
Ce dixième numéro de Revue célèbre cinq années d’existence durant lesquelles nous avons reçu de nombreux invités. Nous est alors venue l’idée de les recevoir à nouveau, en leur proposant de poser une question ou d’y répondre, mélangeant nos précédentes discussions pour en créer de nouvelles. Autant de dialogues entre artistes de tous bords qui revisitent notre histoire tout en proposant une relecture créative.
Sidi Larbi Cherkaoui
(chorégraphe, à relire dans Revue 1, en discussion avec le musicien Woodkid) questionne
Damien Jalet
(chorégraphe, à relire dans Revue 7, en conversation avec le musicien Etienne Daho)
Comment navigues-tu entre le monde du cinéma, celui de la mode et des stars comme Madonna et celui de la danse contemporaine et des compagnies plus classiques ?
J’adore naviguer en effet ! C’est peut-être pour ça que l’une de mes pièces s’appelle Vessel et que l’on retrouve des vagues dans tous mes spectacles ! Ce que j’ai toujours aimé dans la danse, et en particulier la danse contemporaine, c’est sa capacité à inventer ses propres codes, à pouvoir créer des liens avec d’autres mediums, à traverser les frontières géographiques. Venant du théâtre, bien plus cantonné aux frontières linguistiques et à une forme de tradition, la danse contemporaine a toujours été un espace mêlant une extrême rigueur à une vraie liberté. J’aime profondément collaborer, mais je ne le fais qu’avec des gens que j’admire et qui m’inspirent. Je suis très intuitif et surtout très intransigeant avec ça. J’aime aussi tester la limite entre cultures dites « savantes » et « populaires ». Mes chorégraphies se sont parfois faits taxer de « niche » ou de très (trop) spécifique, et je suis assez surpris par le fait que, sans altérer quoi que ce soit, elles se retrouvent aujourd’hui au centre de films à très grand visionnage. Je suis très heureux de recevoir des témoignages de gens qui ne connaissent pas cette forme de danse et qui grâce à ces films sont devenus de vrais amateurs. La même chose s’est passée pour moi quand j’ai découvert Madonna à l’âge de onze ans. Elle a été le déclencheur de quelque chose en moi. Son travail était toujours extrêmement référentiel et, grâce à elle, j’ai découvert Martha Graham ou Bob Fosse. Du coup, lorsqu’elle m’a contacté presque trente ans plus tard après avoir vu mon travail dans Suspiria, c’était comme une boucle qui se formait. Comme si après avoir été l’étincelle qui m’a fait commencer à danser, je pouvais lui rendre quelque chose de cette énergie qu’elle m’avait donnée à un moment clé de ma vie.
The Shoes
Guillaume Brière & Benjamin Lebeau (musiciens, à relire dans Revue 1, en discussion avec la cinéaste Rebecca Zlotowski) questionne
Fishbach
(musicienne, à relire dans Revue 4, en discussion avec la cinéaste Céline Sciamma)
Quel conseil aurais-tu aimé recevoir lorsque tu as commencé la musique ?
Je dirais que je n’ai aucun regret sur mes débuts, car j’ai su faire le tri entre les réflexions avisées et les encouragements douteux. Si je devais recommencer, je referais tout de la même manière.
Études
(créateur, à relire dans Revue 4) questionne
Woodkid
Yoann Lemoine (musicien, à relire dans Revue 1, en discussion avec le chorégraphe Sidi Larbi Cherkaoui)
Comment as-tu vécu la sortie de ton morceau « Goliath » abordant des sujets en écho direct à cette situation inédite dans laquelle nous sommes plongés ?
On s’est posé la question d’un potentiel retardement de la sortie. J’avais peur qu’elle ait l’air opportune par rapport aux conditions. Mais au final on a décidé de garder notre calendrier et de laisser notre film résonner avec l’actualité car la question de la toxicité est quelque chose que j’avais envie d’aborder depuis longtemps. C’est un sujet qui n’est pas nouveau et qui n’est pas arrivé avec la Covid. Je pense que « Goliath », plus particulièrement son clip, peut parler de ça, mais peut aussi prendre une dimension supérieure, plus métaphysique. Mais évidemment, j’aurais préféré que l’actualité ne s’aligne pas avec la mythologie de ce titre.
Soft Baroque
(designer, à redécouvrir dans Revue 6)
Études
(créateur, à relire dans Revue 4)
La surexposition de l’image et du contenu dans nos sociétés digitales nous a, d’une certaine manière, désensibilisés de la beauté, mais nous en a aussi libérés. De la même manière que d’autres ressources sociales et naturelles s’épuisent, pensez-vous que la beauté s’amenuise ?
Il est difficile de mesurer l’impact de la surexposition des images au travers des nouveaux médias. Le phénomène actuel qui nous paraît intéressant, c’est que l’époque où la conception des images était réservée à quelques personnes est révolue. Leur démocratisation et leur diffusion leur ont donné une nouvelle place dans notre société.
Presque comme une forme de résistance, et afin de nous préserver, avec Études Books nous éditons des livres de photographie et d’artistes depuis 2007. Nous avons à cœur de publier des ouvrages de photographie qui rassemblent au sein d’un même objet une série d’images, une conception graphique, un texte. Ces publications sont le fruit de notre relation avec l’artiste.
Woodkid
Yoann Lemoine (musicien, à relire dans Revue 1, en discussion avec le chorégraphe Sidi Larbi Cherkaoui) questionne
Damien Jalet
(chorégraphe, à relire dans Revue 7)
Dans quelle mesure est-ce que ton travail de chorégraphe est transformé lorsqu’il est destiné à être filmé et monté ?
Chorégraphier un spectacle ou un film sont en effet deux processus qui ont leur spécificité propre ; c’est presque aussi différent que pour un acteur de jouer dans un film ou une pièce de théâtre. En général dans mes pièces j’aime créer un cadre, une limite, comme un dispositif scénographique qui est parfois en mouvement lui-même, j’aime aussi explorer comment à partir d’une certaine perspective on peut créer une sorte d’anamorphose, jouer sur ce que l’on voit ou pas. Le cadre d’une caméra devient ce cadre, cette limite dans laquelle le mouvement s’inscrit, comment un corps y apparaît et disparaît. J’ai appris énormément en tournant Suspiria avec Luca Guadagnino – ma première vraie expérience à chorégraphier en utilisant un moniteur. C’est devenu très vite clair que ce que je chorégraphiais en studio à partir d’un point fixe allait être complètement déconstruit par les caméras en multiangles, qui allaient non seulement changer constamment la perception de l’espace mais capturer énormément de détails. Ce qui demande encore plus de précision dans la chorégraphie, mais aussi dans les intentions des danseurs. Sur le plateau, j’ai très vite lâché mon point de vue frontal pour me placer derrière les moniteurs avec Luca. En même temps que l’on tournait, je découvrais des détails et des perspectives (notamment grâce aux top shots), ce qui permettait de continuer à guider les danseurs, mais aussi les cadreurs ; certains mouvements ont été aiguisés pendant le tournage afin de mieux s’inscrire dans l’image. Les scènes de Suspiria sont toute filmées en camera fixe, de plusieurs points de vue, ce qui demandait un énorme travail de montage. La chorégraphie s’est reconstruite en salle de montage, grâce à Walter Fasano, dès lors qu’il a compris qu’il pouvait « remixer » la chorégraphie. Il y a passé trois semaines. J’ai adoré voir le résultat final. C’est, j’imagine, comme pour toi quand tu reçois le remix d’une de tes chansons par quelqu’un qui te fait découvrir des nouveaux aspects de ce que tu as créé !
Pour Anima avec Paul Thomas Anderson, en créant la chorégraphie en studio, je filmais le matériel des danseurs avec mon iPad et me mettant en mouvement ; cette idée de perspective mouvante est propre au cinéma et ne peut pas être vécue par un spectateur dans un théâtre. J’envoyais les vidéos à Paul Thomas et ça nous a inspiré à tout filmer en mouvement constant, avec très peu de coupures. Nous étions dans les rues de Prague avec un steadicam, et j’avais mon propre moniteur portatif pour lequel je donnais les instructions à vue pour faire rentrer et sortir les danseurs du cadre. Paul Thomas adore les longs plans séquence, du coup rien ne peut être repris en montage ; ça montre plus d’imperfections, mais ça amène aussi une émotion plus forte que lorsque la chorégraphie est trop hachée.
Enfin, un autre exemple : quand j’ai développé Train-train, sur une musique de Koki Nakano, avec le réalisateur Benjamin Seroussi, l’idée était de suivre un solo du danseur Aimilios Arapoglou dans la tour Pleyel, à Paris. Nous avons tout filmé en mouvement et je trouve que ce pas de deux entre un danseur et un cadreur est fascinant.
Dans tous les cas de figure, que ce soit au cinéma, dans la mode, pour Madonna, dans mes pièces ou celles que je fais pour des ballets plus classiques, je tâche de garder une même qualité expérimentale.
Ronan Bouroullec
(designer, à redécouvrir dans Revue 2) questionne
Paul Chemetov
(architecte, à relire dans Revue 3, en discussion avec le chef Inaki Aizpitarte)
Si vous deviez choisir un édifice, je serais curieux de savoir lequel ce serait.
On ne peut résumer l’architecture à un bâtiment. S’il reste un livre, La Bible, pour les croyants monothéistes, l’architecture n’a pas sa « Pierre Noire de la Mecque ». Je pourrais citer quelques bâtiments émouvants : les maisons Jaoul, Wright ou Schindler à Los Angeles, ou Kahn à Ahmedabad. Mais ce serait infiniment réducteur!
Perez
(musicien, à relire dans Revue 9, en discussion avec le chorégraphe Olivier Dubois) questionne
Woodkid
Yoann Lemoine (musicien, à relire dans Revue 1, en discussion avec le chorégraphe Sidi Larbi Cherkaoui) :
La musique pop, d’autant plus lorsqu’il s’agit d’un projet solo, passe par une incarnation forte, la mise en avant d’un visage, d’un style vestimentaire, d’une attitude, etc. En quoi la 3D permet-elle de jouer avec ces codes ?
Je trouve qu’on vit à l’ère de l’ultra-explicite. Les réseaux sociaux poussent l’artiste à cela. Dans tout mouvement il doit y avoir un contre-mouvement et je trouvais intéressant d’interroger sur ce qu’est l’ultime façade. L’idée de cet avatar 3D que j’ai introduite avec S16, mon nouvel album, est arrivée très vite. Elle soulève beaucoup de questions qui m’interpellent autour de la réalité, du virtuel, mais aussi de l’authenticité, de la générosité et de la fantaisie. C’est une figure qui peut questionner l’égo comme elle peut questionner la timidité. Elle interpelle sur l’idée de la technologie dans la musique et dans l’image, tout comme sur la manipulation et sur la question fondamentale qui est : « Est-ce que l’artiste est un personnage ? »
Sabine Marcelis
(designer, à redécouvrir dans Revue 6) questionne
Soft Baroque
(designer, à redécouvrir dans Revue 6)
Chère Saša, tu m’as dit un jour que tu manges des aliments d’une seule couleur chaque jour de la semaine. Pourrais-tu me faire part de tes menus de cette semaine ? Je suis très curieuse !
J’adore cuisiner, mais les possibilités sont infinies et peuvent m’épuiser. J’ai créé le système « une couleur par jour » et j’ai centré mon quotidien autour de cela. Chaque jour, je me suis habillée d’une seule couleur et j’ai mangé des aliments d’une même couleur. C’était une règle arbitraire qui m’a aidée à rester concentrée.
Dimanche 7 avril 2019 : BLANC
Yaourt grec à la poire nashi pour le petit déjeuner. Fromage de chèvre pour le goûter. Enokitake (champignons blancs), radis blancs, pousses de haricots et bol de riz au gingembre pour le déjeuner. Chocolat blanc entre les deux. Soupe aux amandes pour le dîner. Meringue comme douceur pour la nuit.
Lundi 8 avril 2019 : ORANGE
Soupe à l’orange, à la mangue, au potiron et aux carottes, patate douce rôtie et butternut, Doritos.
Mardi 9 avril 2019 : VERT
Jus vert, kiwi, soupe de pois, épinards, câpres, brocolis, asperges, olives.
Mercredi 10 avril 2019 : ROUGE
Fraises, grenade, poivron rôti, gelée de coing, biscuits de betterave, pizza marinara.
Jeudi 11 avril 2019 : JAUNE
Banane, pâtes aux tomates jaunes, polenta.
Vendredi 12 avril 2019 : ROSE
Macarons de betteraves, saumon, patate douce violette (beni imo), rhubarbe, framboise.
Samedi 13 avril 2019 : NOIR
Mûres, haricots noirs, riz noir, chocolat très noir.
Paul Chemetov
(architecte, à relire dans Revue 3, en discussion avec le chef Inaki Aizpitarte) questionne
Ronan Bouroullec
(designer, à redécouvrir dans Revue 3)
Je serais heureux de lire votre réponse sur la beauté de l’ordinaire, la représentation du banal, en bref, l’esthétisation de la vie quotidienne.
Je me rappelle assez précisément de la nappe en toile cirée, du tiroir pour ranger les couverts au bout de la table, des bols, chez mes grands-parents. Des piquets de bois autour des champs, des bottes de mon voisin paysan dans l’environnement rural dans lequel j’ai grandi. J’ai toujours été intéressé par les objets de tous les jours : le réveil, la nappe, la cafetière, le lavabo, les lacets, la poignée de porte, le trottoir, le comptoir, la tasse…
Rebecca Zlotowski
(cinéaste, à relire dans Revue 1)
Olivier Dubois
(chorégraphe, à relire dans Revue 9, en discussion avec le musicien Perez)
Quels sont vos longs-métrages favoris pour découvrir l’univers de la danse, que ce soit pour leur narration ou leur manière de filmer le mouvement ?
Voici quelques films, à mon sens, majeurs. Ils sont très diversifiés mais partagent chacun une grâce transpirante !
— Beau Travail, de Claire Denis.
— Fame d’Alan Parker, incontournable !
— Les Rêves dansants d’Anne Linsel et Rainer Hoffmann sur une reprise de Kontakthof, pièce de Pina Bausch par des adolescents.
— This is it, de Kenny Ortega, documentaire autour de Michael Jackson.
— Entrons dans la danse, de Charles Walters, avec Fred Astaire et Ginger Rogers.
— Staying alive, de Sylvester Stallone et avec John Travolta. Improbable rencontre !
— Auguri, de Tommy Pascal, un joli documentaire pour l’une de mes pièces !
Chloé Thevenin
(musicienne, à relire dans Revue 6, en discussion avec le collectif de chorégraphes La Horde) questionne
Rebecca Zlotowski
(cinéaste, à relire dans Revue 1, en discussion avec le groupe The Shoes)
Quelles sont vos bandes originales de films préférées ?
Dans le désordre, et pour ne citer que des scores composés, et non pas des films aux bandes originales somptueuses, mais qui sont des « synchros » – des titres préexistants , je sélectionne :
— Running on empty, de Sidney Lumet, avec une bande originale de Tony Mottola .
— Foxes, d’Adrian Lyne avec Jodie Foster, avec une bande-originale de Girogio Moroder.
— Koyaanisqatsi, la prophétie de Godfrey Reggio, avec une bande originale de Philip Glass.
— César et Rosalie de Claude Sautet, avec une bande originale d’Alain Sarde.
— Un homme un vrai, d’Arnaud et Jean-Marie Larrieu, avec une bande originale de Philippe Katerine.
— Birth, de Jonathan Glazer, avec une bande originale d’Alexandre Desplats.
— Under the Skin, de Jonathan Glazer, avec une bande originale de Mica Levi.
— Toutes les bandes originales de Jonny Greenwood pour Paul Thomas Anderson, et plus spécialement celle de The Master.
Christelle Kocher
(designer, à relire dans Revue 8) questionne
Ronan Bouroullec
(designer, à redécouvrir dans Revue 2)
Philip K. Dick a écrit dans Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? : « The tyranny of an object, he thought. It doesn’t know I exist. », que l’on pourrait traduire par « La tyrannie d’un objet, pensa-t-il. Il ne sait pas que j’existe. » Pensez-vous que les objets modifient notre perception de la réalité ? Comment intégrez-vous cela à votre travail ?
Pour moi un objet posé dans un espace produit le même effet qu’un sachet de thé dans un bol d’eau brûlante.
PROPOS RECUEILLIS PAR JUSTIN MORIN
(C6 H8 O6)n
Sean Raspet
L’œuvre de Sean Raspet s’inscrit dans un univers visuel de formes industrielles dont l’austérité peut surprendre. Cette rigueur est sans doute due au fait que la forme est rarement la finalité de sa production. Artiste chimiste, l’américain – basé à Los Angeles – travaille autour du vivant et manipule les molécules afin de mettre en place fragrances et autres formules de synthèse. Dès lors, et au fur et à mesure que les projets se concrétisent, les structures chimiques se croisent avec des structures sociales et économiques, offrant à ses recherches une complexité insoupçonnée et un véritable écho politique. Raspet a notamment co-fondé Nonfood, une société spécialisée dans les produits alimentaires à base d’algues, conjuguant les bienfaits nutritifs du végétal à une démarche durable. Il s’entretient ici avec Hamid Amini et évoque l’évolution de son travail.
HAMID AMINI
Votre pratique est influencée par les systèmes de circulation et de reproduction, ainsi que par l’économie sur laquelle ils se fondent. Vous dites parfois que ce sont les faiblesses des chaînes d’approvisionnement alimentaire qui vous poussent à soutenir des projets comme Nonfood. La Covid a obligé une grande partie de la population mondiale à porter pour la première fois un regard critique sur les chaînes d’approvisionnement au niveau international, en raison des risques permanents d’infection zoonotique auxquels ils nous exposent et de leur impact sur la santé et les moyens de subsistance de travailleurs essentiels au secteur alimentaire. Bien des choses ont changé – et continuent de changer – très rapidement. Comment, le cas échéant, vos recherches en cours sur l’approvisionnement et la circulation sont-elles affectées par les bouleversements radicaux auxquels nous assistons ?
SEAN RASPET
Il a été intéressant de constater une évolution de l’opinion publique dans ces domaines. Une des raisons qui m’ont poussé à me pencher sur les chaînes d’approvisionnement et les spécificités concrètes de notre mode de production, c’est qu’on les prenait très rarement en compte, et que la plupart des gens les ignoraient pratiquement (du moins des membres d’une certaine classe sociale et sur certains territoires). Elles n’étaient certainement pas une composante du discours sur l’art – en fait, je vois dans l’art un angle mort majeur/une contradiction dans ce domaine, en ce sens qu’on considère souvent qu’il est indépendant du système économique.
Nous vivons dans un environnement où les interactions sont considérables et nous pensons souvent à ces interactions en termes d’« écrans », de « réseaux », etc., mais nous sommes beaucoup moins conscients de la façon dont les produits sont fabriqués (et par qui) et de quoi ils sont faits (des matériaux qui les composent, et ce jusqu’aux molécules), ce qui constitue une forme d’interaction à part entière. Ma démarche se concentre sur les supports concrets qui sous-tendent la culture actuelle et rendent son fonctionnement possible.
De la même manière, je m’intéresse particulièrement à la production agroalimentaire et aux aliments, car ils sont essentiels à notre fonctionnement métabolique – et à tout ce qui en découle. Je ne sais pas encore comment va évoluer mon travail dans ces domaines, mais j’ai été frappé de constater en temps réel à quel point tout est fragile, à bien des égards.
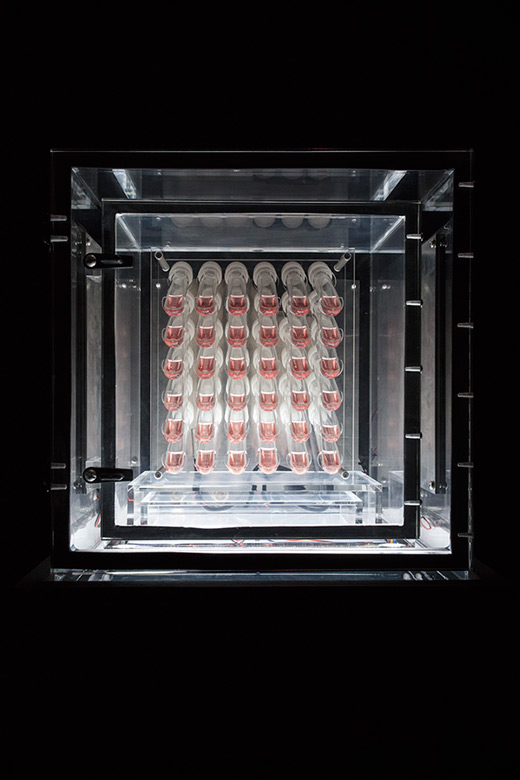
Kiara Eldred & Sean Raspet, Screen (EP1.1 iPSCs stem cell line-derived human retinal organoids), 2018-2019.
Avec l’aimable autorisation des artistes et d’Empty Gallery.
HAMID AMINI
On a pu lire que vous vous inspirez des constructivistes soviétiques, des productivistes et du Bauhaus. Y a-t-il des artistes qui ont plus particulièrement influencé – ou qui influencent actuellement – votre travail ?
SEAN RASPET
Je trouve cette période extrêmement intéressante. Tant de choses se sont produites en l’espace de cinq ou dix ans. En particulier la transition du constructivisme soviétique au productivisme, quand l’art est passé dans le domaine de la production de masse et de l’économie. On a en quelque sorte abandonné le vieux bagage de la pensée et de la pratique artistique pour reconnaître sa nécessité dans le cadre d’une transformation sociale plus large.
De toute évidence, elle fait écho à l’intérêt que je porte aux domaines des systèmes économiques et de la circulation, même si on ne peut pas simplement répéter cette histoire/réponse aujourd’hui. Elle nous éclaire plutôt quant aux possibilités (et aux difficultés) qui se présentent à nous.
Dans l’ensemble, la démarche a été vraiment collective et je trouve plus intéressant de la considérer comme telle, plutôt que comme la somme du travail d’artistes qui ont individuellement influencé le monde que nous connaissons aujourd’hui.
Cependant, les travaux de Varvara Stepanova et Lyubov Popova sur la production de textile et de vêtements ont figuré parmi les plus réussis et les plus concrets dans le cadre de la fabrication et de la diffusion de masse de l’époque.
HAMID AMINI
Pouvez-vous nous parler de votre projet sur le phosphore en collaboration avec Tarek Issaoui, et de ses liens avec vos travaux antérieurs ? Vos recherches avaient pour objectif de proposer des alternatives nouvelles ou, si j’ose dire, idéalistes, à la fois aux aliments et au goût, tandis que votre nouvelle proposition, créer « une réserve de ressources en phosphate et en faire une entité financière » semble beaucoup plus orthodoxe. Le contrôle d’une ressource, et le fait que le phosphore nous est essentiel suppose aussi une certaine violence.
SEAN RASPET
Cela remonte à mes recherches sur le système de production alimentaire, l’écosystème et le métabolisme. Le phosphore est un élément crucial, tant pour l’écosystème que pour le système alimentaire. Il représente environ 1 % de la masse d’un organisme. Pour satisfaire aux niveaux de production actuellement nécessaires, les aliments doivent être enrichis en phosphore – en tant que composant pour les engrais, de nutriment ajouté aux aliments pour animaux et, dans une moindre mesure, en tant que minéral ajouté au produit final destiné à la consommation humaine.
Cependant, les ressources en phosphore sont relativement faibles comparées à celles des autres éléments nutritifs présents dans les engrais tels que l’azote et le potassium. On estime que nous atteindrons un « pic de phosphore » d’ici 30 à 100 ans. (Il ne sera pas épuisé, mais on en aura utilisé plus ou moins la moitié, après quoi il sera de plus en plus difficile de s’en procurer.) Ces estimations font l’objet de nombreux débats, mais même si les dépôts de phosphore sur la terre peuvent durer des siècles, je ne trouve pas acceptable d’épuiser et de disperser en un clin d’œil, du point de vue géologique, une ressource cruciale pour la vie. En travaillant avec Nonfood, l’entreprise agroalimentaire qui produit des aliments à base d’algues (dont Lucy Chinen et Dennis Oliver Schroer sont cofondateurs), je me suis aussi particulièrement intéressé à la production de viande et à ce qui la rend moins coûteuse et plus répandue qu’elle ne « devrait » l’être par comparaison aux aliments moins gourmands en ressources, comme la plupart des végétaux et, surtout, des algues.
Étant donné que la production de viande nécessite environ dix fois plus de ressources qu’une culture végétale typique (et émet au moins dix fois plus de gaz à effet de serre), il est logique que le phosphore soit l’un des facteurs qui limitent la production de viande. Au cours de mes recherches, j’ai constaté une corrélation entre le prix du phosphore et le prix de la viande, au fil du temps. En théorie, si on en retirait de la chaîne d’approvisionnement agricole un stock suffisamment important, il y aurait des répercussions sur le prix de la viande, et en fin de compte la transition vers des sources alimentaires à faibles émissions, comme les plantes et les algues, serait accélérée. Cela pourrait également créer des conditions économiques qui permettraient de mieux rentabiliser le captage et le recyclage du phosphore, de réduire et de collecter les eaux de ruissellement agricoles et d’inciter à arrêter plus vite l’extraction du phosphore.
Au-delà du stock en lui-même (qui devrait être vraiment conséquent pour qu’il y ait un réel effet sur les prix), si le public prenait connaissance de la question, l’impact pourrait être plus important. (C’est là que la diminution de son utilisation se répercuterait sur les prix.) Avec diverses interactions complexes et des boucles de rétroaction, on obtiendrait une augmentation simultanée des prix et de l’exploitation minière, mais les États pourraient aussi choisir de créer de grandes réserves stratégiques, ce qui ferait encore augmenter les prix. Le résultat reste très incertain.
Nous en sommes évidemment bien loin. Mais pour moi il s’agit de concevoir une sorte de mécanisme évolutif, ou un point de levier dans le système de production agroalimentaire et dans l’écosystème qui, si on lui fournit les ressources appropriées, pourrait avoir un effet concret important.
HAMID AMINI
Pouvez-vous nous parler de vos activités quotidiennes ? Qu’est-ce qui vous inspire le plus quand vous êtes au studio ?
SEAN RASPET
Mes journées varient beaucoup selon le type de projet sur lequel je travaille ou les recherches que je mène. Je n’ai pas vraiment de studio à proprement parler, juste divers endroits autour de la maison, où je mène différents projets, et je travaille aussi beaucoup sur ordinateur.
Quoi qu’il en soit, les moments que j’apprécie le plus sont sans doute ceux où des choses surprenantes ou nouvelles voient le jour. Par le passé, j’ai collaboré avec Shengping Zheng au Hunter College pour produire des molécules de parfum inédites. Sentir une molécule de parfum qui n’a jamais existé auparavant est une expérience enrichissante.

Sean Raspet, CCCCC1CCC(=O)O1 CCCCCCC1CCC(=O)O1 CCCCCCCCC1CCC(=O)O1 CCCC1CCCC(=O)O1 CCCCCC1CCCC(=O)O1 CCCCCCCC1CCCC(=O)O1 (Technical Milk) & CC1=CC=CC(C) =N1 CC1C=CN=C(C=C1)C CCC1=CN=CC=C1 CC1C(=0)C(=C(01)C)0 CCC1C(=0)C(=C(01)C)0 (Technical Food), 2015.
Avec l’aimable autorisation des artistes et de Swiss Institute.

Sean Raspet, Texture Map (Normal) (F03), 2014.
Avec l’aimable autorisation de l’artiste et de la galerie Jessica Silverman.
Depuis un an ou deux, je m’intéresse à des plantes cultivées à partir de graines exposées à des radiations. Ces radiations engendrent diverses mutations, aléatoires. Certaines ne se manifestent qu’après plusieurs générations. C’est comme développer une photographie qu’on ne peut admirer qu’au bout de plusieurs années et de plusieurs générations.
HAMID AMINI
Quelle est votre prochaine étape, et quel impact (S’il y en a un !) les événements qui se sont passés et continuent de se passer en 2020 ont-ils influé sur vos projets et vos pratiques ?
SEAN RASPET
En ce qui concerne le travail, j’ai eu un peu de chance car pour cultiver des plantes la quarantaine n’est pas un obstacle. Je les fais principalement pousser dans un petit jardin, et sur quelques étagères en intérieur. La germination et l’entretien peuvent être très chronophages, c’est pourquoi mon activité nécessite de passer beaucoup de temps chez moi.
C’est aussi agréable de travailler sur quelque chose qui se produit nécessairement sur une longue période. Je pense que pour moi et pour mon travail, l’impact le plus important de 2020 sera là : ralentir et donner la priorité à des projets dont la concrétisation exige des délais plus longs.
PROPOS RECUEILLIS PAR HAMID AMINI

Sean Raspet, (-), 2012- 2015.
Avec l’aimable autorisation de l’artiste et de Société.
Corps célestes
PerezOlivier Dubois
Interprète et chorégraphe, Olivier Dubois met à l’honneur une danse puissante et charnelle. C’est dans la répétition et le dépassement que ses interprètes révèlent toute leur singularité, émergeant individuellement au sein du collectif. À l’image des titres des pièces de sa compagnie – citons Tragédie (2012), Souls (2013), 7xrien (2017) ou Tropisme (2019) – , quelque chose de direct et de percutant se joue. On ressent cette même radicalité dans la musique de (Julien) Perez. Surex, son troisième album, sorti en février dernier, affiche treize morceaux dont la juxtaposition forme un poème surréaliste. Puisant ses références dans la littérature et le cinéma, son écriture, qu’il s’agisse de ses mélodies ou de ses paroles, est incisive. Les deux artistes cultivent le décalage, déconstruisant soigneusement leurs partitions pour laisser surgir l’inattendu. Se rencontrant pour la première fois, Olivier Dubois et Perez échangent sur les différents langages de leurs pratiques respectives.
OD J’aime beaucoup ta musique. Il y a quelque chose qui m’a naturellement plu. Ce que je trouve intéressant, c’est qu’il y a une multitude de couches qui la composent. Par exemple, j’ai beaucoup ri. Il y a d’autres émotions qui se mélangent, c’est une question d’angle d’approche. Ce qui est étonnant, c’est que j’ai ressenti ce que certains disent à mon propos : c’est « irrévérencieux ». Je me retrouve un peu piégé car j’ai toujours trouvé que cette formule était un raccourci. À un moment, en tant qu’artiste, on essaie d’être intègre et d’aller au bout de ses idées. Ça permet d’avoir une parole claire, c’est parfois déroutant et c’est perçu comme de l’irrévérence. En ce sens, j’ai trouvé qu’il y avait un écho entre nos deux univers. Je trouve également que dans ta musique, il y a une part érotique très forte. Ça me parle car, pour moi, la danse est par définition érotique. Il y a beaucoup de chair dans ce que tu fais, que ce soit à travers ta voix ou tes clips.
JP La dimension burlesque, ou comique, n’est pas toujours perçue dans ma musique, mais j’y attache beaucoup d’importance. Cet ancrage dans un matériau pop est ce qui permet tous ces différents niveaux de lecture. Choisir de faire ce que l’on appelle de la pop veut dire que l’on va travailler autour de choses que l’on considère largement partagées par une majorité de personnes, contrairement à une forme d’art avant-gardiste qui demande la maîtrise d’un certain jargon. Je fais très attention à ça. Avec quelques accords, l’auditeur pourra comprendre s’il s’agit d’un morceau mélancolique ou entraînant. On peut écouter ma musique de manière très éloignée, en faisant le ménage par exemple ! C’est de prime abord assez inoffensif, mais suivant la manière dont on va l’appréhender, avec plus ou moins d’attention, on va découvrir ces couches superposées. En étant attentif aux paroles, on va voir qu’elles ne sont peut-être pas si évidentes, il y a des distorsions de sens… Partir d’un format pop me permet de ne pas être trop ostentatoire dans les idées que je veux faire passer. J’ai aussi eu ce sentiment en découvrant ton travail.
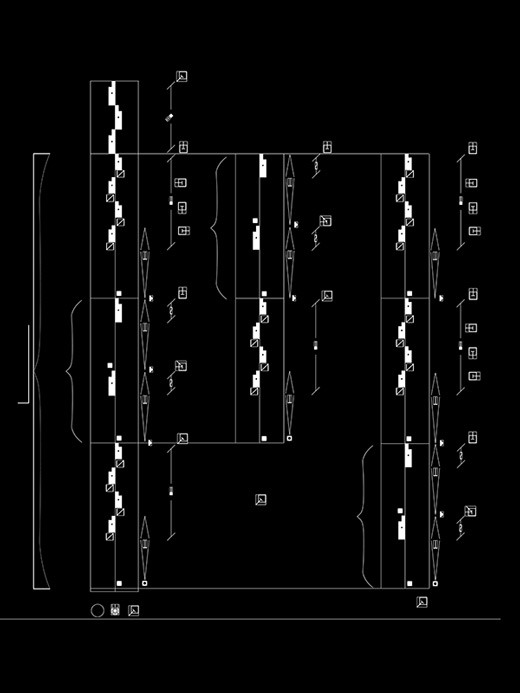
Extraits et détails provenant des partitions en système Laban de pièces d’Olivier Dubois. Notation Estelle Corbière.
OD La notion de pop en danse est très étrange car c’est un domaine où il n’y a pas beaucoup de classifications possibles. On associe souvent la pop à des spectacles qui seraient des succès publics, là où la danse contemporaine serait grisâtre.
En musique, j’avoue que la pop française m’ennuie considérablement. On a ce même problème en danse. Je vois une partie de la danse contemporaine française comme une grande fainéantise. On a dit qu’elle était intellectuelle. Pour moi, l’intellectualisation de l’art est son pire ennemi. L’intelligence oui, l’intellectualisation non !
Si la pop française ne m’attire pas, c’est que j’ai la sensation qu’elle fait peu ; peu importe si on n’a pas de voix ou pas de rythme tant qu’on a une idée. Mais une idée ne fait pas une œuvre !
Ce que j’aime dans ce que tu fais, c’est qu’il y a du travail. C’est choisi, dirigé, pointu. Est-ce que tu te sens appartenir à une certaine scène française ?
JP Il y a des personnes comme Julien Gasc, Chassol, ou Mathilde Fernandez dont je me sens proche. Je pense aussi à Jardin, un artiste belge. Il y a quelques francs-tireurs dont j’aime vraiment l’approche, mais après je te rejoins, la grande majorité des choses qui sortent ne m’intéressent pas vraiment. Souvent, c’est au niveau des textes que ça coince, c’est de la poésie très lisse, ça manque d’accrocs. L’idée de dire qu’une chanson est un poème mis en musique, c’est quelque chose de très français. C’est un lyrisme qui peut être assez gênant. Mais la langue française n’est pas évidente. Avant, j’avais un groupe – Adam Kesher – où je chantais en anglais. J’étais plus jeune et il y avait une forme de mimétisme dans ce choix. Je n’écoutais que de la musique anglo-saxonne donc ça me semblait logique de choisir l’anglais. À l’époque, nous avons tourné en Angleterre et un peu aux États-Unis. Un jour, j’ai eu une crise de doute car je me suis demandé comment ce public percevait ce que je leur racontais. J’imagine que je prononçais certains mots comme un français, d’autres comme un mec du Texas, et d’autres encore comme un type de Manchester, en mélangeant différents argots. Ça devait être insupportable à écouter ! C’est en prenant conscience de ça que je me suis dit qu’il fallait que j’écrive en français. La maîtrise de la langue me permettrait d’accéder à une forme de style. Au départ, cela a été très compliqué. Comme beaucoup de musiciens, pour trouver ma mélodie de chant, je chante en yaourt. Et à chaque fois, aujourd’hui encore, c’est des gimmicks anglais qui me viennent. Si j’essaie d’y mettre des paroles en français, je vais être obligé de trouver des compromis car il y a des sonorités qui n’existent qu’en anglais. Hier, j’écoutais Alain Bashung. Beaucoup de ses morceaux développent cette écriture qui est assez étrange, surréaliste, et j’ai l’impression que certaines de ses tournures de phrases sont faites pour coller à des mots anglais. Dans Osez Joséphine, il chante « et que ne durent que les moments doux, durent que les moments doux ». Je suis persuadé qu’initialement, il y avait quelque chose comme « what can I do what can I do ». C’est évidemment compliqué pour écrire, mais je trouve que c’est intéressant de réfléchir comme ça car ça apporte autre chose. On essaie de rendre la langue autre, c’est l’inverse de ce lyrisme que je trouve souvent gênant. La danse n’a pas ce problème de traduction ! Comment ton travail est-il perçu à l’étranger ?
OD Très bien. La danse française est subventionnée, même si les enveloppes sont de moins en moins importantes, ce qui lui permet de tourner. Pour reprendre ce que je disais un peu plus tôt, il y a eu en France dans les années 90 un courant qui a duré presque vingt ans et que l’on a appelé la non-danse. Il n’était plus question de performance physique ou d’effet. Quelques œuvres majeures sont apparues, puis on a eu droit à une sorte de fainéantise. Les années 90 ont suivi une décennie où l’on avait beaucoup d’argent, et il a fallu faire avec moins de moyens. Les costumes étaient comme ce que l’on pouvait voir dans la rue, les décors ont sauté, l’interprète a peu à peu disparu. Cette économie est devenue à un moment la signature française et elle s’est répandue dans le monde. La bonne nouvelle, c’est qu’aujourd’hui c’est devenu un courant et non plus une règle. On me dit souvent que je suis à part, que je n’appartiens à aucune famille. Tant mieux, car je préfèrerais être père de famille !
JP Souvent je me suis rêvé comme minimaliste, et je ne l’ai jamais été ! J’aime la musique des minimalistes new yorkais, je n’ai jamais réussi à faire quelque chose de proche. Le minimalisme, c’est quelque part le défi ultime de l’artiste, c’est vraiment d’arriver à la sève.
OD Je pense qu’il faut un sacré talent pour faire du minimal.
JP L’interprète a une place importante dans ton travail n’est-ce pas ?
OD Ce sont les rois. En tant que chorégraphe, tout ce que je fais est très partitionnel, c’est très écrit. Je travaille conjointement avec mon compositeur. Tout est inscrit dans la scénographie que je dessine. Il n’y a pas d’espace pour l’improvisation. Pour les danseurs, c’est un cadenassage infernal. Physiquement c’est extrêmement exigeant car ce sont souvent des partitions complexes qui s’étalent pendant une heure et demie, parfois plus, et où tout sera compté. Cela peut paraître un peu anxiogène, les interprètes pourraient se demander à quoi ils servent, mais je crois en leur puissance. Souvent, on ne comprend pas l’interprète comme un artiste, mais il en est un. Cette écriture si cadenassée contraint à la prise de décisions de l’interprète. La liberté ne passe que dans l’emprisonnement. Sinon, c’est faire ce que l’on veut. Il faut être emprisonné pour que cette audace vibre sur un plateau et que ça soit unique. Par contre, si tout est écrit, je ne travaille jamais l’approche du mouvement de mes interprètes. La dynamique est donnée mais ils gardent leur singularité.
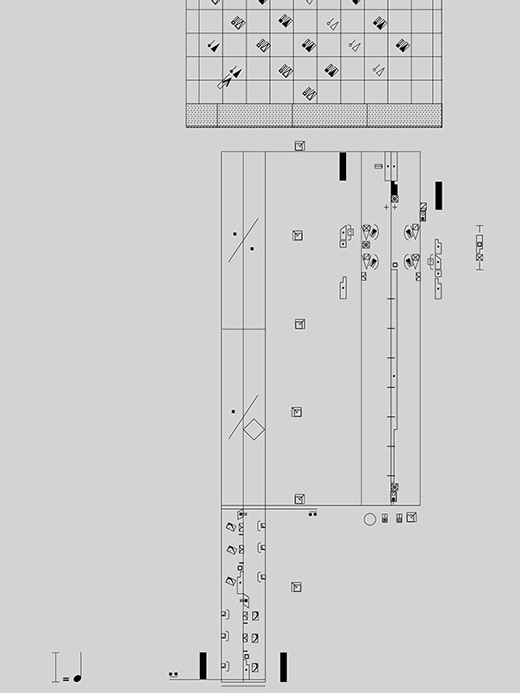
Extraits et détails provenant des partitions en système Laban de pièces d’Olivier Dubois. Notation Estelle Corbière.
C’est ce qui fait que dans mes pièces, il n’y a pas un interprète comme un autre, même s’ils ont tous la même démarche, la même cadence, le même objectif à atteindre. Ils sont magnifiés. Je le dis toujours : j’aime les interprètes glorieux sur un plateau, car ils ont traversé des turbulences incroyables. Mon plus grand échec serait d’avoir un interprète au sol.
JP Comment faire pour que ça n’arrive pas ?
OD À l’automne dernier, j’ai créé une pièce qui s’appelle Come out pour le Ballet de Lorraine. C’est basé sur un morceau de Steve Reich qui dure une douzaine de minutes. Nous en avons fait une version d’une heure. J’adore ce titre, mais j’ai l’impression que Reich s’est arrêté en plein milieu et n’a pas bossé jusqu’au bout ! Come out est un élan collectif. Tout comme l’était Révolution, l’une de mes premières pièces. Le principe est très simple : quinze femmes tournent pendant deux heures et quart autour d’une barre. Ces interprètes savent qu’elles vont devoir tenir pendant tout ce temps sans sortir du plateau. Chacune a une partition indépendante, c’est redoutable. Elles ont dû tout apprendre, pour pouvoir s’en emparer et faire face à d’éventuelles failles. On ne peut pas penser qu’il n’y aura pas de perte. Je dis toujours qu’il n’y a aucun problème à l’erreur. Une fois la partition digérée, il faut se concentrer sur comment gérer les soucis en une fraction de seconde. L’information est entre eux, la solution est entre eux. Parfois un cri poussé par l’un des interprètes leur permettra de se resynchroniser. Il ne faut laisser personne dans le fossé. On est faillible, on est des êtres humains, et c’est d’autant plus beau de voir comment on se redresse et on repart. Il faut arriver au bout, ensemble. C’est de ça dont il s’agit quand je dis qu’un interprète au sol serait un échec terrible.
JP Ce que tu dis a presque une portée politique.
OD L’art est politique, puisqu’il implique une prise de parole. Pour autant, je ne développe pas de discours politisé avec mon travail. La perception politique est intime et propre à ceux qui vont recevoir. Je pense que le rôle des artistes n’est pas de s’occuper de cela. Qu’en penses-tu ?
JP Je suis d’accord. Souvent il y a une confusion autour de cette dimension politique. Les artistes font des choses pour les adresser à un public, c’est donc porteur d’une vision du monde, d’une forme de hiérarchisation. Lorsqu’on écrit une chanson, on choisit de parler d’une chose et pas d’une autre. Mais souvent on confond le politique avec une forme de réaction sur des questions d’actualité. Et ça, c’est très différent. Qu’un artiste s’arroge le droit de commenter les sujets d’actualité, ça n’a pas de sens. Ils ne sont pas forcément les personnes les plus légitimes pour faire ça, même si certains le font bien. L’art s’inscrit dans une temporalité qui est différente de celle d’un polémiste ou d’un journaliste qui va réagir au jour le jour à ce qui se passe autour de lui. Souvent, je me suis demandé comment je pouvais reconnaître l’impact d’une œuvre, comment comprendre à quel point elle a pu me toucher. Cela se passe quand je regarde une pièce de théâtre, de danse, un film, ou quand je lis un bouquin, et que cela me donne envie de créer à mon tour. Il y a comme un passage d’une énergie. Cette excitation de l’imaginaire, ce passage de l’imaginaire à l’action est politique. Il y a des œuvres qui nous donnent les moyens d’agir.
OD Quand on parle de politique, on a tendance à oublier que le premier élan créatif vient de l’intérieur de soi. On est d’abord d’un égoïsme terrible, nous sommes les vampires de nous-mêmes. Ça ne peut fonctionner que comme ça, sur soi et en soi. C’est ensuite que cela va produire quelque chose qui ne nous appartiendra plus, mais qui est pourtant né de quelque chose d’intime. Si on cherche à avoir une approche politique dirigée, à vouloir parler de tel ou tel sujet, alors on fait du commentaire de société. Je ne comprends pas ces artistes qui vont dire : « Je vais faire une pièce sur le climat ou sur la guerre. » Créer, c’est être à la fois dans un état de vulnérabilité et de prétention.
JP Tu parlais de partition un peu plus tôt. La notation en danse est complexe car il y a différentes manières d’écrire la danse, n’est-ce pas ? Comment tu procèdes ?
OD Contrairement au solfège qui est un savoir accessible, il n’y a pas d’écriture universelle en danse. Moi par exemple, je ne sais pas lire la danse mais je fais noter toutes les pièces en Laban (C’est un système mis en place par Rudolf Laban, théoricien et chorégraphe allemand. C’est l’un des plus connus et il est utilisé à l’international depuis son apparition en 1928.) Et j’invente mon propre système d’écriture, qui est repris par mon annotatrice Laban pour ouvrir de nouveaux champs. Puisque je ne lis pas le Laban, pourquoi je fais noter mes spectacles? Parce que j’adorerais qu’un jour quelqu’un vienne me voir et me dise : « J’adore Tragédie mais j’aimerais la reprendre pour la rendre encore meilleure. » Mais malheureusement pour que cela arrive, il faut connaître cette écriture. Tant qu’elle n’est pas enseignée dans les conservatoires et les écoles de danse, elle restera un langage savant à la portée limitée.
Je voulais te demander comment tu développes l’univers visuel qui accompagne ta musique, notamment celui des clips ?
JP Le clip est un objet intéressant car purement promotionnel. Aujourd’hui, c’est une contrainte qui s’étend jusqu’aux réseaux sociaux, il est très difficile de sortir un disque sans être y présent et les alimenter avec des contenus visuels. Ce qui n’est a priori pas le domaine d’expertise des musiciens ! Mais c’est un passage obligé. J’ai eu quelques expériences malheureuses en matière de clips au début de ce projet. Rien de catastrophique, mais j’ai bien senti que pour que les clips servent ce que je voulais faire passer dans ma musique, il fallait que je reprenne la main dessus en travaillant avec des proches dont j’appréciais le travail ou alors en invitant des personnes que je ne connaissais pas directement, mais dont j’admirais le travail, comme le réalisateur Yann Gonzalez. En l’occurrence, pour Yann, il s’agissait vraiment d’une carte blanche autour du morceau « Les vacances continuent ». Pour le dernier, sur le titre « El Sueño », j’ai invité Alexis Langlois. J’étais très content car on se connaît depuis longtemps. Ce qui est intéressant pour ces réalisateurs, c’est que les clips sont aussi un laboratoire, c’est l’occasion de tester des choses.
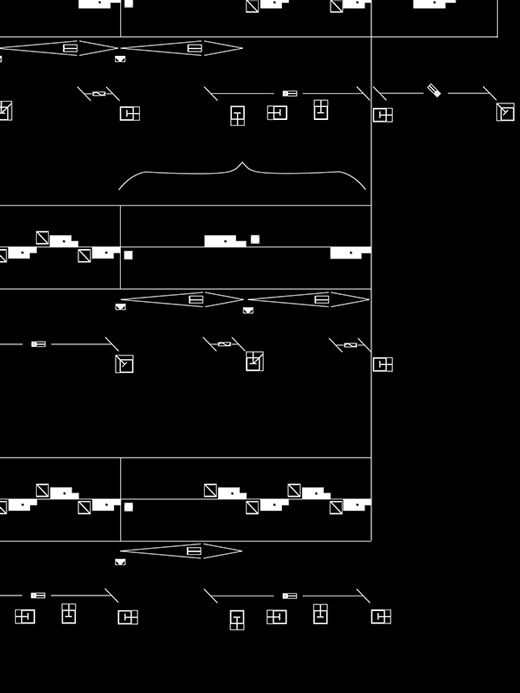
Extraits et détails provenant des partitions en système Laban de pièces d’Olivier Dubois. Notation Estelle Corbière.
OD Comment tu gères le fait d’être interprète du clip ?
JP Ça dépend ! Quand j’ai commencé à faire de la musique, je ne me suis pas dit « Je veux faire des clips ! »
Il y a donc un côté un peu amateur, on incarne quelque chose dans les clips qui doit être raccord avec la musique, et c’est bizarre car on n’est pas vraiment préparé à ça, mais certains musiciens le font naturellement.
Sur « El Sueño », Alexis a été très directif. Je ne suis pas acteur, donc c’était intéressant de travailler avec lui car il est très « mécaniste » dans sa manière de diriger. Il n’est pas du tout dans la psychologie.
Et toi, est-ce que tu pourrais t’amuser de chorégraphier un clip ?
OD J’adorerais ! J’ai eu des propositions mais je n’ai jamais pu le faire. Et j’adorerais être dans le clip! Ce que j’aime avec les commandes, c’est de rentrer dans la tête de l’autre, je ne cherche pas à reproduire mon travail. Il faut que ce soit un hybride au service de l’autre. C’est passionnant car ça permet d’apprendre. En tout cas, si à l’avenir tu cherches un chorégraphe…
Propos recueillis par Justin Morin
Les pensées irrationnelles doivent être poursuivies de manière absolue et logique
Haegue Yang
Compositions géométriques de stores vénitiens en aluminium. Sphères couvertes par des franges de cloches et de poignées. Totems de forme organique en paille et plantes artificielles. Ces sculptures font partie de l’univers développé par Haegue Yang. L’artiste sud-coréenne est installée à Berlin mais vit actuellement dans divers endroits, au gré de ses nombreuses expositions dans le monde entier. Ses travaux abordent les thèmes de la migration, de la mobilité sociale ou de la dichotomie entre espace privé et espace public. Yang bouleverse souvent son vocabulaire d’abstraction visuelle en y introduisant des expériences sensorielles qui font intervenir le mouvement, l’odeur ou la lumière. Avec des références sous-jacentes à l’histoire, l’art, la littérature et la philosophie, sa recherche est dense. Dans cet entretien, Hamid Amini interroge l’artiste sur les procédés et les secrets qui sous-tendent ses créations.
Hamid Amini
Vous avez écrit : « La plupart des gens ne peuvent pas imaginer ce que cela implique d’être un non occidental dans le monde de l’art contemporain. » Quels aspects de cette expérience ont représenté le plus grand défi ? Ou bien « défi » n’est-il pas le terme adéquat ?
Haegue Yang
Oui, cela a figuré dans une interview réalisée en 2017 dans le cadre de ma recherche artistique autour de plusieurs personnalités, en particulier Isang Yun. Pour préciser ma pensée, je vais me citer : « En Corée, l’art n’a jamais été séparé de la philosophie, de l’érudition ou du pouvoir politique ; l’art contemporain est une obsession moderne. » Je ne suis vraiment pas très attachée à la tradition, cependant, au cours de mon travail dans ce domaine, j’ai pris conscience que j’accorde beaucoup plus de valeur à la pensée holistique qu’à une démarche professionnelle axée sur le genre. Nous avons tendance à considérer l’artiste comme un professionnel, mais cette assimilation ne prend pas en considération le sens profond de la création artistique dans la société, ni même dans la civilisation au sens large.
Hamid Amini
J’ai beaucoup aimé l’installation Handles exposée dans l’atrium du nouveau MoMA. C’était formidable de voir des performers interagir avec vos sculptures (littéralement les manipuler). Pour moi, cela reflète l’accent mis par le musée sur les récits historiques alternatifs, comme l’art cinétique et l’art tactile des années 60 et 70, quand les artistes cherchaient différents moyens de faire interagir le public avec leurs œuvres. Quelle est pour vous l’importance de l’interaction entre les spectateurs et vos œuvres ?

Haegue Yang (1971), The Intermediate – Rolling Bushy Nosy, 2016. Paille artificielle, support en aluminium, grille métallique, plantes et légumes artificiels, roulettes. 184 × 105 × 123 cm Avec l’aimable autorisation de l’artiste et de kurimanzutto, Mexico. Photo : Studio Haegue Yang.
Haegue Yang
J’ignore ce que le musée avait l’intention d’explorer sur le plan historique. Souvent, je considère d’un regard critique l’interaction en elle-même, car cette interaction directe nous empêche de maintenir la distance nécessaire à la réflexion et à la contemplation.
Cependant, Handles a été un projet particulier, impliquant un processus de création très riche aussi bien pour les sculptures que pour les peintures murales comportant des ennéagones. Il m’a permis d’enrichir mon expérience avec des mouvements plus adaptés aux sculptures, ce que je n’aurais pas fait autrement. D’ordinaire, je ne m’intéresse pas à la conception de chorégraphies spécifiques pour les sculptures, même si j’ai déjà créé plusieurs sculptures performatives, par exemple Dress Vehicles et Sol LeWitt Vehicles. Bien que j’éprouve une certaine réticence à composer des mouvements prédéterminés, observer cette dynamique et comprendre comment animer une sculpture fut une belle expérience.
Hamid Amini
Quels éléments sensoriels voulez-vous intégrer en particulier ?
Haegue Yang
La plupart de mes sculptures mobiles sont sur roulettes. En fait, elles sont devenues un instrument permettant d’« adhérer » au sol, c’est-à-dire qu’elles suivent la régularité et les irrégularités du sol ainsi que nos propres mouvements quand nous les manipulons.
Le cliquetis des cloches résulte de l’action simultanée de ces éléments, celle du sol (environnement) comme celle du mouvement (performer). Ainsi, l’expérience sensorielle est une amplification complexe de l’interaction entre environnement et performance.
Hamid Amini
Beaucoup de vos pièces, y compris Sallim, vos monotypes de plantes pressées et votre série Trustworthy mettent en scène des objets et des produits domestiques, qui introduisent des enclaves d’intimité dans l’espace d’exposition public. Quelle place occupe la vie domestique dans vos créations ?
Haegue Yang
Cette notion m’a aidée à comprendre l’antithèse des représentations. Souvent, elle correspond à des pensées intériorisées et à des perceptions subjectives, qui ne sont pas visibles en surface. Beaucoup de mes interprétations d’objets, de personnages, d’événements historiques, de phénomènes, tant culturels que naturels, visent à les digérer pour être à même de les utiliser dans la conception de mes pièces. Les cosys tricotés sont une autre étape du parcours qui m’a finalement conduite à rendre hommage à la banale boîte de conserve devenue capsule temporelle (un mode de préservation pour des « temps difficiles » inconnus), symbole de la peur et de l’anxiété humaines, qui sont, selon moi, une vulnérabilité. Sallim défend cette posture d’une manière psycho-architecturale complexe, en exposant la cuisine comme un lieu où l’on fait bouillir, nettoie et cuit, comme un espace habité par la chaleur, la fumée et les odeurs. Contrairement à d’autres espaces de représentation où le respect de l’autorité et des traditions est primordial, celui-ci est perméable.
Hamid Amini
Pourriez-vous décrire la manière dont vous travaillez dans votre studio ? Collectez-vous des matériaux ?
Haegue Yang
Je collectais beaucoup de matériaux toute seule. Au cours de tous mes déplacements, je me rendais dans des quincailleries, des discounts, des magasins de loisirs créatifs, des merceries, etc. et je les rapportais dans mon studio.
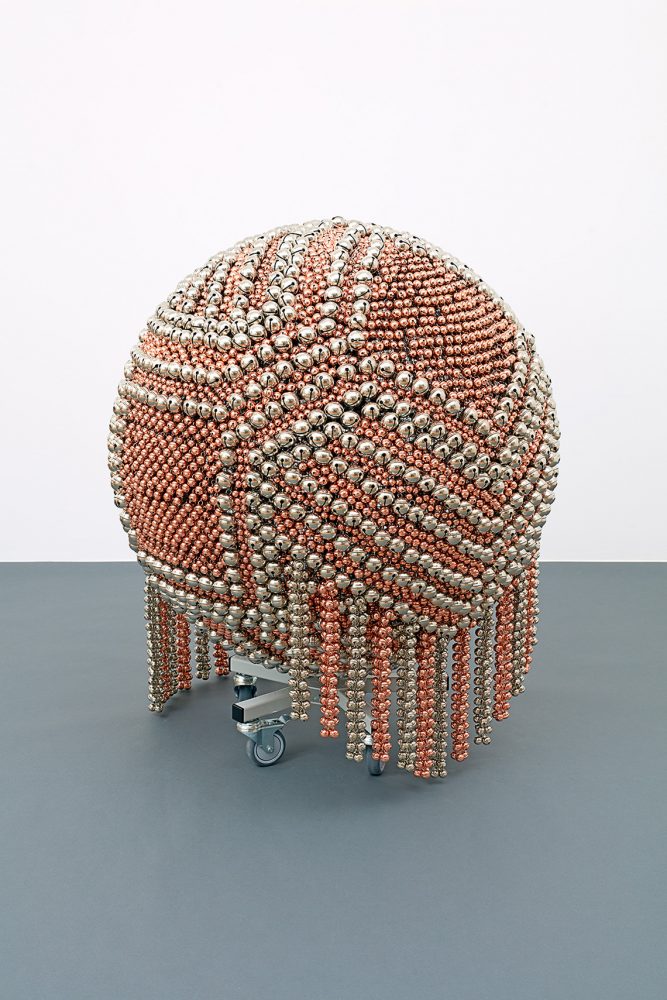
Haegue Yang (1971), Sonic Sphere – Diagonally- ornamented Copper and Nickel, 2015. Support en acier, grille métallique, roulettes, clochettes chromées, clochettes en nickel, bagues métalliques. 99 × 82 × 83 cm Photo : Studio Haegue Yang. Avec l’aimable autorisation de l’artiste et de kurimanzutto, Mexico / New York.
Cette période coïncide avec la production prolifique de sculptures lumineuses où les objets dominaient en tant que voix narratives et en tant que matérialisation de notions, telles que l’étrangeté, la pauvreté, la dévaluation, la banalité, tout ce que je souhaitais mettre en lumière.
Seoul Guts, par exemple, se fait l’écho de toutes les « pauvres voix » exprimant des désirs désespérés : être beaux, sains, propres, etc. C’est une sorte de portrait de gens et de lieux. C’est intense et vital. Il m’est difficile de résumer ou de condamner facilement tous ces désirs qui ne sont pas nécessairement sérieux, mais plutôt triviaux et ordinaires. J’ai également ressenti beaucoup d’empathie à l’égard des gens qui accumulent les accessoires de téléphone, les appareils de massage ridicules et bon marché ou les articles de beauté.
C’était un processus d’intériorisation de leurs désirs et de leurs envies sans avoir de contact direct avec eux.
L’acte d’achat a progressivement disparu, au fur et à mesure que la production de sculptures lumineuses a diminué. Et pour sa dernière phase, j’ai beaucoup cherché des matériaux via Internet, un autre processus d’exploration intéressant, mais très différent d’un déplacement ou de la fréquentation de magasins. Actuellement, j’ai tendance à ne plus accumuler autant de matériaux dans l’atelier.
Hamid Amini
Réalisez-vous des croquis ?
Haegue Yang
Non. J’essaie de ne pas faire de dessins artistiques, car je ne fais pas confiance à mes mains pour dessiner. Je ne fais que des dessins techniques, uniquement destinés à la préparation de mes expositions. La plupart sont préparées à l’aide de dessins en 3D pour compenser ma mauvaise appréhension de l’espace et de l’échelle. De plus, la conception de l’espace est si complexe que la simulation en 3D est une aide précieuse. Cependant, j’essaie de faire en sorte que ces simulations restent simples. La perfection de la simulation est intentionnellement limitée, c’est-à-dire que j’évite un rendu ou de nombreux effets disponibles en 3D. Je cherche principalement à vérifier la forme et l’échelle, la tonalité des couleurs élémentaires, certains points de vue essentiels et la trajectoire des visiteurs.
Hamid Amini
Ce numéro de Revue est consacré au minimalisme. Est-ce une notion que vous prenez en compte dans votre travail ? Pouvez-vous expliquer votre relation avec Sol LeWitt, un artiste que vous citez dans la série Sol LeWitt Upside Down ?
Haegue Yang
Je souhaite citer ici quelques éléments de la pensée de Sol LeWitt :
Propos sur l’art conceptuel
Publié pour la première fois dans 0-9 (New York), 1969, et Art-Language (Angleterre), en mai 1969.
1 — Les artistes conceptuels sont des mystiques plus que des rationalistes. Ils tirent des conclusions que la logique ne peut pas atteindre.
2 — Les jugements rationnels reproduisent les jugements rationnels.
3 — Les jugements irrationnels conduisent à de nouvelles expériences.
4 — L’art formel est essentiellement rationnel.
5 — Les pensées irrationnelles doivent être poursuivies de façon absolue et logique.
Cette liste numérotée comprend 35 entrées. Ce que j’entends ici est très différent de ce qu’on entend généralement par minimalisme. Il y a un caractère absolu et aléatoire, libéré de la logique,et une profonde émancipation.
Hamid Amini
Vos titres, qu’il s’agisse de vos pièces ou de vos expositions, semblent toujours très énigmatiques. Comment les concevez-vous ?
Haegue Yang
Lorsque je donne des titres à mes œuvres et à mes expositions, je tente de révéler mes centres d’intérêt, qui ne cessent de changer, d’évoluer et de se transformer. Cela reflète mon désir de dévoiler la direction vers laquelle je me dirige, car je souhaite vraiment que le public puisse suivre mon parcours. Autrement dit, mon évolution doit être traçable.
Ma précédente exposition individuelle au Bass Museum, en Floride, s’intitule In the Cone of Uncertainty, et la prochaine exposition que je prépare au MCAD à Manille a pour titre The Cone of Concerns. Ces deux lieux ont en commun d’être affectés par des phénomènes météorologiques extrêmes, telles que les pluies torrentielles, les inondations, la montée du niveau de la mer, et autres catastrophes. Dans les titres, je montre que je poursuis mes recherches sur la relation entre l’homme et le climat, et je m’interroge sur les concepts auxquels renvoie cette question surgie quand on a commencé à prévoir la trajectoire des ouragans, des cyclones ou des typhons. Cependant, les prévisions restent assez limitées, si l’on en croit la théorie de l’effet papillon. Encore une fois, selon ces références météorologiques, on tente de modéliser une trajectoire sous la forme géométrique d’un cône. Ces transcriptions graphiques ainsi que les expressions qui mènent à la question : « Sommes-nous dans le cône ou non ? » symbolisent à la fois notre capacité et notre incapacité à prédire le temps qu’il fera. Pourtant, à mes yeux, l’adaptation à l’atmosphère, à l’humidité, à la température, et aux autres paramètres physiques est notre lot quotidien.
PROPOS RECUEILLIS PAR HAMID AMINI
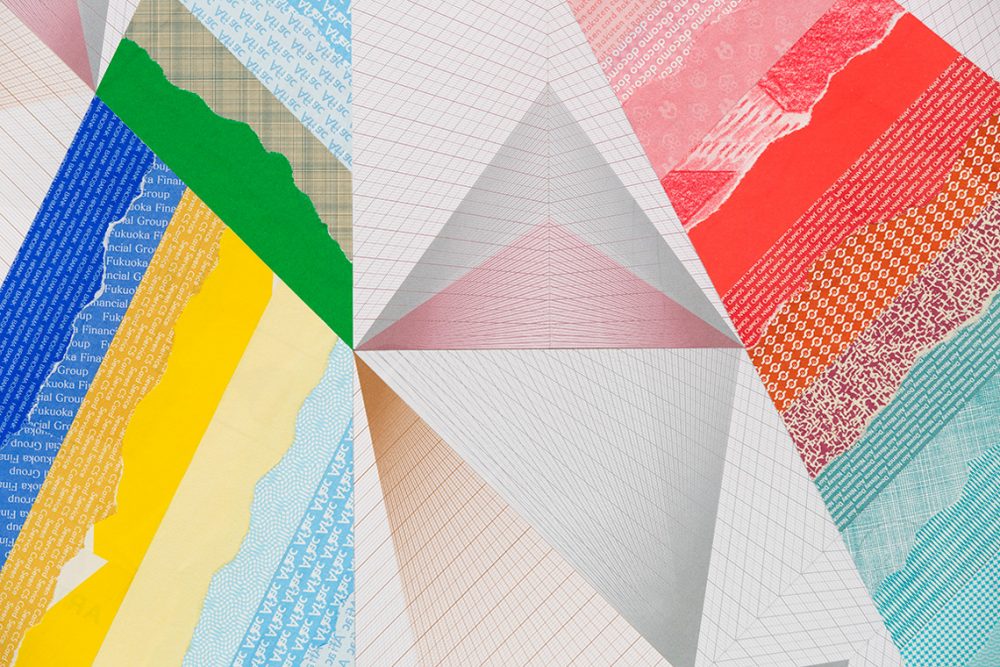
Haegue Yang (1971), Kaleidoscopic Tipping Over in Asymmetry – Trustworthy #241, (detail), 2015. Différentes enveloppes avec motif de sécurité, papier millimétré, encadré, 2 parties. Taille de l’œuvre : 100 × 100 cm chacune. Taille encadrée : 102.2 × 102.2 cm chacune. Avec l’aimable autorisation de l’artiste et de kurimanzutto, Mexico.
Smooth Operator
Bojan Šarcevic
La pluralité de la pratique de Bojan Šarcevic– et notamment son aptitude à se réinventer formellement – a amené les critiques à classer l’artiste parmi les conceptuels. Mais cette étiquette véhicule son lot de clichés. Surtout, elle a tendance à occulter l’une des qualités premières des œuvres du sculpteur : leur puissance sensible. Récemment, le titre de sa quatrième exposition personnelle à la galerie londonienne Modern Art résonnait comme une déclaration : Sentimentality is the Core. C’est bien dans sa capacité à générer des émotions complexes, à même de brasser le politique à l’intime, le monumental à l’accessoire, le minimalisme au lyrisme, que se dessine l’œuvre de Šarcevic.
Ainsi donc, cette exposition présentait plusieurs réfrigérateurs industriels, tous placés le long des murs de l’espace vide de la galerie. Ces ready-made, monolithes de plastique et de métal, se fondaient dans l’environnement blanc de Modern Art. À l’intérieur des congélateurs, aucun produit, ni cornet de glace ni morceaux de viande, juste du vide, ou plutôt, des cristaux de givre et des ensembles de glace aux formes sculpturales abstraites. Seule une musique – lointaine, fantomatique, mélangée au bourdonnement sourd des machines – emplissait l’espace. Parmi cette bande-son, on pouvait reconnaître des artistes comme Sade, Billy Idol, Chaka Khan ou encore George Michael. Ces hits, issus de la fin des années 80, agissent comme des indices autobiographiques. Né en 1974 à Belgrade, Bojan Sarcevic a grandi avec ces morceaux. S’il n’a pas connu la guerre – sa famille a quitté la Bosnie en 1991, quelques mois avant le début du conflit –, la puissance spectrale de l’installation reste troublante. L’exposition prend des allures de supermarché abandonné et se transforme en machine narrative, collision anachronique de souvenirs adolescents et d’inconscient collectif. Pour autant, Sentimentality is the core ne cherche en aucun cas à être un témoignage historique. Quand on questionne l’artiste sur les origines du projet, celui-ci répond : « Tout est parti d’une situation qui m’a marqué. J’étais à l’aéroport d’Amsterdam. Je venais de descendre d’un avion, il était environ 23 heures, et je devais prendre un bus pour aller dans la ville. Il n’y avait personne sur les quais. Il faisait froid, je voyais la lune. Tout était désert. En face de l’arrêt de bus, j’ai vu un camion benne, à cheval sur le trottoir et sur la route, bourré de sacs poubelle. L’engin était visiblement en marche car j’entendais le moteur. Les fenêtres étaient baissées mais il n’y avait pas de conducteur. Une chanson de George Michael sortait de l’autoradio. C’était le titre A Different Corner. Cette scène, cette image d’une machine, a généré en moi un certain type d’émotion, lié à une mémoire précise, et m’a réellement ému. Ça a duré trois minutes, c’était sublime et ça m’a beaucoup travaillé. Ce moment questionnait l’idée de nostalgie. J’ai aujourd’hui 45 ans, je n’arrête pas de regarder en arrière. D’où je viens ? Quel est mon parcours ? L’adolescence est un moment où l’on devient indépendant et on se définit, notamment à travers la musique. » Au-delà de ce télescopage de références – entre géopolitique, culture pop et histoire de l’art ; on pense notamment aux aspirateurs ready-made de Jeff Koons – se joue une recherche formelle ambitieuse. Chaque réfrigérateur dissimule une enceinte qui permet de diffuser la musique. Les ondes sonores influencent directement la structure des cristaux de glace. Ces formes organiques interagissent avec les lignes industrialisées des réfrigérateurs dans un ballet macroscopique au rythme ralenti par le froid.

Bojan Šarcevic, invagination, vue d’exposition, 23 novembre 2016 — 14 janvier 2017. Photo : Robert Glowaci Avec l’aimable autorisation de l’artiste et de Modern Art, Londres. © Bojan Šarcevic
Lorsqu’on regarde le travail de Bojan Šarcevic, qu’il s’agisse de ses précédentes expositions chez Modern Art ou de ses propositions pour la galerie berlinoise BQ, on constate qu’il investit des formes très variées et n’applique aucune recette. Il acquiesce : « Je n’ai pas de méthode. Chaque nouveau projet m’amène à repartir de zéro. Plus jeune, je paniquais face à cette idée ; je ne possède pas un savoir-faire ou une technique que je pourrais appliquer et décliner à l’infini. Il me faut construire une démarche qui m’est propre. Ceci étant dit, je ne suis pas intéressé à l’idée de rentrer dans un système. » Quand on lui demande si sa pratique se développe dans un atelier, il répond : « Certains projets nécessitent de grands espaces et d’autres fois, ma table de cuisine me suffit largement. Je vis entre Bâle et Paris et je m’adapte à cette mobilité. Ces dernières années, mes recherches se partagent entre mon ordinateur, une table et des notes prises dans un carnet. » Ce nomadisme physique se traduit par une aptitude au déplacement sémantique :
« Dans mon travail, beaucoup de choses se construisent autour de la reconnaissance. À partir de quel point on reconnaît quelque chose que l’on ne comprend pas ? Qu’est-ce que ça veut dire de reconnaître quelque chose mais de ne pas le comprendre ? »
Ce décalage se joue à plusieurs niveaux, parfois simultanément, mais toujours dans un élan poétique. Avec les deux sculptures monumentales He and She, Bojan Šarcevic fait se rencontrer l’histoire de l’art à celle d’une roche ancestrale, jouant sur les échelles temporelles. Les deux pièces sont d’imposants blocs d’onyx, une variété d’agate dont les bandes circulaires et concentriques dessinent d’impressionnants motifs. Employée comme pierre d’ornement et comme objet décoratif, elle naît d’un processus de transformation lent et complexe, réactions chimiques d’intercalations argileuses et d’oxydes minéraux. Face à ce travail de la nature, l’artiste procède à des coupes nettes qui permettent de rentrer littéralement dans la matière et dans le temps. Ces incisions rectangulaires rappellent la rigueur de l’art minimal. Les formats de ces œuvres, leur rapport au corps humain, résonnent avec les dimensions des blocs de marbre utilisés dans la sculpture antique. De la même manière, leur titre leur offre une incarnation, un peu comme s’il s’agissait d’une représentation d’une civilisation lointaine, tant dans l’espace que dans le temps. Au sujet de cet ensemble de pièces, l’artiste explique qu’il s’agissait de questionner son rapport à l’image : « Un peu comme j’ai pu le faire avec mes films, où je filmais en pellicule 16mm des petites sculptures, des maquettes afin de leur donner une texture, le principe est ici inversé. Je cherchais à retrouver une picturalité dans l’objet. He et She, c’est de l’image pure, mais en sculpture ! »
Le travail de Bojan Šarcevic développe son lyrisme dans ses zones floues. Parfois, il produit des moments incongrus. Ainsi, le communiqué de presse de l’exposition Invagination se résume à une phrase, qui elle-même synthétise la manière de penser de l’artiste : « Invagination refers to the idea of something being turned inside-out, turned-in, or folded back on itself » (Invagination fait référence à une chose retournée, tournée ou repliéesur elle-même). Avec ce facétieux jeu de mots, il met en avant un esprit à la souplesse créative, sans pour autant imposer une lecture au profit d’une autre :

Bojan Šarcevic, The Breath Taker is The Breath Giver (Film A), 2009. Avec l’aimable autorisation de l’artiste et de Modern Art, Londres. © Bojan Šarcevic

Bojan Šarcevic, Sentimentality is the Core, vue d’exposition — détail, 21 novembre — 21 décembre 2018. Photo : Robert Glowaci Avec l’aimable autorisation de l’artiste et de Modern Art, Londres. © Bojan Šarcevic
« Je ne cherche pas à ériger un discours, je ne pense pas que l’artiste détienne le sens du monde. En tout cas, moi, je n’essaie pas d’exprimer ce sens. J’éprouve la nécessité de construire à partir de l’extérieur, à partir de l’extériorité du monde. C’est une notion paradoxale, car elle est autant politique qu’elle ne l’est pas, et j’essaie de la faire rentrer dans mes pièces. J’essaye d’avoir un certain sens du monde, une intuition, mais en même temps, je ne pourrais pas l’expliquer. Au fond, je ne cherche pas à produire un discours articulé ou un discours militant. Je pense que regarder, percevoir quelque chose, c’est déjà donner sens à cette chose. »
En ce sens, Šarcevic déploie une vision kaléidoscopique, basculant incessamment de la figuration à l’abstraction, de l’infiniment petit à l’immensément grand, du commun au singulier, à travers des dispositifs aussi simples qu’ingénieux.
Texte de Justin Morin

Bojan Šarcevic, Presence at Night, 2010.
Avec l’aimable autorisation de l’artiste et de Modern Art, Londres. © Bojan Šarcevic
Opus Focus Pocus
Trix & Robert Haussmann
Magiciens de l’espace, Trix et Robert Haussmann sont à l’origine d’une œuvre qui débute véritablement dans les années 60. Aménagement de boutiques de designers, création de grands magasins, réalisation de mobiliers graphiques et ludiques, on pourrait tenter de définir leur style par une rencontre incongrue entre les formes minimales et l’op art. Adepte de techniques artisanales, le duo a adopté des positions qui semblent aujourd’hui visionnaires. Zürich, la ville où il est basé, a accueilli nombreux de leurs projets. Originaire de la ville suisse, Syra Schenk a arpenté plusieurs d’entre eux, véritables repères architecturaux. Elle s’entretient avec ce duo dont la modestie n’a d’égal que le talent.
Syra Schenk Vous avez travaillé sur plusieurs décennies avec la famille Weinberg, propriétaire des boutiques multimarques zurichoises du même nom, pour laquelle vous avez réalisé des espaces de vente. Ces projets sont tous très différents mais portent néanmoins une signature Haussmann lisible. Comment cette collaboration a-t-elle commencé ?
Trix Haussmann On a rarement la chance d’avoir des maîtres d’ouvrage comme les Weinberg. Nous étions amis. Tous les deux avaient un grand intérêt pour l’art, ils étaient collectionneurs. Et l’univers de l’art était très important dans notre vie également. Le lien entre l’art et le commerce est très particulier dans notre approche.
Robert Haussmann L’architecture commerciale est toujours de courte durée, voire éphémère. C’est très rare qu’un projet perdure plus de sept ans. Nous avons beaucoup travaillé en Allemagne avec Görtz, une grande chaîne de chaussures, et tous les trois ou quatre ans, ils voulaient quelque chose de nouveau. Les Weinberg étaient une exception, car ils voulaient être impliqués dans le dévelop-pement, ce qui est rare chez un détaillant.
Syra Schenk Avec la boutique Lanvin (Zürich, 1977), une licence de la famille Weinberg également, vous avez ravivé des techniques artisanales oubliées, notamment avec des peintures trompe-l’œil de marbre sur bois. L’espace principal était une pièce étroite, et vous avez réussi à l’étirer grâce à cette technique appliquée du sol jusqu’au plafond. La boutique semblait de ce fait très imposante.
Robert Haussmann Cette boutique Lanvin était comme un précepte de théorie architecturale, non pas sous la forme d’un texte, mais d’une construction – nous avons pu intégrer des éléments fondateurs dans ce magasin. Ce cube, le dialogue entre le vrai marbre et le trompe-l’œil, tout cela était novateur à l’époque. La technique du trompe-l’œil nous a toujours intéressés. À l’époque c’était très inhabituel, on pouvait entendre que nous trichions !
Trix Haussmann L’architecture du XVIe siècle nous a toujours beaucoup influencés. Durant cette période, le trompe-l’œil était fortement utilisé. Nous n’avons bien évidemment rien inventé. Dans l’histoire de l’art, il y a eu la période du maniérisme classique, qui a représenté une véritable rupture avec l’époque qui la précédait. Nous avions l’impression que nous étions à nouveau à un point de rupture dans les années 70. Nous avons donc décidé d’adapter ces techniques artisanales anciennes à notre époque. Nos maîtres d’ouvrage ont joué le jeu,ils trouvaient cela intéressant.
Dans une boutique de mode, tout ce qui attire l’attention est juste : cela laisse la place à l’expérimentation. Les clients viennent si quelque chose est nouveau et intéressant.
Syra Schenk Vous vouliez appliquer la technique du trompe-l’œil jusqu’aux mannequins de vitrines, mais vous vous êtes ravisés.
Robert Haussmann Elles avaient l’air d’avoir une maladie de peau ! Ce n’était vraiment pas possible.
Trix Haussmann Oui, nous avons pensé que ça allait vraiment trop loin !
Syra Schenk Vous avez réalisé un trompe-l’œil sur vitrail pour cette boutique Lanvin, représentant un drapé. Il se trouve que le drapé était un élément important dans le travail de Jeanne Lanvin. Est-ce que son travail a inspiré ces fenêtres plombées ?
Trix Haussmann Le drapé nous plaisait pour sa théâtralité. C’est un motif que nous avons utilisé ensuite pour la Galleria à Hamburg (construite entre 1978 et 1983). La boutique Lanvin a été une œuvre clé pour nous. Elle a beaucoup été publiée à l’international, car c’était la première fois que des architectes d’intérieur réinterprétaient l’histoire de cette manière-là.
Syra Schenk Un peu plus tôt, en 1971, vous aviez réalisé la boutique zurichoise de Courrèges, également en licence des Weinberg. Apparemment, André Courrèges lui-même était ravi de cet espace.
Trix Haussmann Je trouvais sa mode vraiment géniale, je ne portais plus que ça.
Syra Schenk Ses collections à l’époque n’étaient pas seulement modernes, elles étaient pratiques. Elles s’adressaient typiquement aux femmes comme vous, qui travaillaient et avaient une vie de famille.
Trix Haussmann Durant ce projet, j’étais enceinte de notre dernier fils, et je m’habillais en Courrèges ! À cette époque on ne montrait pas son ventre, on portait des vêtements amples… Les robes trapèzes étaient bien différentes des vêtements de grossesse classiques.

Da Capo Bar, IntÉrieur, Aufgang, Hauptbahnhof, Zürich, 1981.
Extrait du livre Trix + Robert Haussmann,
Fredi Fischli, Niels Olsen, Edition Patrick Frey, 2012.
Robert Haussmann La boutique Courrèges était dans un bâtiment qui devait à l’origine être rasé. Il devait être reconstruit dans le style de la Kantonalbank, une construction moderne. Le bâtiment a soudainement été classé monument historique, car il datait de la période Gründerzeit, l’époque des fondateurs. On pensait tout d’abord que notre boutique ne durerait que deux ou trois ans. Donc rien n’a été changé dans la structure de l’architecture : nous avons apposé une façade sur les vitrines existantes, un drap épais tendu sur le plafond, qui servait de cache-misère pour une extraction hideuse, et mis au sol un carrelage plutôt bon marché. Mais tout ça donnait un ensemble homogène. Ça nous convenait bien, et ça convenait à monsieur Courrèges.
Syra Schenk C’était un des projets les plus économiques, n’est-ce-pas ?
Robert Haussmann Oh oui, aucune comparaison possible avec le projet pour Lanvin.
Syra Schenk L’immatériel est très important dans une boutique de mode. Et à ce sujet, vous avez fait quelque chose de très simple, mais d’essentiel : vous avez fait entrer la lumière naturelle dans les magasins, notamment en ouvrant les vitrines, jusque-là cloisonnées.
Trix Haussmann Nous avons peut-être fait partie des pionniers à l’époque car nous nous intéressions à autre chose qu’aux styles conventionnels.
Robert Haussmann Il y avait des projets superbes à l’époque dans le minimalisme, comme ceux de Comme Des Garçons. Il n’y avait quasiment pas de mobilier, seulement une barre et une corde.
Trix Haussmann Nous avions vu la boutique Comme Des Garçons à Paris, et lorsque j’ai vu leurs défilés, j’ai été fascinée. Les vêtements étaient différents, ils ne cherchaient pas à être beaux !
Syra Schenk Rei Kawabuko avait peut-être un peu la même approche que vous, il s’agissait pour elle de créer une véritable rupture.
Trix Haussmann C’est justement ce qui nous a plu – le courage qu’il fallait pour montrer quelque chose comme ça. C’était littéralement des anti-vêtements et des anti-boutiques.
Syra Schenk Vous dites aussi que vous vous limitez à peu de matières. Est-ce voulu ou cela découle simplement de votre approche aux projets ?
Trix Haussmann « Less is more » le dicton de l’architecte Mies van der Rohe, nous plaisait bien !
Robert Haussmann Quand on a des théories comme ça, on peut bien sûr faire l’inverse. Nous avons fait un Lehrstück, littéralement un « instrument pédagogique », qui s’appelle Function follows Form, en opposition au célèbre Form follows Function –le principe architectural de Louis Sullivan qui pose les bases de l’approche fonctionnaliste. On peut détourner cet adage : prendre une forme quelconque et réfléchir à ce que l’on peut en faire.
Trix Haussmann Si l’on veut raconter un point de vue, il faut se concentrer sur l’essentiel. Si l’on intègre une centaine d’anecdotes ou de blagues, on ne voit plus le message au final. Il en va de même avec la collection de matériaux utilisés dans un objet, elle doit être réduite à l’essentiel.

Galleria Hamburg, Passage, Hamburg, 1978-83.
Extrait du livre Trix + Robert Haussmann, Fredi Fischli, Niels Olsen, Edition Patrick Frey, 2012.
Syra Schenk Parlons justement des Lehrstücke, les instruments pédagogiques. Pourquoi avoir choisi ce nom ?
Robert Haussmann Nous avons tous deux toujours enseigné. À l’origine, ces objets étaient vraiment destinés à un but pédagogique. Nous voulions matérialiser certaines problématiques, visuellement, en volume, et non sous forme de texte, de livres.
Trix Haussmann Oui, nous voulions les représenter tridimensionellement. Ils s’agissaient vraiment de modèles de réflexion.
Robert Haussmann Les Lehrstücke étaient des objets didactiques. Au début il ne s’agissait pas de produits, mais de supports de réflexion. Certains Lehrstücke sont devenus des produits par la suite. Lors de notre dernière exposition à Londres, à l’automne 2019 chez Herald St, nous avons réalisé les modèles « üppige Kargheit », que l’on peut traduire par « sobriété opulente ». Ce sont presque des caricatures de meubles.
Trix Haussmann Ces fauteuils paraissent très lourds, mais le jeu de reflets des miroirs semble leur faire perdre leur volume et leur poids. Un étrange dialogue se créé, la lourdeur, le moelleux, donc l’opulence, et en même temps il y a cet accoudoir boudin, comme une saucisse, qui semble flotter.
Syra Schenk Pourquoi avoir choisi des couleurs primaires ?
Robert Haussmann C’est un hommage à l’époque Bauhaus. J’ai été élève chez Rietveld. Mais comme on disait, souvent l’idée vient de soi, et on doit l’habiter rétroactivement.
Trix Haussmann Ce qui n’est pas du tout « bauhäuserlich » – dans l’esprit Bauhaus – c’est quenos fauteuils et le canapé sont confortables. Ils ont des rembourrages mous. Le Museum für Gestaltung – musée des arts décoratifs – de Zurich va exposer ces pièces. Lorsque nous les avons dessinés, nous n’aurions jamais pensé qu’un musée s’y intéresserait.
Syra Schenk Il me semble que certaines de vos œuvres s’apparentent au mouvement Memphis. Étiez-vous en contact avec certains designers du groupe ?
Robert Haussmann Notre colonne Lehrstück II a été conçue avant l’époque Memphis.
Trix Haussmann Nous avions des liens avec les designers de Alchimia – le mouvement initié par Alessandro Guerrero –, et le mouvement Memphis est né de certains membres d’Alchimia.
Syra Schenk L’humour est-il important dans votre œuvre ?
Trix Haussmann Nous avons certainement toujours eu un rapport ironique, même envers des éléments qui nous dérangent ou nous irritent.
Robert Haussmann Il faut avoir le réflexe de contempler son travail avec du recul, comme un autre le verrait. Cette perspective mène rapidement à l’autocritique, et à d’autres positions que celles que l’on aurait prises initialement. Quelquefois c’est évident et réussi, d’autres fois ça fonctionne moins.
Au final, il faut bien faire quelque chose qui t’amuse. La saucisse volante justement, me plaisait terriblement.
Syra Schenk Les œuvres Chair Fun sont-elles aussi issues de cette envie?
Robert Haussmann Nous venions de nous rencontrer en 1967, quand il y a eu un petit feu dans l’atelier et ma chaise Eames a brulé. J’ai dévissé l’assise et gardé la structure, dans l’idée de la réparer un jour. Comme toujours dans ces cas, il n’en a rien été. La structure traînait dans un coin. Trix a trouvé des petits cactus chez le fleuriste du coin, nous les avons posés sur cette structure Eames et l’avons appelée la Maso-chaise ! Le Werkbund Suisse (l’association des créateurs et créatrices suisses) a missionné des artistes dans l’idée de faire une vente aux enchères. Nous avons créé ces quatre chaises spontanément, ce sont en réalité des objets trouvés. Par exemple, j’ai trouvé l’une d’entre elles dans une brocante. Nous nous sommes demandé ce qui se passerait si elle était en chocolat, comment elle fondrait… Des tubes de néon en forme de U ont été assemblés pour en faire une chaise. Nous avons démonté des chaises Thonet pour les entrelacer, pour créer des triplés inséparables… Bon, cela n’a pas rapporté beaucoup d’argent !
Syra Schenk Ce numéro de Revue porte sur le Minimalisme. Qu’est-ce que cela vous évoque ?
Trix Haussmann C’est justement ce qui m’intéresse le plus en ce moment. Je suis sur un projet… enfin il est en gestation depuis plus de vingt-cinq ans ! Il s’agit d’une maison qui doit être à la fois indépendante d’un point de vue énergétique et être réduite au strict minimum d’un point de vue de la forme.
Robert Haussmann De surcroît sur un terrain très difficile. Autrement ce serait simple de faire un cube. Mais quand il y a des centaines de contraintes additionnelles, avec des coins du terrain qui ne sont pas utilisables par exemple, alors l’exercice est bien plus complexe. Mais c’est vraiment un projet idéal.
Syra Schenk Tout comme Revue qui a un nom générique, votre société porte également un nom très simple, littéral : Allgemeine Entwurfsanstalt que l’on peut traduire par « Établissement de conception générale ».
Robert Haussmann Ce nom est arrivé quasiment par hasard ! Nous avions travaillé pour un éditeur de textiles et avions une exposition à réaliser pour lui au Casino Zürichhorn, une histoire purement commerciale. Vous savez sûrement que les échantillons de tissus sont des lambeaux plus ou moins grands. Les espaces étaient si hideux qu’on ne pouvait rien accrocher aux murs. Notre associé Alfred Hablützel a eu l’idée géniale d’aller chercher des rouleaux de carton ondulé de deux mètres de haut. Ces rouleaux déroulés à la verticale de manière aléatoire permettaient de placer les échantillons dessus, ou sur des manches à balai posés perpendiculairement en travers. Nous ne savons pas si ça a été un succès commercial, mais dans tous les cas nous sommes restés à la fin de l’exposition avec ces deux grands rouleaux de carton, que nous voulions réutiliser. Trix a donc eu l’idée de les annoter, pour qu’ils ne soient pas volés.
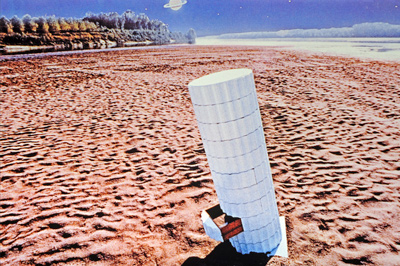
bauhaus art collection, Lehrstück II, Inszenierung Studio Alchimia, Mailand, 1980.
Extrait du livre Trix + Robert Haussmann, Fredi Fischli, Niels Olsen, Edition Patrick Frey, 2012.
Trix Haussmann Notre bureau à l’époque était atypique, il n’y avait pas de chef en soi, l’idée était que tout le monde participe de manière égale. Nous nous considérions une équipe et menions le bureau ainsi, en communauté. La secrétaire ne faisait pas le café par exemple.
Robert Haussmann Nous acceptions tout type de mission, de la conception de petite bureautique, d’assiettes ou de tissu, jusqu’aux maisons. Nous faisions comme ça, du « général ».
Trix Haussmann Et nous faisons de la conception. J’ai donc noté sur ces rouleaux de carton « Établissement de conception générale », et c’est resté !
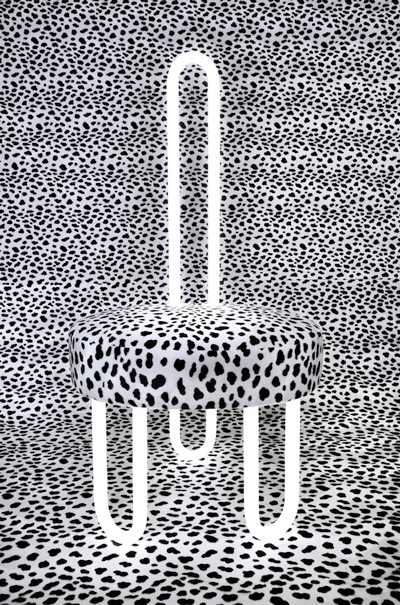
Chair-Fun : Neon-Chair, 1967.
Extrait du livre Trix + Robert Haussmann, Fredi Fischli, Niels Olsen, Edition Patrick Frey, 2012.
La science des odeurs
Sissel TolaasPhilippa Nesbitt
Le travail de Sissel Tolaas trouve sa source dans la recherche et l’enseignement et chevauche l’art et la science pour repenser notre manière de concevoir les odeurs. Elle a enregistré et reproduit l’odeur des villes, des océans, des individus — en d’autres termes de la vie du niveau micro au niveau macro. Ses installations ont été exposées partout dans le monde dans de multiples institutions tels que le Musée d’art moderne de Tokyo, le MoMA, la Galerie nationale de Singapour, le Centre Pompidou, la Biennale de Kochi-Muziris et la biennale de Venise. À travers ses différents projets, elle cherche à bousculer les préjugés qui dictent nos réactions aux odeurs. Sa recherche, d’une complexité délibérée, met en œuvre des méthodes inspirées de ses diverses expériences. Pour Sissel Tolaas, aucun thème ne reste inexploré, aucune odeur n’est interdite.
Philippa Nesbitt Votre travail porte sur l’intangible, il est donc assez difficile de le dépeindre avec des mots. Comment le définiriez-vous ?
Sissel Tolaas Toute ma vie j’ai été animée par une curiosité infinie et irrésistible pour l’invisible. Comment comprendre l’invisible ? Comment potentiellement rendre visible l’invisible ? Mener différentes opérations entre le possible et l’impossible, les entre-deux, est devenu mon quotidien. Je me définis comme une professionnelle de l’entre-deux. Je viens de la chimie organique, de la linguistique et des arts visuels. Au départ, je ne savais ni où j’allais ni dans quelle réalité je me retrouverais.
Tout ce que je savais c’est que j’avais besoin d’air pour rester en vie.
L’air est devenu le centre de mes préoccupations et, puisque chaque nano partie de l’atmosphère contient des molécules odorantes, j’ai fait de l’odeur mon sujet de recherche. Entre 1990 et 1997, j’ai constitué un répertoire considérable à partir d’odeurs réelles. Il consiste en 6730 sources et traite divers thèmes tels que « Odeur et préjugés », « Odeur et souvenir », « Odeur et langage » ou « Odeur et tolérance ».
La présence sur les lieux représente la moitié de mon travail — le travail sur le terrain est essentiel. Je recueille et j’enregistre les odeurs qui m’intéressent. Chaque matin, je me réveille en me disant : « Je respire ! Ça veut dire que je peux travailler. » À chaque inspiration, j’inhale des molécules d’odeur. J’inspire jusqu’à 24000 fois par jour et je déplace 12,7 mètres cubes d’air. Tant qu’il y a une planète à sentir et des habitants à qui apprendre à sentir, je ne m’arrêterai pas.
Depuis 2004, mon Smell Re_searchLab est financé par l’IFF [L’International Flavors & Fragrances Inc]. Grâce à cette aide, j’ai accès à une grande partie des recherches en chimie et en technologie des odeurs. Je possède des outils qui me permettent de recueillir les molécules émises par les sources odorantes. Au moyen de l’analyse chimique, les chimistes en laboratoire décomposent les échantillons recueillis pour en tirer des molécules individuelles identifiables. À partir de ces données, je suis en mesure de reproduire chimiquement l’odeur à l’infini pour atteindre divers objectifs. Chaque échantillon rejoindra ensuite une base de données de molécules dans de vastes archives qui englobent différents thèmes centraux : City SmellScape ; Body SmellScape; Ocean SmellScape (paysage d’odeur de ville, paysage d’odeur de corps, paysage d’odeur d’océan). Ces catégories principales se subdivisent ensuite en sous-catégories : ségrégation, tolérance, pollution, peur, biodiversité, navigation, éducation etc.
La plupart de mes projets s’intéressent au reboot sensoriel, invitant le public à sortir de sa zone de confort et à mettre sa perception à l’épreuve.
Philippa Nesbitt Pouvez-vous m’en dire davantage sur vos archives de données linguistiques ?
Sissel Tolaas Le plus souvent, nous parlons d’odeurs en termes métaphoriques : ça sent comme ci, ça sent comme ça. La majorité des articles scientifiques qui traitent des odeurs et du langage sont rédigés par des hommes, blancs. Rares sont ceux qui se sont rendus sur le terrain pour travailler à partir de langues possédant moins de locuteurs et là où l’odeur est inhérente à la vie quotidienne. Non seulement j’enregistre, reproduis et amplifie les odeurs réelles, mais au fil des ans, j’essaie de trouver des moyens de les communiquer et d’exprimer dans différentes langues leur processus d’inhalation.
J’ai mis au point une méthodologie qui me permet de générer un langage en fonction de la situation que je rencontre. L’odeur est immédiate — on sent quelque chose puis une réaction dans le cerveau provoque des émotions et fait ressurgir des souvenirs — la réflexivité de ce processus sous forme de mots semble complexe. Les odeurs enregistrées et reproduites sont ensuite présentées au public dont on enregistre, analyse et évalue les réactions verbales. Les divers enregistrements d’un même échantillon sont ensuite comparés et servent de base à un mot construit ou à des termes abstraits. Nommer les couleurs est également abstrait. Que signifient vert, jaune et rouge ? Différents phénomènes, émotions et teintes sont codés dans le langage. J’espère qu’un jour nous coderons les odeurs de la même façon.

Image de Mathilde Roussel & Matthieu Raffard.
J’ai inventé le Nasalo Lexicon (lexique nasal) comme système de codification pour les besoins de la communication au moyen de molécules d’odeur et de structures odorantes complexes. La recherche est un projet en cours. J’enregistre des gens décrivant une même odeur en un mot ou en un son. Ces expressions abstraites sont ensuite analysées et comparées. Puis chaque terme vient enrichir le Nasalo Lexicon. Cette base de données comporte sa propre logique et ses propres règles linguistiques. Chaque terme a sa propre racine non-dérivée, non-métaphorique, non-métonymique avec des fonctions attributives et prédicatives. En 2019, le Nasalo Lexicon compte 3710 mots et termes.
Philippa Nesbitt Comment les utilisez-vous par la suite ?
Sissel Tolaas J’utilise le lexique au quotidien. J’anime beaucoup d’ateliers pédagogiques et je travaille très souvent avec des enfants. Ils n’ont pas de préjugés et sont souvent très créatifs ; leur capacité à rationaliser n’est pas encore entièrement développée, ils tendent à être beaucoup plus spontanés dans leurs réactions aux odeurs et les résultats sont incroyables ! J’applique ensuite la même méthodologie aux adultes.
Philippa Nesbitt J’ai l’impression qu’on n’associe pas souvent les odeurs au langage, que nos cinq sens ne sont peut-être pas vraiment connectés les uns aux autres.
Sissel Tolaas Notre société et notre culture sont traditionnellement dominées par le visuel. Cependant, la vue nous tient à distance des objets. Nous cadrons des « vues » pour les photos avec les objectifs des appareils photo ; la probabilité d’une réaction intellectuelle est considérable. Par contraste, nous sommes entourés d’odeurs ; elles pénètrent le corps et imprègnent l’environnement immédiat. Nos réactions sont donc bien plus susceptibles de faire intervenir de fortes émotions et d’être retenues plus longtemps.
Nous utilisons les odeurs constamment, consciemment ou inconsciemment, pour communiquer au milieu des plantes, des animaux et des êtres humains.
Philippa Nesbitt À partie de cette idée d’éducation, d’entraînement aux odeurs ou d’enseignement, comment travaillez-vous pour vous détacher des préjugés que nous avons envers des senteurs particulières ?
Sissel Tolaas Nous naissons neutres. Les êtres humains, les cafards et les rats sont les plus grands érudits de la planète. Le nez était, et demeure, un moyen de trouver de la nourriture et des partenaires. Cela semble simple, mais la réalité est différente. Les systèmes sanitaires et les surfaces aseptisées et brillantes sont devenus la norme, en concordance avec notre manière de juger le monde. Il n’existe pas de gène pour nous dire ce qui est bon ou mauvais. On se déodorise et on désinfecte nos environnements à tel point que ça n’en devient bon ni pour nos corps ni pour la planète, et bien au-delà.
J’étais moi aussi pleine de préjugés et j’étais très curieuse de voir si je pouvais m’en débarrasser. La première fois que nous sentons quelque chose, nous créons une référence que nous conservons jusqu’à la fin de notre vie. Cette expérience, chargée d’émotions positives ou négatives influencera notre relation à cette odeur. C’est à ce niveau-là que nous avons besoin d’aide, d’une « détox d’odeurs » et d’une « rééducation aux odeurs ». On rééduque d’autres déficits alors pourquoi pas l’odorat ? J’ai donc utilisé les données scientifiques auxquelles j’ai pu avoir accès, j’ai réalisé le test sur moi-même, puis nous avons pu développer une méthodologie qui fonctionne : je me suis libérée des préjugés et je crois pouvoir dire que suis l’une des « senteuses » les plus tolérantes au monde.
Philippa Nesbitt On retrouve souvent dans vos travaux l’idée que nous considérons notre contexte, tant moral qu’éthique, en termes d’odeur. Selon moi, c’est très important, parce qu’au quotidien nous ne pensons pas l’odeur comme nous percevons nos autres sens.

Image de Mathilde Roussel & Matthieu Raffard.
Sissel Tolaas Exactement. L’un de mes premiers critères, c’est d’aller au-delà de la hiérarchie des odeurs. J’ai par exemple réalisé une étude de terrain dans un bidonville de New Delhi où les odeurs vous pénètrent avant que vous ne pénétriez l’environnement où elles se trouvent. Certains auraient pu faire demi-tour, mais pour moi, c’était le début de l’expérience. C’est incroyable de découvrir à quel point nous pouvons gagner en tolérance et agir par la suite pour permettre aux autres d’évoluer.
Aujourd’hui la politique des odeurs est plus forte que jamais.
Philippa Nesbitt Dans les paysages urbains que vous avez recréés, vous avez évité les clichés des odeurs qu’une ville peut évoquer et vous vous êtes au contraire intéressée à ce que vous appelez les réalités invisibles de la ville. Quels espaces ou quels aspects approchez-vous pour capturer les odeurs urbaines et comment développez-vous le concept d’odeur d’une ville ?
Sissel Tolaas Cela dépend vraiment des thèmes étudiés. Ils peuvent aller de la pollution ou de la ségrégation à l’identité et à la justice. En ce qui concerne la recherche, je sélectionne des zones ou des quartiers et je décide quelles odeurs représentent quel contenu.
Je marche le matin, à la mi-journée, la nuit, sans arrêt, parfois à plusieurs reprises et à différentes saisons. Au cours de cette phase de pré-recherche, je décide si j’ai besoin de mes appareils d’enregistrement ou si je peux simplement rapporter la source odorante au laboratoire pour l’analyser. Je pratique ensuite des analyses et je décompose chaque source en molécules individuelles. Elles sont répliquées et reconstruites au plus proche de l’original. Les odeurs imitées sont ensuite proposées dans divers dispositifs interactifs. Le rapport au site de départ est toujours inclus, il agit comme une extension du dispositif. Il est toujours très important de faire l’expérience du réel.
Philippa Nesbitt J’aime beaucoup cette idée d’abject si présente dans vos travaux. L’idée de ne pas considérer l’abject seulement en termes de matière corporelle comme la sueur, mais aussi dans son rapport à certains environnements. Qu’est-ce qui vous donne envie d’enquêter sur ce sujet et de cette manière-là ?
Sissel Tolaas Tout est question d’honnêteté, rien n’est plus honnête qu’une odeur ; comme je l’ai dit plus tôt, les odeurs viennent à moi et sont si prégnantes que je n’ai pas le choix. Je suis lassée des surfaces. Quand on creuse, on rencontre des obstacles mais les obstacles me stimulent. Ce qui me motive, c’est d’aller au-delà de mes compétences et de ma force. J’ai les outils, les connaissances, j’ai montré au monde que j’ose faire les choses autrement, alors on m’engage souvent pour me rendre dans des zones extrêmes, explorer de nouveaux territoires et étudier des sujets complexes. Je refuse rarement. Quand on veut on peut. Si je ne peux pas être présente sur le terrain, je ne le fais pas. Si quelqu’un me disait : « Sissel, peux-tu reproduire l’odeur de Mars ? », je dirais non. Ce serait trop spéculer. J’en ai assez de la spéculation. Aujourd’hui, je m’intéresse à de nombreux sujets qui traitent de la réalité. Nous devons le faire avant de spéculer, sinon nous allons nous retrouver prisonniers d’une esthétique utopique de zombies dépourvus d’émotions.
Philippa Nesbitt Vous vous intéressez souvent au rapport entre odeur et identité. Qu’avez-vous découvert de la manière dont nous sommes enclins à apprécier une odeur, même si nous ne la penserions pas agréable, à cause de nos préjugés sociaux ?
Sissel Tolaas Je décontextualise de multiples réalités invisibles. Le caractère abstrait d’une odeur in situ est essentiel dans tous mes travaux parce que c’est la seule manière dont le « senteur » est ouvert et accessible à l’information qu’elle fournit. Le défi, c’est de sortir de notre zone de confort qui consiste à en avoir trop pour traiter une odeur seule. Nous vivons dans un monde d’hyperstimulation sensorielle et nos sens sont tristes, et complètement confus.

Image de Mathilde Roussel & Matthieu Raffard.
Les odeurs sont exposées dans un environnement « sûr » — une galerie, un musée, une université — loin de leurs contextes d’origine. Disons que le thème est le corps et la peur : les odeurs reproduites des hommes anxieux sont logées dans la surface des murs. Les murs deviennent une métaphore de la peau. La seule façon d’activer l’odorat est de toucher le mur.
Les odeurs sont une composante essentielle qui permet à chacun de se comprendre et de comprendre l’environnement. Je mets le public au défi d’utiliser son nez et je lui apporte de nouvelles méthodes et de nouveaux moyens de comprendre et d’approcher divers thèmes importants qui le concernent. Il y a un côté ludique dans la découverte du monde à l’aide des odeurs. L’expérience et l’apprentissage dans un contexte joyeux a presque disparu du monde sérieux aux problèmes sérieux dans lequel nous vivons. Apprendre dans un contexte d’émotion est essentiel pour que l’apprentissage soit efficace et modifie nos comportements. Rien n’empeste, mais notre intellect nous pousse à le penser.
Formes et déformations du corps féminin
Antoine Bucher
Collectionneur et spécialiste des ouvrages anciens de mode, Antoine Bucher dresse une petite histoire du nu à travers un portfolio paru en 1933 dans La Revue Heim.
Le lecteur du XXIème siècle est toujours surpris lorsque son regard croise un exemplaire de la trop méconnue La Revue Heim. Ce magazine semestriel créé à l’hiver 1930-1931 par Jacques Heim et destiné à la clientèle de sa maison de couture rassemble en effet des contributeurs dont les noms s’affichent aujourd’hui sur les frontons des musées : Man Ray, Dora Maar, Léonor Fini, Marie Laurencin, etc.
Pour le sixième numéro paru en mars 1933, la revue confie à Max Ernst le soin de parler du corps féminin. Dans la continuité de la technique de collage qu’il utilise à l’époque dans ses créations plastiques, l’artiste choisit ici de procéder à des juxtapositions d’images. La mise en page accentue les rapprochements visuels dont le titre de l’article « Formes et déformations du corps féminin » guide la lecture.
Plusieurs dynamiques sont à l’œuvre, l’une pourrait reposer sur une forme d’évolution du corps nu au corps habillé, une autre jouer sur le dialogue créé par chaque paire d’images placée sur la page. La sélection opérée par l’artiste surréaliste propose une réflexion sur les corps nus ou vêtus et offre au lecteur un spectacle de la variation de beauté féminine à travers le temps par un système d’échos visuels.
C’est un mannequin sans bras, ni tête, de la maison parisienne Girard qui ouvre la série. Le corps apparaît alors modelé par la fonction de porter un vêtement, une forme plutôt que des formes dont les jambes réalistes et la position des pieds ramènent la vie à cette femme décapitée. Fétiche des artistes surréalistes, le mannequin avance ici comme la statue d’Égypte antique qui le jouxte. La robe portée par la prêtresse est un léger voile brodé d’hiéroglyphes qui révèle les formes plus qu’elle ne les dissimule. La poitrine est généreuse, les hanches marquées, le visage rond accentué par une perruque tressée. Si plus de deux mille ans séparent les deux œuvres, elles partagent une silhouette dont la verticalité est accentuée par la mise en page.
C’est un parallèle différent que met en avant la paire d’images suivante associant la Venus de Willendorf à une robe à tournure des années 1880. La forte corpulence de l’idéal féminin paléolithique et son imposant postérieur stéatopyge dialogue avec le faux cul caractéristique de la silhouette devenue à la mode à partir de la fin des années 1860.
De la réalité adipeuse à l’artifice, la beauté dépend de la faveur d’une ligne ou plutôt ici d’un jeu de courbes.
Les deux images suivantes rapprochent, elles, deux dos, celui d’une statue du IIIème siècle avant J.C. et celui d’un nu des années 1930 immortalisée par l’objectif d’Yvonne Chevalier. Les deux représentations célèbrent ici une similaire chute des reins.
La série se conclut sur un duo d’images rassemblant la presque prépubère Venus au voile de Lucas Cranach de 1532 et une photographiede Deberny-Peignot de 1933 figurant uneélégante dans une robe Heim. La similitude dans la gestion de la lumière, l’opposition du nu et du vêtu conduit à croire qu’alors la beauté ne vient plus du corps mais du vêtement qui l’habille. Et rien ne vaut alors une robe de Heim pour devenir une Venus moderne.
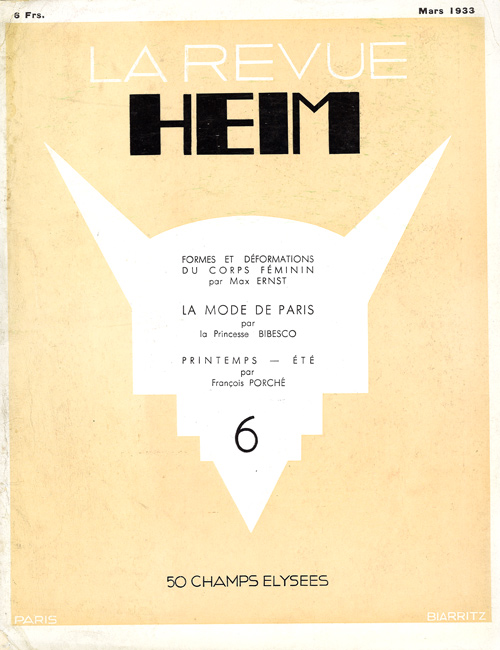
Couverture de La Revue Heim, numéro 6, mars 1933.
Publiée par la maison de couture Jacques Heim, Paris, 1933.
Bibliothèque Antoine Bucher
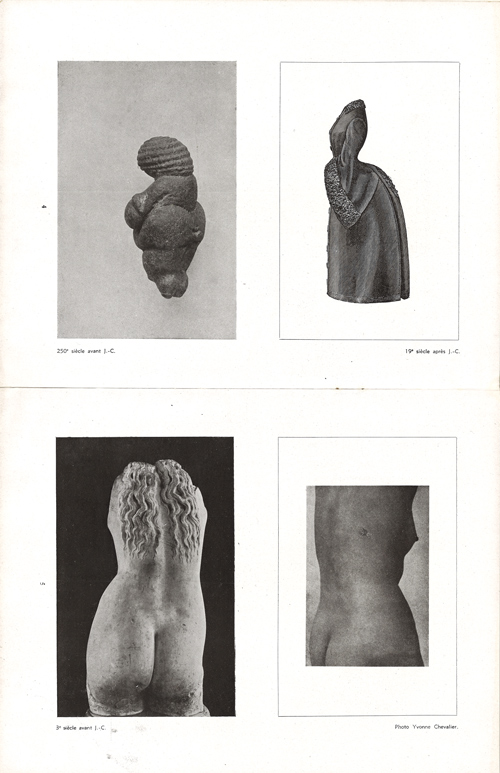
La Revue Heim, numéro 6, mars 1933.
Formes et déformations du corps féminin, par Max Ernst.
Bibliothèque Antoine Buche
Divine Comédie
Go Nagai
Si son nom reste peu connu du grand public, les œuvres du mangaka Go Nagai jouissent d’une renommée internationale et ont marqué les imaginaires de plusieurs générations. Né en 1945 à Wajima, il est l’auteur de plus de trois cent soixante titres, dont les plus connus sont sont Devilman (1972), Mazinger Z (1972) et Cutie Honey (1973). Prolifique, Go Nagai n’a cessé au cours de sa carrière de s’essayer à tous les genres, de l’humour au fantastique en passant par l’horreur et l’érotisme, n’hésitant pas à les mélanger pour mieux se les approprier. Notre rencontre est l’occasion de revenir sur ses influences, les aspects novateurs de sa carrière et sa vision profondément humaniste du monde.
Adolescent réservé, Go Nagai se réfugie très jeune dans les salles obscures. Le western, la science-fiction, les histoires de samouraï peuplent son monde imaginaire et lui fournissent un vocabulaire qu’il ne cessera d’hybrider pour donner naissance à des univers fantasmagoriques. « Les films sont très importants dans ma vie, j’essaie d’en regarder un tous les jours, parfois jusqu’à trois ! J’ai toujours préféré le monde imaginaire au monde réel. Quand j’étais enfant, j’utilisais la majeure partie de mon argent de poche pour aller au cinéma. Je ne sais pas de quelle manière, mais ça a certainement eu une influence sur mon œuvre. Il m’est très difficile de citer mes réalisateurs fétiches car il y en a vraiment beaucoup, mais Akira Kurosawa est sans aucun doute l’un de mes préférés. C’est en regardant L’homme de Rio de Philippe de Broca, avec Jean-Paul Belmondo que je me suis dit que je pouvais peut-être moi aussi faire de la comédie en me basant sur les procédés humoristiques de ce film ».
Le parcours professionnel de Go Nagai ressemble au chemin de croix des dessinateurs de mangas : il enchaîne les histoires courtes qu’il envoie à différentes maisons d’éditions, finit par décrocher un poste d’assistant auprès de Shotaro Ishinomori, sommité dont il a toujours été fan. Son premier succès est polémique : Harenchi Gakuen (1968 — L’école impudique en version française) est un récit parodique qui suit les aventures outrancières d’écoliers et de leurs professeurs. « Mon idée initiale était de créer un monde à l’envers, où tous les rapports étaient inversés. À cette époque, les professeurs au Japon faisaient parti d’une espèce d’intelligentsia et étaient très respectés. En réalité, cela allait un peu à l’encontre de ce que j’avais vécu enfant : j’ai vu pas mal d’enseignants qui n’étaient pas si doués que ça! » Sous ses traits caricaturaux et son air léger, cette histoire absurde résonne avec les manifestations étudiantes qui bouleversent l’archipel à la fin des années 60. Alors que les associations parentales crient au scandale et tentent de l’interdire, le titre est plébiscité par les jeunes enfants.
Suite à la pression de son éditeur pour développer ce manga, véritable locomotive commerciale, Go Nagai décide de créer sa propre société, Dynamic Productions. Celle-ci lui permet de structurer ses activités, en engageant notamment des assistants, et de publier de nouveaux récits. Plus important encore, Dynamic Productions révolutionne le rapport hiérarchique entre auteur et éditeur, puisque la société permet à Nagai de contrôler les droits et recettes générés par les produits dérivés. Il s’associe également avec la Toei Animation, acteur incontournable du secteur, pour adapter ses mangas en dessin-animé parallèlement à leur publication. Ce système permet à Nagai de faire fructifier ses succès tout en cultivant sa popularité avec des héros que l’on retrouve aussi bien dans les pages des magazines, sur les écrans de télévision ou dans les rayonnages des magasins de jouets.
Devilman est aux antipodes de la légèreté lubrique qui a révélé l’auteur au grand public, et est considéré comme son manga le plus marquant. Le titre, sorti en 1972, est clairement destiné à un lectorat adulte. Il dépeint un monde peuplé de démons auquel le héros devra faire face en en devenant un lui-même, questionnant les limites de l’humanité, ses faiblesses et sa foi. Quasiment cinquante ans après sa publication, le récit semble aujourd’hui prophétique, ce qui surprend l’auteur : « Cette série se rapproche des évènements que l’on voit apparaître un peu partout dans le monde, et cela me fait un peu peur. Devilman écrit la fin du monde et j’espère que nous autres, êtres humains, ferons tout pour que cela n’arrive pas. » Si le titre n’est pas très connu en Occident, il est considéré comme culte dans son pays d’origine.
En Europe, et en France particulièrement, Go Nagai doit sa célébrité à Grendizer (Goldorak en version française), troisième partie de la saga Mazinger Z. Il en raconte ainsi la genèse : « L’idée m’est venue alors que j’observais une file d’automobilistes coincés dans un bouchon, je me suis dit qu’il serait bien pratique d’avoir un véhicule qui posséderait bras et jambes pour s’extirper. » Mazinger Z est le premier manga où un robot géant est piloté par un humain, créant ainsi un sous-genre particulièrement vivace, celui des mechas, popularisé depuis par l’industrie du jeu vidéo et du cinéma. Cutie Honey est un autre exemple de la diversité de l’auteur. On y découvre Honey Kisaragi, écolière androïde qui a la particularité de se transformer en héroïne aux cheveux rouges et à l’épée acérée, qui combat l’organisation criminelle — et extra-terrestre — « Panther Claw». Chaque protagoniste, qu’il soit masculin ou féminin, bon ou méchant, ne peut résister au charme naïf de Honey. Érotisme, action et humour forment un cocktail détonnant. Le style graphique de Nagai varie selon ses séries : simple et rond pour les œuvres destinées aux enfants, sombre et fourmillant pour les récits noirs. Les nombreux gadgets qu’il a mis à disposition de ses héros, leurs costumes extravagants, le design de ses robots, sont des éléments visuels forts qui ont marqué les esprits, jusqu’à se retrouver aujourd’hui distillés dans de nombreux domaines créatifs, qu’il s’agisse de design ou de mode.
Sortis au début des années 70, Cutie Honey, Devilman et Mazinger Z continuent à passionner les lecteurs contemporains. Si Nagai a continué à publier d’autres histoires, il a surtout proposé des versions parallèles, des suites et des crossovers de ses œuvres phares, construisant une mythologie savamment remise au goût du jour, prête à conquérir un nouveau public et à rassembler les nostalgiques. En 2018, la plateforme Netflix a accueilli les dix épisodes de Devilman Crybaby, adaptation à l’impressionnante réalisation, démontrant, si cela était encore nécessaire, que l’animation n’est plus un territoire réservé à un jeune public. Outre ses multiples adaptations animées, Cutie Honey a eu droit à son film live, délire visuel réalisé par Hideaki Anno, bien connu pour la saga Evangelion. On retrouve d’ailleurs chez les deux hommes les mêmes motifs scénaristiques : robots géants, invasions extra-terrestres et réflexion philosophique autour des notions de bien et de mal. Lorsqu’on lui demande pourquoi certaines de ses mangas sont si sombres, Go Nagai conclut : « Contrairement à certaines séries où les héros remportent toujours la victoire, il m’arrive d’écrire des histoires où le mal triomphe. Mais cela se produit également dans la réalité. Mes œuvres sont un miroir tourné vers le monde. »

Cutie Honey, 1973 — © GO NAGAI/DYNAMIC PLANNING

Cutie Honey, 1973 — © GO NAGAI/DYNAMIC PLANNING

Devilman — © GO NAGAI/DYNAMIC PLANNING
ARTICLE DE JUSTIN MORIN
L’aventure intérieure
Pamela Rosenkranz
Lors d’un récent voyage aux États-Unis, alors que je cherchais à acheter une bouteille d’eau dans un supermarché, je me suis retrouvé face à une variété impressionnante de produits dont les terminologies m’ont dérouté : « purified water », « vapor distilled water and electrolytes for taste », « alkaline water », « ionized alkaline bottled water », « electrolyte infused for smooth taste pH 9.5 or higher », etc. La technicité affichée sur les étiquettes, démultipliée par le gigantisme des rayonnages américains, m’a laissé coi. Au-delà de l’exotisme de ces produits américains, ces centaines de bouteilles m’ont marqué par les contradictions qu’elles portent en elles. Il y a bien évidemment les préoccupations écologiques, de plus en plus évidentes, mais également la dichotomie entre la qualité élémentaire de l’eau – sa nature hydratante – et une ressource naturelle dopée aux valeurs ajoutées – ceux-ci concernant autant le branding que les additifs. Ce choc m’a rappelé la complexité et l’intrigante beauté des œuvres de Pamela Rosenkranz. L’artiste Suisse a été découverte au tournant des années 2010 avec ces installations utilisant des bouteilles d’eau remplies de liquide aux teintes beiges rosées, ouvrant une réflexion qui puise autant dans l’histoire de la peinture que dans la science, ou encore dans la cosmétologie ou la philosophie.
Parfaite synthèse de ses recherches, l’installation Our Product, développée en 2015 pour le Pavillon Suisse dans le cadre de la Biennale d’Art Contemporain de Venise est à la fois une proposition picturale et une expérience sensorielle. Le visiteur pénètre dans un espace perméable à la nature environnante (insectes, feuilles d’arbres et autres brindilles des Giardini) immergé dans une ambiance chromatique verte produite par des murs peints et des jeux de lumière. On pense déjà aux œuvres de Dan Flavin ou de James Turrell, connus pour leur utilisation de la lumière dans la perception de l’espace, des œuvres « à vivre » puisqu’elles engagent littéralement les corps et les sensations des regardeurs. À l’intérieur de l’édifice, les murs blancs deviennent les contours d’une immense piscine remplie d’un liquide rose. Sa surface brillante est perturbée par des vaguelettes générées artificiellement, sur laquelle se torde les reflets des néons éclairant la pièce. Opaque, ce monochrome a été créé en fonction de la couleur moyenne de la peau des personnes originaires d’Europe centrale. Épurée en apparence, l’installation atmosphérique est riche d’éléments intangibles. Ainsi, « Heather », une voix artificielle et informatique à laquelle l’artiste a déjà fait recours dans de précédentes expositions, récite un à un chaque composant utilisé dans la création de cet tapis aqueux. Quelques exemples : Abeen, Celinor, Clodium, Europiome, Genaeta, Imersa, Meteris, Neotene, Querms, Sorbasol, Veletite, Wivium… L’ensemble forme un poème abstrait aux consonances scientifiques. Si la plupart de ces mots nous semble familiers, ils ont pourtant été inventés par Rosenkranz afin de désigner des états orphelins, à savoir des choses que l’on peut voir, sentir, ou entendre mais qui restent aujourd’hui encore sans vocabulaire attribué. Pour l’artiste Suisse, les éléments dits « immatériels », comme la lumière, le son ou la couleur ont une existence physique à laquelle nous nous confrontons immédiatement. Il s’agit pour elle d’identifier ce qui « est » mais n’est pas considéré, et ainsi mieux comprendre le monde qui nous entoure. Pour en revenir à cette liste de mots, et plus particulièrement à cette pratique empruntée au marketing que l’on appelle « naming » – qui consiste à optimiser la résonance entre le consommateur et le produit grâce à son appellation – , Rosenkranz constate qu’il est aujourd’hui commun d’utiliser des termes techniques pour vendre ; un phénomène qui touche aussi bien la cosmétologie, l’informatique que… l’eau. Il est intéressant de noter que ces trois domaines touchent à la surface : la peau d’un visage, l’écran d’un ordinateur ou d’un téléphone, la transparence d’une source aquatique. Paradoxalement, même si le langage des experts reste opaque pour les néophytes, il rassure, il est signe de maîtrise technique, et tant pis si tout cela n’est que narration.
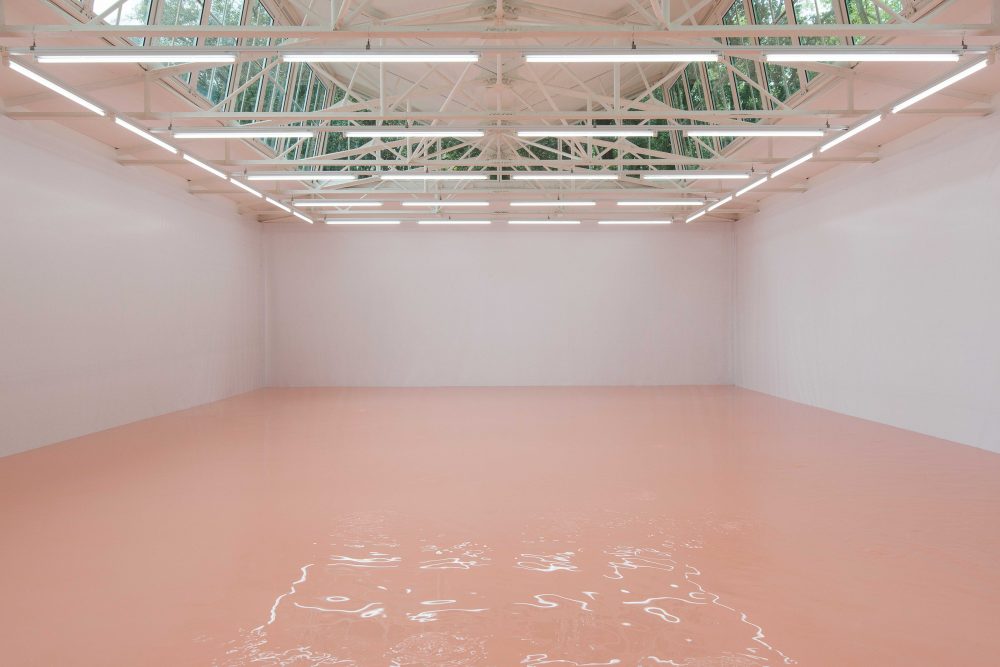
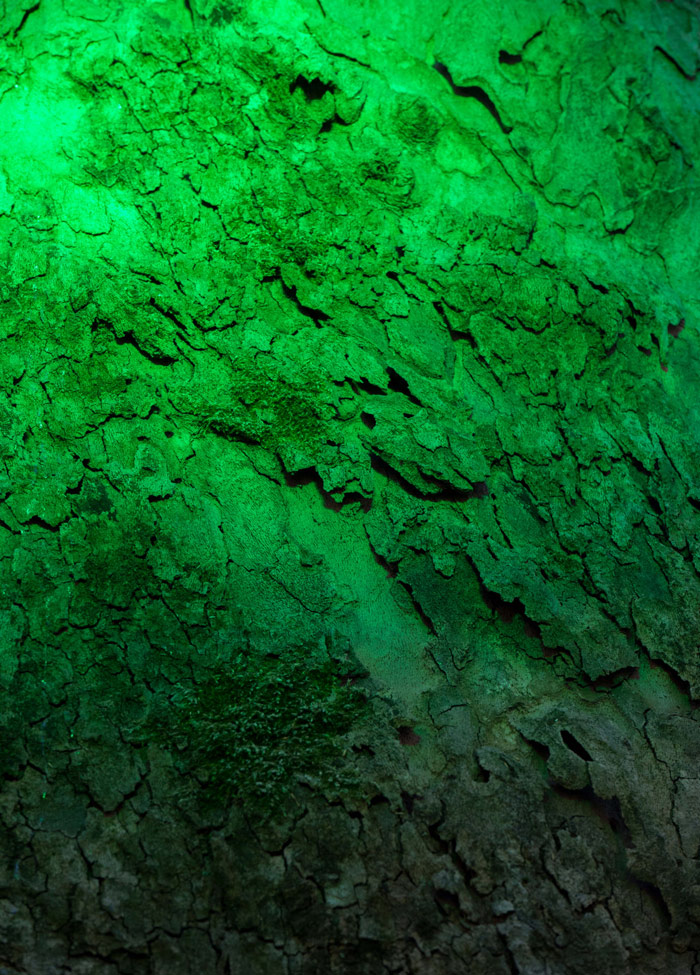
Pamela Rosenkranz, Our Product, vue d’exposition, Pavillon Suisse à la 56e Biennale de Venise, 2015.
COMMENT AGIT L’ATTRACTION?
Pour autant, Our Product ne se contente pas du trouble opéré par ce jeu de vocabulaire fictif. L’installation bénéficie d’une fragrance mise au point par les parfumeurs Frédéric Malle, tête pensante du secteur, et Dominique Ropion, nez aux créations iconiques. L’idée était ici de diffuser à travers le pavillon une senteur proche d’une peau fraîche de bébé. Pour se faire, parmi les ingrédients, ont notamment été utilisées des phéromonesanimales. On retrouve là la volonté de Rosenkranz de décoder les structureset de pénétrer dans la surface pour voir, à une autre échelle, ce qui compose. Elle utilise le même procédé en 2017, à la Fondation Prada de Milan, où elle met en place un imposant monticule de sable qui remplit l’espace d’exposition. Intitulée Infection, l’installation est éclairée d’une lumière LED verte et diffuse de manière imperceptible un parfum synthétique de phéromones de chats. Cette odeur active une réaction biologiquement déterminée d’attraction ou de répulsion, selon que le spectateur est affecté ou non par le parasite neuroactif de la toxoplasmose. La toxoplasmose est une infection parasitaire qui touche les animaux à sang chaud, y compris l’être humain. Elle est jugée asymptomatique dans l’immense majorité des cas, ne présentant un risque sérieux que pour les femmes enceintes ou les sujets ayant un système immunitaire affaibli. Il a été établi que le parasite est capable de modifier la connectivité des centres du plaisir et de la peur. Ainsi chez le rat, la toxoplasmose abolit l’aversion du rongeur envers son prédateur, le chat, pour la remplacer par une attirance fatale. La maladie est présente partout dans le monde, et on estime qu’un tiers de la population mondiale est porteur de Toxoplasma Gondii. Si elle est bénigne, elle n’en est pour autant pas exempte de conséquence. Aussi, il est intéressant de se plonger dans l’histoire de la parfumerie : pendant plus de deux mille ans, la civette, animal au croisement du renard et du chat, a été utilisée. Elle a été élevée en captivité pour pouvoir extraire une substance, également appelée civette, qui apporte, après dissolution, rondeur et sensualité aux fragrances. Aujourd’hui synthétisésous le nom de Civetone, il se retrouve dans de nombreux parfums, de Chanel n°5 à Obsession de Calvin Klein, mais aussi dans des produits ménagers. Ces informations, qui peuvent sembler anecdotiques mais dont les liens de causalité sont évidents, constituent les terrains de recherche des neurosciences, domaine qui traverse l’ensemble de la pratique de Pamela Rosenkranz.
UNE OEUVRE PLASTIQUE
C’est en 2009 que l’artiste débute sa série Firm Being : des bouteilles en plastique de différentes marques d’eau minérale remplies d’un liquide à la teinte rose. La carnation y est déjà à la fois couleur et désirabilité. Or, depuis la Renaissance et ses techniques de peinture, on sait que la peau n’est pas monochrome. Elle n’est ni marron, jaune, rose ou noire, mais un canevas composé de plusieurs nuances. Pourtant, les images publicitaires font un usage poussé des techniques de retouche pour obtenir des peaux lisses et homogènes, standards auxquels le public cherche à se conformer. L’uniformité est une valeur aussi rassurante que fictive. Et puisque Pamela Rosenkranz nourrit également sa réflexion de l’histoire de l’art, il est important de rappeler l’importance du monochrome dans la peinture. Elle a souvent cité Yves Klein et son célèbre bleu. Les peintures abstraites de la Suissesse ne sont pas sans rappelerles anthropométries du Français. Toutefois, pour Rosenkranz, la peau n’est pas une enveloppe qui contient notre moi physique, mais une membrane par laquelle le corps montre. Elle révèle et connecte au monde extérieur. Tout comme ses bouteilles de plastique indiquent leur provenance. Dans le catalogue de Our Product, l’artiste explique à quel point, lors de ses recherches, la vision de ces centaines de bouteilles dans les canaux de Venise l’a interpellé : « provenant du monde entier, que ce soit de Nouvelle Zélande (Kiwaii), France (Evian), Croatie (Jana), Maroc (Ciel), USA (Poland Spring), UK (Smart Water), Chine (Wahaha) et ainsi de suite, chacune de ses bouteilles porte les traces génétiques de la personne qui l’a consommé. En utilisant les microbiotes trouvés dans la salive, nous pourrions tracerles trajets de ces visiteurs avec un test génétique ». Un peu plus loin, la curatrice Susanne Pfeffer, avec laquelle elle s’entretient, dit ceci : « La distinction entre « organique » et « synthétique » ne peut plus être si facilement être appliquée aux gens, puisque beaucoup d’entre nous sont devenus des « cyborgs », à force de substances synthétiques ou de plastique infiltré dans le corps. Peut-être que la question peut être encore plus radicalisé en se demandant, par exemple, si le plastique en lui-même est synthétique, puisqu’il est extrait du pétroleet donc de la nature ». Organique / synthétique, rose / vert, plastique / chair, science /philosophie, Pamela Rosenkranz fait se rejoindre ce qui est dit comme étant opposé, et questionne ainsi l’ordre des choses dans un geste plastique aussi ample que beau.
Texte de Justin Morin

Pamela Rosenkranz, Firm Being (Drop Up), 2016.
Bouteille en plastique, silicone, pigments, plexiglas et piédestal, 32,4 × 8,9 × 8,9 cm. © Pamela Rosenkranz
Avec l’aimable autorisation del’artiste et de Sprüth Magers.
Photo : Gunnar Meier.
Réorganiser la réalité
Gabriel Kuri
Depuis une vingtaine d’années, l’artiste mexicain installé à Bruxelles, Gabriel Kuri, met en lumière le banal à travers la sculpture. Ses œuvres incluent des objets de tous les jours, tels que des distributeurs de papier et des comptoirs de cuisine qu’il traite rarement comme des objets trouvés ou des ready-made. Il préfère explorer l’ordinaire en modifiant son échelle (par exemple, des allumettes d’un mètre) ou sa composition matérielle (par exemple, des tickets de caisse devenus tapisseries). L’intérêt de Kuri pour le quotidien, qu’il s’agisse du sien ou de celui des habitants des différentes villes dans lesquelles il a habité, confère naturellement à ses œuvres un air d’instantané de la vie au début du XXIe siècle.
Piero Bisello Vous êtes originaire du Mexique, mais vous avez vécu dans différents pays. Quelles sont les raisons de ce nomadisme ? Sont-elles liées à votre vie professionnelle ou personnelle ?
Gabriel Kuri je ne peux jamais séparer les deux, mais heureusement, je peux travailler partout où je vais. Mais je ne pourrais pas me déplacer pour des raisons professionnelles si ma vie personnelle m’en empêchait, et vice versa. Heureusement, il n’y a plus simplement un ou deux centres mondiaux d’art contemporain, il n’y a plus d’hégémonie d’un lieu spécifique. Vous n’êtes plus obligé d’être à Paris, comme au début du XXe siècle. De nos jours, on peut être à peu près partout, tant qu’il s’agit d’une ville. Le contexte a radicalement changé depuis l’époque où j’étais étudiant, alors que New York commençait à peine à perdre cette hégémonie dans le monde de l’art. Maintenant, si vous dites aux étudiants en art que New York est le seul endroit qui compte, ça les fait rire.
PB Vous souvenez-vous du moment où vous avez décidé de devenir artiste ?
GK Je ne pense pas qu’il y ait un moment précis où j’ai décidé de devenir artiste. Je n’ai pas eu de révélation et je n’ai pas d’histoire extraordinaire à raconter. Très jeune, je savais déjà que je voulais me consacrer à quelque chose de créatif. J’ai toujours été très inspiré par le travail d’autres artistes, que je l’aie vu exposé ou découvert dans des livres, et l’idée de voir le monde à travers les yeux de l’artiste me séduisait.
PB En tant que jeune étudiant en art, vous n’étiez donc attiré par aucun métier particulier, aucune technique spécifique ?

Gabriel Kuri, sorted, resorted, vue d’exposition, WIELS–Contemporary Art Centre, Brussels, 2019.
Avec l’aimable autorisation de l’artiste et de : Sadie Coles HQ, Londres; kurimanzutto, Mexico, New York; Galleria Franco Noero, Turin; WIELS–Contemporary Art Centre, Bruxelles; Esther Schipper, Berlin.
Photographie © Andrea Rossetti
GK Pas vraiment. Je pourrais dessiner et jouer de la batterie, mais pas aussi bien que des artistes plus talentueux. J’essaie encore de développer mes compétences et mon potentiel, qui consistent à générer un système d’idées rigoureux et à l’exprimer à travers la forme et la matière. Je me plais à croire que je peux distiller l’idée au point qu’elle conditionne la manière dont elle doit être concrétisée. Par exemple, si elle doit aboutir sous une forme industrielle ou sous une forme plus fragile et rustique. Au fil des ans, je me suis rendu compte que je me passionne pour les objets parfaitement conçus, mais cela ne veut pas dire qu’ils doivent être immaculés. Ils doivent plutôt permettre de comprendre comment ils sont censés être fabriqués et comment ils se manifestent. Ce sont une compétence et un métier spécifiques, quelque chose que j’essaie de cultiver depuis le début. Je ne suis peut-être pas le meilleur dessinateur, ni le meilleur fabricant de moules, mais j’essaie de tendre vers une manière parfaite de réaliser mes œuvres.
PB Vous avez mentionné que Gabriel Orozco vous avait inspiré par l’utilisation de carnets de croquis pour structurer votre travail pratique, en y notant des tâches quotidiennes ou les grandes lignes des œuvres. Pourriez-vous parler un peu de leur contenu ?
GK Je pense que mes carnets de croquis ressemblent beaucoup à ceux de mes collègues. J’y dessine des croquis/note des projets et des impressions. Parfois, ils m’aident à revenir sur d’anciennes idées ou à les mettre simplement par écrit. Parfois, j’écris en espagnol, parfois en anglais. Dans mes carnets figurent l’évolution de mes pièces en progression et des idées de titres pour des expositions. Parfois, j’aime juste lire les mots que j’écris. Je les utilise également pour des études sur les objets auxquels je m’intéresse, par exemple des croquis des signes trouvés au-dessus des distributeurs automatiques de billets. J’aime lire des livres d’économie comportementale ou de science amateur et m’en inspirer dans mes carnets de croquis, par exemple « intervalle de confiance », qui relève du domaine des statistiques. Gabriel Orozco m’a appris qu’il fallait toujours utiliser des carnets à croquis. J’emporte le mien partout, cela évite qu’il s’use trop. Mon sac est toujours très lourd. Contrairement à beaucoup de mes contemporains qui se servent de leur téléphone pour tout, je dois en permanence porter mon carnet de croquis, mon appareil photo et mon ordinateur portable.
PB Les critiques et les conservateurs de musées semblent apprécier placer votre œuvre dans le contexte des tendances historiques de l’art. De la tradition du ready-made au pop-art, on trouve dans vos textes et vos œuvres des similitudes avec d’autres artistes. Pensez-vous que l’histoire de l’art joue un rôle dans votre pratique d’artiste ?
GK Bien sûr. J’étudie l’histoire de l’art, je vais voir des expositions en pensant à la continuité historique. Mais cette démarche n’implique pas une volonté d’écrire ma propre histoire ou de m’inscrire dans une histoire de l’art. Je ne cite jamais d’autres artistes, et je n’y pense jamais pendant que je travaille. En fait, ce n’est que récemment que je me suis habitué à ce qu’on intègre mes œuvres dans une mode historique. Auparavant, je ne voulais faire référence à l’histoire de l’art dans aucun texte, car j’avais peur que cela soit interprété comme de l’auto-louange.
PB Vous dites à propos de votre pratique qu’il s’agit d’un voyage dans la vie, dans lequel vous zoomez sur certains aspects, en les isolant puis en les incorporant dans votre travail. Vous semblez très attentif au quotidien, au banal, au quelconque, avant de le traduire dans votre travail. Comment décidez-vous de vous concentrer sur un objet plutôt qu’un autre dans cet immense champ ? Est-ce plutôt un choix intuitif ou une quête motivée par certaines préoccupations ?
GK Je ne suis pas sûr de pouvoir répondre à cette question, car je ne cherche rien en particulier. J’aime être ouvert à ce qui m’arrive, je me nourris de surprises. Naturellement, j’ai un domaine d’intérêt, mais je ne me contente pas de filmer partout pour voir ce qui va sortir des images. Ce genre de relativisme ne fait bien sûr pas partie de mes recherches. C’est peut-être une sorte de « quoi », une spécificité de l’objet qui m’attire, une confluence entre de nombreux aspects présents dans cet objet ou dans une situation qui transmet l’expérience de l’objet lui-même, ce qui se rattache bien sûr au contexte dans lequel il existe.
PB Pouvez-vous citer quelques exemples de ce domaine d’intérêt que vous mentionnez ?
GK J’aime le monde des échanges, compris comme le lieu où les individus établissent des conventions et des accords afin que les choses circulent en tant que biens et activités, où on établit la valeur. Le lieu où le désir a un prix, et où on vous le revend. Les objets qui m’attirent sont très souvent des témoignages de ce monde, par exemple les reçus ou les imitations de produits de luxe.
PB Quels sont les objets qui ne vous intéressent pas, ceux dont vous avez dit dans le passé qu’ils « sont allés trop loin », ceux auxquels vous ne pouvez plus rien ajouter et que vous ne pouvez pas transformer en œuvres d’art ?

Gabriel Kuri, sorted, resorted, vue d’exposition, WIELS–Contemporary Art Centre, Brussels, 2019.
Avec l’aimable autorisation de l’artiste et de : Sadie Coles HQ, Londres; kurimanzutto, Mexico, New York; Galleria Franco Noero, Turin; WIELS-Contemporary Art Centre, Bruxelles; Esther Schipper, Berlin.
Photographie © Andrea Rossetti

Gabriel Kuri, sorted, resorted, vue d’exposition, WIELS–Contemporary Art Centre, Brussels, 2019.
Avec l’aimable autorisation de l’artiste et de : Sadie Coles HQ, Londres; kurimanzutto, Mexico, New York; Galleria Franco Noero, Turin; WIELS-Contemporary Art Centre, Bruxelles; Esther Schipper, Berlin.
Photographie © Andrea Rossetti
GK Vous ne verrez par exemple pratiquement aucune partie du corps dans mon travail, ni certains aspects de la technologie. J’estime que tout ce que je considérerais aujourd’hui sans intérêt aura l’air ennuyeux. De plus, je ne suis pas anthropologue. Dans mon travail, vous ne trouverez pas d’objets qui ont leur place dans des livres d’histoire.
PB Vous avez mentionné que vous trouviez l’inspiration dans des situations inconfortables lors de vos voyages, par exemple dans les aéroports et les hôtels. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cet inconfort et sur la manière dont il nourrit votre art ?
GK Les toilettes publiques ou les chambres d’hôtel sont supposées être des lieux d’intimité, mais ce n’est pas le cas. Elles sont à la fois privées et publiques. Je pense qu’on peut créer à partir de ce genre d’endroit. Je prends souvent des photos de dispositifs et d’équipements, en me concentrant sur leurs propriétés ergonomiques et sur la manière dont elles sont conçues pour fonctionner, la manière dont elles sont censées survivre à une utilisation intensive.
PB L’essai de Cathleen Chaffee dans le catalogue de votre récente exposition au WIELS soulève la question des messages qu’on peut deviner dans votre travail. Par exemple, elle associe votre utilisation des comptoirs de cuisine mis au rebut à une critique de l’obsession bourgeoise d’avoir une belle maison. Quelle est votre relation avec ce type de messages, presque politiques, qu’on pourrait percevoir dans votre travail ?
GK Je ne peux pas empêcher les gens d’y trouver ces messages, mais je ne rencontre pas ce genre d’interprétation très souvent. Je pense que mon travail comporte plus de subtilités que l’art qui propose un commentaire sur des questions politiques. J’aime apprendre de ce que les autres voient dans mon travail, même s’il s’agit souvent d’une projectionde leurs propres idées, de ce qu’ils comprennent et de ce qu’ils veulent être. J’aime que mes œuvres soient ouvertes et que le public y réagisse, mais cela ne signifie pas pour autant qu’elles sont relativistes, qu’il peut les interpréter comme il lui plaît. Elles ne devraient pas non plus transmettre de message littéral. Je pense que l’art a plus de succès lorsque les pièces, quelle que soit leur forme, établissent clairement une sorte de contrat avec le public pour ce qu’elles lui fournissent dans la limite de l’utilisation qu’on peut en faire. Lorsque les œuvres sont trop ouvertes, elles n’attirent plus. Quand elles imposent une interprétation, elles deviennent un art de prescription, qui ne me plaît pas. La magie se produit lorsque les règles du jeu de l’œuvre sont claires, même quand elles sont très abstraites, comme les peintures monochromes par exemple. Lorsque ces règles sont claires, il y a un véritable échange et un plaisir partagé avec le public.

Gabriel Kuri, Self-portrait as a basic symmetrical distribution loop, 2014.
Avec l’aimable autorisation de l’artiste — Photographie de Brian Forrest
Prétextes
Claes Oldenburg
À l’occasion de la rétrospective de l’artiste Pop Claes Oldenburg en 1969 au MoMa, et en guise d’introduction à son œuvre, la critique d’art Barbara Rose inaugure le catalogue d’exposition sous forme de charade :
« WHAT IS BOTH HARD AND SOFT? WHAT CHANGES, MELTS, LIQUEFIES, YET IS SOLID? WHAT IS BOTH FORMED AND UNCONFORMABLE? STRUCTURED AND LOOSE? PRESENT AND POTENTIAL? »
La bonne réponse s’ensuit sur près de 200 pages, donnant lieu à l’un des premiers essais critique d’Oldenburg. Identifié, avec Andy Warhol ou Roy Lichtenstein, comme l’un des représentants essentiels du pop art américain, Claes Oldenburg est aujourd’hui un artiste reconnu et apprécié. Pourtant, si ses œuvres sont immédiatement identifiables — cerises géantes et autres tartes à la crème cyclopéennes réalisées en collaboration avec son épouse Coosje Van Bruggen — ses pièces d’une efficacité visuelle redoutable s’inscrivent dans un discours complexe. En convoquant à la fois le détachement laconique et l’humour caractéristique au pop art, Oldenburg aurait-il inventé un art grand public, cet « art conceptuel pour les masses » dont parle David Robbins ? Retour sur le parcours non-exhaustif d’un artiste à la fois héros et bouffon de sa propre farce.
Subjuguer le quotidien
« I am the art of underwear and the art of taxicabs. I am for the art of ice-cream cones dropped on concrete. I am for the majestic art of dog-turds, rising like cathedrals. » déclare Claes Oldenburg dans son manifeste « Je suis pour un art » (1961). Cette allégation ne surprendra pas les promeneurs tombés par hasard nez à nez avec la Bicyclette ensevelie (1990), bien connue des parisiens du parc de la Villette. Chaque rencontre avec l’une de ses œuvres est réjouissante : c’est une même simplicité, un même impact immédiat qui s’imposent dans un premier temps. Mais des années avant de se tourner vers l’acier et l’aluminium, l’artiste, âgé aujourd’hui de 90 ans, innovait avec des matériaux davantage évolutifs et créait des installations basées sur des environnements réels, allant du carton froissé à la toile imbibée de plâtre et peinture. Ces premières œuvres sont concomitantes avec son arrivée dans le Lower East Side des années 55. Dans le journal qu’il tient régulièrement, Oldenburg décrypte à la fois la fascination pour la nouveauté de ses sujets pop et l’incompréhension de la spécificité de leur forme, face à un expressionnisme abstrait encore en vogue. Il se consacre alors à observer l’environnement qui l’entoure, dominé à l’époque par la pauvreté, le trafic, le travail, et l’économie monétaire. Et tandis que des artistes tels Warhol ou Lichtenstein s’inspirent des médias populaires, l’ancien illustrateur du City News Bureau de Chicago élève au rang de muse les objets délaissés du quotidien : hamburgers, ventilateurs électriques ou autres ustensiles défraichis qu’il assemble à partir de cartons et de bois collés, grossièrement peints. Mug (1960) ou Two Girl dresses (1961) en sont symptomatiques. Au même moment en Europe, Jean Fautrier ou Jean Dubuffet explorent eux aussi un style à rebours des valeurs esthétiques traditionnelles.
Côté imagerie, la nouveauté du pop est de représenter le monde tel qu’il est. Si Oldenburg tient sur lui un discours parfois critique, il est aussi fasciné par l’énergie de ces formes nouvelles simplifiées, efficaces, voire agressives, développées par une société publicitaire du tout-image. Ayant rejeté toutes formes d’abstraction pourtant en vogue à ce moment, Oldenburg cherche une alternative à la peinture figurative. Il la trouve en la figure incarnée de Ray Gun, sorte d’alter ego de l’artiste. Né de l’imaginaire des anti-héros de ses contemporains — ceux, pathétiques, de Samuel Beckett ou renouant avec l’acceptation pessimiste de Jean-Paul Sartre ou Alain Robbe-Grillet — Ray Gun (littéralement « pistolet à rayon ») ne semble guère menaçant. Sa forme boursouflée, composée de fragile papier mâché, ressemble davantage à un sèche-cheveux fossilisé qu’à une arme.

Claes Oldenburg « catalogus nr. 472 », édité à l'occasion de l'exposition monographique « Claes Oldenburg » au Stedelijk Museum, janvier 1970, Amsterdam
Typographie Wim Crouwel
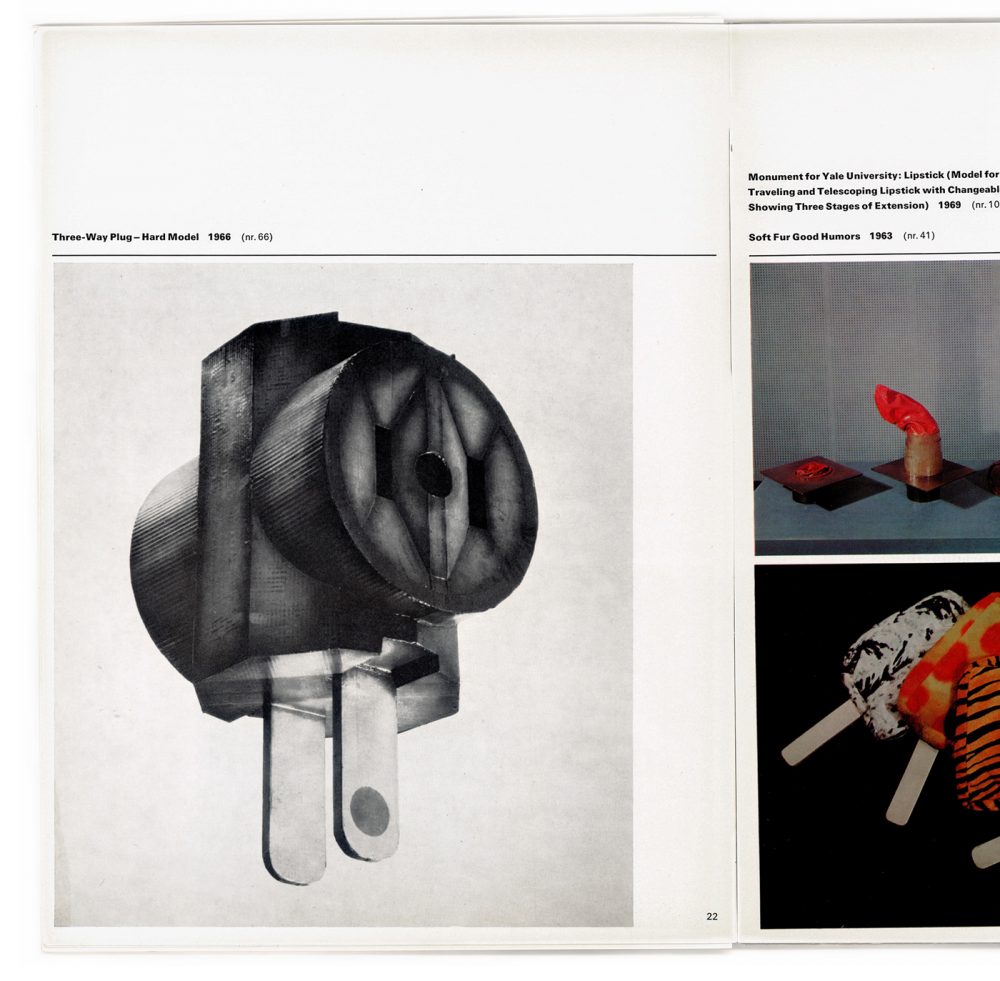
Claes Oldenburg, « catalogus nr. 472 », édité à l'occasion de l'exposition monographique « Claes Oldenburg » au Stedelijk Museum, janvier 1970, Amsterdam
Il a toutefois été conçu dans un esprit d’assaut, parodie des épopées de série B d’aliens zigouillés à coup de canon laser. Ray Gun va tout d’abord être utilisé dans les nombreux happenings auxquels Claes Oldenburg participe et qui se multiplient à cette époque à New York. George Brecht, Jim Dine, Dick Higgins et Allan Kaprow, des artistes de la même génération qu’Oldenburg, éprouvent alors le besoin de sortir du contexte d’un cadre artistique connoté (ateliers, galeries, musées) pour se réapproprier la vie urbaine. Les Environmentsnaissent, à mi-chemin entre le ready-made et l’intervention plastique, dans lesquels les matériaux éphémères (carton, papier, tissu, cellophane, etc.) sont les composants essentiels de cette réflexion autour de l’espace d’art total.
Début 1960, Ray Gun fait partie d’un environnement plus ambitieux intitulé The Street (1959). Le visiteur, invité à déambuler entre les sculptures en plâtre du clochard de Big Man (1960), ou des visages grimaçants de Big Head ou Gong, (1959), découvre pêle-mêle cartons, journaux et autres vrai-faux détritus en toile de jute, recouverts de suie et de peinture. Oldenburg tente ici de dépeindre le panorama immersif d’une ville agitée et l’existence marginale des classes dépressives. À la sortie de cette installation qui jette les fondements d’un art baptisé plus tard « Pop urbain » par l’artiste, les spectateurs se voyaient attribuer un million de dollars en devise Ray Gun pour acquérir les œuvres en plâtre qui la composent. Des rues défraîchies d’une ville chaotique, Oldenburg se replie en 1961 sur l’espace semi-privé du magasin. Tandis que The Street fonctionnait comme une alternative à l’espace de la galerie traditionnelle, en éliminant la distinction entre grand art et art mineur, galerie et brocante, The Store est composé de sculptures peintes de couleurs vives et de reliefs en mousseline plâtrée conçus pour évoquer une économie d’abondance, saturée de produits commerciaux alléchants et d’aliments dégoulinants. Placées sous le signe de l’assemblage, les sculptures bariolées deviennent des versions appauvries des choses désirées par le grand public : paquet de cigarettes, paire de bas rouge, hamburger-frites couvert de peinture brillante et criarde de style clairement expressionniste.
On dénote déjà le caractère théâtral de ces pièces, dans une relation qui s’établira par la suite de facto entre le spectateur et les sculptures dites soft de l’artiste:
« LES SCULPTURES SONT LITTÉRALEMENT SORTIES DES ENVIRONMENTS. LES PIÈCES AVAIENT CETTE PRÉSENCE DRAMATIQUE, CETTE QUALITÉ THÉÂTRALE QU’ELLES PROJETAIENT VERS LE DEHORS »
Côté forme, structure et abstraction : l’insistance d’Oldenburg, dès les années 1960 et ce jusqu’à aujourd’hui, sur l’objectif d’unification de l’œuvre, place non seulement le sujet au second plan, mais le fait immédiatement disparaître à la fois comme prétexte (« ce que je fais, c’est donner une forme ») et dans le temps (« Les significations du pop art sont instantanées et ne sont pas supposées durer pour détourner du contenu formel »). Ainsi, le Pop art d’Oldenburg se définirait comme une stratégie dissimulant derrière son sujet le travail formel, proche des recherches de ses contemporains et notamment des minimalistes. Pool chapes (1964) ou Giant Pool Balls (1967) sont symptomatiques de cette recherche de Gestalt, tout comme The Bedroom Ensemble (1963), où l’artiste délaisse le plâtre et la peinture pour explorer les modalités du vinyle. A contrario de l’expressivité des sculptures de The Street ou The Store, les objets de Bedroom Ensemble provoquent des sensations de distance ou d’étrangeté. Conçue comme une chambre kitsch de motel et décorée d’une parodie de tableau moderne à la Pollock, l’installation anticipe le Furniture art de Richard Artschwager ou John Armleder, avec son mobilier faussé par une perspective à point de fuite unique. S’inspirant de l’intimité et du caractère privé du foyer, Oldenburg en reconstitue un fragment dont le décor figé, statique, témoigne d’une projection de l’artifice et du narcissisme inhérent à l’American Way of Life.
Poétique du Mou
Si les œuvres de Claes Oldenburg sont immédiatement reconnaissables et d’une efficacité visuelle redoutable, celui qui ressent le besoin de creuser un peu s’apercevra assez vite que l’efficacité Pop n’est pas la seule donnée en jeu, et que sa démarche réunit en une savante alchimie des directions multiples, entre valorisation esthétique de ce qui, a priori, ne le mérite guère et dévaluation réglée des emblèmes du Bel Art. Son œuvre repose ainsi sur une logique de curseur, oscillant entre la construction d’une image-signe hyperpuissante et sa dégradation, autorisant ainsi un large spectre de lectures.
La première technique d’épuisement de l’image réside dans les matériaux employés : c’est à partir des années 1960 qu’Oldenburg tourne sa pratique vers des matériaux mous et malléables (tissu, mousse, toile, vinyle) pour représenter des objets « en dur », issus du quotidien. Si, dans l’histoire de l’art, la première apparition d’une sculpture molle est le Pliant de Voyage de Marcel Duchamp en 19161, Oldenburg s’est davantage inspiré d’éléments plus concrets. Alors invité à exposer à la Green Gallery de New York à l’automne 1962, un problème apparait : comment remplir les centaines de mètres cubes de la galerie avec la maigre production de sculptures plâtrées de The Store ? C’est en découvrant les concessions automobiles et la façon dont elles sont présentées dans les vitrines de la 57ème avenue qu’il décide d’agrandir les pièces de The Store à l’échelle de voitures. Le plâtre ne permettant pas de sculptures aussi grandes, l’artiste se tourne vers d’autres matériaux industriels, économiques et proches de l’esthétique pop : la mousse et le tissu rempli de Kapok. À l’agrandissement de ses œuvres s’ajoute donc un changement de matière première. Les premières sculptures dites soft dont Floor Cone, Floor Cake, Soft Calendar sont des formes pleines et moelleuses, aux couleurs criardes et à la planéité affichée. Le réel auquel il fait référence est immanquablement reconnaissable et l’effet comique résulte de l’inadéquation totale de l’objet à sa fonction, en raison de sa déstructuration et son aspect mou — l’artiste gardant généralement quelques parties solides par contraste et pour accentuer l’effet de désarticulation (paradoxalement, le beurre dur de Soft Baked Potato, Open and Thrown, 1970) ou démontrer l’affaissement par la suspension (Soft Viola, 2002).
Si Barbara Rose parle de « physicality, concreteness, presence » de la sculpture soft, cela est peu perceptible sur les reproductions. Il faut alors imaginer la sensualité, l’aspect théâtral dû aux dimensions gigantesques et l’accrochage spécifique des œuvres, pour comprendre à quel point leur confrontation avec le spectateur est volontairement heuristique, de façon immédiate et globale par la tentative de l’atteindre dans sa présence corporelle. On remarque d’ailleurs chez Oldenburg un effet d’élévation dans de nombreuses sculptures : les quilles de bowling de Flying Pins (2000), ou encore les clubs et balles de golf de Golf/Typhoon (1996). Cependant, ce désir de lévitation n’est jamais pleinement vécu, et apparaît fréquemment contrarié, soit par la présence d’un élément (faussement) à moitié enfoui (la boule de bowling de Flying Pins) ; soit par un effet d’inversion qui amarre irrémédiablement l’action au sol : c’est la cravate renversée de Francfort, c’est le cornet de glace écrasé sur le toit d’un immeuble de Cologne (Dropped Cone, 2001), c’est encore la flèche pointée vers le sol de Cupid’s Span (2002). Si le deuxième facteur d’épuisement du sujet réside dans la remise en question de sa présentation, c’est que, traditionnellement, la sculpture dans l’histoire de l’art tend à souligner sa résistance à la gravitation. La notion de structure interne, d’une ossature sous-jacente à laquelle se rattache la musculature demeure liée à la représentation du corps humain. Ici, nulle évocation de ce dernier. Dans la mesure où il est saisissable, le corps humain d’Oldenburg (imaginé sous la forme d’objet — le Giant Ice Bag ne se gonfle et dégonfle-t-il pas comme un gigantesque poumon à l’aide d’un système hydraulique sophistiqué ?) se propose toujours de façon fragmentaire, abandonné, vulnérable par la déstructuration, ou par le choix de la partie du corps, sexuelle (les bourses du Dormeyer Mixer, 1965) ou viscérale (les boyaux du Giant Soft Fan, 1966). De la même manière les appétissants gâteaux de The Store se cachent derrière une vitre et le glaçage douteux en vinyle de Floor Cake (1962) annule toute gourmandise. Entre frustration et mise à distance du contact, l’œuvre d’Oldenburg apparaît continuellement écartelée entre la lévitation et la flaccidité, entre l’envol et la chute.
Peu connues du grand public, les œuvres qui découlent de la dernière stratégie d’épuisement de l’image sont issues de la série Le Foyer, que Claes Oldenburg entreprend lors d’un séjour à Los Angeles en 1963.

Claes Oldenburg, Soft Washstand, 1966.
Extrait de Claes Oldenburg, catalogus nr. 472, Stedelijk Museum, janvier 1970, Amsterdam.
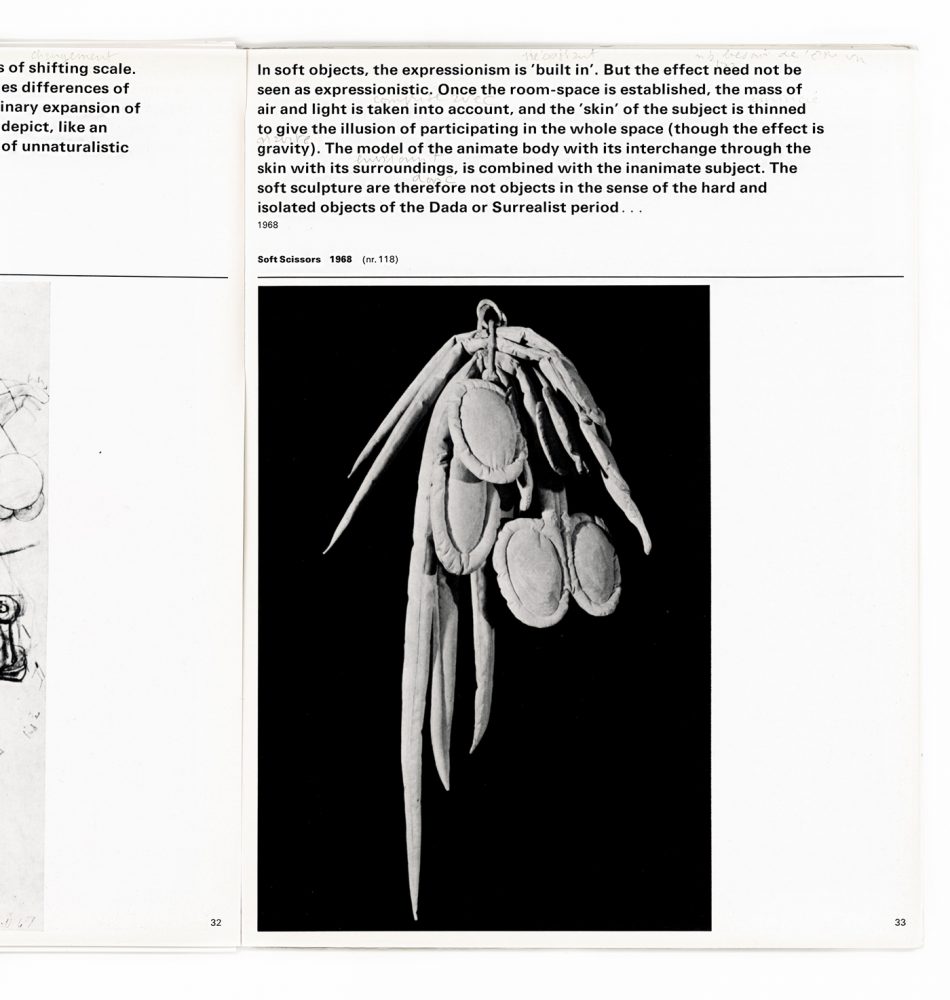
Claes Oldenburg, catalogus nr. 472, édité à l’occasion de l’exposition monographique Claes Oldenburg au Stedelijk Museum, janvier 1970, Amsterdam.
Mise en page de Wim Crouwel & Jolijn van de Wouw.
Bibliothèque Thibaud Meltz
Apparaît une transition thématique de The Street à la sphère privée du Foyer en passant par l’espace semi-public de The Store. Il commence à s’emparer d’objets caractéristiques de la vie moderne, téléphone, W.-C., ventilateur, ou interrupteur, qu’il décline ensuite en plusieurs échelles, couleurs et différentes versions : celle « dure » ou hard, évoque des maquettes d’objets et des formes ébauchées ; la version « molle » ou soft en vinyle, imitant les matériaux froids des objets tels que la porcelaine, la bakélite ou encore le métal ; et enfin la version « fantomatique » ou ghost soit le patron de l’objet dévidé, comme une peau de St Barthélémy s’abandonnant à son propre poids. L’expérience de ces différentes versions est autant visuelle que parcellaire, et les vues se succèdent : faces, plongées, contre-plongées sur des objets mous sans structure, sans cohérence apparente et fuyantes, mais en réalité parfaitement pensées pour disperser leurs échos. Dans la version soft de Pay Téléphone (1963), les coutures et orifices sont soulignés et mettent en évidence l’apparence érotisée de l’objet mais également sa mise à distance par l’aspect brillant et lisse du vinyle. Le froissement de sa version ghost lui confère quant à lui une grande vulnérabilité, comme si l’on atteignait l’ultime enveloppe, la plus fragile. À travers cette série, Oldenburg parcourt un cycle d’ordre vital des objets de consommation : après une première phase d’énergie et d’activité représentée par une version dure, le sujet se dégrade en s’amollissant, et ce jusqu’à sa mort, pour achever son cycle dans une phase de décomposition où sa matière s’efface au profit de l’idée2. Ces versions d’un seul et même objet contribuent à l’effacement du sujet et à une forme d’abstraction, chacun de ces états correspondant à l’évolution de la matière vers l’entropie finale.
Paradoxe et humour
Il lui a fallu aller jusqu’au paradoxe pour démontrer à la fois la prégnance et la fragilité des archétypes de l’American Way of Life. Prouver à la fois son incroyable présence visuelle et le vide sidérant qu’elle recouvre. Aller jusqu’au paradoxe, et en démontrer enfin le comique dans des projets monumentaux. C’est pendant la gestation de ses sculptures « molles » qu’Oldenburg commence à entrevoir la possibilité d’exposer ses objets de consommation dans des espaces publics. Il tire ses sources des ballons gigantesques des défilés de Macy’s lors de Thanksgiving mais également des travaux d’architectes de la fin du XVIIIe siècle tels qu’Étienne Boullée, Claude-Nicolas Ledoux ou encore Jean-Jacques Lequeu, dont il a étudié les dessins en travaillant à la bibliothèque de Cooper Union. De ses voyages fréquents en avion également, il imagine des objets hors d’échelle et des angles surprenants :
« Le monde lui-même est maintenant un objet du point de vue des voyageurs de l’espace. Je me suis dit qu’il serait bon d’avoir un grand lapin de la taille d’un gratte-ciel en centre-ville, dont on apercevrait les oreilles depuis la banlieue. »
Malheureusement, ce projet n’a jamais vu le jour, le site initialement choisi par Oldenburg ayant été racheté par le Playboy Club, empêchant ainsi toute érection de léporidé géant à cet endroit précis. À la suite de cette anecdote, il conçoit dès 1965 ses premiers projets utopiques pour l’espace public : apparaît une série d’esquisses de monuments imaginés pour New York, Londres et Los Angeles tels que Giant Teddy Bear (1965) au beau milieu de Central Park ou Ball (1967) sur la Tamise. Les premières commandes se manifestent alors. L’occasion pour l’artiste de mettre en pratique son adage : « l’humour est la seule arme de survie ». Car si le banal est la matière de prédilection d’Oldenburg, c’est en refaçonnant les bribes de notre quotidien qu’il leur confère un sens nouveau et une relation inattendue avec l’espace. Avec un sens unique de la transgression, il extrait ses objets triviaux de leur contexte pour les convertir en sculptures monumentales installées au sein des paysages urbains et auxquelles le public peut librement se confronter. L’exagération des dimensions et la banalité des sujets amènent le visiteur à réfléchir sur les rapports qu’il entretient avec eux, mais également à son environnement direct. Déterminé à imprégner ses sculptures d’un contenu social et politique (plus ou moins masqué), Oldenburg conçoit ses monuments comme une satire de la banalité de la vie quotidienne et son absurdité. C’est le cas de Lipstick (Ascending) on Caterpillar Tracks (1969) gigantesque tube de rouge à lèvres dressé sur des chenilles de pelleteuse érigé à l’université de Yale à la polarité douteuse. À la fois machine de guerre ensanglantée et symbole de féminité, ce mariage de l’érotisme et de la guerre tourne en dérision la puissance des États-Unis, au sein de l’un de ses plus prestigieux établissements, tout en dénonçant l’éducation paritaire dudit établissement, les femmes n’étant admises à Yale qu’en 1969. Pourtant, si l’ordinaire devient critique dans ses œuvres monumentales, les sculptures ne s’en tiennent jamais à un simple diagnostic négatif sur les sociétés contemporaines. L’objet quotidien et utilitaire à grande échelle acquiert une richesse sémantique, dont la forme transfigure la banalité de l’objet.
Texte par Joy Des Horts
Généalogies du futur
Kapwani Kiwanga
Il est toujours intéressant de voir comment circulent et évoluent les concepts, les appellations, les labels. La destinée fascinante des mots. Ainsi va du terme afrofuturiste qui depuis son apparition sous la plumede Mark Dery en 1994, a vécu déjà plusieurs vies. Sun Ra fait résonner les cuivres de la diaspora électronique des années 2000, basse en avant, des ruines de Detroit aux radios pirates de Londres. Sam Delany cruise dans les cinéma new-yorkais et invente avec Octavia Butler des mondes où d’autres genres et sexualités sont possibles. Et l’Europe danse sur les rythmes techno de l’Underground Resistance. Fin de la première bobine.
Un concept c’est un outil utile, unificateur, prenez le terme diaspora par exemple, mais l’outil est de sable, il ne tient que le temps de se dire et s’effrite aussi vite qu’il a été assemblé. L’espace culturel de l’Atlantique Noir est né au bord des plaques tectoniques et se nourrit des séismes successifs des vagues divergentes du cool, de l’adoubement par les milieux culturels et académiques qui ne savent trop quoi faire de ces Noirs et de leurs expressions que de les mettre en cage pour pouvoir mieux les étudier, les appréhender, les classer. Les rendre réels tout en s’efforçant de les effacer. Parce que les Noirs n’existent pas dans cette société. L’afrofuturisme est au cœur de l’expérience Noire, il est le point nodal qui relie tous les fils de la toile diasporique.
Tu es Noir et tu regardes vers le ciel : afrofuturiste. Tu fais de la techno à Soweto. Afrofuturiste. Tu tries les déchets informatiques dans un dépotoir de Lagos : afrofuturiste. La seconde bobine s’effrite. Mais la force de la diaspora afroplanétaire c’est cette capacité au recyclage, à l’hybridation, à pouvoir sentir le sens du vent et s’en servir pour renvoyer les préjugés par l’ascenseur par lequel ils sont arrivés. Hollywood vomit un Black Panther américain jusqu’au cliché, alors que du Togo au Nigéria, de Dakar à Kinshasha, on entame une troisième bobine afrofuturiste, entre réalisme magique et spéculations, entre culture de masse et mondes de l’art contemporain.
Afrogalactica, le projet proprement labellisé afrofuturiste en trois volets de Kapwani Kiwanga, naît au cœur de cette histoire, en 2012. Artiste, formée à l’anthropologie, Kapwani Kiwanga dessine, dans son travail aux contours multiples, une véritable phénoménologie Noire, celle de peuples dispersés mais toujours en lien, traversés par des savoirs qui sont communs et divergents en même temps. Elle cultive avec exigence et minutie, au fil de ses recherches et expositions, la fragilité et la nuance qui s’exprimait déjà dans Bon voyage, son film de 2005, réalisé pour la BBC. Déjà, il s’agissait de récit, de diaspora, de mythes, de corps déplacés, broyés par la machine travail. Notre discussion s’ouvre sur le deuxième volet du projet, The black star chronicles.
Peggy Pierrot Pouvez-vous m’expliquer ce qui a motivé Afrogalactica II ?
Kapwani Kiwanga C’est la suite d’une série de trois conférences performées où j’incarne un scientifique du futur. C’est un projet qui a commencé en 2012, donc ça date un peu. Ces performances, je les réactive lorsque l’on m’invite à en livrer une interprétation, mais je ne les retravaille pas. Le premier volet, qui devait être le seul au départ, c’est un peu « afro-futurisme 1.01 ». Je parle de certains artistes afro-américains. En travaillant sur ce premier volet, j’ai pris conscience qu’il n’y avait pas de place pour les questions et points de vue féminins et les questions de genre dans ce que j’explorais et en même temps je n’arrivais pas à tout faire rentrer de ce que j’avais amassé. deuxième volet, parce qu’il ne servait à rien de forcer, d’essayer de tout faire entrer dans une seule performance. J’ai fait comme un abécédaire de l’afrofuturisme. Du coup, j’ai construit le second volet en prenant Octavia Butler comme point de départ. Il y a certains de ses livres que j’aime plus que d’autres, et plus que la forme ou certaines phrases, ce sont
ses idées que j’adore.
Peggy Pierrot Quel était votre point
de départ dans l’œuvre d’Octavia Butler ?
Kapwani Kiwanga Le point de départ c’était le premier tome de la Xenogenesis, Dawn et cette idée qu’après la séparation d’avec la terre, inhabitable, le fait de se retrouver dans un vaisseau perdu dans l’espace est l’occasion de se repenser un peu, de repenser la société. Je pars d’une situation fictive et je retrace l’histoire avec des archives populaires qui montrent la création de races et de genres comme un processus intentionnel, que la création des hommes et des femmes résulte d’une intention. Je puise des exemples chez différents penseurs, je refais la généalogie des catégories. Par exemple, je mentionne le cyborg et
le travail de Donna Harraway. J’explore aussi le concept américain de miscegenation, qui n’existe pas vraiment en français — on dirait amalgamation ce qui n’est pas très joli. C’est le mélange des races qui est exposé dans ce cadre.

Kapwani Kiwanga, Jalousie, 2018.
Avec l’aimable autorisation de l’artiste et de la Galerie Jérôme Poggi, Paris.

Kapwani Kiwanga, Vumbi, 2012.
Photographie numérique, tirage pigmentaire couleur.
Avec l’aimable autorisation de l’artiste et de la Galerie Jérôme Poggi, Paris.
l’Europe et l’Afrique, où on se projette dans un futur. Je pense que c’est afrofuturiste même si la technologie n’est pas mise en avant, car il y a la question du temps, celui avant et celui après nous, ce temps qu’on ne voit pas à l’œil nu.
La plaque européenne avance vers la plaque continentale africaine. On pense qu’elle passera en dessous à terme. On parle de temps géologiques ici. De centaines de milliers d’années. Cette question des continents tels qu’on les connaît est temporaire, cela changera comme cela a déjà changé.
Peggy Pierrot Le lien entre la géologie et les minéraux est intéressant. On sait qu’on se tourne pour l’archivage longue durée vers le minéral. La relation à la pierre et à la transmission. On a reçu beaucoup d’archives gravées dans la pierre, que ça soit la pierre de Rosette ou les Tables de la Loi, pour en revenir aux questions mythologiques et religieuses. On sait aujourd’hui que les supports d’archivage numérique sont limités dans le temps et on cherche du coté des minéraux des façons de transmettre à plus long terme que sur les disques durs sur lesquels nous basons toute notre mémoire aujourd’hui.
Kapwani Kiwanga La transmission orale persiste plus que par exemple les manuscrits de Tombouctou qui peuvent brûler, les informations sont peut être codées dans les histoires, mais sont plus sûrement gardées dans les coffres-forts du langage.
Peggy Pierrot Évoquons le Sun Ra Repatriation Project. D’où vient l’idée du portrait-robot et l’idée de l’envoyer dans l’espace par radio transmission ?
Kapwani Kiwanga L’idée a été de recom-poser un portrait de Sun Ra à partir du souvenir des gens qui ont travaillé avec lui. C’est le portrait qui ressort de ces souvenirs, un portrait- robot qui ne lui ressemble pas physiquement mais qui est le fruit fidèle de ces souvenirs, et qui nous renvoie à des thématiques qu’il a creusé, ce qu’est l’essence, la représentation au delà de l’image. La limite de l’image qui représente l’humanité et qu’on envoie à travers l’espace. On a peut-être quelque chose de plus juste avec quelque chose qui n’est qu’un collage de souvenirs qu’avec une vraie photographie. C’est de là qu’est partie l’idée du portrait-robot, avec l’idée aussi de questionner cette façon de représenter les gens qui est aussi une partie du système de violence de l’image et de la représentation dans un contexte sécuritaire.
La radioastronomie est venue quant à elle parce que c’est un des moyens les plus faciles pour faire voyager des données à travers l’espace et le temps. Ça m’a semblé être le meilleur moyen de communiquer sur de longues distances. C’est aussi un clin d’œil à la période de la guerre froide où beaucoup d’argent a été mis dans la conquête spatiale. C’était le vecteur qui permettait de lier ma pratique et tous ces travaux de recherche de vie extra- terrestre, et les thématiques abordées par Sun Ra lui-même.
Le troisième volet, qui date de 2014, s’appelle Deep space scrolls, (les manuscrits des confins de l’espace). Il fait la même durée mais effectue une sorte de retour au continent africain pour puiser dans les connaissances astrales et astronomiques anciennes, dans les runes et les ruines de l’empire zimbabwéen. Le contexte fictif de cette partie ce sont des relations qu’il y aurait eu entre des nations extra-stellaires et des humains dans le passé. Je creuse cette idée que la connaissance, la vie, vient d’ailleurs…
Peggy Pierrot Vous avez évoqué plusieurs fois le rapport au savoir, à l’académie.
Kapwani Kiwanga J’essaye toujours d’avoir différentes tonalités : académiques, des histoires du folkore, de la mythologie, des chansons traditionnelles ou populaires, mes mots, mes notes personnelles surtout. Je travaille toujours différents types de textualité pour garder un coté polyforme et une multivocale. J’ai une formation en religions comparées, et j’ai été vers l’art parce que ça m’intéressait, c’est pas anodin, cette dimension philosophique et spirituelle. Elle s’exprime au travers de langages codés, je continue à creuser cela dans mon travail sur les croyances au sens large, juste la force de croire m’intéresse, que ça soit une croyance spirituelle ou politique.
J’ai un autre corpus qui parle du futur, à travers le rapport géologique entre
Peggy Pierrot Dans votre travail, il y a aussi les archives qui dénotent d’un intérêt fort pour la relation passé/présent/futur. Je pense à votre travail sur les Maji Maji.
Kapwani Kiwanga Ma relation aux archives… Au départ ce ne sont pas tant les archives en tant que telles qui me motivent, mais d’abord l’envie de regarder, de poser des questions sur les événements, d’explorer ce qui a pu se passer. Ma recherche sur les Maji Maji commence d’abord par des histoires racontées par des personnes, oralement, un autre type d’archive en quelque sorte. D’une certaine façon, je pose la question du document : qu’est-ce qu’un document qui a valeur d’archive ? Quels matériaux sont reconnus comme témoins ? Et quelle place laisse-t-on à l’invisible ? À ce qui n’est pas écrit, pas calligraphié, pas photographié — la matérialité entre l’oral et l’écrit. La matérialité de manière générale, celle de la société occidentale dans laquelle j’ai grandi et j’évolue, dans laquelle ce qui existe doit être tangible parce que si c’est là physiquement ça existe et si ça n’est pas là, matériellement, ça n’existe pas.
C’est la question de ce qui est occulté et effacé, dans les archives, qui m’intéresse. Du coup, pour rester dans cette thématique du futur, ce sont des archives accessibles avec lesquelles je travaille, des images que parfois on connaît déjà. C’est un processus de comprendre comment on en arrive à maintenant. Mais les archives ne sont pas quelque chose de sacré, d’hyper protégé. Pour moi les archives doivent être ça, manipulées, usées, vivantes. Dans mes installations lorsqu’elles sont présentes, quand elles existent, je fais de façon à ce que les personnes puissent les manipuler, ou moi-même je les manipule, je les plie, afin que les archives ne deviennent pas trop autoritaires, trop figées.
Peggy Pierrot Autoritaires ?

Kapwani Kiwanga, White Gold Morogoro, 2016.
Vue de l’exposition « Ujaama » à la Ferme du Buisson, 2016.
Avec l’aimable autorisation de l’artiste et de la Ferme du Buisson. © Emile Ouroumov
Kapwani Kiwanga Qu’elles ne parlent que d’une seule voix, hégémonique, qu’elles ne laissent pas de place à l’interprétation. Je fais référence aussi à l’autorité de celui qui peut dire, à l’autorité des faits. Derrière l’idée de faire ces conférences- performances, il y aussi une idée d’investir cet endroit de savoir qu’est la conférence, qui est aussi un de ces espaces autoritaires et espace de transmission comme l’archive. J’ai aussi envisagé cette forme car j’étais agacée d’entendre des gens parler avec autorité, avec un manque d’humilité dans leur relation à la transmission.
Peggy Pierrot Est-ce que ça veut dire que vous n’avez pas de passion particulière pour les récits spéculatifs, la science-fiction ou d’autres genres…
Kapwani Kiwanga J’aime tout ce qui est fantastique, j’ai toujours été intéressée par le cinéma de zombies, par les vampires. La spéculation vient plus de la lecture de Butler. La spéculation comme méthode ou stratégie m’intéresse politiquement. C’est devenu plus clair au fur et à mesure que je formulais ce projet.
Mais le pouvoir de lutte et le pouvoir du récit ont toujours été en moi, la narration est au cœur de ce que je fais même si c’est de manière éclatée, que ce n’est pas toujours mis en avant. Les récits spéculatifs ou fantastiques, c’est une autre façon de regarder les mythes ou plutôt, je devraisdire les langages codés, les langages symboliques que je trouve assez forts. Ils travaillent sur différents niveauxde conscience et c’est ce qui m’intéresse. Après cette période afrofuturiste et de science-fiction entre guillemets, je continuemais autrement, pas forcément en traversant mes spéculations ou récits personnels, à suivre et creuser des spéculations faites par d’autres personnes en ce qu’elles permettent de créer quelque chose de nouveau. La spéculation a une force politique. On voit les effets de pouvoir du récit dans nos sociétés, dans les familles. On le voit dans les chances qu’on se donne et que l’on donne aux autres.

Kapwani Kiwanga, vue de l’exposition « The sum and its parts », Reva and David Logan Center for the Arts, Chicago (États-Unis), 2017.
Avec l’aimable autorisation de l’artiste et de la Galerie Jérôme Poggi, Paris.
Le langage performe, on le voit, alors la spéculation c’est se donner la possibilité de voir les choses différemment, c’est nous autoriser à penser que d’autres choses peuvent exister, que l’on est pas si loin que ça de voir nos pensées se matérialiser. La spéculation peut-être de tout ordre. Puisque que je performe dans le registre universitaire, ce n’est pas de la narration littérairecomme peut le faire un écrivain. Je me plonge dans les termes et tournures de phrases universitaires. Mais il y a d’autres spéculations dans le politique, le Black Panther Party dansses choses bien ou moins bien tenait de ce type de tentative. C’était aussi une spéculation : et si on prenait les armes et on s’occupait de nous-même ? La spéculation c’est partir de cet état présent et se projeter dans un futur imaginé qui soit autre. De manière générale, il y a une obsession du futur auquel s’ajoute une angoisse. On peut regarder à quel moment de l’histoire sortent le plus de films apocalyptiques, l’angoisse du futur c’est d’abord l’angoisse du présent.
Nouvelles de demain
Rirkrit Tiravanija
L’artiste thaïlandais Rirkrit Tiravanija est volontiers reconnu comme l’un des plus influents de sa génération.
Ses travaux défient les descriptions traditionnelles car sa pratique associe la créationclassique d’objets, les perfor-mances, publiques ou privées, l’enseignement ainsi que d’autres formes de services publics et d’actions sociales. Il invite le spectateur à prendre part à l’expérience en temps réel et à l’échange dans la création artistique.
Participer et faire participer sont des éléments-clés dans la pratique de Tiravanija. Comme il le dit lui-même, le terme « relationnel » peut s’appliquer à la majeure partie de ses travaux. Ses œuvres, qui explorent le rôle social de l’artiste sont, pour le curateur Nicolas Bourriaud qui les a régulièrement citées, représentatives de sa conception de l’art relationnel.
Hamid Amini Votre dernière exposition à la galerie Gavin Brown’s Entreprise présente une série de tableaux inspirés par Philip Guston, représentant un mur et faisant clairement référence à l’autorité. Selon vous quels changements sont apparus dans l’art depuis l’investiture de Trump ?
Rikrit Tiravanija L’opinion s’est beaucoup divisée. Il y a davantage d’ignorance, de peur, et avec l’investiture de Trump, les nationalistes (blancs) se sont enhardis. Le monde de l’art est pris au piège du mondialisme et des profits de l’économie de marché. L’art devient hors de propos, il se met à genoux et se voit réduit à un simple produit décoratif.
Hamid Amini Pensez-vous qu’il existe une différence entre les artistes occidentaux et les artistes des pays d’Asie ? Dans une interview, vous déclarez que les artistes asiatiques n’ont rien d’autre qu’eux-mêmes comme point de départ… Comment avez-vous débuté ? Étiez-vous déjà bien familiarisé avec l’histoire de l’art ? Comment vous frayiez-vous un chemin dans l’histoire de l’art occidental en tant que thaïlandais ? Et ces questions sont-elles même pertinentes ?
Rikrit Tiravanija Selon moi, l’amnésie de l’histoire (du passé) résultede la modification des lieux de création, et de la nature de l’art et de son univers. Je pense donc qu’il est important de comprendre vraiment l’histoire, les traditions, les intentions et les combats, de trouver comment on peut appliquer ses idées dans le monde actuel et d’avancer vers l’avenir.
Hamid Amini Vous travaillez souvent à partir de l’absence d’objets ou d’actes. Vos cours s’intitulent en général « Comment ne pas travailler » ou « Créer sans objets ». Pensez-vous qu’il existe une présence dans l’absence ? Comment traitez-vous la notion de manque ?
Rikrit Tiravanija Le manque est la peur de l’absence, mais là encore je pense qu’il s’agit de la perspective culturelle que chacun de nous entretient avec la valeur de la vie. Nous naissons nus et nous quitterons ce monde sans objets, c’est inévitable, et le fait de bâtir son existence sur de faux postulats est au cœur des problèmes du monde dans lequel nous vivons. Je pense que les objets n’ont pas de valeur à moins qu’on les utilise, et c’est à travers leur utilisation qu’ils trouvent leur signification, que les relations apparaissent.
Hamid Amini La cuisine est essentielle dans votre pratique. En 1992 vous avez mis en place une exposition baptisée Untitled (free) à la 303 Gallery, à New York, convertie pour l’occasion en cuisine où vous avez servi gratuitement du riz au curry thaï. Cuisinez-vous parfois seul, pour vous ?
Rikrit Tiravanija Tout le temps.
Hamid Amini Quelle est votre boisson préférée ?
Rikrit Tiravanija Le Negroni.
Hamid Amini Vous semblez beaucoup apprécier le rôle d’enseignant. Que vous apporte l’enseignement ? Pensez-vous que tous les artistes devraient enseigner au cours de leur carrière ? Comment définiriez-vous le terme de générosité dans votre pratique ?
Rikrit Tiravanija J’enseigne parce que j’aime rencontrer des gens, ça me permet de rester en contact avec les autres. Mais c’est aussi un acte d’opposition, car je n’adhère pas à l’idée d’ « apprendre » aux autres comment devenir artiste. Je trouve que l’institution de l’enseignement et l’étude (de l’art) relèvent d’une démarche erronée. On professionnalise quelque chose qui devrait être entre les mains d’amateurs. Je ne pense pas que les artistes doivent devenir des professionnels, je suis devenu artiste parce que je ne voulais pas être un professionnel. C’est contre-intuitif.

Rirkrit Tiravanija, « Une rétrospective (tomorrow is another fine day) », Paris-Musées, Paris, février 2005.
Conception graphique de M/M (Paris).
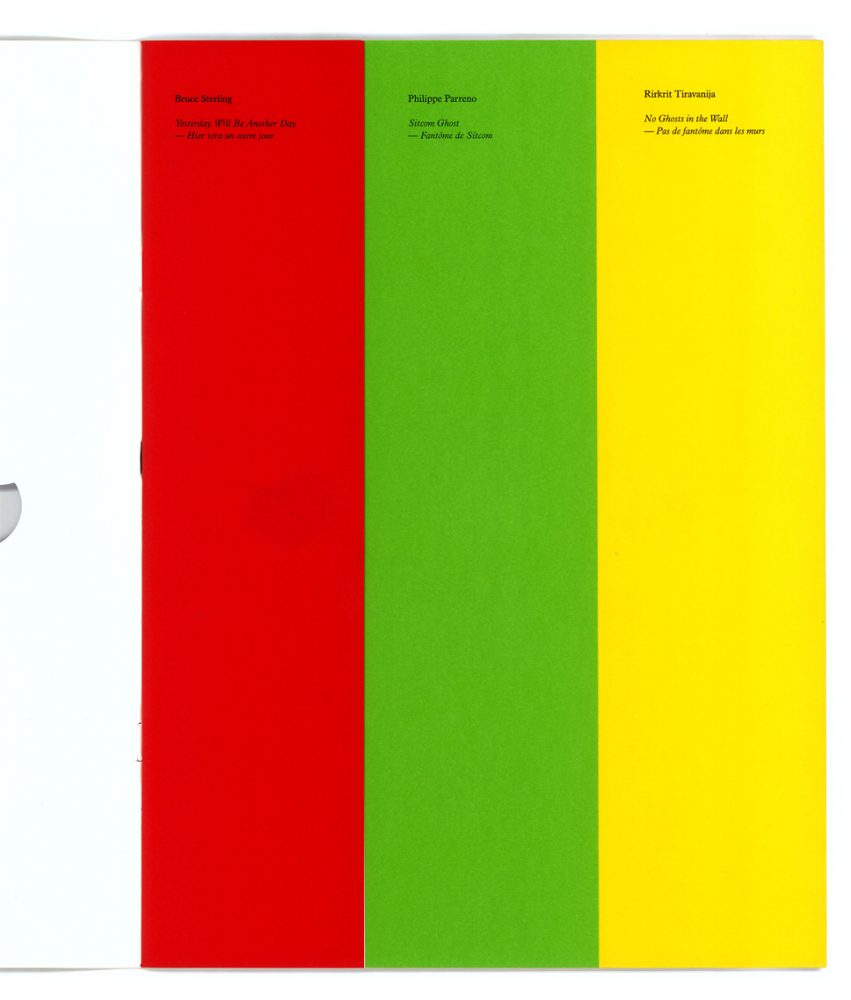
Rirkrit Tiravanija, « Une rétrospective (tomorrow is another fine day) », Paris-Musées, Paris, février 2005.
Conception graphique de M/M (Paris).

Les lignes de demain
Nouvelle Génération
Si les géants industriels ont permis de démocratiser le design d’objet,ils ont aussi banalisé certaines formes, les rendant aussi efficientes que tristement familières. Face à cette homogénéisation, des studiosindépendants proposent des alternatives inspirantes. Flirter avec l’art contemporain. Insuffler une touche de surréalisme. Marier artisanat et techniques industrielles. Ces jeunes designers réinvestissent les formes arché-typales et proposent des univers à même de réinventer le quotidien.
OS ∆ OOS
Alternance de formes géomé-triques, du rond au triangle en passant par les courbes du « S », le nom du label OS ∆ OOS ressemble à une énigme qu’il faudrait déchiffrer. Ce sont aussi les lignes qui caractérisent la première version de « Syzygy », la lampe qui l’a révélé au public : un socle en béton triangulaire ornéde disques de verre. En astro-nomie, la syzygie correspond à l’alignement de trois corps célestes dans le système gravitationnel. Les éclipses solaires et lunaires apparaissent alors. La création de OS ∆ OOS reproduit ce phénomène à l’aide de verre polarisant. En tournant les disques, la lumière est plus ou moins filtrée et dessine une éclipse, permettant ainsi de moduler l’intensité de l’éclairage. Ce parfait mélange d’abstraction et de fonctionnalité caractérise la pratique de OS ∆ OOS. Constitué d’Oskar Peet (« Os ») et de Sophie Mensen (« Oos », pour « Oosje », son surnom), le duo s’est rencontré en 2009 alors qu’ils étudiaient à l’Académie de Design d’Eindhoven, où leur studio est aujourd’hui basé. En 2017, le couple a conçu l’aménagement de la boutique du lunetier Ace & Tate. L’espace est une brillante démonstration de la modularité de leur projet « Matrix » : une simple structure de grille qui peut à la fois prendre la forme d’un banc, d’une cloison ou de support pour luminaire. Son esthétique minimale, entre prévisualisation filaire de logiciel 3D et matériaux de construction, est un clin d’œilaux architectures industrielles présentes à Eindhoven. Lorsque l’on questionne le duo quant à son souhait pour l’avenir, celui-ci répond : « Nous aimerions collaborer avec un architecte pour dessiner une maison et ensuite concevoir son intérieur, en prenant en compte tous les détails, des matériaux aux couleurs en passant par les formes du mobilier. »
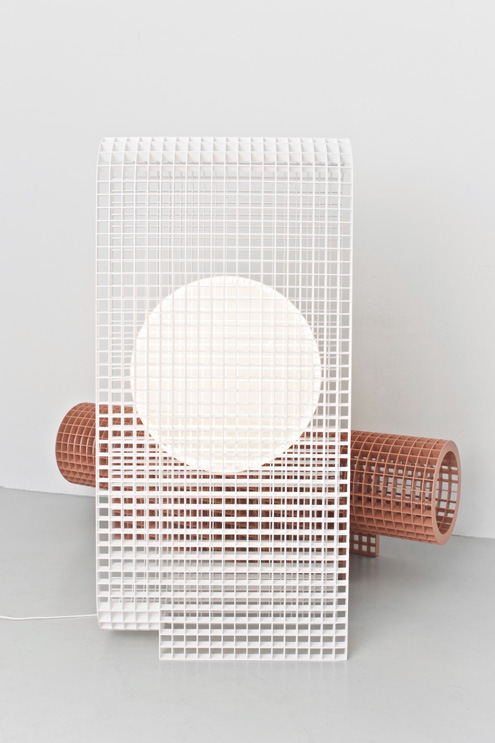
OS ∆ OOS, projet Matrix, banc 30 × 140 × 42 cm
& luminaire 24 × 60 × 125 cm, 2017.
SOFT BAROQUE
Les créations de Soft Baroque sont irrévérencieuses, dans le sens où elles ne cherchent pas à se conformer aux canons esthétiques ou aux tendances dictées par le marché. Le binôme, formé en 2013, est composé de l’artiste slovène Saša Štucin et du designer australien Nicholas Gardner, et est basé à Londres depuis la fin de leurs études au Royal College of Art. Le marbre, généralement employé pour sa magnificence, est ici en morceaux réagencés comme un vase brisé que l’on aurait maladroitement recollé et devient pot, luminaire ou table avec la série « Corporate Marble ». Le duo cherche à redéfinir les frontières du design : en jouant sur les contradictions du système, il opère à l’intersection de l’artisanat et des logiques fonctionnelles inhérentes à chaque objet. Pour autant, les propositions de Soft Baroque ne sacrifient pas la beauté sur l’autel de la réflexion. Leurs objets séduisent par leur incongruité. Ils diffusent une douce poésie, un soupçon de surréalisme qui les rend aussi intrigants que désirables. Ainsi les « Pearl screws » sont la rencontre de l’accessoire le plus banal et économique de la construction, la vis, et d’une perle de nacre, pierre précieuse dont la valeur culturelle reste inégalée. Habituellement cachées ou recouvertes, les têtes de vis sont donc serties de perles, comme autant de petites sphères laiteuses qui viennent décorer la surface plane d’un miroir ou briser la géométrie d’une tablette à la Donald Judd. Plus surprenante encore, la « Primitive Progressive Plinth » est une étagère dont la structure est recouverte de terre glaise. Automatisée, elle se met en mouvement pour danser sur elle-même dans un mouvement cinétique, répétitif et hypnotique. Cherchant à éclater les espaces préconçus où l’on segmente art et design, Soft Baroque développe une pensée transversale. Leur projet rêvé est à l’image de leur fantaisie et de leur ingéniosité : « Nous aimerions réaliser une fontaine, bien réelle et fonctionnelle ! »

Soft Baroque, « étagère murale », 52 × 26 × 106 cm, 2018.
ARANDA / LASCH
Duo basé entre New York et Tucson, Benjamin Aranda et Chris Lasch dessinent aussi bien des immeubles que du mobilier. Inspirés par les volumes géométriques engendrés par la nature, leurscréations sont faites de polygones et de structures filaires, convoquant aussi bien les formes primitives que les symboles cosmogoniques. Si la rigueur mathématique est bien présente, leur esthétique cultive un goût pour l’asymétrie. Ainsi la série « Quasi » (débutée en 2007), déclinée en table, console, miroir et cabinet, se base sur le quasi-cristal, état de la matière découvert en 1982 dont la qualité distinctive est que son motif structurel ne se répète jamais deux fois de la même manière. Il en résulte des formes qui semblent s’échapper ou se propager. Cette idée d’un design modulaire se manifeste d’une manière encore plus surprenante avec la série « Railing » (2015). Ici, chaque pièce de mobilier (deux chaises et un tabouret composent la collection) est une boucle composée de plusieurs arcs de cercle.

Aranda/Lash, « Railing », 2015.
Au lieu de dessiner une circonférence parfaite, la ligne serpente et se fige dans une forme convulsée. Sculpturales, ces boucles offrent assise et dossier dans un jeu de tension entre vide et plein. Habillés de mousse de silicone ou de cuir, les tubes deviennent d’intrigantes volutes colorées. Au-delà de son projet esthétique, le binôme souhaite réduire les inégalités. Benjamin Aranda développe : « En ces temps perturbés, la tendance est que les riches le deviennent encore plus et les pauvres de plus en plus démunis. Le design et l’architecture ne font que participer à ce problème, ils ne le réduisent pas. Et je suis certainement coupable, de par le genre de travail que je fais, mais je ne suis pas pour autant riche. J’espère changer le monde d’une manière positive. On m’a appris à croire que le design pouvait rendre le monde meilleur mais il semble que la promesse du modernisme, du design pour les masses, n’était qu’un rêve brumeux, perdu sur le chemin de ce moment laid de marché capitaliste. Mon projet rêvé n’est pas de concevoir un musée ou une tour, mais quelque chose de modeste, comme une maison que quelqu’un avec peu d’argent pourrait acquérir et ainsi réduire les inégalités qui font basculer l’équilibre de notre planète. »
SABINE MERCELIS
La transformation des matériaux est au cœur de la pratique de la designer néerlandaise Sabine Marcelis. Privilégiant les techniques artisanales aux technologies de pointe, les objets qu’elle crée témoignent d’une sensibilité accrue pour le toucher. Ses cubes en résine, à la fois tables basses et assises, joliment nommées « Candycube », présentent des couleurs pastels nées d’une technique de polissage savamment exécutée, difficilement compatible avec la production de masse. Immaculé, chaque plan capte les reflets du décor environnant, plaçantles interactions entre objet, espace et personne au centre de la réflexion de Marcelis. Autre exemple caractéristique de sa recherche, ses miroirs sont des disques dont la surface unie se fragmente en plusieurs aplats géométriques colorés. Les couleurs se réverbèrent et se déploient selon l’intensitéde la lumière du jour. La composition puise dans les références modernistes, un courant que la designer maîtrise parfaitement, comme le prouve le PavillonNéerlandais qu’elle a imaginé à l’occasion du festival de Cannes, en 2017. Lieu de rencontre professionnel, cet espace est une interprétation en trois dimensions de la Composition en rouge, bleu et jaune de Mondrian. Des châssisnoirs déterminent les différentes zones et leur fonction, et encadrent les tables et autres luminaires monochromes de Marcelis. Fidèle à la philosophie De Stijl qui prônait la dissolution des frontières entre le design, l’architecture, le cinéma et les arts, Sabine Marcelis questionne l’expérience. Cela explique pourquoi elle ne ressent nullement l’envie de concevoir de manière industrielle. Ne souhaitant pas participer à la surenchère d’objets déjà produits, elle préfère se concentrer sur des petites séries afin de créer des objets uniques. D’ailleurs, son projet rêvé témoigne de cette volonté expérientielle : «J’aimerais créer une installation de land art. Quelque chose dans la nature, où mes matériaux et objets pourront interagir avec un décor naturel et jouer avec la lumière qui s’y déploiera ».

Brit van Nerven & Sabine Marcelis, « Seeing Glass »,
projet en cours depuis 2013. Photo : Lee Wei Swee
COIL + DRIFT
Avant de fonder Coil + Drift, John Sorensen-Jolink s’est illustré dans le domaine de la danse contemporaine, à la fois en tant qu’interprète (il a notamment participé à la reprise en 2012 du classique de Philip Glass, Robert Wilson et Lucinda Chid Einstein on the beach) et chorégraphe. Il n’est donc pas étonnant de déceler dans le mobilier qu’il crée un sens affirmé de l’espace. La chaise « Soren » présente un dossier réduit à sa plus simple abstraction : un demi arc de cercle circonscrit le plan, ellipse d’un disque parfait. On peut s’amuser à retrouver d’autres références au vocabulaire chorégraphique dans les créations du designer. Ainsi les luminaires de la gamme «Bishop» jouent sur la notion d’équilibre. L’étagère « Hover » est constituée de panneaux disposés en quinconce, faisant naître lignes et interruptions, à la manière d’une partition rythmique. Elle permet aussi de constater le soin qu’apporte Coil + Drift aux matériaux employés. Différentes essences de bois, du frêne au noyer, du laiton, du marbre ou encore de la résine transparente renforcent le raffinement des propositions. Un sentiment d’harmonie se dégage de l’univers imaginé par John Sorensen-Jolink. Il a mis en scène cette sensation à travers différentes propositions chorégraphiques, entre performances live et pièce vidéo, où différents danseurs évoluent dans un intérieur constitué de son mobilier. Ils les manipulent, les déplacent, s’y installent et se les échangent. Ainsi les surfaces de ces meubles, leurs échelles, leurs volumes s’inscrivent tangiblement dans une réalité poétique, une mini-mode en soi. D’ailleurs, cette idée de microcosme, cette envie de constituer sa sphère, semble logique quand on pense aux nombreux déplacements qu’a effectué le danseur lors de ses différentes tournées. Il explique également : « Aujourd’hui je rêvede concevoir un hôtel ; sonespace et tous ses objets. J’aime profondément les hôtels et suis excité par la possibilité qu’ils offrent d’échapper à son environnement domestique, ne serait-ce que pour une nuit, pour s’entourer d’une réalité différente. »

Coil +Drift, « miroir » June, 2016.
Photo : Sean Davidson
MULLER VAN SEVEREN
Dès le premier regard, la pureté des lignes se dégage des créations du duo Muller Van Severen. Pour Petit H, le projet d’Hermes visant à donner une seconde vie aux matériaux non utilisés, ils ont mis au point « Waves of leather » : des bandes de cuir bicolore sont disposées sur des patères et forment des étagères souples, successions de lignes horizontaleset de vagues, telles des calligra-phies en volume. On retrouve cette même utilisation du cuir dans leur série de fauteuils. Les formes sont réduites à l’essentiel : les structures sont matérialisées par les arêtes de parallélépipèdes qui accueillent les lés de tissus et autres peaux qui forment les dossiers. Les lignes perpendiculaires dialoguent avec les courbes tandis que les couleurs assurent les contrastes. Cette idée de discussion et de complémentaritéest inhérente au fonctionnement du couple.

Muller Van Severen, « wire s # », 2016.
Tous deux artistes — Fien Muller est photographe, Hannes Van Severen est sculpteur —, ils confrontent leur point de vue pour aboutir à des créations souvent hybrides. Les fauteuils se dédoublent tête-bêche pour devenir un module à partager à deux, les structures se prolongent en tablette ou luminaire, les étagères deviennent des tables… Plus récemment, Muller Van Severen a mis au point des éléments de mobilier à l’esthétique plus radicale. Les pièces de la série « wire s # » se résument à des volumes réalisés en grillage. Les formes sont archétypales et troublent par le sentiment d’immatérialité qu’elles dégagent. Bien présentes et pourtant laissant apparaîtrele décor environnant, elles semblent virtuelles. Un sentiment renforcé par les prouesses techniques qui voient certains de ces blocs se bomber pour devenir des méridiennes. Là aussi, les variations les transforment en mobilier hybride, décuplant leur aura sculpturale. À propos de son souhait professionnel pour l’avenir, le duo aimerait voir sa production distribuée à une autre échelle : « Nous aimerions créer une série spéciale pour une grande compagnie de design comme Vitra ou Flos ».
Texte de Muriel Stevenson
Notes sur l’ambiance
Pierre Paulin
À ne pas confondre avec son ainé et homonyme, Pierre Paulin est un artiste dont la pratique se partage entre œuvres visuelles et écrits. Son texte Notes sur l’ambiance analyse la notion de nostalgie à travers le prisme de la musique et de la mode.
Point de fuite
Il y a des vestiges enfouis qui peuvent à tout moment réveiller une passion : un goût étonnant pas encore labellisé, une idée assez floue pour être réinvestie, un groupe de Cold Wave oublié dont le temps a poli la singularité et délavé les ressemblances. L’enthousiasme pour les restes de culture accompagne le changement technologique de notre siècle, comme si la circulation des documents sur le web avait impulsé une fouille généralisée des productions enregistrées. En même temps, il est possible que cet engouement, étrange et invasif, soit juste une couverture pour recycler l’ambivalente mélasse de la culture pop de ces cinq dernières décennies. Derrière chaque élan se cachent une exaltation et un doute. Ici, un balancement compulsif entre excitation et écœurement, qui semble creuser la pente du début de l’ère de l’Internet, et emporter l’art dans une glissade commémorative donnant l’impression de ne plus savoir vraiment ce qui est célébré, ni pourquoi.
La mode aussi fouille son histoire pour alimenter son inclination pour l’exotisme et la fraîcheur. D’ailleurs, les pratiques artistiques actuelles partagent avec elle la même frénésie permanente et divinatoire.
Il ne s’agit plus de produire un présent, mais d’anticiper un futur où chaque proposition relègue la précédente à un présent désuet. Les dressings sont les lacs de cette mélancolie. Au XVIIIe siècle, la mode, comme l’ornement en architecture, avait pour fonction de distinguer les classes sociales et le pouvoir. Aujourd’hui, la mode puise aussi bien dans les tendances populaires que dans son histoire fantaisiste ; l’objectif n’étant plus d’asseoir un style vestimentaire pour redessiner les frontières du territoire conquis par la bourgeoisie, mais de détrôner le dernier coup d’éclat d’une collection ayant fait sensation. L’intensification du rythme des saisons, de deux à six pour certaines marques de haute couture, est la trace de cette dynamique conduisant le cycle de l’obsolescence. Il est possible que nous traversions une période d’un romantisme maniaque, les objets exhumés n’invitant plus à méditer sur la disparition des mondes d’autrefois, mais sur l’obsolescence produite par l’accélération des cycles de la culture excavant et recombinant monde après monde. Cet emportement du rythme laisse entrevoir la primauté symbolique du délire temporel sur celui d’une géographie réduite aux tristes mouvements des frontières. Peut-être que la fouille massive, entraînée par la diffusion sur le web, dessine le territoire d’une nouvelle colonie, à cheval sur l’histoire et la ruine de celle-ci.
Bon, l’important c’est que l’on ait avancé…
Ce gimmick de langage sonne comme un mantra destiné à calmer l’anxiété de celui ou celle qui le prononce. Il y a bien une angoisse commune à tous et à toutes les époques : celle de perdre le sens de ce qui est entrepris. Se prémunir contre la désorientation est une manière de conjurer un trop tard, aussi bien celui qui marque l’échec d’une course, que celui qui pleure une époque révolue… Je suis né trop tard… Que ce soit la fouille du passé ou l’accélération du cycle de l’obsolescence, l’accord inachevé de ces deux postures, dans le champ de la culture, témoigne certainement de la fuite du présent lui-même. Peut-être que l’excitation combinée à la confusion générale entraîne une oscillation lascive produisant une ambiance rassurante. Un présent comme un parfum des temps passés, comme le sifflement sourd d’un appareil en veille, comme l’excitation coupable que l’on ressent lorsque l’on théorise les effets néfastes des évolutions industrielles en ayant aussi le désir intime de participer à la frénésie que celles-ci génèrent.
Ambiance rassurante
L’idée d’ambiance rassurante pourrait très bien caractériser l’intensification des appropriations d’images et de textes au sein des pratiques artistiques actuelles. On pourrait imaginer la circulation et la rediffusion de documents, d’origines et d’âges divers, comme la retombée de poussière de ruines suivant l’explosion numérique, et la frénésie adolescente induite par l’interactivité du web comme le souffle de la déflagration ; une sorte de futurisme nostalgique laissant dans son sillage un sentiment de déjà-vu. Il y a dans la combinaison de mots « futurisme nostalgique » autant d’excitation que de confusion, l’une stabilisant l’autre — c’est une charmante manière de cacher le flou par une affirmation, comme les paroles d’une chanson pop semblent cristalliser une effusion sentimentale et générationnelle en quelques mots.
Souvent, lorsque quelque chose nous échappe, on a plutôt tendance à désigner un point de fuite comme si l’on pouvait colmater une brèche de l’index. L’impressionnante litanie qui jalonne l’histoire de l’art moderne, en bégayant une suite de « ismes », évoque une régularité dans ce principe d’indexation. Cette étrange kyrielle reflète l’exercice d’une histoire de l’art à l’allure journalistique, qui aurait distingué les propositions artistiques au fur et à mesure de leurs tentatives. Peut-être que cette constellation de fuites dessine déjà les contours d’un monde paradoxal émergeant à la fois de mécanismes industriels et du désir de s’y confronter. D’un côté, il y a la nature invariable de la compulsion d’indexation qui a rythmé la marche incoercible de l’évolution, et de l’autre, il y a l’extraordinaire diversité des propositions artistiques qui ont cessé de surprendre et de dépasser la dernière tentative dans un jeu amoureux. Il semblerait qu’il y ait dans le mouvement trébuchant des avant-gardes modernes autant de délivrance que d’aliénation.
D’ailleurs, on pourrait se demander dans quelle mesure les sites d’actualités artistiques en ligne ne sont pas à la fois une célébration d’une critique produite parallèlement à l’art, et la ruine de la proximité entre l’artiste et l’historien. L’intensification de l’indexation numérique semble réduire le temps dédié autrefois à l’interprétation, au profit du rapport immédiat au flux de l’actualité — il faut dire qu’une longue liste d’expositions, ou d’images, a quelque chose d’incroyablement plus rassurant qu’un discours. Mais attention, lorsqu’une invention industrielle trouve une application culturelle, plane toujours le sentiment que s’organise, dans l’ombre, le suicide arrangé de la subjectivité. Au danger de faire une hypothèse et d’imputer au web la responsabilité d’une fuite en avant définitive s’ajoute l’habituelle suspicion pointant d’un index réprobateur tout ce qui ressemble à une surface. Il est quand même curieux que ce qui habille un contenu doive toujours essuyer les postillons du débat opposant la surface au contenu ; ici les tabloïdes qui servent d’interface pour les images de l’actualité artistique. Pourtant, l’interface du web n’est pas une surface ; en réalité elle ne fait que hiérarchiser la visibilité et donner la priorité à la logique de la connexion. L’interface relègue les images et les textes à une condition d’éléments de seconde zone, de paysages à volonté, donnant ainsi le sentiment que la réception du contenu semble davantage liée à la plateforme qui le diffuse, plutôt qu’à la personne qui en est l’auteur.
Il existe un dilemme similaire lorsque l’on souhaite décrire quelqu’un en s’appuyant sur son style vestimentaire. Parfois, il semble clair qu’une combinaison de vêtements figure un ensemble de choix singuliers. Mais il suffit de croiser une personne dans la rue avec une paire de baskets similaire à la nôtre pour que cette confrontation trahisse notre première conviction et réduise l’ensemble des choix que l’on pensait authentiques à de simples particularités. C’est la triste ritournelle à laquelle nous lie la répétition inhérente à la communication numérique et à la production d’objets industriels. Alors, lorsque l’image de soi se trouve continuellement fragilisée par le ravalement de l’authenticité de nos choix, il reste encore la possibilité d’une parade discursive, dont nous sommes aussi les seuls exégètes.
Tu te rappelles de l’arrivée des Reebok Pump au collège ?
Je m’en suis payé une paire! Enfin, une sorte d’ellipse un peu étriquée qui influe sur la manière de considérer un objet, un vêtement, une idée en vogue ; proposant ainsi une résistance aux effets de la production sérielle et générique, par le biais d’un sentimentalisme fadement discursif.
En tout cas, la relecture plate et sentimentale de l’actualité en ligne semble être le moteur qui génère la frivolité adolescente émergeant sur le web. Dans ce sens, les réseaux sociaux proposent une configuration personnelle du flux d’information. Et les pratiques artistiques influencées par le modèle du web corroborent cette logique interactive en raccordant un discours sentimental aux assemblages de documents hétéroclites mêlant snapshots, poèmes érotiques trouvés sur un blog, histoire du New Age, analogies à des maladies diverses : dépression, schizophrénie… C’est là toute l’ingénuité de ces combinaisons, elles sont suffisamment imprécises pour construire une présence à la manière d’un look — en référence à l’assemblage de créations portées par un mannequin lors d’un défilé — ou comme une suite de hits qui tournent en boucle dans les halles d’une grande surface pour habiller, ou couvrir, le caractère angoissant de ce type d’architecture. Cette excitation environnementale infuse de partout. Cependant, il me semble qu’il se cache derrière ce voile d’ambiance la seule idée qui ne repose pas sur une digression ou sur une spéculation de ma part. Le modèle du web, malgré sa candeur et sa frénésie interactive, est contraint aux modalités de l’enregistrement, dans le sens où le web diffuse uniquement un temps révolu, passé, achevé même si ce n’est que de quelques millisecondes. L’actualité en ligne produit sans conteste une ambiance vivifiante et anxiolytique, mais avec un arrière-goût diffus d’après-coup. Une sorte de présent juste un peu trop tard, comme si la nostalgie n’était plus seulement le hobby des sceptiques, mais aussi la condition, à peine perceptible, de la communication empruntant les techniques de l’enregistre-ment.
Nostalgie de l’instant
Voici l’une des pentes d’aujourd’hui : ne jamais vraiment ressentir d’adéquation avec le présent de notre monde. Sentiment rimbaldien d’un nous ne sommes pas au monde, comme si l’on était continuellement éclipsé du présent par l’actualité. Même si l’actualité produit un fort sentiment de présent, il n’empêche que son flux est diffusé en différé. Moins le décalage est visible, plus il est pernicieux, car si infime qu’il se dérobe lorsque l’on cherche à s’y confronter. On le subit sans le voir, tout semble accessible sauf la mesure qui permettrait de s’en saisir. Cette latence invasive se diffuse comme un parfum. Il est impossible de refuser sa présence. C’est le coût symbolique pour accéder aux joies de l’enregistrement.
D’ailleurs, c’est le même deal que le voyeur passe avec la pornographie en ligne, il voit tout instantanément, mais l’effet de ce présent est simulé par l’accessibilité. Les plans, les positions des acteurs, les corps et les sexes rasés, tout est mis en scène pour faciliter la pénétration du regard, pourtant le présent du voyeur ne peut pas s’ajuster à la nature révolue de l’enregistrement. C’est le caractère déprimant de la pornographie en ligne ; la perversité du voyeurisme ne peut s’émanciper de la perversion du média qui la rend possible, et pèse sur le voyeur, le déprimant sous le poids mort, enfin révolu, de l’enregistrement.
Mais même aux prises avec une nostalgie générique, il existe toujours un moyen de déstabiliser son influence anesthésiante. Au début des années 2010 apparaît une vague musicale principalement accessible sur le web, baptisée Vaporwave. De jeunes musiciens amateurs se sont mis à produire et diffuser une musique reposant principalement sur l’assemblage de samples de morceaux commerciaux glanés sur YouTube. Si les sources sont diverses, la Vaporwave profile une relecture de la production musicale industrielle des quatre dernières décennies. Les samples isolés sont ralentis, détunés, triturés, à l’aide des outils offerts par les logiciels d’édition musicale. Le sampling est ici poussé jusqu’à un écœurement jubilatoire reposant sur l’intensification du pathos des morceaux détournés. Plus étrangement émotionnelle que les pratiques de DJs éclairés, qui garantissent une réécriture savante de l’histoire de la musique, la Vaporwave fouille les hits produits à la chaîne, dans une interprétation vaporeuse et lascive qui semble relever en douceur le caractère grotesque de la pop industrielle. Il faut imaginer des lignes de synthé New Age trouvées dans les presets de l’ordinateur, mélangées à des samples de chansons mainstream, mal calés et ralentis, le tout disloqué par une reverb et un delay caricatural.
Cette vaporisation des sources produit un son pleurant et ondulant. D’abord, l’hétérogénéité entre le présent et les fragments d’enregistrements nous étreint : synthétiseur rétro, flûte et cuivre synthétiques, voix excavées d’enregistrements… Puis, curieusement, nous encourage à renouveler le contact dans un grand écart pathétique, à la manière d’une agrafe rapiéçant les tissus temporels qui naturellement se déchirent. La répétition d’un enregistrement cicatrise le présent, en révoquant pour un temps la nature éphémère de celui-ci. C’est précisément ce qui est fascinant lorsqu’un sample est conduit en boucle, il se rafraîchit constamment du souvenir de lui-même, à la manière d’un logo qui s’impose à la mémoire par une surimpression continue.
Si cette nostalgie savamment agencée produit une ivresse, son interruption menace aussi de dévoiler un paysage bien tragique, un présent nu laissant entrevoir la trivialité de l’engrenage répétitif. À chaque ivresse sa gueule de bois… Néanmoins, l’intensité de l’impression ne rend que plus précieuse cette expérience, car il est possible de la brandir sans trembler, de la porter comme lorsque l’on s’habille d’une paire de lunettes aux verres teintés, pour avoir le sentiment d’habiter un autre monde ou une autre époque.
Nostalgie de l’obscurité
Un poème pour décorer une journée, un fredonnement pour changer la couleur de l’air, enfin quelque chose qui ne soit pas enregistré…
L’esquisse de cette radicalité est une suave ritournelle annonçant aussi sa trahison prochaine. Aujourd’hui, retrouver l’élégance espiègle et candide du début du XXe siècle signifie aussi s’extirper du corps social modélisé par l’évolution des médias. Et puis, l’industrie culturelle a produit la majorité des enregistrements sur lesquels sont indexées nos vies intérieures : une chanson sur laquelle nous avons éprouvé du désir pour quelqu’un, la série télévisée de notre adolescence fixant l’ambiance d’une époque, un morceau d’Eurodance fédérant sur la piste de danse des trentenaires, l’actrice ou l’acteur d’un film dont nous sommes tombés amoureux. Enfin l’industrie a produit les marqueurs qui permettent à chacun de se situer dans une généalogie culturelle. Et cette situation est probablement ce qui nous confronte à la difficulté d’entreprendre une lecture critique de la culture mainstream, car les sources de nos souvenirs intimes sont en proie à une mise en doute légitime. D’un côté, la culture de masse fonctionne à la manière d’un dispositif qui permet de communiquer et de nous localiser dans le temps. De l’autre, elle réduit l’expérience de la culture à de simples particularités, qui semblent restreindre notre histoire personnelle à un index ou à un catalogue de chansons, de films, enfin, de productions industrielles. Curieusement, les gestes de résistance capables de préserver notre subjectivité de cette promiscuité avec l’industrie semblent de même nature que ceux que l’on peut appliquer à notre corps : l’altération et le travestissement. Devant le miroir de la culture de masse, qui renvoie une image de soi indexée à son histoire, il est possible de grimer ses intentions en les formulant à l’envers. L’objectif de cette manipulation est de produire des gestes dans le bon sens pour soi-même en inversant la symbolique du reflet. Ce maquillage se traduit par une attitude paradoxale où feindre de ne pas travailler demande de travailler encore plus. C’est ne pas être critique pour engendrer la critique. C’est écrire un texte en évitant les oppositions, en évitant de cibler un problème. Et cette situation est probablement ce qui nous confronte à la difficulté d’entreprendre une lecture critique de la culture mainstream, car les sources de nos souvenirs intimes sont en proie à une mise en doute légitime. C’est ressentir de l’excitation à disparaître sachant que la culture de masse produit d’elle-même, et à ses dépens, l’illustration d’une mélancolie actuelle. C’est une posture habillée de contradictions : une indécision cosmétique, qui lorsqu’elle est formulée, ne conduit pas l’auteur, mais son masque, à obtempérer.
La Vaporwave produit ainsi une vapeur pastiche laissant les voix samplées relever le caractère mélancolique et pathogène de l’évolution culturelle dans une joie sans illusions. Mais, l’obsolescence cyclique sur laquelle repose l’industrie musicale ne peut pas être enrayée par des vapeurs ni ralentie par un logiciel de musique. C’est le destin tragique du masque qui devient à son tour le visage de l’échec qu’il recouvre. Voilà pourquoi cette musique, exorcisant une mélancolie actuelle, semble aussi pouvoir être la bande originale d’un trébuchement plus général. C’est peut-être cela, le post-modernisme. Ce n’est pas une période, c’est l’histoire qui chute continuellement, où chaque tentative impulsée par une mise en crise est avortée, déjà révolue, déjà « post » avant d’avoir pu prendre une forme originale. C’est l’histoire et la forme qui ne se rencontrent plus. C’est l’histoire qui se formalise uniquement suivant les modalités de l’industrie. C’est un morceau de Vaporwave mettant en crise la surproduction industrielle, qui se retrouve finalement diffusé sur YouTube suivant la nouvelle forme de l’industrie numérique.
Mais quitte à ravaler indéfiniment l’espoir de nouvelles perspectives, un bon morceau de Vaporwave a suffisamment de délicatesse pour faire passer le goût de l’échec dans un cocktail de sensations.
Aujourd’hui, les pratiques artistiques ne semblent plus vouloir, pouvoir, aimer, fournir de nouvelles formes, mais des sensations en agglomérant des formes disponibles. Un collage de formes déjà vues, comme un événement qui nous surprend et nous pousse hors du présent. C’est une soirée qui suspend le temps par la dépense de celui-ci; une célébration de la ruine qui produit une actualité vibrante. Alors, quelque chose rôde et entraîne la curieuse impression de c’est dans l’air… garantissant de pouvoir partager l’expérience de l’art avec d’autres, mais nous contraignant à être toujours au fait du rafraîchissement de l’actualité artistique. Mais faut-il être au parfum au risque de ne plus rien sentir d’autre ? Est-il possible de jouir de l’obscurité ? Enfin, de ne pas être poussé à tout voir et connaître ?
Voici l’interrogation qui désarme toute velléité critique. Un désir d’obscurité contient sans doute une nostalgie pour les sociétés prémodernes, où le savoir se construisait de manière empirique, un avant les sciences, un avant l’idéologie des Lumières, un avant le développement industriel. C’est là un cercle vicieux : mettre en cause les effets délétères de l’industrie revient à faire état des bouleversements dus à son évolution, à sonder l’étendue de notre nostalgie. Un peu comme lorsque l’on quitte une soirée en ayant le sentiment d’avoir participé à un rite social d’une profonde vacuité, et que la seule satisfaction que l’on en retire est d’avoir, une nouvelle fois, pu mesurer à quel point ce sentiment (de ruines) peut être justifié.
Parfums
Souvent, en quittant une exposition, il reste une sensation à la fois floue et étrangement rassurante. Il y a quelque chose comme une douce menace électrisante, dont les vapeurs d’interrogations diffuses accompagnent malgré tout la renaissance d’un sentiment apaisant. Il faut dire que l’activité ardente des musées et des galeries a le pouvoir de solidifier et de présenter, comme continuité ou perspective,l’ambiance qui rôde sans que l’on puisse vraiment la nommer. Aujourd’hui, dans une exposition, un objet ou un événement est inévitablement relié à un discours. Généralement, celui-ci garantit à la fois sa nature orbitale à l’art et son attachement à une période historique : sortes de coordonnées en longitude et en latitude permettant de visualiser l’environnement culturel dans lequel on se doit d’accueillir l’expérience. Ce gimmick de médiation semble fondu dans une logique interactive infantilisante. Il schématise de façon excessive le protocole en le rapportant à une logique de communication. C’est la ruine de la syntaxe conceptuelle des années 70 restaurée à la manière d’une vieille église, c’est-à-dire sans ses couleurs originelles. Un peu comme lorsque l’on se retrouve nu dans son appartement, et que de sentir son corps libre nous donne la sensation à la fois excitante et téléphonée de célébrer un cliché culturel des années 60. Enfin, c’est l’aspect défigurant de la conservation, une sorte de nivellement qui indexe de manière systématique une œuvre à une origine didactique, détruisant du même coup la singularité et l’érotisme de la proposition.
C’est peut-être pour pousser cette logique interactive jusqu’à l’écœurement que la présence d’objets dans une exposition semble aujourd’hui servir une autre perspective que l’élégance du déploiement d’une idée : une élégance vaporeuse. Alors quelque chose plane dans les expositions sans que l’on puisse trancher sur son origine ou sa composition, comme un parfum à chaque fois différent. Ainsi, les idées et les formes sont de petits points brillants dans un paysage flouté par l’ivresse de l’urgence. Mais comment ne pas être attiré par cette cosmologie éthérée ? Et même s’il existe un risque — celui de perdre le sens de lecture de l’histoire, ou de sombrer dans une profonde mélancolie emportée par une profusion d’accords nostalgiques… — et même si le premier contact est toujours un peu décevant, voire obscur, il ne faut pas avoir peur de persévérer. Les stimuli cachés dans les plis des œuvres sont capables de restaurer l’emphase musquée de l’âge du plâtre et de la peinture ; ou la note de tête d’un protocole prolongeant la fragrance vers une dérive poétique ; ou une rhétorique d’appropriation accordée à l’expression libre laissant dans son sillage encore un doute au sujet de l’auteur.
Toutes ces fragrances, relatives à des accents de notre histoire culturelle composent un langage fiévreux reposant nonchalamment sur l’élégance des accords. Et, si l’idée de parfum semble masquer la ruine du langage traditionnel de l’art derrière une nostalgie générique, il ne faut pas oublier que chaque évolution délivre aussi le synopsis d’une tragédie.
C’est sans importance…
Le parfum semble déjà partout. Il n’y a qu’à être attentif à la manière dont il nous arrive de décrire le travail d’un artiste lors d’une discussion à la volée. Afin de ne pas couper le flux de l’échange ou pour le relancer, il est difficile de ne pas utiliser de qualificatifs relatifs au cheminement artistique et culturel du XXe siècle, allant jusqu’à employer certains néologismes pour aller plus vite, compressant de façon barbare les détails qu’un historien passe plusieurs années à distinguer. Mais un parfum n’est ni une réponse ni une solution, c’est un langage en formation brassant le déjà-vu, le déjà entendu. C’est l’oscillation entre une renaissance et une disparition annoncée, c’est le sillage odorant laissé par le déplacement d’un corps qui restaure, pour un temps, la présence d’une personne déjà loin. Un parfum est à la fois une sensation et une aliénation, une délivrance et une contrainte, une libération et un repli, la frivolité et la ruine. C’est un espoir emporté par la vitesse du défilement des propositions culturelles.
C’est la présence synthétique et rassurante d’un langage qui continue malgré tout de se reformuler. Puis, il ne faut pas oublier qu’un parfum est capable d’habiller la nudité et de combler le vide. Les magasins de mode l’utilisent bien pour estampiller une identité, comme si cette permanence invisible contrastait malgré tout avec la violence du turn-over des saisons et des tendances.
Un changement singulier avait eu lieu dans l’atmosphère ; de vagues teintes roses se mêlaient, par dégradations violettes, aux lueurs azurées de la lune ; le ciel s’éclaircissait sur les bords ; on eût dit que le jour allait apparaître…
Pourquoi cette phrase charnière d’un récit décrivant le passage d’un monde à un autre, d’une époque à une autre, semble-t-elle aussi douter de l’événement qu’elle annonce ? Au matin, un paysage émergeant de l’obscurité est toujours coloré des rêves et des cauchemars de la nuit.
Y a-t-il plus déprimant que de réfléchir à la prochaine paire de baskets que nous voudrions acheter ?
Peut-être d’y réfléchir avec un tiers.
Un effet collatéral du rafraîchissement continu de l’industrie culturelle :
le sentiment, un peu honteux, d’avoir aimé.
Quelquefois, il est plus facile de convaincre avec les mots de quelqu’un d’absent, car son évocation induit une présence évasive au discours.
Un poème glissé au cours d’une phrase est un peu comme un article de mode : il ne paraît pas vraiment ostentatoire lorsqu’il est porté avec assurance.
Le danger ne vient pas véritablement du romantisme, mais de l’aspect historique associé à un tel sentiment. Mais on peut toujours l’utiliser comme un accessoire !
J’imagine qu’il vaut mieux ne pas complètement ravaler nos goûts passés…
leur validité peut à tout moment redevenir actuelle.
La tendance est un peu comme une suite de hits qui tourne en boucle dans une galerie marchande, elle est rassurante.
Certaines personnes choisissent un sac plastique estampillé d’une grande marque pour transporter quelque chose d’un endroit à un autre. Peut-être qu’un logo peut couvrir le sentiment d’un présent en fuite.
Être nu dans son appartement peut produire la sensation de vivre une célébration des années 60.
Deux vases
Marc-Camille Chaimowicz
Deux vases,
Le premier, le Vase Tulipe, est le plus grand mais, fait de plâtre habillé de
papier, il ne pouvait pas,
matériellement, servir de vase…
c’est un simple accessoire…
sa fonction est décorative…
et cette mascarade est accentuée par son rôle :
recueillir un bouquet d’images de fleurs…
Le second, le Vase Rose,
peut légitimement exister,
mais il est fourbe, il œuvre,
vase et accessoire d’un petit scénario…
dans lequel il tient le rôle principal
sur une photographie qui sera plus tard éditée…
Chaque vase aspire à une certaine autonomie…
ils semblent pourtant avoir vécu un événement qui les mène à se rendre volontairement
complices d’une histoire plus vaste,
… toutefois, le Vase Rose bénéficie du potentiel de redevenir simplement un vase…


Série photographique de Lise Queïnnec, invitée par Marc Camille Chaimowicz pour l’exposition One to One… Ketsner Gesellschaft, Hanovre, Allemagne 29 septembre 2017 — 7 janvier 2018.
Sandwiches de réalité
Tom Burr
Le travail de Tom Burr a été associé à la création in situ, à la critique institutionnelle et contextuelle et à l’exploration de la subjectivité homosexuelle et de l’espace. Qu’elles prennent la forme d’installations architecturales et spatiales, de sculptures, de photographies ou de collages, l’artiste américain a largement exposé ses œuvres depuis le début des années 90. Ses investigations conceptuelles interrogent la manière dont l’identité se construit ou existe, contrainte par la société et ses espaces matériels. Hamid Amini s’entretient avec lui de ses sujets d’étude récurrents, de la politique du genre à la sociologie.
Hamid Amini On vous définit souvent comme un artiste conceptuel, je me demande quelle direction prend le conceptualisme aujourd’hui ? Y a-t-il des artistes conceptuels actuels qui vous inspirent ?
Tom Burr La plupart du temps, le terme d’artiste conceptuel semble être une catégorie par défaut, un compartiment dans lequel on range l’art ou les artistes quand on ne peut pas les classer dans la famille « peintre » ou « sculpteur », peut-être sans lien très net avec l’histoire du terme. Ceci dit, j’adhère au mot « concept ». C’est intéressant, d’avoir un élan, un terme, qui réponde au poids, à la densité et au volume d’un grand nombre de réalisations artistiques, y compris les miennes. Et de placer en tête d’affiche les idées, ou la création artistique comme circulation d’idées, qu’on peut ou non révéler dans les objets physiques. Je pense que nous avons besoin de cette exigence. Et il y a de nombreux artistes actuels qui m’inspirent, que vous pourriez classer dans cette catégorie, (s’il vous fallait le faire). Adrian Piper me vient en premier à l’esprit, parce que son travail a toujours puisé dans la tradition spécifique de l’art conceptuel tout en l’enrichissant, elle l’a utilisé mais aussi transformé en une manière de concevoir et de pratiquer la création artistique comme une réflexion sur la nature de l’art et sur le rôle de la nature de l’art et de l’artiste qui évolue dans le cadre de la politique du monde réel et des associations. C’est une pratique qui réfute toute appréhension solipsiste de l’art conceptuel. Je dois aussi beaucoup à Yvonne Rainer et j’ai récemment étudié la place conceptuelle du corps dans l’œuvre de Maria Hassabi et Park McArthur, entre autres… dans laquelle la conceptualisation des corps, et de la différence, entre en contact direct avec les réalités et les contraintes matérielles. Je suis rarement inspiré par des œuvres qui ressemblent aux miennes en surface.
Hamid Amini Vous avez une relation particulière au béton, pourriez-vous m’en dire un peu plus à ce sujet ? Pourquoi aimez-vous autant ce matériau ?
Tom Burr J’ai écrit un court texte à ce propos, dans lequel j’évoquais la réalité physique du béton en tant que matériau sensuel, voire sexualisé. J’ai grandi dans une maison dont les murs enduits de crépi brossé étaient impossibles à distinguer du béton, du moins dans mon esprit d’enfant. Ce n’était pas une maison moderniste, mais j’en trouvais la reproduction dans les nombreuses surfaces des bâtiments modernes et brutalistes, et ils sont nombreux dans la ville où je suis né, et j’ai été instinctivement attiré vers eux. J’ai développé une fascination pour le béton, en tant que matériau de construction, que matériau — à l’image du contreplaqué auquel il est étroitement associé — humble et pratique, et relativement ancien, bien qu’il ait gagné une place centrale nouvelle au XXe siècle. Il est devenu visible dans l’architecture moderniste, après Le Corbusier, et d’autres. Il pouvait devenir une surface qui n’avait pas besoin d’être recouverte avec un autre matériau, qui méritait d’être exposée. Comme une sorte de strip-tease architectural, d’effeuillage. Et le mot m’intéresse. Il devient un absolu, et se substitue à celui plus fixe, plus concret, de condition physique factuelle : la réalité matérielle, par exemple
Hamid Amini Je sais que vous êtes né à New Haven. Pouvez-vous nous parler un peu de votre récent travail là-bas dans l’usine Pirelli de Marcel Breuer.

Tom Burr, Dressage, 2013, Bortolami, New York, vue d’installation.
Avec l’aimable autorisation de l’artiste et de la galerie Bortolami, New York.

Tom Burr, Extrospective: Works 1994 — 2006, 2006. Vue d’installation, Musée cantonal des Beaux-Arts, Lausanne.
Avec l’aimable autorisation de l’artiste et du Musée cantonal des Beaux-Arts, Lausanne.

Tom Burr, endlessly repeated gesture, 2009. Bois, crochets métalliques et boulons, moquette, carreaux de miroir, 168.9 × 243.8 × 243.8 cm.
Avec l’aimable autorisation de l’artiste et de la galerie Bortolami, New York.
Tom Burr Oui. Là encore, c’est lié à la question du béton, n’est-ce pas ? Au fait que j’ai grandi à New Haven et que j’ai été conditionné par cette ville. Il y a un an et demi j’ai eu l’occasion grâce à Bortolami, la galerie avec laquelle je travaille à New York, de réaliser un projet d’un an dans une ville. J’ai choisi New Haven pour ce projet après avoir réfléchi longtemps à ce que serait un site intéressant pour moi… New Haven était apparu dans mon travail avant, et dans mes écrits, et j’avais l’impression que c’était vraiment le bon moment de revisiter ce lien et de le développer considérablement. Nous avons envisagé plusieurs lieux pour le projet. Je gardais toujours à l’esprit ce bâtiment brutaliste en béton de Breuer sans jamais penser que ce serait possible. Mais ça l’a été. IKEA, le propriétaire actuel du bâtiment, laissé à l’abandon pendant quinze ans a accepté de nous louer le rez-de-chaussée pendant un an. Presqu’aussitôt, des inspecteurs de la sécurité des bâtiments de New Haven sont venus et ont exigé de nombreuses modifications de l’espace pour permettre l’ouverture au public. J’ai décidé de me servir des interventions exigées comme substance pour mon travail, en concevant les rampes nécessaires conformément au code, tout en les imprégnant d’autres significations, d’autres références qui reliaient le site du bâtiment et sa période de construction à l’époque actuelle. J’ai entremêlé dans l’installation plusieurs silhouettes susceptibles de démêler ces liens en créant des occurrences de simultanéité et de réalité qui se chevauchent. Jean Genet a été une figure centrale, ancré historiquement à New Haven par sa visite en 1970 — l’année de la fin de la construction du bâtiment — pour donner un discours de soutien aux Black Panther. Anni Albers, qui a vécu et travaillé dans les environs est présente elle aussi, à cause de ce lien à New Haven mais aussi parce qu’elle a participé au Bauhaus en même temps que Breuer, bien qu’avec un accès très limité au programme d’étude puisque c’était une femme. Et il y a aussi d’autres figures, qui fonctionnent toutes comme une sorte de constellation transhistorique proposant la notion de bâtiment comme témoin de contextes sociaux, esthétiques et politiques à la fois à l’époque de sa construction et aujourd’hui. Mais le projet a été baptisé Body/Building et a été conçu pour envisager le bâtiment de Breuer en tant que corps, qu’entité : une chose qu’on a rêvée, dessinée, moulée et érigée, utilisée un moment, abandonnée, en partie détruite, réparée, etc. tout une série d’états. Et je voulais aussi m’inscrire dans le processus, et dans le projet lui-même, mon corps et les coordonnées de ma biographie vus comme bâtiment, comme une construction eux aussi.
Hamid Amini Au-delà des histoires que vous racontez à travers vos œuvres, êtes-vous un bon conteur dans la vie de tous les jours ?
Tom Burr J’en doute. J’admire les gens qui le sont. Je perds le fil de ma pensée. C’est plus facile quand j’ai bu un verre, je m’ouvre davantage et je peux me lancer dans des récits.
Hamid Amini Vous considérez-vous comme un artiste américain ? Quel effet les événements de 2017 ont-ils eu sur votre pratique ?
Tom Burr Oui, je me considère comme un artiste américain. C’est à la fois un fait parce que je suis né aux États-Unis et que j’ai choisi d’y vivre et d’y travailler, et je crois que c’est aussi une attitude politique. J’ai souvent considéré que mon travail était engagé dans la scène américaine, s’intéressait au problème américain, et s’il a d’abord été reçu plus vigoureusement dans des contextes européens, c’est peut-être en fait à cause de son contexte américain. Je ne sais pas. Les réticences préalables de la culture américaine, le paradoxe qui entoure le divertissement, la violence, la sexualité et l’exposition, tout cela pèse sur moi et m’a servi de cadre, moi et ce que je fais. J’ai aussi puisé dans l’héritage largement — bien que pas exclusivement — de l’art américain, depuis les minimalistes. Je me demande si cette image de moi-même et cette auto-désignation se modifieraient si je quittais les États-Unis. J’ai le sentiment que je serais toujours un artiste américain, mais qui vivrait ailleurs. Et bien que le changement de gouvernement de 2017 ait d’une certaine manière tout bouleversé, de façon terrible, je ne peux pas dire que ma pratique s’en soit trouvée modifiée. Beaucoup des atrocités, des stupidités et des injustices auxquelles nous sommes confrontés sont là depuis le début, camouflées à des degrés plus ou moins importants, certaines radicalement diminuées pendant le mandat d’Obama, d’autres non. Mais c’est la raison pour laquelle je suis attiré par ce qu’on a nommé « pratique critique » — je suis toujours convaincu que c’est le profond questionnement systémique qui rend l’art pertinent. Et cela peut prendre de nombreuses formes, les créations n’ont pas besoin d’avoir un aspect particulier ou de coller à certaines stratégies visuelles plutôt qu’à d’autres. Il peut exister sous des myriades de formes. C’est le questionnement et la remise en cause qui sont essentiels.
Hamid Amini Je me souviens que vous avez réalisé une série de découpages de barbes. Celle d’Allen Ginsberg, de Karl Marx et d’autres hommes… Pourquoi la barbe ? Diriez-vous que les thèmes de vos œuvres sont parfois queer ?
Tom Burr Ces œuvres sont baptisées Beard Boards. Ce sont des images qui viennent de partout, vraiment, de visages barbus, dont une grande partie est supprimée, seules les barbes et des morceaux de visages subsistent. Elles sont ensuite montées sur du contreplaqué, dont la texture fournit des motifs prononcés, presque psychédéliques. J’ai voulu que ce soit une sélection démocratique, certains sont des visages célèbres, d’autres non, mais dans tous les cas ce sont des visages vers lesquels j’ai été attiré ou que j’ai trouvé beaux pour un certain nombre de raisons : pertinence historique, lien avec moi, coup de cœur. J’ai puisé dans la mode croissante à l’époque — et devenue mainstream aujourd’hui — de la culture de la barbe qui s’est étendue au-delà des catégories historiques de l’homme barbu. Je les vois comme queer, oui, mais pas juste à cause de la raison la plus évidente, que les barbes sont un fétiche de la communauté gay. Je voulais réfléchir au concept de « naturalisme » — c’est là que le contreplaqué fonctionne si bien, avec ses torsades et ses nœuds, à la fois organiques et manufacturés — et au désir d’exprimer, physiquement, une idée de… masculinité ?

Tom Burr, extrait de Brutalist Bulletin Board, 2001. Bois, photographies, images, punaises, 300 × 45 cm.
Avec l’aimable autorisation de l’artiste et de la galerie Bortolami, New York.

Tom Burr, Fifteen Minutes with You, 2013. Chaises d’écolier en bois et métal, chemise d’homme, boulons, punaises sur planche de contreplaqué, 183 × 120 × 14 cm.
Avec l’aimable autorisation de l’artiste et de la galerie Bortolami, New York.
Une espèce de représentation de la « nature ». Dans l’exposition où je pense que vous avez vu ces œuvres, Hamid, elles étaient couplées à d’autres que j’appelle Wall Skirts : de longues découpes noires de rideaux de théâtre trouvés, la partie qu’on trouve en haut de la scène pour en masquer l’éclairage au public. Je les ai pendues près du sol de l’espace d’exposition, bien plus bas que les Beard Boards par exemple et je les ai considérées comme des jupes pour la salle ou des jupes pour certains murs en particulier. J’aurais pu appeler ça Body/Building. C’est aussi un geste queer.
Chaque jour, chaque instant, s’offre à mille hasards
Arp
Quelle place le hasard occupe-t-il dans l’œuvre de Jean Arp ? L’historienne Joy Des Horts explique comment l’aléatoire devient méthodologie chez l’artiste franco-allemand et révèle la poétique de l’errance.
Rêve d’une œuvre où « intérieur, extérieur, haut, bas, ici, là, aujourd’hui, demain se mélangent, se tissent, se dénouent ». Autant de variations sur un même thème de formes rondes et lisses, sensuelle éloquence d’une vision synthétique issue du schème pur désiré par Brancusi et confondue avec des phénomènes terrestres. En observant lesdites formes, on ne saurait dire où commence l’abstraction et où finit la figuration. L’ensemble est autotélique, défiant la logique et toutes les lois de la gravité, sans heurts ni brusqueries.
Si l’image semble familière, elle n’en décrit pas moins un corpus d’œuvres bien précis : les collages sur papier ou bois de la série Selon les lois du hasard de Jean Arp, initiée en 1916. Derrière les formes biomorphiques convoquant à la fois les règnes humain, végétal et minéral, c’est la question du hasard qui est posée. Celle d’une incertitude consubstantielle garante du mouvement dans l’œuvre, où perce une volonté de défier l’académisme et les lois strictes de l’art en cherchant dans ce nouvel auxiliaire à la création le relais de l’artiste. Si le hasard s’impose comme un enjeu de l’avant-garde et l’emblème de nouvelles esthétiques, l’artiste, à l’image d’un Protogène achevant sa toile en « jetant l’éponge », fait état de pratiques esthétiques de l’informe associant étroitement contrôle et déprise.
L’aléa domestiqué : petite histoire du hasard comme méthode
Le topos du hasard comme méthode dans les pratiques artistiquesn’est certes pas l’apanage de Jean Arp. Déjà dans La Nouvelle méthode pour assister l’invention dans le dessin de compositions originales de paysages publié en 1758, Alexander Cozens enseigne l’art de réaliser des taches artificielles, en indiquant précisément ce qui relève de l’intention et ce qui doit être laissé au hasard. Parallèlement et à la même époque se multiplient en Europe plusieurs versions de jeux de dés musicaux, permettant à n’importe quel aficionado de composer valses, menuets et polonaises en assemblant des éléments pré-composés, par l’intermédiaire d’un lancer de dés et de tables combinatoires. Se déploient des exemples de méthodes d’utilisation du hasard parfaitement concertées et réfléchies, en peinture comme en musique, où l’effacement du geste et l’association hâtive entre hasard et radicalité seront définitivement mis à l’honneur quelques années plus tard chez les avant-gardes. Revendiquant ouvertement le hasard comme mode opératoire, Trois stoppages-étalon (1913) de Marcel Duchamp est sans doute l’œuvre la plus symptomatique de cet exercice. Le hasard, à fortiori Dada, apparaît alors comme une potentielle issue pour l’art lorsqu’il n’intervient plus simplement à la marge ni sous les traits occasionnels de la chance, mais comme un paramètre du processus de création parfaitement intégré à l’œuvre et revendiqué par l’artiste, à condition d’embrasser pleinement sa part automatique et méthodique. Et tandis que Francis Picabia exhume d’une tache d’encre renversée une hypothétique Sainte Vierge (1920), un numéro d’autobus ramassé par Tristan Tzara fait office de poème et Serner se livre à l’écriture automatique en déviant l’inconscient de la pensée. Dada proclame : l’œuvre littéraire et plastique s’émancipe, elle est a priori autarcique.
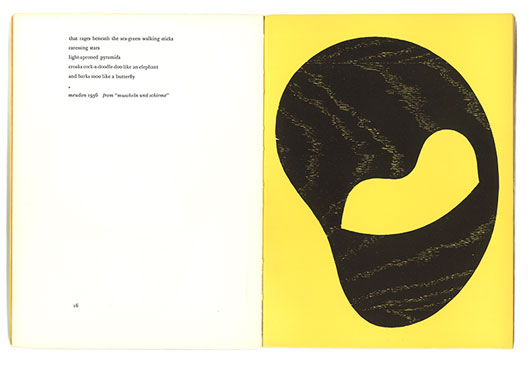
Arp, Gravure sur bois, Meudon, 1948. arp, On My Way, poetry and essays 1912…1947,
Jean Arp, The Documents of Modern Art, Wittenborn, Schultz, Inc., New York, 1948.
Mise en page de Paul Rand.
Bibliothèque Alexandru Balgiu
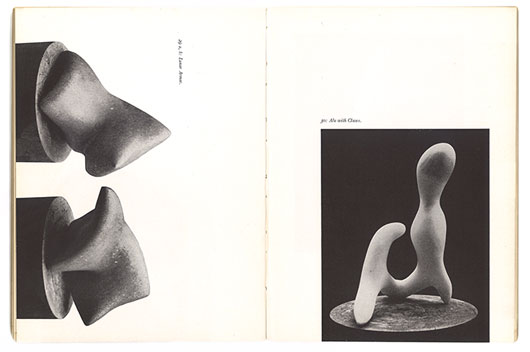
Arp, Lunar Armor, calcaire, 1938.
Photographie de Burckhardt
C’est dans ce contexte que Jean Arp, affranchit des contraintes d’antan, crée à l’aide de matériaux bruts des formes mi-géométrique mi-organiques et découvre le hasard « par hasard ». Telle est la légende : ayant déchiré un dessin dont il n’était pas satisfait puis en ayant jeté les morceaux, il fut si étonné par l’évidence de leur disposition accidentelle sur le sol qu’il les ramassa et en fit Collage avec carré disposés selon les lois du hasard (1916-1917). Arp, le nouveau Protogène ? En réitérant l’expérience d’un accident non souhaité, il établit alors une méthode qui donnera suite à toute une série intitulée Selon les lois du hasard, soit une absence quasi totale du contrôle du geste de l’artiste dans des compositions abstraites faites de carrés, formes organiques et autres taches colorées. Nul déterminisme n’intervient. Au contraire, la porosité intrinsèque oblige à des échanges métaboliques entre les formes. Si à propos du hasard, Jean Arp évoque une pratique s’accommodant à la fois des « yeux ouverts et yeux fermés » c’est pour déterminer à la fois l’occultation et la révélation que lui procure une telle méthode, tout en substituant à son système clos un réseau de signes ouverts, à l’image de la couverture de la Révolution surréaliste de décembre 1929 reproduisant 16 portraits d’artistes surréalistes encadrant une œuvre de Magritte et qui ne « voient pas la [femme nue] cachée dans la forêt ».
Poétique de l’errance
Si, dans ses préfigurations antérieures, le hasard chez Arp est synonyme de compositions systématiques, une nouvelle esthétique se profile à partir des années 1920 : l’indéterminisme, encore résolument Dada, s’inscrit dans une visée volontairement démystificatrice qui engage plus largement une forme de dénaturation joyeuse, puisant dans des motifs organiques. Surgit tout un monde peuplé de Torse à la tête de fleur (1924), de Fleur-Marteau (1916) ou Bouteille-Oiseau (1925) mi-figuratif mi-abstrait, où la ligne se délie dans l’immanence d’une floraison luxuriante. Matériaux bruts, variations des agencements, formes végétales constituent un répertoire jubilatoire, que rien n’entrave dans ce dispositif ouvert à la surprise.
Ces formes vont de paire avec la prolifération de commentaires et poèmes, inventifs et intempestifs, qu’il compose simultanément. Si Arp possède une plasticité et une légèreté qui lui sont propres, ses textes reflètent ce même caractère facétieux et onirique, véritables haïkus visuels mixant l’absurdité et l’humour propres à l’écriture automatique. On les retrouve pour la plupart dans On my way, anthologie publiée en 1948 et regroupant les écrits de l’artiste, de ses premières années Dada jusqu’à la fin des années 1950. On y laisse entrevoir alors le glissement de l’œuvre plastique à celle poétique en de véritable mélodies à voir dont le point de départ se trouve dans les objets de la nature : branches cassées, racines, herbes, pierres dont ne subsiste que le « tressaillement » — c’est par ce terme que Arp qualifiait les œuvres de Kandinsky, qui l’ont indéniablement marqué. Galets, bulles, feuilles, mains, formes et mots errent le long des pages. Arp joue de la souplesse que lui offre ce vocabulaire pour mettre au monde un peuple de figures qui attendent d’y germer.
Si le surréalisme n’est pas loin, l’évolution de cette esthétique semble cependant être une déclinaison quasi naturelle : la simplification de ces objets le conduit à « unir leur essence dans des ovales mouvants », symbolisant « la métamorphose et le devenir des corps ». De fait, que ce soit dans son travail sculptural ou dans ses écrits, rien n’est stable mais rien n’est non plus hiérarchisé : la contre-forme devient forme, un même motif se décline et le thème du hasard s’incarne à la fois dans un fragment de bois évoquant une Femme-amphore (1929) que dans la mélancolie d’une ballade où les « nuages se démaquillent », où « une rose chantante » peut sortir d’un « œuf de lune », où l’on croise « des jets d’eau sur échasses » ou bien des hommes « dont les jambes / deviennent de plus en plus longues / de plus en plus molles ».
On assiste dans les poèmes de Jean Arp à un état momentané, mais aucunement arrêté. Le hasard chez l’artiste entame alors un processus de croissance et de métamorphose : il est mouvant, hésitant entre diverses formes dans l’espace immobile du dessin et du texte. Que la montre s’allonge un peu et une horloge surgit, laquelle n’est pas loin d’un buste. Le cercle devient nombril, puis soleil, avant de devenir œil. La genèse est continuelle et la ligne souple, puisque tout est autre chose. À l’instar de la photographie du nombril d’un Arp sans tête, l’homme est chosifié : loin d’être la mesure de toutes choses, il suit irrévocablement un processus naturel vers des formes nouvelles. Nul caprice d’artiste derrières les lignes tracées, nulle subjectivité à l’œuvre dans la prolifération des mots aléatoires, mais un hasard indissociable d’un système posé en amont, comme une règle de jeu cheminant vers l’infini. Ainsi le thème du hasard prend-il une coloration éminemment poétique chez Jean Arp dont l’ensemble des textes forme une constellation organisée autour de l’évocation d’un univers magique, dont l’empreinte est ici aussi vecteur de versatilité permanente. De ses collages issus de la série Selon les lois du hasard, l’artiste a gardé la conscience de l’autonomie des formes et des mots, comme échelon premier de la construction d’un monde potentiellement œcuménique : c’est l’Arpoétique, soit l’avènement chez l’artiste d’une nouvelle sensibilité. Le hasard nourrit son œuvre, à maints égards corrosive et joueuse.
Texte de Joy des Horts
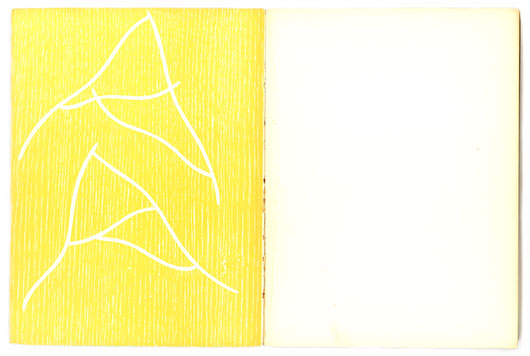
Arp, Gravure sur bois, Meudon, 1948. D’après un croquis de 1923. arp, On My Way, poetry and essays 1912…1947, Jean Arp, The Documents of Modern Art, Wittenborn, Schultz, Inc., New York, 1948.
Mise en page de Paul Rand.
Bibliothèque Alexandru Balgiu

Arp, Papier bleu déchiré et redéchiré, 1947.
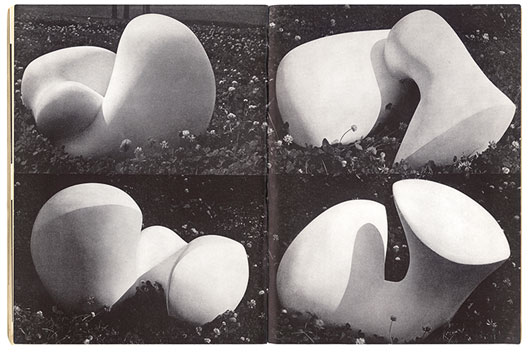
Arp, Concrétion humaine, 1936, quatre vues, collection Maja Sacher, Bâle, Photographie de Rolf Tietgens.
arp, On My Way, poetry and essays 1012…1947, Jean Arp , The Documents of Modern Art, Wittenborn, Schultz, Inc., New York, 1948.
Bibliothèque Alexandru Balgiu
Les lois du hasard
Muriel Stevenson
En interrogeant l’importance du hasard dans leur pratique, six artistes français redéfinissent les contours de ce principe protéiforme et incontrôlable.
Inhérent à sa condition originelle d’objet sacré et à ses ambitions avant-gardistes, l’art continue de rester un mystère qui amène certains à se demander comment une œuvre naît. Quelle place occupe le hasard dans la création ? S’il y a évidemment autant de réponses que d’artistes, certains schémas se répètent et mettent en évidence le rôle que l’aléatoire peut jouer. Qu’il soit sujet de recherche ou outil de production, il s’illustre à diverses occasions. Nous avons donné la parole à six artistes français, âgés de 35 à 40 ans — plus vraiment émergents, pas totalement consacrés — , afin qu’ils nous éclairent sur l’importance de l’insaisissable dans leur pratique. Ainsi cette enquête devient un portrait générationnel, une photographie collective qui présente un fragment subjectif de la scène artistique française.
Laetitia Badaut Haussmann
Puisant à la fois dans l’histoire de la littérature, du cinéma, du design et de l’architecture, les œuvres de Laetitia Badaut Haussmann s’appréhendent comme des espaces fictionnels. L’artiste se plaît à faire dialoguer ses pièces avec l’histoire des lieux qui les accueillent. Ainsi, en 2017, elle investit les différentes pièces de la Maison Louis Carré (unique construction d’Alvar Aalto en France), créant une narration dans cette espace à la fois domestiqué et muséifié. Son intérêt pour le modernisme se retrouve aussi bien dans ses relectures sculpturales des daybed de Charlotte Perriand que dans son exploration des pages de la revue Maisons Françaises, une collection, où elle prend le soin d’effacer toutes traces rédactionnelles et publicitaires afin de créer des images artificielles. Elle revendique le hasard comme un constituant de son processus : « C’est un des éléments avec lequel je pense et élabore mes projets. Il ne s’agit pas de tout prendre, sans filtre, mais d’être sensible à la porosité, à l’influence, au parasitage. De manière quasi philosophique, je crois que le hasard est une manière d’être au monde. Il s’agit d’être dans un rapport d’adaptation à des situations. Je pense notamment à une série de pièces que j’ai débutée en 2015 : L’amour est plus froid que la mort (qui est également le titre d’un film réalisé par Fassbinder en 1969). Je l’ai présentée cinq ou six fois, dans des formes adaptées au contexte. Il s’agit de la rencontre entre une forme molle, organique, et une forme rigide, de l’ordre de l’ossature. Dans sa première version, présentée à Brest, la structure a été réalisée par un artisan qui a soudé des tubes d’acier selon mes instructions. La seconde version, présentée en Italie, a été repensée à partir de tubes en inox trouvés localement, chez des grossistes, que j’ai simplement coupés aux dimensions souhaitées et assemblés à l’aide d’une clé Allen. Tout cela rejoint ma réflexion autour du modernisme, de la reproduction en masse, de la globalisation des marchandises et cette idée erronée selon laquelle on retrouve aujourd’hui les mêmes matériaux partout dans le monde. La pièce change à chaque nouvelle présentation, s’adaptant à des données qui m’échappent totalement. Il y a de ma part une obstination, je suis dans un rapport de contrôle ; une tension se met en place entre cet aléatoire et moi. »

Laëtitia Badaut Haussmann, Gogolplex, 2017. Résine, peinture acrylique, diamètre 60 cm.
Photo : Martin Argyroglo. Vue d’exposition,
« La Politesse de Wassermann », Maison Louis
Carré.
Avec l’autorisation de l’artiste et de
la Galerie Allen, Paris. Production : Lab’bel.

Laëtitia Badaut Haussmann, Maisons françaises, une collection #556-557, 2013. Photographie retouchée, tirage pigmentaire sur papier enhanced matte, 66,77 × 105,61 cm.
Avec l’autorisation de l’artiste et de la Galerie Allen, Paris.
Collection Centre National des Arts Plastiques. Source : Revue Maison & Jardin nº327, 1986. Éditeur : Molteni & C.
Jean-Baptiste Bernadet
Faire l’expérience de la peinture de Jean-Baptiste Bernadet est une excursion au cœur même de la couleur. Si elles vivent en toute autonomie, ses toiles deviennent les protagonistes d’un récit mélodramatique dès lors qu’elles sont juxtaposées, formant un ensemble riche en contrastes. Il faut ici entendre « mélodrame » à travers sa définition la plus élémentaire : la réunion du chant et de la mélodie à l’action dramatique. Car ces peintures purement abstraites savent convoquer les émotions les plus variées, qu’elles soient empreintes de romantisme ou de noirceur. Construites à partir d’un vocabulaire de gestes limités et précis, la peinture de Bernadet fourmille de références à l’histoire de l’art. Il explique : « August Strindberg écrit en 1894 dans Des Arts nouveaux ou Le Hasard dans la Production Artistique que sa peinture est dans un ‹ à peu près ›, c’est-à-dire en deçà des limites de la représentation. Étant le fruit d’explorations picturales spontanées et totalement détachées d’une réalité perceptible, on ne peut parler ici de paysage, mais seulement d’évocations qui doivent autant à l’inconscient de son auteur qu’à ce que va y projeter le spectateur. Strindberg, en fait, est déjà en train d’annoncer et de devancer à la fois par ses propositions théoriques mais aussi par sa peinture une bonne partie de l’art du XXe siècle : Dada, les surréalistes, mais aussi l’art informel et l’expressionnisme abstrait. » Quand on lui demande si le hasard trouve une place dans son atelier, il répond en citant un autre peintre. « Albert Oehlen, dans une interview dont je ne me rappelle que ce passage et que je ne suis jamais arrivé à retrouver, dit quelque chose comme cela : ‹ Mes tableaux préférés sont ceux qui, lorsque je retourne à l’atelier le jour suivant, m’ont l’air d’avoir été pendant la nuit victime d’un accident causé par quelqu’un ›. »

Jean-Baptiste Bernadet, Untitled (Plate 151), 2014. Céramique émaillée, diamètre : 28 cm. Photo : Sylvie Chan-Liat
Avec l’autorisation de l’artiste et de la galerie Valentin, Paris.
Ainsi Oehlen me permet de dépasser le hasard comme simple méthode de production décrite par Strindberg, pour évoquer une force surnaturelle, surpuissante, capable d’intervenir dans le tableau à l’insu de son auteur. J’ai toujours pensé à propos de cette phrase que ce quelqu’un dont parle Oehlen est Dieu. Enfin, ce qu’il en reste, c’est à dire rien du point de vue du non-croyant que je suis, mais tout si j’arrive à concevoir que cette force est en moi et qu’il m’appartient de lui laisser la possibilité d’avoir des accidents contre moi-même. »
Clément Rodzielski
Tabac de contrebande, peinture acrylique, poussière, mousse, peinture à la bombe, affiches de films : la liste des matériaux utilisés par Clément Rodzielski pour concevoir ses pièces s’affranchit des conventions et révèle un goût pour la légèreté. Il est vrai que ses œuvres témoignent d’un certain ascétisme et refusent le spectaculaire. Sa réflexion s’articule autour de l’image, de ses manifestations et de ses manipulations. À travers une série d’actions génériques (imprimer, plier, découper, recadrer, isoler), il fait apparaître des signes qui amènent à s’interroger sur la nature des objets exposés. Le surgissement est sans doute l’un des aspects les plus sensibles de ce travail qui suggère une sorte d’économie, une manière de saisir les choses les plus éphémères et fragiles. Avec Untitled (l’artiste affectionne ce titre puisque la quasi totalité de ces pièces le portent), il collecte la poussière à même le sol de la galerie à l’aide d’un film adhésif. Cette empreinte devient la base d’une composition qu’il agrémente de touches de peinture acrylique, avant de la figer en la collant sur un morceau de carton. Les plans sont inversés (le sol se retrouve à la verticale), la peinture se transforme en réalité augmentée. À travers ses gestes pauvres se dessine une réflexion sur la nature des images à l’ère de leur démultiplication numérique. Quand on l’interroge sur la place de l’aléatoire dans sa pratique, Clément Rodzielski affirme : « Il ne me semble pas que le travail ait tant à voir avec le hasard. Je ne suis pas à l’affût du hasard en tant qu’il serait ce par quoi le travail s’invente. Mais le travail, qui est dépendant d’objets qui le précèdent, se révèle changeant selon ces objets mêmes. Le travail débute avec des données concrètes que le monde fabrique, et en fixe les conditions. Ce sont elles qui organisent les variations du travail, contrarient le strict protocole. Certaines pièces pointent un détail qui serait le dénominateur commun d’une série d’une même image, d’un même objet. Ce qu’elles sont, ce qu’ils sont dans leur ensemble, ne m’appartient pas. »

Clément Rodzielski, Untitled, 2011. Feutre et impression jet d’encre contrecollée sur aluminium, 29.7 × 21 cm.
Photo : Florian Kleinefenn. Avec l’autorisation de l’artiste et de la Galerie Chantal Crousel, Paris.
Eva Nielsen
La peinture d’Eva Nielsen se situe dans une zone floue, laissant le regard dérouté par la familiarité méconnaissable qui se joue sur la toile. L’artistepose un regard inédit sur son sujet de prédilection : la rencontre de la nature et de l’architecture, ou plutôt, l’irruption de formes architecturales au sein de paysage naturel. Elle explique cet entre-deux par son quotidien ; vivant en proche banlieue parisienne, Eva Nielsen est constamment entre deux points, effectuant des allers-retours réguliers et répétitifs. Elle documente cette périphérie en la photographiant, captant ses détails les plus insignifiants, qu’il s’agisse de chantiers, d’édifices ou de végétation sauvage. De ces images, la peintre extrait des motifs qui seront ensuite transposés sur la toile. « Je développe un amour du volume depuis toujours sans pour autant maîtriser les techniques nécessaires pour m’y épanouir et il m’a semblé que la sérigraphie pouvait me permettre de l’aborder différemment. On reste dans une image en deux dimensions, le volume est suggéré, un peu comme dans la peinture flamande. L’œil humain est fascinant car il arrive à établir et réévaluer de manière incessante les rapports entre surfaces, volumes et plans. » Eva Nielsen compose une image singulière en mélangeant les techniques, ce qui lui permet de travailler la profondeur, les flous et les effets de perspective. Ainsi, la sérigraphie côtoie l’acrylique et l’huile, le noir et blanc se teintent de couleurs terreuses et les superpositions troublent la ligne d’horizon.

Eva Nielsen, Ascien III, 2017. Huile, acrylique et sérigraphie sur toile, 200 × 150cm.
Définitivement artiste d’atelier, elle confirme : « C’est ce lieu qui fournit la matière première inattendue, les aléas des juxtapositions, la surprise finale. Parce que le sol maculé interfère sur la sérigraphie en changeant son aspect quand elle est imprimée à même le parquet, parce que l’inclinaison du sol change la façon dont la peintureimprègne la toile, parce que c’est là que se joue l’ultime révélation. Que rien n’est prévu dans ce cadre pourtant anticipé. »
Samuel François
Travaillant l’espace comme une partition, Samuel François met en place des objets à partir d’éléments issus de la vie de tous les jours. Entre peinture, sculpture, photographie et vidéo, sa pratique cherche à créer avec ce qui est à proximité et se glisse dans les interstices du savoir-faire. Des vareuses (ces toiles cirées de pêcheur) sont découpées puis tendues sur châssis, pour créer un ensemble de toiles monochromes, révélant les structures du vêtement — ses poches thermocollées, ses boutons. Si l’artiste est un adepte de la série, c’est qu’elle lui permet de mettre en lumière les variations qui lui sont chères et de souligner leur valeurs poétiques. En mélangeant un esthétisme fait de bricolage (matériaux de construction, soudures et câbles apparents, etc.) et de minimalisme, il met en place une expérience questionnant notre rapport au quotidien. Il n’est donc pas étonnant de découvrir qu’il poursuit, depuis quelques années maintenant, une relecture de l’objet chaise, travaillant sur une multitude de déclinaisons, entre sculptures minimales et collisions surréalistes. Il raconte : « Une chaise de jardin et un guidon de vélo. L’une ramassée sur un trottoir, l’autre abandonné dans un coin de mon atelier. Ils se rencontrent trois jours avant le vernissage d’une exposition personnelle à Cologne en 2015. Ils deviennent Elle (« View 1 » ndlr). Elle est exposée dans la foulée. Souvent les formes que je produis sont composées d’éléments, d’images, d’images mentales issues de lieux, d’espaces, de moments, des éléments qui se trouvent sur mon chemin, au hasard d’une promenade, de lectures, de rencontres, de voyages.

Samuel François, View 1, 2015. Chaise de jardin en plastique, peinture acrylique et guidon de vélo, 40 × 45 × 82 cm.
Avec l’autorisation de l’artiste de la galerie Berthold Pott, Cologne.
Deleuze parle souvent d’espaces déconnectés comme dans le cinéma de Bresson : ‹ Raccordement de petits espaces… dont la connexion n’est pas prédéterminée. › Connexion pas connue d’avance, mais connectéepar la main. Comme essayer d’expliquer quelque-chose qui m’échappe, que je n’ai pas esquissé ou essayé de produire. Elle est comme un son qui s’échapperait de moi. »
Point et ligne sur plan
Barbara Kasten
Depuis plus de quarante ans, l’artiste américaine Barbara Kasten a développé une œuvre explorant la notion d’espace à travers un vocabulaire fait de couleurs et de formes. Hybridation de photographie, de sculptures et d’installations, son travail se déploie à travers une signature esthétique puissante, à la fois pure et narrative. Dans ce ballet abstrait, les énigmes spatiales sont autant de poésies visuelles. Si elle fut souvent copiée au fil des années, Barbara Kasten semble n’avoir jamais souffert des imitations, tant elle a su renouveler, constamment, ses expérimentations artistiques.
Justin Morin J’ai été étonné de découvrir qu’un des premiers métiers que vous avez exercés a été celui d’étalagiste pour un grand magasin. Étonné, parce qu’avec le recul, c’est tout à fait logique. Même si c’est une brève expérience, pouvez-vous m’en dire un peu plus sur cette période ?
Barbara Kasten C’était une époque extraordainaire. J’ai fait ce boulot dans les années soixante. Juste après ma licence, je suis allée à San Francisco avec trois amis et j’ai vécu en colocation dans un grand appartement avec une vue magnifique sur le Golden Gate ; c’était génial. Je me suis toujours intéressée à la mode, je suis moi-même une espèce de fashionista. Réaliser des installations sculpturales pour les vitrines, ça me convenait bien, c’était très intéressant. Mais je me suis vite lassée du monde de la mode, il n’était pas assez riche pour nourrir ma créativité et je me suis lancée dans une carrière artistique. Cependant, mon expérience d’étalagiste a été agréable parce que c’était très créatif. À cette époque, on ne faisait pas d’installations comme maintenant, mais il y a des points communs entre les deux parce que cela revenait à créer un environnement dans chaque vitrine. Il y a un côté commercial, mais il laissait un peu de place à l’imaginaire. C’était aussi assez technique parce que quand on doit intégrer des accessoires dans des volumes réduits, il faut penser en termes de cadres et d’espaces. Tous les aspects de mon activité actuelle constituaient l’essentiel de mon travail d’alors.
Justin Morin Je suis aussi curieux de savoir si vous avez vécu des expériences esthétiques déterminantes pendant votre enfance.
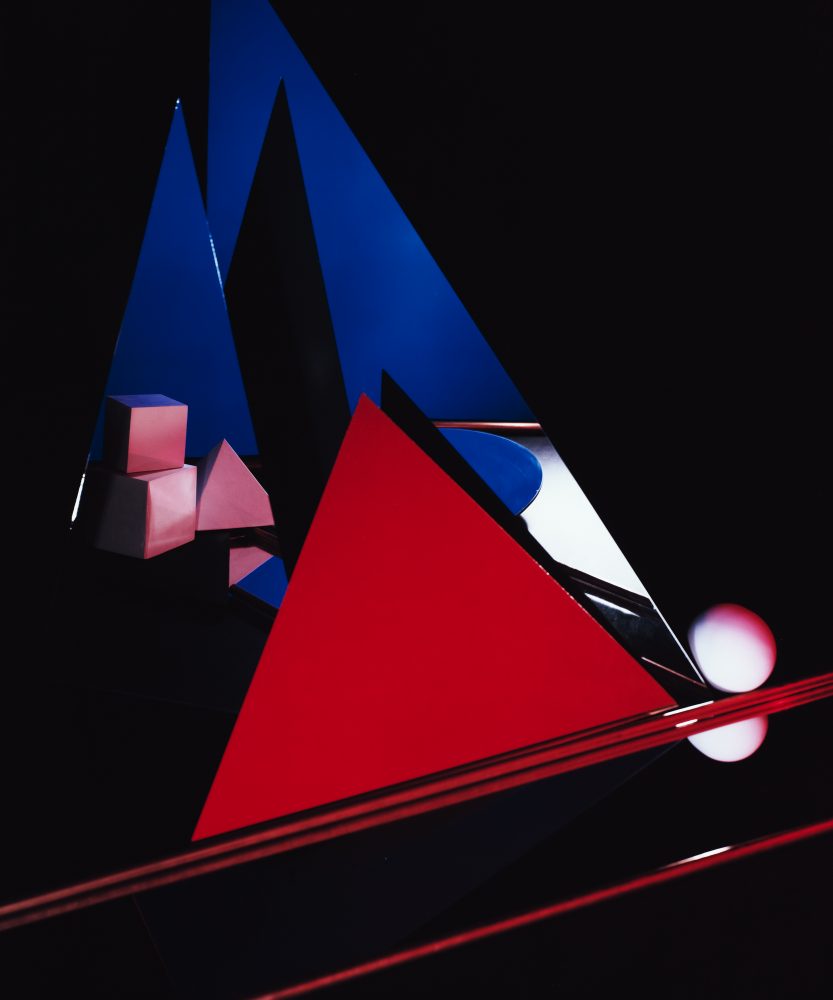
Barbara Kasten, Construct NYC 7, 1983.
Barbara Kasten Je viens d’une famille de la classe moyenne sans aucun lien avec le monde de l’art. Mais j’ai eu une professeur à l’école qui m’a prise sous son aile ; je suppose qu’elle a dû déceler du talent chez moi. J’ai visité l’Institut d’art de Chicago avec elle quand j’avais dix ou douze ans. Je crois que cela a fait naître en moi le désir d’être artiste. Ma famille m’a beaucoup soutenue et m’a généreusement laissée faire ce que je voulais.
À l’époque les femmes n’étaient pas aussi libres de faire ce qu’elles voulaient que maintenant.
Ma famille était assez progressiste. Elle a compris et m’a permis de suivre une voie qui ne menait pas au mariage et à la maternité, même si elle s’attendait à ça. J’ai été mariée, mais je n’ai pas eu d’enfant. C’était un vrai choix. Je ne suis pas froide de caractère, mais je n’avais aucune envie d’être mère. Je me suis toujours dit : « Peut-être que plus tard, j’épouserai quelqu’un qui a des enfants. » Et il s’avère que maintenant, j’ai tellement de contacts avec de jeunes artistes, que ce sont des sortes d’enfants de substitution. Ma relation avec les jeunes est essentielle, ils me soutiennent. C’est pour cette raison que j’ai vraiment aimé enseigner.
Justin Morin Une de vos premières œuvres qui pourrait être importante pour comprendre votre relation à l’espace est Carcass (1971). Au sujet de cette sculpture, vous avez écrit : « Plus les dimensions de l’œuvre augmentent, plus l’implication du spectateur est grande. Avec sa capacité à faire l’expérience de l’œuvre sous tous les angles et de se sentir dans son orbite physique, l’observateur adopte un rôle de participant. » Je trouve que c’est une très bonne manière de présenter vos travaux photographiques dans lesquels l’espace est un terrain de jeu sans limites.
Barbara Kasten Ç’a été une période très intéressante pour moi. J’étudiais la fibre comme matériau avec une femme très intéressante : Trude Guermonprez, une tisserande qui avait étudié au Bauhaus. Elle enseignait à Oakland au California College of Arts and Crafts (CCAC). Ce programme proposait d’expérimenter le textile en relief.
C’était une époque où le textile relevait de l’artisanat mais tentait aussi d’être davantage reconnu comme une forme d’art. Pour mon exposition au Musée des beaux-arts de Boston,
j’ai présenté mes œuvresà côté de celles de huit autres artistes qui utilisaient ce medium comme forme de sculpture. C’était la première fois que ces artistes internationaux exposaient leur travail aux États-Unis. Magdalena Abakanowicz, l’une des artistes invitées m’a beaucoup inspirée. En fait, j’ai passé neuf mois en Pologne à travailler, non pas en tant qu’assistante, mais avec elle comme mentor. J’avais une bourse américaine — la Fulbright Hays Fellowship. L’idée qui sous-tendait Carcass, c’était de créer une forme à trois dimensions à partir de plans en deux dimensions, ce qui ressemble à ce que je fais en photographie aujourd’hui. Mes plus récents travaux — exposés à la galerie Bortolami en septembre dernier à New York — réintroduisent en fait ce procédé. Je faisais la même chose là-bas, j’utilise simplement un autre medium cinquante ans plus tard. J’ai toujours eu ça à l’esprit.

Barbara Kasten, Construct NYC 5, 1983.
Avec l’aimable autorisation de l’artiste, de la galerie Thomas Dane, Londres, et Bortolami, New York.
Justin Morin Pouvez-vous m’expliquer comment vous procédez dans vos recherches ? Je sais que vous vous impliquez physiquement avec vos accessoires, mais je suis curieux de savoir si vous faites des croquis ou des maquettes. Êtes-vous en quête de nouveaux matériaux ? Quel genre de studio avez-vous ?
Barbara Kasten Tout ça à la fois ! Je m’intéresse aussi beaucoup à la peinture et la sculpture classiques. Je mène ma recherche en allant au musée, en lisant des livres, des manuscrits, des articles, juste pour rester investie. Parfois je trouve les matériaux que j’utilise dans des endroits étranges. Je dispose maintenant d’un espace idéal, immense, ce qui n’a pas toujours été le cas. À Los Angeles, je vivais et travaillais dans un local industriel. Dans le studio, j’ai monté des installations sculpturales en trois dimensions, temporaires. Quand je me suis installée à New York, c’était quasiment impossible d’avoir un grand atelier, pour des questions de prix et de disponibilité. Alors je me suis mise à travailler in situ, dans des endroits où je faisais la même chose que dans les studios. J’ai travaillé directement dans les espaces architecturaux des bâtiments et je les ai photogra-phiés. Dans les années quatre-vingt-dix, j’ai voyagé et utilisé des collections provenant de divers endroits. Par exemple, je suis allée en Turquie, à Bodrum, et j’ai fait des photogrammes d’amphores dans le Musée d’archéologie sous-marine…
Justin Morin L’échelle et le cadre ont une grande importance dans la construction de vos images. Qu’est-ce qui vous a poussée à explorer ces notions quand vous avez mis en œuvre Inside/Outside : Stages of Light. Pouvez-vous m’en dire un peu plus sur cette chorégraphie ?
Barbara Kasten En 1985, j’ai réalisé un projet au Capp Street Project à San Francisco. C’était un bâtiment très intéressant, converti à la fois en résidence d’artistes et en espace d’exposition… C’était très novateur pour l’époque. J’ai été invitée à y séjourner et y travailler. J’ai transformé tout l’espace d’exposition en environnement sculptural et j’ai intégré le mouvement parce que j’étais vraiment — et je le suis toujours — passionnée par la conception de pluridisciplinarité du Bauhaus. J’ai invité la chorégraphe Margaret Jenkins à prendre part au projet. C’était une expérience très riche parce que j’ai pu me servir de l’univers que j’avais créé pour l’appareil photo et intégrer un personnage dans ce concept.

Barbara Kasten, Construct PC IX, 1982.
Justin Morin Est-ce que cela a été votre seule expérience avec la danse ?
Barbara Kasten Oui, mais je dois dire que je réfléchis en ce moment à une autre possibilité. C’est un projet auquel j’espère travailler au printemps 2018.
Justin Morin Dans le cadre de ce projet de danse, comment vous êtes-vous accommodée du fait qu’on ne peut pas contrôler le point de vue du spectateur ?
Barbara Kasten J’ai, me semble-t-il, une approche différente de cette question : je ne considère pas qu’il s’agit de mon point de vue. C’est intéressant de garder à l’esprit qu’on peut voir les choses sous différents angles. Je n’essaie pas de tout contrôler, c’est plus ouvert à l’expérience et à l’interaction avec le public. Pour moi, le plus difficile est de travailler avec une grosse équipe; il faut prévoir, planifier, concevoir de manière différente que lorsqu’on est seul dans le studio. Pour la chorégraphie — et les œuvres que j’ai créées pour l’exposition Parti Pris à New York — je travaille avec une équipe qui doit donner corps à mes idées, alors il faut que j’ai une idée plus précise du résultat final. Mais ma pensée est si flexible que je n’arrive pas à imaginer m’en tenir à un programme que tout le monde suit. J’ai besoin d’avoir la possibilité de changer les éléments au fil de la réalisation. Cela a été une sorte de réflexion inversée pour moi.
Mais finalement, je suis toujours en quête d’ambiguïtés spatiales.
Justin Morin Même si ce n’est pas une manière habituelle de lire votre œuvre (surtout parce que cette approche pourrait facilement être considérée comme psychanalytique), je dois dire que l’absence de repré-sentation humaine dans vos photos est très intéressante. Il y a un véritable équilibre entre les formes et les couleurs, le visible et l’invisible. En un sens, cet équilibre parfait accentue la notion d’absence.
Barbara Kasten L’interaction humaine y est suggérée, insinuée, parce que les choses ne s’assemblent pas de la façon dont je les ai installées sans une intervention extérieure. Mais il ne me semble pas nécessaire de montrer quelqu’un dessus, ça dérive plus de l’expérience, je pense. Je veux que les gens y projettent leur propre conscience et leur propre mémoire.
Justin Morin Combien de jours vous faut-il pour réaliser vos photos ?
Barbara Kasten La plupart du temps, c’est long ! Mais, comme mon studio me le permet, je peux travailler à deux ou trois projets en même temps. Ils sont liés mais je ne me concentre pas sur chaque œuvre jusqu’à ce qu’elle soit terminée. J’y travaille, je m’en écarte et j’y retourne.
Justin Morin Les gens vous présentent souvent comme une photographe, même si vous utilisez d’autres mediums. Est-ce que cela vous convient ?
Barbara Kasten J’aimerais ne pas être toujours étiquetée photographe. Je ne me définis pas en ces termes. Bien sûr, la photographie est présente dans le processus de création, mais c’est simplement un procédé intéressant supplémentaire, un outil. En ce sens, je suis très reconnaissante à Alex Klein, le curateur de l’exposition individuelle que j’ai présentée en 2015 au ICA à Philadelphie, qui a su restituer avec brio ma singularité en cernant ma personnalité et l’originalité de mon travail.

Barbara Kasten, Construct NYC 6, 1983.

Barbara Kasten, Construct PC VII, 1982.
L’image miroir
Adam BroombergOlivier Chanarin
Depuis plus de vingt ans, le duo de photographes Oliver Chanarin et Adam Broomberg repousse les limites de la photographie. En combinant le photojournalisme et les arts visuels, ils présentent des séries photographiques de moments historiques importants, mais refusent d’attribuer à ces images une intention bien définie. En abordant les thèmes de la politique, de la religion, de la guerre et de l’Histoire, Broomberg et Chanarin tentent de mettre en évidence les lignes de fracture habituellement associées à cette imagerie et créent de nouvelles réponses, de nouveaux chemins pour conduire à une compréhension de la condition humaine. Le langage et la littérature jouent un rôle majeur comme matériau dans leurs travaux aux facettes multiples, depuis les principes philosophiques de l’ABC de la guerre de Bertolt Brecht jusqu’aux textes sacrés de la Bible, ouvrages revisités et recréés par les artistes dans le format de leur imagerie ambigüe et contradictoire.
Hamid Amini La politique, la religion et la guerre ont été les points centraux de votre travail, comment traitez-vous l’univers du populisme post-Trump dans vos œuvres récentes ?
Adam Broomberg & Olivier Chanarin Juste après l’élection de Trump, nous avons consacré un certain temps à galvaniser les acteurs du monde de l’art qui partageaient notre révolte. Nous ne sommes pas certains que ce soit vraiment du travail, mais le mouvement que nous avons créé et nommé « Hands Off Our Revolution » en a demandé énormément. Il a commencé avec près de 250 signatures, pour la plupart de camarades artistes, de curateurs, de directeurs de musées. Il a aujourd’hui acquis une existence propre avec 5000 membres et des bases dans 6 villes tout autour du globe. Nous ne sommes plus directement impliqués, mais il semble remplir sa mission.
HA J’ai vu récemment votre œuvre Prestige of Terror à la « documenta ». Dans quelle mesure le message du Printemps arabe est-il pertinent dans l’exposition de cette année ?
AB & OC Notre travail a été intégré dans la « documenta » presque par accident. Ces œuvres sur papier, que nous avions imprimées dans un atelier d’impression du Caire sur un support fragile datant de la fin des années 1930, ont été achetées par un collectionneur privé, puis données au musée d’art moderne d’Athènes. Les curateurs de la « documenta » ont dû tomber dessus par hasard. C’est pertinent parce que le hasard est un thème de prédilection pour les surréalistes égyptiens. S’il y a un autre message, c’est peut-être le sentiment inné d’échec qui a imprégné toutes les entreprises des surréalistes égyptiens. Nous avons créé Prestige of Terror au Caire durant une résidence au Town House Gallery. C’était quelques mois avant le début du Printemps arabe. Mubarak était encore au pouvoir. La place Tahrir était calme ; des camions vert foncé remplis de membres de la police anti-émeutes qui semblaient affligés étaient tapis dans les ruelles environnantes. Les surréalistes égyptiens nous ont intrigués, à ce moment-là en particulier, parce que tout comme les policiers anti-émeutes ils craignaient de disparaître. Ils étaient suffisamment futés pour comprendre qu’un mouvement francophile tel que le surréalisme n’avait pas sa place en Egypte dans le sillage du nationalisme arabe. Et l’échec du Printemps arabe n’a fait qu’intensifier cette sensation de mélancholie.
HA Dans votre ouvrage, Holy Bible, dont nous publions certaines images dans ce numéro, vous développez la notion de manifestation de pouvoir à travers la catastrophe. Étant donné l’obsession des médias de masse pour ces images, quel est votre point de vue sur la manière dont nous recevons et déchiffrons l’information aujourd’hui ?
AB & OC Chaque catastrophe a pour contrepartie un miracle. Ce brin de chance qui sépare la victime qui périt dans un tremblement de terre, un tsunami, ou un acte de terrorisme gratuit et le survivant, qui par un coup de chance s’en sort indemne. Les images de catastrophe captent l’imagination du public parce qu’elles témoignent de notre fragilité face aux probabilités atroces, et nous rappellent que nous avons été épargnés. Dans notre exposition Divine Violence nous avons exploré la Bible à la recherche de phrases qui évoquent des images de catastrophes. Ces images ont été tirées d’Archive of Modern Conflict. Mais à chaque fois que nous rencontrions la phrase : « et cela se produisit » qui apparaît sans cesse aussi bien dans le Nouveau que dans l’Ancien testament, nous avons utilisé l’image d’un événement miraculeux. Toutes proviennent d’un carton de photographies étiqueté « magic ». Nous n’avons aucune idée de ce qu’il faisait sur les étagères d’Archive of Modern Conflict, mais il s’y trouvait et nous nous sommes en quelque sorte sentis obligés de les utiliser.
HA Vous avez plus de 20 ans de collaboration à votre actif, quelles sont les difficultés à surmonter pour continuer de travailler ensemble aussi longtemps en respectant une stricte discipline ? Pourriez-vous encore travailler séparément ? Ou le feriez-vous ?
AB & OC C’est une question très personnelle. L’une des conséquences de cette collaboration c’est que nous disposons de moins d’espace, dans le travail du moins, pour les aspects intensément plus intimes. Nan Goldin n’aurait pas pu réaliser The Ballad of Sexual Dependency si elle avait travaillé au sein d’une équipe ! L’envie de travailler ensemble trouve sans doute sa source dans des forces profondément inconscientes, des doutes irréductibles. Ha ha, (rire nerveux). Mais il y a aussi un aspect pragmatique dans le travail collaboratif, une manière d’aborder le monde avec une conception partagée de l’indignation et de l’humour. C’est le côté agréable. Parfois cependant, la collaboration ressemble au personnage tourmenté de How to get ahead in advertising qui découvre un matin à son réveil qu’une seconde tête lui a poussé pendant la nuit !
HA Allez-vous voir beaucoup d’expositions ? Qui sont les photographes que vous admirez en ce moment ? Quels sont ceux qui vous ont particulièrement inspirés tout au long de votre carrière ?
AB & OC John Baldessari, pour nous avoir rappelé que l’art se doit de ne jamais être ennuyeux. Aujourd’hui, nous avons tous les deux de jeunes enfants, alors se rendre dans les musées et les galeries d’art ressemble plus à une chasse aux papillons qu’à la contemplation tranquille d’œuvres d’art ! À nos débuts, nous avons été beaucoup influencés par August Sanders qui réalisait de simples portraits sans concession de toutes sortes de civils durant la République de Weimar en Allemagne. Et le photographe italien Olivero Toscani a sans doute constitué une influence plus importante qu’aucun de nous deux ne veut bien l’admettre. Nous lui devons beaucoup.
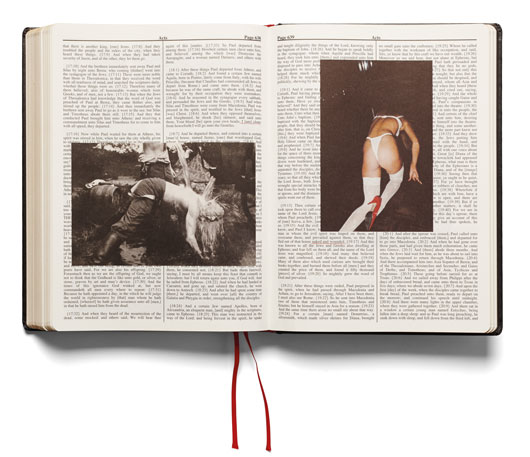
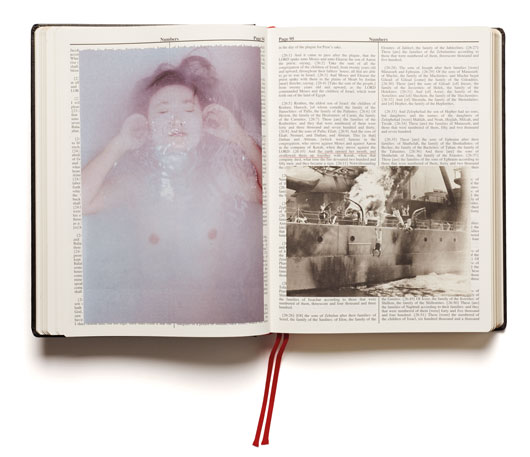


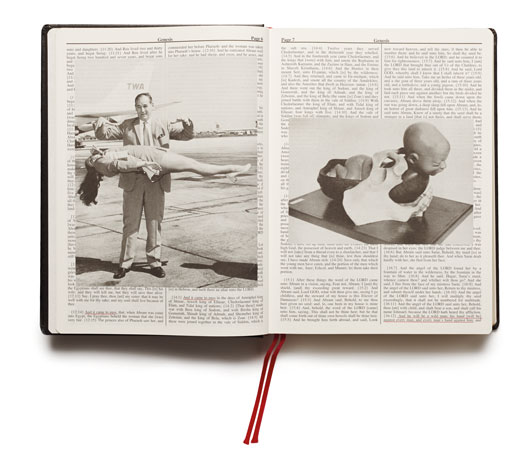
Holy Bible (2013) d’Adam Broomberg & Oliver Chanarin est publié par MACK.
Toutes les images sont publiées avec l’aimable autorisation des artistes et de MACK.
L’enquête
Sophie CalleMai Nguyen
Photographe, écrivain, réalisatrice, plasticienne : si Sophie Calle est tout cela à la fois, elle reste malgré tout une énigme. Son talent à restituer les choses les plus intimes de manière fulgurante nous amènerait presque à l’envisager comme une personnalité familière, quelqu’un que l’on côtoie depuis plusieurs années. Mais pour vraiment la découvrir, et à travers le jeu de l’interview, j’ai décidé de me faire enquêtrice. Je l’inviterai à préciser et à creuser, à confirmer tout ce que je crois connaître d’elle à travers son travail si particulier et prolifique. « Il faut durer. Pas juste faire des choses » me dit-elle.
Des femmes
J’ai toujours trouvé le travail de Sophie Calle très féminin. Banalité et platitude. Pas tant que ça. Autour de moi, très peu d’hommes sont vraiment sensibles à son œuvre. C’est une artiste femme qui touche involontairement les femmes, avec qui les femmes se sentent connectées, et proches par les thèmes qu’elle aborde, par le ton qu’elle emploie pour les aborder, par la sensibilité qu’elle y déploie. Je l’interroge, je marche sur des œufs, délicat de nos jours de parler de « féminin », de parler de genre sans tomber dans des clichés. « Je ne vois pas pourquoi ça m’offusquerait. Je ne me pose pas ce genre de questions. Je ne me décrirais pas spontanément en disant je fais un travail de femme.» Je lui demande si elle ne trouve pas que les femmes ont beaucoup de pression aujourd’hui. L’obligation à la performance, la réussite professionnelle, sentimentale, familiale… Être indépendante et libre, mais en même temps sensible et aimante, difficile de tout concilier. « Je ne peux pas vous répondre car je ne trouve pas que ça soit si compliqué que ça d’être une femme. Je le vis c’est tout ! Oui, je suis indépendante. Oui, j’ai la chance d’arriver à faire ce que j’avais envie de faire. Mais dans mon travail je cherche ce qui présente un potentiel artistique, et non pas à résoudre mes problèmes personnels. Mes motifs ne sont pas d’ordre thérapeutique.»
De l’intimité
J’ai beau savoir que comme tout artiste ce que Sophie Calle nous donne à voir n’est que ce qu’elle choisit de nous donner à voir. J’aime cela dans son œuvre, ce que j’interprète comme une forme de pudeur et de retenue, qui va à l’encontre de cette injonction à rendre sa vie publique, révélée et transparente. « Ce n’est pas par pudeur mais pour des raisons artistiques. Je montre ce qui me semble intéressant sur un mur, dans les pages du livre, ce qui peut intéresser les autres, sans que ce soit uniquement mon histoire. Mon matériau c’est le récit, mais je ne parle pas toujours de moi. » Une question me taraude : comment réussir à se séparer d’une œuvre? Elles sont toutes tellement personnelles, privées même. Cela doit être un déchirement. « Ça n’est pas personnel pour moi, je raconte une histoire, je ne raconte pas ma vie, je ne tiens pas un blog. Ce que je raconte, ça n’est même pas intime, c’est arrivé à tout le monde, tout le monde a été quitté… Je n’ai même pas l’impression que c’est ma vie. Un moment de ma vie, oui, et même pas vraiment, car j’ai choisi cette minute-là plutôt que telle autre, cet événement plutôt que tel autre.»

Extrait de Sophie Calle, Ainsi de suite (Éditions Xavier Barral, 2016) Collateral Damage. Targets / Dommages collatéraux. Cœur de cible, 1990-2003
© Sophie Calle / ADAGP, Paris, 2017
Portraits de délinquants fichés, utilisés comme cibles pour l’entraînement des policiers du commissariat de la ville de M., États-Unis.
C’est donc la banalité quotidienne des situations et des émotions dépeintes par Sophie Calle qui me touche. Son universalité ni plus ni moins. « Une rupture, une mère qui meurt…c’est ma mère sur l’écran mais c’est une mère qui meurt avant tout. Et puis le même projet peut être terriblement impudique selon la personne et selon les mots qu’on choisit. Par exemple mon père était très discret, protestant : si je l’avais filmé en train de mourir, cela aurait été incroyablement impudique. Alors que ma mère le souhaitait ; elle était extravagante et voulait être le centre d’attention. Le même geste, la même idée peut être incroyablement agressive et violente pour l’un, amicale, amoureuse et un hommage pour l’autre. »
Du temps
À l’entendre, Sophie Calle sait suivre le cours naturel de sa pensée. L’idée doit mûrir, faire son chemin. Moi qui cours après le temps, la voir qui semble prendre son temps me rassure.
« Mais j’ai le temps. Je n’ai pas d’obligations. Je travaille seule. Je n’ai pas de studio, pas d’assistant. Le plus difficile c’est d’écrire, ce qui est le plus complexe. Mais je n’ai pas toujours été dans cette situation ; j’ai aussi le temps parce que j’ai un certain âge et que je n’ai rien à prouver. Ne pas faire d’expo pendant un an ça n’est pas très grave. À une certaine époque de ma vie, il fallait que je cons-truise quelque chose. Et parfois ça en prenait du temps ! Par exemple, pour le projet sur la banque, j’avais trouvé des images dont la beauté m’avait séduite. J’avais donc les images mais pas l’idée. Alors j’ai continué à chercher. Et il m’a fallu seize ans pour trouver. Certains projets sont une lutte ! En ce quiconcerne Douleur Exquise j’ai eu l’idée, j’ai accumulé tous les éléments, les textes, les images, mais je n’avais pas la forme adéquate. Je l’ai trouvée au bout d’une quinzaine d’années. » Je lui parle de mon angoisse du temps qui passe. Je viens d’avoir 40 ans, je suis à « mi-parcours », comme on dit : « Plus jeune, je ne m’inquiétais pas de ne pas avoir de temps. Je n’avais pas de temps parce que j’étais pressée.
De l’amour et de l’absence
Je lui parle de moi, encore, de ce qui préoccupe les femmes de ma génération. Mais pas uniquement les femmes. Vivre sa vie et tomber amoureux, être et rester amoureux, aimer, être aimé, ne plus aimer ou ne plus être aimé. Sur sa vie amoureuse, finalement Sophie Calle n’aura consacré que deux œuvres Prenez Soin de vous et Douleur Exquise. Dans son film No Sex Last Night, elle exprimait la difficulté de la vie à deux. Le temps d’un road trip, les deux amants Sophie Calle et Greg Shephard se sont confiés à leur caméra pour tenter de dire ce qu’ils ne parvenaient pas à se dire l’un à l’autre. « Ce n’est pas le chagrin d’amour qui revient dans mon travail, c’est le manque, l’absence, et ça peut prendre des tas de formes.» Dans sa réflexion sur l’absence, le manque, la disparition, le deuil, Sophie Calle, loin de rester dans une démarche de gestion de crise, tente de stimuler la mémoire et l’imagination. Et de donner une présence positive à l’absence.
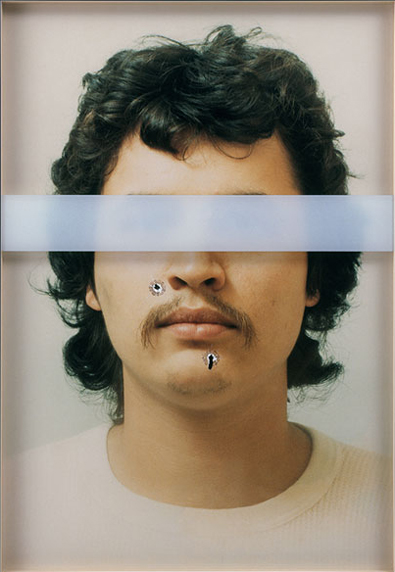
Extrait de Sophie Calle, Ainsi de suite (Éditions Xavier Barral, 2016)Collateral Damage.
Targets / Dommages collatéraux. Cœur de cible, 1990-2003
© Sophie Calle / ADAGP, Paris, 2017
De l’écriture et de l’image
Ni simple plasticienne, ni uniquement écrivain, le langage, les mots et l’écriture jouent un rôle primordial dans le travail de Sophie Calle. On lit Sophie Calle. Comme on lit un roman. Je lui demande si un jour elle aimerait écrire un vrai roman sans image. « Je crois que je n’y arriverais pas. Et puis pourquoi le faire ? J’ai trouvé une manière d’écrire qui m’appartient.»
Soixante-dix-neuf. C’est le nombre de publications, catalogues d’exposition et éditions limitées, parues entre 1980 et aujourd’hui. Je suis impatiente de pouvoir découvrir le livre qui sortira à l’occasion de « Beau Doublé Monsieur le Marquis ! », sa prochaine exposition au Musée de la Chasse et de la Nature à Paris. Elle m’explique avoir trouvé l’inspiration dans un ouvrage spécialisé. « Alors que je cherchais des idées, je suis allée à Belval, le domaine qui appartient aux propriétaires du Musée de la Chasse. Dans ma chambre, il y avait un livre sur la chasse que j’ai commencé à feuilleter. Il y avait un vocabulaire que je ne connaissais pas du tout : « le chien de rouge », « le beau revoir », « la recherche du sang ». Cela m’a fait penser à Valère Novarina, qui a écrit des textes dans lequel il énumérait tous les noms des fleuves et des vents dans le monde, c’était magnifique. Et là j’ai commencé à piocher toutes ces expressions que je ne comprenais pas ou qui avaient du mystère. C’est un livre fourrure, qui s’appellera Les Fanfares de Circonstance.

Extrait de Sophie Calle, Ainsi de suite (Éditions Xavier Barral, 2016)Collateral Damage.
Targets / Dommages collatéraux. Cœur de cible, 1990-2003
© Sophie Calle / ADAGP, Paris, 2017
Du langage et des petites annonces
Sophie Calle m’explique que Beau Doublé, Monsieur le Marquis ! parlera de la mort, de l’absence, des hommes et des bêtes. Elle a également invité l’artiste Serena Carone à venir présenter plusieurs de ses pièces, dans un dialogue inédit entre les deux artistes. On y retrouvera un médium qu’elle affectionne et qu’elle a déjà exploité précédemment : les petites annonces. « Cette fois-ci, je suis partie du Chasseur Français, le magazine, car ils m’ont ouvert leurs archives. Je ne voulais pas analyser un phénomène mais un langage. Comment on se décrit, qu’est ce qu’un homme recherche principalement chez une femme… Dans la plupart de ces annonces, le langage se doit d’être économique. Il faut dire les choses avec un minimum de mots, car ils sont payants, être le plus bref et efficace possible. Cette économie des mots, je m’y confronte également car mes textes étant principa-lement destinés aux murs des galeries, il a fallu que j’apprenne à écrire de façon concise, pour que les gens acceptent de lire debout, ce qui n’est pas rien ! Couper, ramasser, raccourcir, résumer, c’est quelque chose qui est mon souci à chaque fois que j’écris le moindre texte car je pense l’exposition avant le livre. Je relis mes textes parfois pendant un an jusqu’à ce que chaque mot me semble indispensable. »
Du jeu et du hasard
Toute mon existence et en dépit du bon sens, j’ai été superstitieuse. Je ne pouvais m’empêcher de voir des signes dans ce qui m’arrivait dans la vie. « Ce qui m’arrivait », comme si les événements me tombaient dessus. Evidemment, j’ai songé à consulter une voyante plus d’une fois. Mais par peur de la mauvaise aventure, je suis toujours restée entre deux eaux, entre fascination et crainte. Sophie Calle, elle, aime le jeu. Je lui parle du projet « Où et Quand ? », réalisé avec la complicité de la voyante Maud Kristen, en 2008, dans l’espace parisien de la galerie Perrotin. « Paul Auster devait faire un film sur moi, à la demande d’un metteur en scène anglais. Il a bâti un scénario mais n’a jamais trouvé l’argent pour le réaliser. Alors il a écrit un roman Leviathan en se servant de certains éléments de son scénario. On y découvre donc, le temps d’un chapitre, un personnage qui me ressemble. Elle garde ses cadeaux d’anniversaire, suit des gens dans la rue, se fait suivre par un détective privé, devient femme de chambre et ensuite ce person-nage vit sa vie de personnage de roman sans se mélanger à la mienne. Mais il avait aussi glissé deux performances de son invention dans mon chapitre : il faisait suivre à son personnage un régime chromatique et vivre selon quatre lettres de l’alphabet. J’ai voulu jouer avec le roman, c’est venu tout seul, de fil en aiguille, l’envie d’obéir à un roman. Plus tard j’ai rencontré un peu par hasard cette voyante, dont j’aimais le langage, la manière de s’exprimer, l’intelligence. Je ne sais pas comment l’idée est venue de lui demander d’imaginer mon futur pour obéir à ses visions. Non pour démontrer quoique ce soit sur la voyance, mais pour suivre une trame, un scénario. Parce que j’aime les rituels, le jeu. »

Extrait de Sophie Calle, Ainsi de suite (Éditions Xavier Barral, 2016) Collateral Damage. Targets / Dommages collatéraux. Cœur de cible, 1990-2003
© Sophie Calle / ADAGP, Paris, 2017
De l’avenir
Avant de nous quitter, Sophie Calle partage avec moi ses projets à venir. Elle me parle notamment d’une collaboration prochaine avec le Süddeutsche Zeitung. Elle me présente toutes ses pistes de réflexion avec un enthousiasme sincère et une voix pétillante. Je perçois alors un peu, peut-être, qui est Sophie Calle. La plasticienne des mots m’est moins inconnue. « Le plus difficile c’est de durer. Durer. Jusqu’au jour où ça s’arrêtera. »
Pas de roses sans épines
Joy Des Horts
Le retour du floral comme sujet majeur, parfumé de significations subtiles, subversives et poétiques, offre l’occasion de se pencher sur une pratique contemporaine qui embrasse dans ce motif « décrépi » une multiplicité d’approches vers ce que les fleurs symbolisent : le décoratif, le mineur, l’éphémère, le kitsch, l’émoi facile.
Si, au Moyen-Âge, la fleur revêt un caractère symbolique (dans le cycle marial, le lys, l’iris, l’ancolie sont posés aux pieds de l’archange Gabriel) et représente l’harmonie retrouvée dans l’Hortus Conclusus, l’art du XVIe siècle l’isole de la scène religieuse et lui donne une existence indépendante et moralisatrice dans de grandes Vanités. Stimulée par les découvertes scientifiques de nouvelles variétés dans des compositions naturalistes, des études d’herbiers ou trompe-l’œil, c’est véritablement au XIXe siècle que la fleur se confond avec la grande histoire de la peinture, chez Delacroix, Courbet ou Fantin-Latour. Avec les impressionnistes, le motif floral se pare d’un nouvel éclat : en plein air, le peintre étudie l’intensité de la lumière ; les fleurs deviennent autant de taches colorées, accidents nécessaires aux jeux de clarté. Les fleurs de Manet, aux formes suggérées par des indications rapides, illustrent sa vision de la modernité, tandis que Berthe Morisot se réclame de Corot et de ses harmonies grises. Le décor floral s’épanouit aussi dans l’ornementation graphique et l’architecture, des lignes sinueuses de l’art nouveau à la rose de Mackintosh et aux mosaïques végétales de Klimt. Les artistes du XXe siècle se sont presque tous, à la suite de Cézanne, essayés à la peinture de fleurs. Bonnard trouve dans la fleur l’exaltation domestique du bonheur bourgeois, tandis que Matisse la disperse en arabesques colorées et flamboyantes. Après la Seconde Guerre mondiale, l’art prend un tournant plus intellectuel et la fleur tombe dans l’oubli, considérée comme l’apanage des peintres du dimanche. Elle retrouve cependant un regain d’intérêt chez des artistes pop et les Nouveaux Réalistes (Warhol, Wesselmann, Raysse, Klein), agrandie ou multipliée à l’infini. Irrémédiablement absente dans les Pots de fleurs de Raynaud, elle suscite toujours émotions et réflexions.
De la beauté avant toute
Wolfgang Tillmans, Ushuaia Lupine, 2010, Flower Pipe, Podium, 1999
Loin des photographies marquées par l’engagement politique des années 1990, qui témoignaient d’une jeunesse en révolte contre les normes d’une société en qui elle ne se reconnaît pas, les clichés de fleurs de Wolfgang Tillmans, plus intimes, révèlent une profondeur et une poésie de la trivialité, se manifestant par une lumière naturelle, douce et une palette chromatique sobre.
Ces visions, presque ordinairement ennuyeuses, reflètent la relation de l’artiste au monde environnant, des explorations de l’intimité de son atelier et de son jardin vu de sa fenêtre aux vagabondages plus lointains qui le mènent aux rues désertes de Londres et à sa périphérie. Photographe soucieux de la qualité du tirage, condition du potentiel expressif de l’image, Tillmans obtient de l’épreuve argentique le meilleur de son atmosphère et de son pouvoir évocateur. Ses compositions s’articulent autour de la mise en scène de formes désuètes, où les objets manufacturés se mêlent aux éléments naturels : fleurs séchées, bouteille en plastique, le tout dans un paysage de banlieue anglaise.
Des fleurs délaissées, fanées ou coincées derrière des radiateurs, qui pourtant par leurs grâces, déjouent le memento mori que l’on aurait attendu ici. Ces fleurs qui exercent sur l’artiste une inépuisable fascination, sont comparables à la surface d’une toile, réfléchissant des instants de tendresse exquise et d’espoir lorsqu’un rayon de soleil vient caresser les feuilles d’un pommier, elles se veulent poignante mélancolie lorsqu’il observe les pétales tombés de pivoines flétries, comme autant d’absences et de manques. Le végétal procède chez l’artiste d’un état d’âme et veut le susciter chez ses contemplateurs. Construisant des narrations à la fois intimes et collectives, les natures mortes de Tillmans transmettent un état de dissolution du moi, difficile à décrire : des instants suspendus, trop glissants pour être retenus, d’hyper-tranquillité.
De tous ces clichés de fleurs pris ici et là — pour la plupart dans son atelier d’où l’on peut apercevoir à l’extérieur un train renvoyant les derniers rayons de soleil sur les toits d’un paysage industriel — et qu’il considère avec l’intérêt d’un ethnographe, Wolfgang Tillmans établit un lien sensible entre la photographie (l’acte de regarder et s’engager avec les surfaces du monde) et l’expérience sensuelle, il nous invite à investir l’image muette de nos sens. Les digitales saisies au bord d’un trottoir, les fleurs exotiques s’étirant lascivement dans des bouteilles en plastique deviennent autant de prétextes pour capter l’éclat naturel du monde observé, scandaleusement beau.

WOLFGANG TILLMANS, USHUAIA LUPINE (A), 2010.
IMPRESSION JET D’ENCRE SUR PAPIER, 208 X 138 CM.
AVEC L’AUTORISATION DE L’ARTISTE ET GALERIE CHANTAL CROUSEL, PARIS.
© WOLFGANG TILLMANNS
Wolfgang Tillmans s’intéresse à la peau du monde, la façon dont elle change au fil des ans. Les photographies de ses fleurs entremêlent les temporalités et captent une mémoire collective des affects, des troubles et des bonheurs simples qui parsèment nos existences éphémères. Il suggère une façon de regarder notre environnement avec une sensibilité remarquable et parvient à transcender la banalité et à faire jaillir de la beauté là où nous ne la suspectons pas : entre les pavés clairsemés d’une cour, d’un jardin, aux abords d’une autoroute, Tillmans recueille le miracle de l’extas.
Jordan Sullivan, After the Funeral, 2016
Ombres chinoises dans un champ, un jardin, les fleurs de Jordan Sullivan sont décontextualisées, isolées, saturées, surexposées. On les devine à travers un prisme très particulier, révélant la matérialité primaire d’images apparemment sans commentaires. Pourtant, dans une tradition de la nature morte où les fleurs sont devenues banales dans leur multiplicité et menacées dans leur forme actuelle, Jordan Sullivan cherche à préserver l’expérience personnelle du paysage. Fasciné par les possibilités expressives qu’offre la photographie, il y développe un sens aigu de l’observation, un goût pour les compositions éthérées, et pour l’intensité psychologique des paysages.
La série After the Funeral rend compte des liens étroits entre poésie, rêve et réalisme : un diaporama de fleurs sauvages que l’artiste a capturé après l’enterrement de sa grand-mère, dans un champ près de sa maison. Les couleurs y ont une présence fantomatique et s’ajoutent comme un filtre kaléidoscopique par-dessus les clichés de fleurs, imprimés sur une soie translucide, qui étend le dialogue entre photographie de paysage et la physicalité de l’expérience. Les œuvres répondent au mouvement et au toucher du spectateur, elles réaniment le paysage et engendrent une image flottante, qui ne cherche pas à séduire au premier coup d’œil, mais se rappelle encore et encore au souvenir de son observateur, comme le musc entêtant des violettes des champs.
Irving Penn, Flowers, 1967
En 1967, Alexander Liberman, directeur artistique du célèbre magazine américain Vogue, commande à Irving Penn des photographies de fleurs pour sa prochaine édition. Ce sera le début d’une collaboration sur sept numéros avec le photographe, qui chaque année, se consacre à une fleur particulière : 1967 — Tulipes ; 1968 — Coquelicots ; 1969 — Pivoines, 1970 — Orchidées ; 1971 — Roses; 1972 — Fleurs de Lys ; 1973 — Bégonias.

JORDAN SULLIVAN, FORGOTTEN ANCESTORS, 2016.
TIRAGE C-PRINT, 40 X 60 CENTIMÈTRES.
Irving Penn s’applique ici à un exercice de style que nombre d’artistes ont étudié dans l’histoire de l’art. Et si l’attention particulière qu’il porte à la structure des fleurs, leurs textures, palettes et anatomies rappelle les peintures des grands maîtres tel Chardin, le photographe semble explorer et repousser les limites du modernisme dans son traitement des sujets de la nature morte. Ses images prises chacune sur fond neutre, omettent le contexte et subliment la fleur, elles sont à la fois surprenantes et d’une beauté peu conventionnelle — déployées sur les pans de doubles-pages pour exposer aux lecteurs leur splendeur botanique, elles exhibent aussi leur fragilité, de leur floraison précoce à leur flétrissement. L’image, qui en réfère explicitement au réel, voit ici ce réel rendu fuyant, vulnérable jusqu’à un point de non-retour, par un choix de spécimens ayant passé la perfection, tachetés, légèrement déchirés, loin de l’esthétique glacée et chic de ses éditoriaux de mode. Il exprime ainsi son idée de la beauté, dégagée des conventions selon lesquelles une fleur doit être photographiée intacte, dans toute sa perfection. Une beauté imparfaite du fugace. Tout est paradoxal, déroutant chez Penn. Il trouve dans la fleur une perfection intrinsèque ne supportant aucune autre sorte de modification plastique, et aborde avec humilité leur fragile éclat.
DE LA POLITIQUE
Willem De Rooij & Jeroen De Rijke, Bouquet I, 2002
Certains artistes contemporains trouvent dans la fleur une puissance symbolique poétique et politique. Ouvrir le champ artistique aux emblèmes diplomatiques et à la grande Histoire, c’est libérer les fulgurances romanesques, les brèches poétiques venues s’infiltrer dans notre monde hyper-rationnel qui ne concorde plus avec la sensibilité des êtres. Contre la beauté intrinsèque et universelle, certains artistes — à la suite de l’art contextuel émergeant lors des années 80-90 — incorporent dans leurs œuvres politique et sociale, reprenant l’argument du philosophe français Jacques Rancière, selon lequel le « sensible » n’est pas le domaine exclusif de l’art, mais est aussi une dimension de la politique. Rancière considère la « division du sensible » comme un processus dans l’espace et dans le temps, les frontières entre l’art et la politique se veulent souples et dynamiques. L’art n’est pas « essentiellement politique » parce qu’il a une dimension politique, mais parce qu’il « configure un sensorium spatio-temporel qui détermine les modes d’être ensemble ou séparés, à l’intérieur ou à l’extérieur, en travers ou au milieu de. » Il se réfère à la division entre les images artistiques et non artistiques, problématisée dans la série des Bouquets, initialement commencée en 2002 par le duo hollandais Willem De Rooij et Jeroen De Rijke. À première vue, leurs compositions florales suggèrent un sentiment d’harmonie, par l’attention minutieuse du détail, où composition et palette sont méticuleusement pensées. Le spectateur glisse dans un plaisir sensoriel saturé de couleur, démonstration naturelle et simple de beauté. Cette forme de beauté la plus générale n’est pas un espace à part. Au contraire, la réalité, et toutes ses facettes imprévisibles, peut y pénétrer à tout moment : le bouquet, forme inoffensive et séduisante, est associé à un texte sur l’engagement hollandais pour la liberté irakienne. Le texte décrit la célébration de leur fête nationale par une délégation hollandaise en Irak, durant laquelle le commandant appelle à la lutte contre la menace de L’État islamique. Implicitement, Willem De Rooij et Jeroen De Rijke s’interrogent sur ce qui constitue les canons et se demandent dans quelle mesure ces derniers peuvent être déplacés, en affirmant qu’il n’y a pas de séparation entre l’éthique et l’esthétique. Peut être est-ce ainsi : lorsqu’on ne peut plus supporter, au risque de s’y noyer, l’intensité, la richesse, la complexité et la beauté d’une couleur, d’une forme, d’une odeur, un mot, une phrase balaient tout ceci pour agir en tant que détonateur, bien plus puissant que toute référence explicite.

WILLEM DE ROOIJ, BOUQUET VI. 100 TULIPES NOIRES, 100 TULIPES BLANCHES, VASE, SOCLE, DESCRIPTION ÉCRITE, LISTE DES FLEURS, VUE D’INSTALLATION À LA GALERIE CHANTAL CROUSEL, PARIS 2011.
AVEC L’AUTORISATION DE L’ARTISTE ET GALERIE CHANTAL CROUSEL.
PHOTO : FLORIAN KLEINEFENN.
À l’ère des grands enjeux politiques et idéologiques, Willem De Rooij et Jeroen De Rijke vont au-delà de l’examen des conventions esthétiques pour dégager le potentiel critique du beau : une cristallisation des sens radicalement modifiée en outil de réflexion incisif.
Kapwani Kiwanga, Flowers for Africa, Uganda, 2012
En reprenant le motif de la fleur, d’autres artistes s’intéressent à son exotisme dans ce qu’il a de construit, de factice. L’œuvre de Kapwani Kiwanga retrace un processus méthodologique pointilleux, fruit de recherches historiques, iconographiques et végétales qui entendent mettre en avant une autre réalité, loin des discours officiels qui ont fait l’histoire africaine. En révélant comment ces récits prennent forme dans les objets, la série Flowers For Africa (2012) questionne la matière dont est faite l’Histoire, sa fragilité, son infaillibilité, sa visibilité et sa hiérarchie.
Partant d’un long travail sur les archives visuelles liées à la décolonisation, Kapwani Kiwanga reconstitue à partir de documents iconographiques d’époque les bouquets de fleurs ayant été utilisés à des fins symboliques lors de cérémonies ou manifestations relatives à l’indépendance de pays africains. Des œillets, anémones et bougainvilliers sont mis en scène, témoins muets de grands moments historiques, du triomphe de Benyoucef Benkhedda en Algérie en 1962 à la négociation majeure entre Frelimo et le Portugal en 1975. La focalisation sur ces détails en apparence mineurs est associée à la tradition de la nature morte, aux symboliques complexes et chargées au sein de l’histoire de l’art.

Kapwani Kiwanga, Flowers for Africa : Nigeria, 2014. Dimensions variables, pièce unique.
Avec l’autorisation de la Galerie Jérôme Poggi.
Photo : Aurélien Mole.
Taryn Simon (dont l’œuvre révèle également les logiques cachées derrière les représentations et les discours officiels) voit dans ces bouquets, qui agrémentaient les tables de négociation aux lendemains des guerres d’indépendance africaines, des « potiches réduites à leur seule fonction décorative ». Fraîches et éclatantes pour le vernissage, les fleurs ne sont pas préservées. Elles laissent libre cours à leur cycle naturel, œuvre éphémère sur la mémoire passée ramenée à la vie pour être à nouveau considérée. Célébrations, dédicaces, commémorations, condoléances… voilà les actions, sentiments, et devoirs divers de cette œuvre qui entend réinterpréter les symboles de l’histoire.
De la symbolique
Maria Loboda, A Guide to Insults and Misanthropy, 2006
Dans le symbolisme complexe du langage des fleurs, Maria Loboda développe un art de la séduction dangereux, codifié de signes dans lesquels les craintes et les désirs se manifestent esthétiquement. Par-delà la sensualité des matériaux invoqués — fleurs, plantes vertes et autres herbacées — le contenu de ses pièces est délibérément opposé à leur mode de présentation, et les formes emblématiques y sont mouvantes.
Dans A Guide to Insults and Misanthropy (2006), les bouquets de Maria Loboda paraissent de prime abord bien innocents. Mais derrière l’élégance et la tranquillité de fleurs soigneusement sélectionnées, se cache un discours venimeux : le langage symbolique des fleurs à l’ère victorienne nous apprend que chaque plante représente un mot : le basilique sous entend la haine, l’œillet jaune est synonyme de dédain, et l’iris évoque l’horreur. Opérant par tromperie, Maria Loboda convoque une nature observée et lue, où les fleurs émergent en allégories d’insultes et autres épithètes, réorganisant nos icônes et semant le trouble. Dans cette sculpture verbale, rien n’est comme il paraît — et le bouquet innocent est supplanté par un effet trompe-l’œil chargé de sens. En insufflant dans l’univers sans faille du beau la possibilité d’une singularité, Maria Loboda réalise un travail subtil sur les marges ; l’aura esthétique est supplantée par l’impertinence.

Maria Loboda, A Guide To Insults and Misanthropy, 2006. Avec l’autorisation de l’artiste et de la Galerie Maisterravalbuena, Madrid.
Camille Henrot, Is it possible to be a revolutionary and like flowers ?, 2012
En se référant directement à l’ikebana, historiquement marginalisé, considéré comme le sous-produit d’un amateurisme charmant, et d’une création artistique mineure, la série de Camille Henrot, « Is it possible to be a revolutionary and like flowers ? » (2012) embrasse la nature morte florale dans toutes ses formes, esthétique et sémantique. Les fleurs délicates et les tiges torsadées des bouquets ponctués de vides et d’éléments incongrus, telles des plumes du Kansas séchées ou des tuyaux de machine à laver, appellent à une beauté réduite et ramenée à sa simplicité essentielle. Bien plus que des compositions animées d’une élégance naturelle, les bouquets de Camille Henrot sont des traductions florales de titres littéraires de grande envergure, de thèmes et de citations extraits des étagères de la bibliothèque personnelle de l’artiste. En attribuant ainsi à ses livres une existence purement matérielle, un retour à leur élément primitif, le végétal, Camille Henrot perpétue la pratique japonaise du bouquet dont l’assemblage des fleurs doit refléter l’état d’esprit de celui qui le réalise et fait basculer les interprétations simples, troublant les associations avec la culture et le genre. Si les ouvrages de Bronislaw Malinowsk (dont l’un des titres, Les argonautes du pacifique occidental illustre des feuilles de strelitzia savamment agencées) traitent bien peu de compositions florales, il faut aller chercher du côté de l’affinité entre fleurs et littérature. Car là est toute la pertinence de l’œuvre de Camille Henrot, qui sonde les idiosyncrasies culturelles, engendre des ré-interprétations interculturelles et contribue à créer sa propre re-création visuelle du monde. Le titre de ces arrangements floraux gracieusement équilibrés reprend les paroles d’un collaborateur de Lénine :« On commence par aimer les fleurs et bientôt l’envie vous prend de vivre comme un propriétaire foncier, paresseusement étendu dans un hamac et qui au milieu de son magnifique jardin lit des romans français et se fait servir par des valets obséquieux ».
Cette méfiance envers le caractère conformiste des fleurs rejoint la littérature, deux éléments agissant comme obstacles à la rébellion et à l’action, mais également comme matériaux lénifiants dans le cas de l’artiste qui commence à s’intéresser à l’Ikebana suite à la perte d’un être cher. Camille Henrot voit dans cette pratique un « espace privilégié » ayant vocation à apaiser celui qui le regarde, comme celui qui le compose. En utilisant la nature comme pinceau, les ikebanas-livres de Camille Henrot combinent des fragments disparates et des sentiments épars en un ensemble harmonieux d’éléments déracinés, coupés de leur contexte et réunis dans un tout hors du temps.
Nathalie Czech, Critic’s bouquet, 2015
À l’ère de l’horizon technologique et économique du monde globalisé, les messages s’envoient en quelques micro-secondes par un tweet et s’autodétruisent aussitôt sur Snapchat. Le petit bouquet de jacinthes, moyen de communication non verbale entre les amoureux signifiant selon la coutume victorienne, « votre beauté me charme » paraît bien désuet. Pourtant, c’est bien ce langage des fleurs, datant du XIXe siècle, que Nathalie Czech invoque dans sa série des Critic’s bouquet (2015). Oscillant entre poésie concrète et photographie conceptuelle, son œuvre cherche à traiter des mots en image et à (dé)composer une image par des mots.
Elle invite ici plusieurs critiques à écrire un court texte sur une œuvre ou une exposition de leur choix. Puis elle fournit une charte où chaque fleur correspond à une émotion ou un mot et demande aux auteurs de jumeler le sens de chaque phrase à un bouquet, qu’elle immortalise ensuite en photographie. Ainsi, lorsque Peter Scott choisit de faire un compte-rendu de l’exposition de Fischli & Weiss présentée à Documenta en 1987, sa phrase « Le comportement des objets, comme chez les gens, n’est jamais une chose sûre», se traduit en rhododendrons, fleurs évoquant l’éphémère et la tempérance. Le processus se répète ainsi pour chaque phrase, et le bouquet devient ainsi une polyphonie de descriptions, jouant sur la taxinomie, et le pouvoir palimpsestique des fleurs. Entrainant le spectateur dans un incessant va-et-vient entre le langage et la forme qui le contient, Nathalie Czech s’efforce de contenir son œuvre dans un cadre alors que tout tend à se déployer en dehors de ses limites, comme pour libérer le sens des mots. Elle rejette la hiérarchie rigide des arts sensoriels et intellectuels et articule sa pratique à rebours de la tradition occidentale qui favorise le décoratif au détriment du sens. Dévoilant de nouvelles perspectives visuelles au spectateur, les gerbes flamboyantes de Nathalie Czech décodent et recodent la petite marguerite.
Du décoratif
Marc Camille Chaimowicz A Charged Frivolity, 1992-1993
L’art contemporain semble trouver dans le motif floral un sujet décrépi. Pourtant, de sa décadence, de son langage sophistiqué de couleurs et de formes, des artistes tels John Armleder ou Marc Camille Chaimowicz s’émancipent de la soi-disant obsolescence du sujet pour reposer les questions essentielles de la peinture et ses dérivés : celles du motif, du kitsch, de la limite entre abstraction et figuration, celles d’un médium pour certains considéré comme dépassé, pour d’autres comme synonyme de l’art — et s’interrogent sur ce qui la différencie du décorum.
De cette volonté de brouiller les catégories, dates et grands styles du modernisme, l’univers hybride de Marc Camille Chaimowicz se joue de la désuétude du motif floral et de sa donnée humoristique. En réponse à un art contemporain qui cherche à atomiser les frontières entre art et vie, Chaimowicz entrelace frises d’orchidées et d’iris, en confirmant son intérêt pour le décoratif comme art envahissant, enivrant, omniprésent. Cette célébration du low s’applique à nos zones domestiques de subversion douce, où les éléments décoratifs qui absorbent nos regards participent de la transformation du réel, et non de la reproduction des conventions. En mettant en situation des éléments de mobilier — fauteuils crapaud, paravents, papiers peints et buffets — dans d’élégants intérieurs bourgeois surannés, les fleurs prennent alors la même valeur décorative qu’un motif de tapisserie, anti-hiérarchique, privilégiant l’ornement sur une conception globale de l’œuvre. En se recentrant sur les détails et fioritures, l’artiste exalte la dimension affective des objets avec lesquels nous vivons. Le motif floral incarne chez Chaimowicz une vie intime, découlant d’un passé ouaté, dont les couleurs pastels confèrent une tonalité fanée et passéiste à ses mises en scène proustiennes. Ces célébrations de la vie réelle procèdent d’une comique fusion du temps et de sentiments : mélancoliques et artificielles, elles mettent en scène une sentimentalité de la fleur qui se joue d’elle-même.
John Armleder, Furniture-Sculpture, 2016
Ainsi, les fleurs resurgissent soudain au milieu de préoccupations que l’on imaginait uniquement formelles, détournant les modèles du modernisme et du minimalisme en les dotant d’une valeur d’usage courant, nourrie par la culture de masse et l’entertainment.
Entre la norme industrielle et le standard artistique, John Armleder, dans ses Furniture-Sculpture ne semble pas vraiment soucieux de choisir son camp, préférant zigzaguer de l’une à l’autre dans l’indétermination des références. Initiée en 1979, cette série fait directement référence aux ready-made duchampiens en mariant un meuble domestique, tel qu’une chaise ou une table, à une peinture abstraite. Par leur modestie, ces sculptures se réfèrent à des parcelles de vie, en déplaçant par exemple des stands de fleurs des épiceries new-yorkaises entre les cimaises d’une galerie. Tulipes, pivoines, roses, sont élevées ici au rang de sculptures sur socles en plastique, moins dans une logique de transgression que de mise à mal de la valeur artistique, semblant souligner l’inévitable réification de l’art, la fatalité de procéder à son propre pastiche. La démarche d’Armleder atteste de la valeur décorative de l’art, composé d’éléments interchangeables et vides du moindre message. Cette dichotomie entre l’art et la vie, où tout est considéré au travers de rapports d’équivalence, remet en question le statut de l’œuvre, les idées de style et de décoration, tout en portant un regard ironique et distancié sur l’académisme du motif floral.

John M Armleder, While, 2016.
Peinture sur toile, 215 x 150 x 6 cm.
John M Armleder, Shishito Peppers, 2016.
Acrylique sur toile, panneaux de bois laqués, fleurs vivaces, pots métalliques, 233,68 x 731,52 x 121,92 cm.
Avec l’autorisation de l’artiste et Galerie Almine Rech
© John M Armleder Photo: Matt Kroening.
Spectroscopie
Vincent Beaurin
Alchimiste de la couleur, Vincent Beaurin dévoile au curateur Domenico de Chirico lapuissance cosmogonique de ses sculptures et en commente la dimension décorative.
Cher Vincent,
en tant que sculpteur, votre approche de la forme semble passer par la couleur, de sorte que l’on pourrait presque vous définir comme un peintre. Vos « spots » sont autant de repères qui viennent rythmer l’espace.
J’ai pu lire sur votre site internet un essai de 2016, intitulé Sur la peinture, dans lequel vous écrivez : « Il arrive que par une œuvre, on ressente
une présence. À ce propos, j’aime beaucoup la théorie des intermédiaires développée par Oleg Grabar dans son livre, L’Ornement, formes et
fonctions dans l’art islamique. » Pouvez-vous m’en dire un peu plus ?
Quel est le lien entre la peinture, cette pensée de l’ornement et vos œuvres ? J’aurais également aimé connaître votre rapport à la nature.
Quelle a été son importance dans votre parcours artistique ?
Enfin, je ressens dans vos sculptures une dimension quasi spirituelle.
La cosmogonie (du grec cosmo — « monde » et gon — « engendrer »)
est définie comme un système de la formation de l’univers. Par ses jeux d’échelles, son rapport à la lumière, ses abstractions, pourrait-on dire
de votre œuvre qu’elle est cosmogonique ?

Vincent Beaurin, Spot couleurs, 2016, polystyrène, verre, Ø 71 x 13,5 cm.
Pièce unique.
Bien à vous,
Domenico Milan, février 2017
Cher Domenico,
Voici ma réponse à vos questions, à part celles qui concernent mon rapport à la nature et l’importance de celle-ci dans mon parcours artistique, que je n’ai pas réussi à comprendre et devant lesquelles, je déconnecte et tombe en dissociation.
Il y a encore quelques temps, je réfutais l’idée de discontinuité entre toutes les choses qui existent dans le monde. Aujourd’hui, mon regard a un peu évolué. Les corps se distinguent et s’identifient par leurs contours, leurs limites.
Mon travail de sculpteur consiste à résoudre ou équilibrer les pressions réciproques, notamment entre un corps en formation et l’espace qui le contient ou l’espace et un corps qui vient l’encombrer, sans oublier tout ce qui occupe déjà l’espace. Plus loin, il est possible que la plénitude de l’espace impose la sphère comme forme, volume ou résolution. De même, si un objet ou une figure réclame de plus en plus de précision dans l’élaboration de ses contours, il y a de fortes chances que l’on obtienne des surfaces, des volumes, des corps de résolution quasi mathématique. L’air ou le gaz, ainsi que le souffle paraissent tenir un rôle important dans cette « approche ». Les volumes semblent souvent avoir été gonflés comme des ballons, bien que ma technique et mes outils soient très rudimentaires voire rustres : scier, gratter, arracher. La peau est le lieu et l’organe de ces opérations, de ces échanges. Elle enregistre et porte les traces de toutes les frictions, affections, érosions, projections de toutes parts, une peau tendue, mais rugueuse voire écorchée, un peu comme le présent, coincé, raboté et abrasé entre les deux géants, passé et futur, à tel point même que beaucoup d’objets ressemblent à des débris broyés et inertes. Et c’est ainsi que sur cette croûte épidermique vont se refléter les couleurs qui à la différence des objets n’ont pas d’autres contraintes que l’apparition et la disparition, d’autre champ qu’entre lumière et obscurité. Sur ce sujet, je me demande si Newton ne nous aurait pas livré une allégorie spagyrique ou alchimique concernant le potentiel éblouissant de la couleur, plutôt que sur la nature prétendue composite de la lumière.

Vincent Beaurin, Spot couleurs, janvier 2017, polystyrène, verre, Ø 71 x 13,5 cm. Pièce unique.
Photographies Sonia Beaurin 2017.
Post-production Grégory Copitet.
La couleur pourrait se révéler un domaine, comparable aux mathématiques et à la physique nucléaire. Je parle de ce qui se cache dans la couleur comme ce qui se cache dans l’intimité de la matière. J’ajoute qu’il y a deux types de lumière, celle qui éclaire les objets et qui se distingue de l’ombre, et celle pour laquelle les mêmes objets ou corps ne constituent pas des obstacles ni des écrans et que l’on ne commence précisément à percevoir que dans la nuit. Les couleurs peuvent être celles de la matière, des ondes, de l’énergie, du paysage, bucolique ou urbain. Elles peuvent être atmosphériques ou signalétiques, troubles ou limpides, simples ou complexes, sombres ou claires, mates ou brillantes, opaques ou transparentes, etc. Les couleurs ne se figent pas. Elles se reflètent les unes dans les autres. Elles dialoguent. Avec nos yeux elles jouent une partie de va-et-vient continue. Tout l’univers vibre dans la couleur, en contrastes, des plus nocifs assemblages aux plus puissantes harmonies, des expressions les plus crues aux plus subtiles et sophistiquées. La couleur ne se fige pas. Elle évolue sans cesse dans sa plénitude. Elle a aussi le pouvoir de se présenter alternativement comme individu et comme collectif. Comme l’ocelle de la plume d’un paon ou d’un papillon, la couleur attire, absorbe, projette et regarde.
Et les « spots » en référence à un lieu particulier plus qu’à un appareil d’éclairage, s’assimilent à des yeux comme à des astres dans un univers rayonnant ou explosif dans lequel les vides, les trous, les absences, sont autant d’ailleurs possibles, à l’inverse d’une ébauche linéaire comme l’histoire, qui voudrait tout ordonner dans le temps sans souffrir ou supporter la moindre interruption ni dissociation, entre un début et une fin que jamais elle ne saisit et qui menace constamment de s’effondrer sous la lourdeur des commentaires que seule elle suscite et génère.
Si j’étais peintre, ce qui était le cas pendant une dizaine d’années au début de ma pratique, je ferais exactement ce que je fais. De même, les spots sans se conformer à la fenêtre, seraient des tableaux et plus particulièrement, des tableaux de paysage.

Vincent Beaurin, Spot couleurs troubles, 2015, polystyrène, verre, ø 71 x 13,5 cm.
Pièce unique.
« L’ornement issu de la nature est peut-être un véritable démon, au sens particulier d’intermédiaire actif et essentiel que Platon donne au mot daimôn. Les artistes chinois et leur imitateurs en Iran, en Turquie ou en Occident, conscients de ces qualités démoniaques, donnaient à leurs volutes végétales des formes contorsionnées évoquant des dragons, quand ils ne voyaient pas directement un dragon dans chaque volute. Car l’ornement naturel — quelle que soit la manière dont il est perçu et où qu’il se trouve — conduit toujours ailleurs qu’à lui-même; il assure la médiation entre l’œuvre d’art et le spectateur, entre l’objet et la personne qui en fait usage. »
Oleg Grabar, L’Ornement, Formes et Fonctions dans l’art islamique Flammarion, Paris, 2013, p. 303.
Une œuvre d’art comme intermédiaire ou vecteur, c’est aussi quelque chose qui ne se décrit pas par des termes finis. Ce type d’œuvre n’est pas une fin en soi, bien que son élaboration ainsi que son usage requièrent une grande attention.
Sous mes pieds et autour de moi ne me paraît pas très stable ni très solide ou fiable. Il me semble souvent que je dérive et cela m’angoisse un peu, ivre ou désemparé. Ainsi, passant le plus clair de mon temps dans le cosmos où il y a beaucoup moins de monde que dans la ville, il m’arrivait aussi de souffrir de solitude ou d’isolement. Alors j’élabore et produis des repères pour me situer, mais aussi auxquels me fier. Et ces repères, ces lieux ou ces corps, par une sorte d’efficience ou de vitalité qui les occupent ou les animent, manifestent une présence et un ailleurs qui m’apaisent. Voilà le paysage ! Un paysage suffisamment vaste et ouvert pour que d’autres que moi y trouvent leur place ou puissent s’y inscrire.

Vincent Beaurin, Spot couleurs, 2016, polystyrène, verre, Ø 71 x 13,5 cm.
Pièce unique.
« J’ai parlé de la vanité de l’art, mais pour être sincère, j’aurais dû dire aussi les consolations qu’il procure. L’apaisement que me donne ce travail de la tête et du cœur réside en cela que c’est ici seulement, dans le silence du peintre ou de l’écrivain, que la réalité peut être recréée, retrouver son ordre et sa signification véritables et lisibles. Nos actes quotidiens ne sont que les oripeaux qui recouvrent le vêtement tissé d’or, la signification profonde. C’est dans l’exercice de son art que l’artiste trouve un heureux compromis avec tout ce qui l’a blessé ou vaincu dans la vie quotidienne, par l’imagination, non pour échapper à son destin comme fait l’homme ordinaire, mais pour l’accomplir le plus totalement et le plus adéquatement possible. »
Lawrence Durrell, Le Quatuor d’Alexandrie,
Librairie Générale Française, Paris, 2009, p. 27.
Et pour finir, de près ou de loin, l’univers dans toutes ses dimensions, n’est-il pas un nuage de particules scintillantes ou un miroir qui ne demande qu’on le traverse ?
Vincent Beaurin Symi, mars 2017
Figures de style
ORLANDomenico de Chirico
Le commissaire et critique Domenico de Chirico s’entretient avec ORLAN, figure emblématique d’un art féministe, singulier et politique depuis plus de quarante ans.
Domenico de Chirico Puis-je vous demander de choisir quelques adjectifs qui décrivent pleinement les spécificités de votre carrière artistique ?
ORLAN Mon engagement et ma liberté font partie intégrante de mon travail, je défends des positions qui me semblent innovantes et subversives. Je cherche à dérégler les règles et à briser les conventions, les prêt-à-penser. Je m’oppose au déterminisme naturel, social et politique, à toute forme de domination, à la suprématie masculine, la religion, la ségrégation culturelle et au racisme.
Domenico de Chirico Votre rapport à votre corps, tant dans votre pratique artistique que dans votre intimité, a-t-il changé ?
ORLAN Non, pas du tout. Je continue toujours d’effectuer les mêmes performances que lorsque j’étais au début de ma carrière d’artiste, telles que les mesuRages où je me servais de mon corps comme instrument de mesure. Je suis de plus en plus créative et je n’ai pas la sensation que mon âge devrait avoir une conséquence sur ma manière de percevoir et de créer avec le corps. Dans la vie, nous n’avons pas un corps mais des corps…
Domenico de Chirico Comment définiriez-vous le dualisme entre corps vécu et corps anatomique? Pensez-vous que les deux peuvent être associés à ces concepts qui vous sont si chers de « défiguration » et de « réfiguration » ?
ORLAN L’anatomie n’est plus un destin. Ce qui m’a paru important c’est de remettre en question l’inné, en m’attaquant à son « masque » pour créer sur mon propre visage un autoportrait où s’affiche de la différence, ma différence. De manière à ce que mon vécu prime et que mon corps et mon visage soient à la fois une meilleure carte de visite et une carte de visite non normée. J’estime que notre corps nous appartient et que nous pouvons l’utiliser comme support pour concrétiser nos projets de société et que nous pouvons les y inscrire visuellement. Pour ma part, j’ai fait de mon corps le support, la matière première et l’outil visuel de mon travail : il est devenu un lieu de débat public.
Domenico de Chirico Est-ce que « excès » rime avec « spectacularisation » ?
ORLAN En ce qui me concerne, les œuvres que j’ai produites et qui ont pu être qualifiées d’excessives n’étaient pas gratuites. Je n’ai jamais voulu me donner en spectacle pour attirer l’attention et satisfaire un quelconque ego d’artiste. J’ai fait ce que je pensais devoir faire pour faire évoluer les mentalités. En tant qu’artiste, je me suis positionnée dans le monde et j’ai essayé d’être une chroniqueuse éclairée de mon temps. Mes œuvres sont motivées par des idées et des réflexions profondément ancrées dans les problématiques contemporaines.
Domenico de Chirico Avez-vous en ce moment un désir que vous voudriez voir se réaliser ?
ORLAN Adolescente, je voulais être exploratrice ou batteuse dans un groupe de musique. Dernièrement, les Chicks on Speed m’ont proposé de travailler avec elles. Nous prévoyons de sortir un EP sur vinyle et de faire une tournée dans plusieurs institutions culturelles dans le monde, où nous pourrions donner lieu à nos performances artistiques et musicales.
Domenico de Chirico Pourquoi ORLAN ?
ORLAN Changer de nom est dans l’esprit de l’invention de soi. Après une séance de psychanalyse, je me suis rendu compte que j’oubliais des lettres de mon nom parental et que je signais « morte » sur mes chèques. J’ai voulu réutiliser les syllabes qui produisaient une connotation positive en conservant le mot « or », j’ai ensuite rajouté « LAN » et à partir de ce moment, je me suis appelée ORLAN.
Je suis ORLAN, entre autres et dans la mesure du possible, mon nom s’écrit chaque lettre en capitale car je ne veux pas que l’on me fasse rentrer dans les rangs, dans la ligne.

ORLAN, Self-hybridations Africaines, 2000-2003.



Perforations
William E. Jones
Artiste, réalisateur et critique, William Jones revient sur la captivante histoire des clichés perforés par la Farm Security Administration.
Le site de la bibliothèque du Congrès explique dans le texte qui suit les objectifs et le contexte de mise en œuvre de la Collection de la FSA.« Les photographies de la Farm Security Administration – Office of War Information Photograph Collection [Collection de photographies du bureau de l’information de guerre] constituent un important recueil d’images sur la vie aux États-Unis entre 1935 et 1944. Ce projet à l’initiative du gouvernement américain a été en majeure partie dirigé par Roy E. Stryker, auparavant professeur d’économie à l’université de Columbia.
Au départ, le projet visait à récolter des données en image sur l’impact des subventions accordées aux paysans par la Resettlement Administration [Agence pour le relogement] et sur la construction de villes nouvelles de banlieue. La seconde étape consistait à s’intéresser à la vie des métayers dans le Sud et des ouvriers agricoles migrants dans les États du Midwest et de l’Ouest. À mesure que le champ d’investigation du projet prenait de l’ampleur, les photographes se sont attachés à recueillir des images témoignant des conditions de vie sur l’ensemble du territoire américain, aussi bien à la campagne qu’à la ville, et des efforts de mobilisation pour la Seconde Guerre mondiale.
La collection comprend les clichés réalisés par les photographes de la section Stryker, laquellea fonctionné tour à tour sous la tutelle de plusieurs agences gouvernementales : la Resettlement Administration (1935-1937), la Farm Security Administration (1937-1942), et l’Office of War Information (1942-1944). Au total, elle rassemble environ 171 000 négatifs et diapositives en noir et blanc, 1610 diapositives couleur et environ 107 000 tirages en noir et blanc obtenus pour la plupart à partir de ces mêmes négatifs et diapositives. Elle a été transférée à la Bibliothèque du Congrès en 1944.
Les photographes de la section de Roy Stryker étaient envoyés en reportage à travers tous les États-Unis et à Puerto Rico, mais le siège se trouvait à Washington. L’agence distribuait l’équipement photographique et les pellicules, établissait les budgets, allouait les fonds pour les voyages, embauchait le personnel, développait, imprimait et répertoriait la plupart des négatifs, contrôlait les pellicules développées, révisait les légendes des photographes rédigées sur le terrain et les conservait dans des dossiers avec les négatifs et les tirages. Elle se chargeait également de fournir des clichés aux journaux, aux magazines, aux maisons d’édition, et aux organisateurs d’expositions.
Les photographes de l’équipe se voyaient confier des sujets spécifiques et/ou des zones géographiques à couvrir. Ces missions sur le terrain duraient souvent plusieurs mois. Afin de se familiariser avec le sujet à traiter, avant de les entreprendre les photographes lisaient divers rapports, quotidiens locaux et ouvrages. Un canevas préalable était fréquemment mis au point pour les prises de vue. Les photographes étaient encouragés à fixer sur pellicule tout ce qui pouvait apporter un éclairage supplémentaire au thème de leur reportage et étaient par ailleurs formés à la prise de contact avec le public concerné et aux techniques d’entretien.
Le plus souvent, ils envoyaient par la poste au laboratoire de l’agence à Washington leurs négatifs exposés pour le développement, le classement et le tirage. Durant les premières années du projet, c’est Stryker, et pratiquement lui seul, qui se chargeait de vérifier les planches contact réalisées à partir des négatifs et de sélectionner les images qui lui semblaient mériter un tirage. Avec le temps, cependant, les photographes ont commencé à jouer un plus grand rôle dans le choix des clichés à conserver. Les images rejetées étaient classées ‹ éliminées ›. »
Roy Stryker, directeur de la FSA, perforait systématiquement les négatifs 35 mm éliminés qui devenaient ainsi inutilisables. Walker Evans, Theodor Jung, Carl Mydans, Marion Post Wolcott, Arthur Rothstein, Ben Shahn et John Vachon ont vu leur travail détruit, sans pouvoir l’empêcher. Certains des photographes qui travaillaient pour la FSA (en particulier Evans) protestèrent vigoureusement contre cette pratique éditoriale tenue pour arbitraire et destructrice. En 1939, Stryker cessa finalement de percer des trous dans les négatifs de ses employés. Avant cette date, deux photographes avaient évité la destruction de leurs négatifs : Dorothea Lange, qui développait ses pellicules dans sa propre chambre noire en Californie et dont le mari, Paul Taylor, occupait dans le gouvernement un poste hiérarchiquement supérieur à celui de Stryker et Russell Lee, de loin le photographe le plus prolifique de la FSA, et celui qui respectait aussi scrupuleusement que possible les consignes de prises de vue de Stryker, en généralsans se plaindre. En dehors des images elles-mêmes, il existe très peu d’éléments pour témoigner de la pratique des négatifs éliminés. De plus, Stryker ne fournissait pas de justification. Ce qui suit relève en grande partie de l’hypothèse, mais une hypothèse nourrie par l’étude de centaines de photographies.
Si on laisse de côté la question de savoir pourquoi quelqu’un percerait un trou dans une pellicule de 35 mm exposée, quand une note pour l’imprimeur aurait suffi (par exemple « sauf les clichés 10 à 12 »), on peut deviner qu’un jugement brutal a motivé la destruction de certains négatifs. Bien sûr des photos sont meilleures que d’autres : plus accomplies sur le plan technique, plus réussies sur le plan esthétique, plus cohérentes du point de vue idéologique, plus utiles sur le plan politique. Les clichés flous et sans préparation de Marion Post Wolcott — un portrait cadré au-dessous de la ceinture sans doute pris au bar d’un fast-food, l’autre sans doute avant que la lentille ne soit correctement fixée sur l’appareil — ne satisfont pas aux critères en vigueur en matière d’art photographique dans les années trente. La photographie de John Vachon montrant un conducteur de tram vu de dos pourrait être l’œuvre d’un touriste venu visiter Omaha, si Omaha avait été un lieu touristique pendant la crise de 1929. Celle de Ben Shahn, à la composition artistique, figurant un camelot grimé en caricature de Noir en train de présenter des potions, à peine visible derrière des rangées de chapeaux flous (page 173) compte parmi les plus susceptibles de choquer. Celle de Theodor Jung représentant une vitrine de drugstore dans l’Ohio que décore une affiche de film de Mae West est charmante, mais n’a probablement été d’aucune utilité dans la mission de la FSA.
En examinant des séries de négatifs éliminés, on peut percevoir certaines constantes. Les poinçonnages semblent parfois sanctionner le gaspillage de pellicule, tout en exprimant une préférence éditoriale. Les négatifs de la série de portraits réalisée par Theodor Jung d’une enfant avec sa poupée et un chat dans une niche recouverte de journaux ont pour la plupart été perforés, mais si l’on a un peu d’expérience dans la photographie d’enfants et d’animaux on sait qu’il est judicieux de réaliser de multiples prises de vue dans une telle situation. Le même principe s’applique aux clichés de John Vachon représentant deux fillettes vêtues de robes à fleurs identiques (page 172). Aucun n’est particulièrement mauvais ; la silhouette adulte désarticulée et floue qui équilibre la composition leur confère un caractère assez moderne. Un observateur de l’ère digitale
— dans laquelle un professionnel a la possibilité de prendre des milliers de photographies par jour — peut apprécier l’esprit d’économie avec lequel travaillaient les photographes de la FSA, qui réalisaient de magnifiques clichés en utilisant très peu de pellicule. Roy Stryker semblait insensible à cette prouesse et on se le représente sans peine en dictateur mesquin quand on regarde ces séries de négatifs éliminés. Certaines des préférences de Stryker sont évidentes : il voulait une mise au point impeccable pour tous les sujets photographiés et, à l’instar des réalisateurs de films conventionnels, il ne supportait pas que le sujet regarde directement l’objectif.
Détruire les négatifs lui permettait également d’asseoir son autorité sur les photographes, en particulier au début d’une relation de collaboration. Certains, comme Jung, n’ont pas supporté d’être dirigés par Stryker et sont partis au bout de peu temps ou, comme Evans, ont entretenu la plus grande distance possible avec le personnel de Washington. D’autres ont tenu bon et produit un important corpus. Le plus tenace fut John Vachon, coursier assistant à la FSA, qui après un certain nombre de shootings à l’essai, a finalement été intégré à l’équipe. Ses négatifs font partie de ceux que l’agence a le plus éliminés. Ils sont une preuve de la détermination avec laquelle il a surmonté un apprentissage frustrant.
L’emploi frénétique que Roy Stryker faisait du poinçon, aussi chargé d’implications psychologiques qu’il soit, recelait par ailleurs des implications politiques. Bien entendu, il souhaitait montrer qu’il savait repérer un bon photographe quand il en voyait un, mais ce faisant, il cherchait à contrer les Néandertaliens qui régnaient dans les couloirs du congrès américain. Doué pour la politique, il a pendant plusieurs années protégé avec succès la FSA des nuisances bureaucratiques dues aux à des controverses périodiques (et parfois ridicules).
Le sénateur de l’Indiana Homer Capehart, ou plus probablement son équipe de conseillers, a examiné les photos contenues dans les dossiers de l’organisme afin de trouver parmi les dizaines de milliers disponibles les plus banales et les plus neutres sur le plan esthétique. Le résultat de ce travail acharné a été publié dans le numéro du magazine Life du 7 juin 1948. Sous le titre « Senator on Warpath » [Le sénateur sur le sentier de la guerre] — plutôt que « Flogging a Dead Horse » [Coup d’épée dans l’eau] qui aurait été plus adapté à une attaque sur une agence ayant cessé d’exister cinq ans auparavant — la double page montrait Capehart dans un fauteuil « observant attentivement les photographies qui le choquaient ». À l’inverse du cliché d’une église de la Nouvelle Angleterre recouverte de neige, donné en exemple, des photos tout aussi quelconques (bien que moins appréciables du point de vue conventionnel) réalisées par Russell Lee, David Myers, Marion Post Wolcott, Arthur Rothstein et d’autres encore étaient tournées en ridicule car considérées comme du gaspillage d’argent public. Étrangement le sénateur fut incapable de s’exprimer quant à leur faiblesse artistique. Sous le cliché d’une pile de briques, la légende indique « Capehart était trop scandalisé pour faire un commentaire ». Les rédacteurs en chef de Life n’utilisèrent pas les photographies de Walker Evans ni celles de Carl Mydans dans cet article, peut-être pour éviter de donner l’impression qu’il s’agissait simplement d’une farce sadique aux dépens de deux anciens photographes de la FSA travaillant à cette époque pour l’empire de l’édition d’Henry Luce.
L’année 1948 vit l’apogée de l’anticommunisme américain avant que le sénateur McCarthy lui donne très mauvaise réputation. Sans aucun doute le sénateur Capehart souhaitait-il prendre le train en marche en attaquant un programme gouvernemental perçu comme « rouge » dans les cercles conservateurs. Peu importe que Roy Stryker ait eu du mal à exclurede la FSA quiconque avait des fréquentations communistes, et que les objectifs de l’agence aient été à mille lieues de fomenter une révolution. Le projet d’une documentation du quotidien des citoyens privés de leurs droits portait la marque du New Deal, et attaquer l’héritage de Franklin Roosevelt fut l’idée la plus judicieuse des hommes politiques réactionnaires de la période post Seconde Guerre mondiale. Les explosions de colère de Capehart en public lui permirent de conserver son activité et d’entretenir sa popularité pendant trois mandats en tant que sénateur jusqu’à ce qu’il attire le mécontentement du leader de la majorité du Sénat, Lyndon Johnson, lui aussi loin d’avoir la langue dans sa poche. Au cours d’un très long débat au sujet des allocations destinées aux logements sociaux, Capehart lança à Johnson : « Cette fois, je vais te mettre le nez dans le caca ». Il ne le fit pas. Le camp de Johnson l’emporta, et un peu plus tard, en 1962, Capehart perdit de peu son siège au bénéfice de Birch Bayh. Aujourd’hui on se souvient surtout d’Homer Capehart pour son surnom au Sénat, « le Néandertalien de l’Indiana ».
Même si le sénateur Capehart et les siens ont perdu la bataille, si l’on se réfère à une autre grande dépression — sans majuscules cette fois, car elle n’a pas été officiellement reconnue en tant que telle — on peut dire que les réactionnaires ont réalisé d’énormes gains. Les programmes d’aide fédéraux ont été compromis ou progressivement supprimés quand près d’un millier de milliards de dollars de subventions aux sociétés se sont volatilisés. (Le principe d’un billion en dépenses publiques est lui-même assez récent ; le projet de la FSA aura coûté au total 750 000 en dollars de 1940.) Le gouvernement américain n’a pas accordé d’aide directe aux photographes, ni aux artistes en général, depuis de nombreuses années. Les démagogues d’extrême droite qui auraient donné le vertige au Père Coughlin essaient maintenant de plaire à la classe ouvrière délogée et sans emploi. La pratique respectable de l’art du portrait à l’époque du New Deal a laissé place au désespoir de la téléréalité, un genre que George Orwell aurait réprouvé pour la simple raison que son nom relève d’un abus de langage. Même le discours politique du plus haut niveau est devenu vulgaire, comme a pu le constater Patrick Leahy lors d’un débat passionné au sujet des profiteurs de guerre, quand un récent président du Sénat, qui a largement tiré profit de la guerre, lui a dit d’aller se faire voir.
Mais pour revenir au thème de cet article, la pratique de la photographie documentaire socialement engagée est tombée en disgrâce alors qu’elle serait bien opportune à l’époque actuelle. L’économie américaine a connu des changements structurels. Des dizaines de millions de personnes se retrouvent sans emploi et sans carrière. Confrontée à la crise, la culture officielle a recyclé ses produits dans des remakes hollywoodiens toujours plus ennuyeux ou, dans une sphère plus restreinte qui rassemble moins de capital, avec des œuvres d’art peu originales et autoréférentielles. Nous ignorons que nous vivons une dépression car personne ne nous en a proposé d’image ; on n’en a pas conscience sauf bien entendu lorsqu’on se retrouve à vivre dans sa voiture sans emploi ni couverture sociale. Même si culturellement, nous tournons le dos au désastre économique du XXIe siècle, le passé peut nous transmettre ses leçons. Les États-Unis, en dépit de leurs errements, possèdent des archives d’une transparence et d’une accessibilité inégalées. Des millions de fichiers numériques, pas seulement les « greatest hits », mais aussi les plus obscurs, ceux qui ont subi des altérations et des mutilations sont accessibles au regard et au pouvoir de l’interprétation pour qui a la patience d’aller les chercher, et le fait-même que ce soit possible peut nous donner de l’espoir.












Secret constellation
Mai-Thu Perret
Depuis plus d’une quinzaine d’années, l’artiste Suisse Mai-Thu Perret a mis en place uneœuvre tentaculaire composée de textes, sculptures, vidéos et performances. Regroupé sous le projet global « The Crystal Frontier », ce récit protéiforme documente la vie d’un groupe de femmes installé au Nouveau-Mexique. Cette communauté utopique, entièrement fictive, permet à la plasticiennede questionner des sujets aussi variés que le patriarcat, la croyance ou encore la place de l’objet dans notre quotidien. Justin Morin s’entretient avec Mai-Thu Perret à propos de ses multiples jeux référentiels, de l’esthétisme de ses pièces et de son approche de la production.
Justin Morin L’une des premières fois où j’ai pu découvrir ton travail, c’était dans un contexte qui n’est pas évident, puisque c’était pendant la Biennale de Venise de 2011, dans l’Arsenal. C’est un endroit compliqué car beaucoup d’œuvres doivent y coexister. Pourtant je me souviens très bien que ton travail s’y détachait.
Mai-Thu Perret Je présentais un ensemble de trois pièces : un mannequin, un néon abstrait et sa réplique qui était assez difficile à voir puisqu’il s’agissait d’une peinture murale en blanc sur blanc. Avec ce double quasi invisible, l’idée était de faire une sorte d’image rétinienne, une persistance. Au moment où j’ai créé ces pièces, je réfléchissais beaucoup aux migraines. Elles sont parfois de nature ophtalmique : c’est extrêmement désagréable, ce sont des petites taches qui apparaissent à l’intérieur de l’œil. Cette ombre blanche agissait un peu comme un rappel de ces effets.
JM De manière générale, le néon a cette capacité très forte à capter le regard. Mais le tien n’est pas qu’un pur objet graphique, il est une citation empruntée à une grande figure de l’histoire de l’art…
MTP Tout à fait, il est directement inspiré d’un dessin d’Agnes Martin que j’ai trouvé dans un livre. En 2005, il y a eu une très belle exposition qui lui était consacrée, ainsi qu’à Emma Kunz et Hilma af Klint, au Drawing Center de New York. Elle s’intitulait 3 X Abstraction et questionnait l’idée du spirituel dans l’abstraction. Elle évoquait notamment le fait que cette pratique méditative, entre ésotérisme et guérison, est spécifiquement féminine. Pour en revenir au néon, il ne faut pas oublier que c’est initialement un matériau publicitaire. Ce que je trouve beau, c’est que tu peux le voir partout, dans toutes les villes. C’est aussi une forme d’écriture ; quand les néonistes tordent les tubes de verre, c’est vraiment comme du dessin. J’ai malgré tout quelques réserves par rapport à l’utilisation des textes en néon dans les expositions d’art contemporain, que je trouve parfois un peu trop évidents. C’est pour cela que je vais personnellement vers l’abstraction.
JM Le mannequin présenté à Venise portait une robe de Schiaparelli.
MTP Cette robe m’a toujours fascinée, c’est une vieille obsession ! J’ai tendance à travailler comme ça, autour d’objets ou d’idées qui m’obsèdent. Je procède souvent par appropriation, c’est une manière de comprendre les choses. Schiaparelli est un personnage intéressant, en relation avec l’avant-garde et les surréalistes. Cette robe est d’ailleurs une collaboration avec Dalí. Avant de l’exposer à Venise, je l’ai utilisée dans une vidéo que j’ai réalisée il y a quelques années. Il s’agit d’un film en 16mm dont l’héroïne est une amie musicienne. J’ai donc fait réaliser une copie de la robe, aux mensurations de mon actrice, d’après des photographies fournies par le Victoria & Albert Museum qui détient l’originale. Le film est une errance qui commence à Londres, devant la station de métro de Tufnell Park et qui se poursuit vers Hamsptead. L’héroïne marche dans le parc, qui est un endroit étrange, une immense oasis de verdure dans le centre de Londres. Elle chante une chanson élisabéthaine très mélancolique. Il s’agit d’un titre de John Downland, un musicien anglais du XVIè siècle,intitulé In Darkness Let Me Dwell, qui est devenu le titre du film. Je voulais ensuite qu’elle aille nagerdans les ponds, les espèces de piscines que l’on retrouve à Hampstead. Ce sont des endroits très beaux, des étangs complètement entourés de verdure. Malheureusement, il nous a été impossible d’obtenir une autorisation de filmer, cela nous aurait coûté tellement cher qu’on s’est finalement dirigés vers un autre endroit. Nous sommes allés sur la côte, dans le Kent, à Dungeness. Le paysage y est un peu marécageux, avec plein de ruines et de bunkers, c’est assez sauvage. Et donc l’héroïne passe de Hampstead au bord de la mer à Dungeness, elle enlève sa robe et plonge sous l’eau. Le film se boucle et reprend à Tufnell Park. C’est un parcours entre underground et overground, traversé par l’idée d’un monde souterrain. Le film a été mis en musique par Ikue Mori du groupe DNA.
Quand j’ai commencé à réfléchir à ma proposition pour Venise, il me restait toujours la robe.
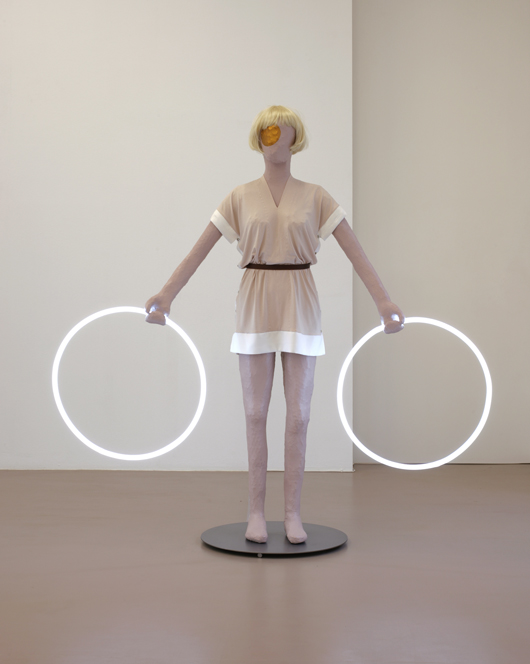
Mai-Thu Perret avec Ligia Dias, Apocalypse Ballet (Two White Rings), Sculpture en acier, fil de fer, papier mâché, acrylique, gouache, perruque synthétique, tubes au néon, costume de soie, support en acier, 175 cm x 165 cm x 165 cm.
Photo : Jens Ziehe.
Rubell Family Collection, Miami, 2006.
Un film, c’est un instant, ça passe… J’ai donc pensé à réutiliser la robe avec ce mannequin. Son visage est en verre soufflé et est moulé sur celui de mon actrice. Il est argenté, réfléchissant, comme liquide. C’est une sorte de fantôme…
JM On le voit, tes références sont très riches et précises, mais pourtant le spectateur reste libre de créer sa propre interprétation. La force visuelle de tes pièces les emmène ailleurs.
MTP Oui ça reste assez ouvert. J’ai parcouru un certain cheminement pour arriver à ces pièces, mais tu peux te raconter l’histoire différemment, il n’y a pas de narration obligatoire. D’une certaine façon, les objets se suffisent à eux-mêmes.
JM Pour comprendre tes pièces, les titres semblent agir comme des indices. Ils sont souvent très littéraires. Un exemple, pour une de tes céramiques : If you do not throw yourself into the breakers, how will you ever meet the one who frolics in the waves ?
JM Je voulais savoir comment tu les récoltais. D’où viennent-ils ? Comment s’articulent-ils les uns avec les autres ?
MTP J’ai des sources différentes selon le type de pièce. Par exemple, puisque la céramique découle d’un travail processuel et que j’en réalise beaucoup, j’avais envie pour les titres de mettre en place un système qui joue vraiment avec le hasard. Ces sculptures murales ont toutes des titres trouvés dans un livre qui s’appelle Zen Sand: The book of capping phrases for Kôan Practice. C’est un manuel de pratique zen avec des réponses au Kôan. Il est très imposant, il y a plus de 600 pages, et les phrases sont toutes incroyables.
Les titres des pièces de Venise sont en rapport avec le film… J’ai choisi une autre chanson de Dowland, qui s’intitule Flow my tears. C’est aussi accessoirement le titre d’une nouvelle de Philip K. Dick, Flow my tears,the policeman said, dont le personnage principal est obsédé par la musique de Dowland, ce qui est un écho assez drôle. Dans la mesure du possible, j’essaie d’éviter les pièces « Sans Titre », sauf pour les peintures abstraites où il m’est vraiment difficile de donner des titres. De manière générale, si je peux avoir un titre, c’est mieux.
JM Tu viens récemment de faire une exposition à Dallas au Nasher Sculpture Center. Alors que tes précédents travaux fonctionnent comme un collage de références historiques, leur conférant une aura atemporelle, ces nouvelles sculptures résonnent particulièrement avec l’actualité. On y découvre notamment une série de mannequins, des femmes en tenue militaire, affublées de mitraillettes en résine colorée. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
MTP Effectivement ces pièces font écho à l’actualité. C’est un choix mais c’est aussi une force majeure, par rapport à tout ce que l’on traverse. Je suis évidemment, comme pas mal de gens, affectée par les événements que l’on vit depuis plus d’un an, et leur rythme qui s’intensifie. J’ai commencé à travailler sur cette exposition après les attentats de novembre 2015. Parallèlement à cela, je suis allée une dizaine de jours dans la partie kurde de la Turquie à l’occasion d’une résidence. J’y étais initialement pour réaliser des tapis avec une organisation qui travaille avec des nomades kurdes qui sont désormais sédentarisées. Cela rejoignait naturellement mon intérêt pour le travail des femmes, l’artisanat, mais aussi l’abstraction : comment un tapis peut être narratif ? Il y a de nombreuses histoires dans les motifs que les femmes tissent dans les kilims… Pendant mes recherches, je suis tombée sur des vidéos You Tube qui présentaient les femmes des YPJ — Unités de protection de la femme, en français —, une organisation militaire kurde composée exclusivement de femmes qui combattent Daech. Ça m’a complètement obsédée. La question de l’actualité et l’histoire de la Syrie sont deux éléments compliqués à gérer par rapport aux pièces présentées à Dallas. Je crois qu’il est important d’en parler car c’est un point de départ essentiel dans la réalisation de ces œuvres, même si cela peut complètement parasiter la lecture que le public en a. J’ai remarqué que dès que l’on parle de la Syrie, il y a un boulevard d’interprétations qui s’ouvre : on ne regarde plus du tout l’objet comme une œuvre, on bascule dans des questions de politique.

Mai-Thu Perret, Alone I walk the red heavens, céramique vernie, 28 x 26 x 5 cm.
Photo : Mareike Tocha. Avec l’autorisation de la Galerie Francesca Pia, Zurich, 2013.
C’est comme un court-circuit, et c’est un problème qui m’intéresse. Je ne sais pas si je l’aborde correctement, mais pour moi, il n’y a pas d’opportunisme à aborder ces questions d’actualité.
Les pièces du Nasher sont aussi nées d’un mille-feuille de références. Je les ai créées au même moment où j’ai découvert Les Guérillères, le livre de Monique Wittig. Il date de 1969, c’est un classique du Mouvement de libération des femmes qui raconte l’histoire d’une arméede femmes. Il est intéressant de voir comment ces éléments, dans des contextes différents, peuvent se recouper et se mélanger. Ces œuvres ne se résument pas à leur rapport à l’actualité, elles sont très compliquées au niveau des matériaux employés. Il y a beaucoup de techniques différentes, c’est comme un collage, un inventaire de toutes les techniques de sculpture que j’ai utilisées jusqu’alors. On y trouve du rotin, du bronze, de la céramique, des masques en silicone… Parmi tous les mannequins, il y a une échelle descendante autour du réalisme ; l’une des figures est réaliste, fait illusion, sans pour autant être parfaite alors que les autres sont plus étranges, et mélangent notamment les effets (un visage en silicone et des bras en rotin) pour apporter un côté hybride, presque cyborg.
JM Ce numéro de Revue est traversé par la notion d’anomalie. Plutôt que d’évoquer ton rapport aux normes, qui me semble être un point d’entrée un peu trop évident, notamment pour ta réflexion engagée avec The Crystal Frontier, je voulais connaître ta position face à l’erreur, à l’accident, qui sont sont des processus importants dans la création, surtout en sculpture.
MTP J’ai réalisé il y a quelques temps un néon en trois versions. Il s’agit d’une forme logotype constituée de cercles. Le premier néon est de couleur blanche, les deux suivants sont orange et bleu. Le format diffère également : il y a une versionqui est plus ou moins carrée, et une autre beaucoup plus étroite. En fait, il s’agit d’une erreur de dessin sur le logiciel Illustrator. Alors que je travaillais dessus, j’ai appuyé par hasard sur « aligner au centre ». La forme qui en a résulté était super belle et je me suis dit qu’il fallait que je fasse les deux. Si un hasard de ce genre se présente, je suis preneuse.
JM J’ai souvent lu, à tort selon moi, que tu avais une approche lo-fi de la sculpture.
MTP C’est un commentaire un peu idiot qui est apparu avec les premiers mannequinsque j’ai réalisés et qui étaient en papier mâché. Si on prend l’exemple des pièces de Dallas, elles sont très produites, parfois avec une technologie qui emprunte directement aux effets spéciaux. Je ne crois pas tellement à l’opposition entre lo-fi et high-tech, j’ai toujours cherché à déconstruire les frontières. Si mes premiers mannequins ont un côté simpliste apporté par le papier mâché, je n’ai jamais pensé que c’était une valeur en soi de faire quelque chose de pauvre. Je n’ai pas tellement de valeurs morales par rapport au niveau de production des œuvres. Il y a des artistes pour qui c’est très important d’être dans l’atelier et d’arriver à faire quelque chose avec un bout de papier. Je ne travaille pas comme ça. Je me sens plus comme un directeur artistique avec ces choses-là : j’exploite les effets qu’ont certains matériaux.
JM Est-ce que tu as un rapport physique avec la matière ?
MTP Oui, avec la céramique, notamment. J’ai également fait un peu de tapisserie mais je ne suis pas très douée. Mais pour tout dire, je ne vois pas vraiment de différence entre moi et les autres. Je comprendsque lorsque l’on fait les choses soi-même, ça n’est pas du tout la même expérience, il y a une intention qui s’inscrit dans l’objet. Mais je ne suis pas du tout obsédée par ça. Je pense juste qu’il est parfois dommage de ne pas du tout savoir comment les choses sont faites.

Mai-Thu Perret, I suddenly realized I was totally inside the imperial city, céramique vernie, 37 x 48 x 5 cm.
Photo : Mareike Tocha.
Avec l’autorisation de la Galerie Francesca Pia, Zurich, 2013.
La main de l’artiste, ça m’intéresse assez peu.
Pour en revenir à la céramique, j’ai un collaborateur avec qui je développe un rapport très fort depuis plusieurs années. Il est basé à Cologne et travaille avec beaucoup d’artistes. Je vais dans son atelier fréquemment depuis presque dix ans. Je réserve l’espace, on y est seuls, j’arrive avec un projet, un plan, des croquis, et on essaie de trouver comment on peut réaliser les pièces. Dans mon quotidien, je n’ai pas une équipe d’assistants, un studio à l’américaine, comme certains de mes amis peuvent avoir. Pour moi, cela équivaut à mettre un système en place dans lequel tu dois ensuite travailler… Tu peux vite te retrouver coincé. J’ai personnellement plus de souplesse en étant seule et en collaborant avec des artisans.
JM Et comment ça se passe avec une personne qui n’est pas du tout dans ton domaine d’expertise, comme la danseuse Agnès Schmidt, avec laquelle tu as réalisé la performance Figures ?
MTP J’apporte des directions, des outils pour travailler. En l’occurence le mannequin utilisé pour Figures n’était pas du tout adapté, il était tellement dur à bouger que ça a été très compliqué. Mais la contrainte était tellement forte qu’Agnès a vraiment essayé de tirer tout ce qu’elle pouvait avoir de cette chose. C’est vraiment elle qui a écrit la pièce. Avec le recul, avec une meilleure marionnette, cela aurait été beaucoup plus compliqué car nous aurions eu beaucoup plus de choix.
JM Quelles sont les personnes qui nourrissent ta pratique, qui la stimulent ?
MTP J’adore la musique et l’approche de Beatrice Dillon, avec qui je travaille le son dans mes performances. Je peux citer également l’artiste suisse Emmanuel Rossetti. Et puis j’admire des figures plus âgées comme Joan Jonas, ou Rosemarie Trockel. Mais la liste serait trop longue pour l’énumérer.
JM Quels sont tes projets à venir ?

Mai-Thu Perret, In the middle of the cooked rice he suddenly comes upon a grain of sand, céramique vernie, 37 x 48 x 5 cm.
Photo : Mareike Tocha. Avec l’autorisation
de la Galerie Francesca Pia, Zurich, 2013.
MTP Je prépare deux expositions : une à Londres, en novembre, chez Simon Lee, et l’autre à Los Angeles, en mai, dans le nouvel espace de David Kordansky. Je réfléchis aussi à un événement qui aura lieu l’année prochaine à The Kitchen, à New York, mais dans l’espace qui est dédié à la scène. Ça sera de nouveau un travail autour de la performance et cela m’excite beaucoup.
Matching facial expressions
Robert Heinecken
Décédé en 2006, l’artiste californien Robert Heinecken a développé un vaste corpus d’images au statut résolument contemporain. Bien qu’il ait rarement eu recours à un appareil photo, il est considéré comme l’un des photographes américains les plus influents. Découpages, collages et re-photographies d’images préexistantes, Heinecken se définissait volontiers comme un « paraphotographe ». Son œuvre questionne l’effet normalisant des mass medias tout en s’emparant de grands thèmes comme la culture populaire américaine, le genre ou encore la pornographie.
François Aubart, commissaire et critique, s’entretient avec Devrim Bayar, commissaire de l’exposition « Lessons in posing subjects » (qui s’est tenue au printemps 2014 au Wiels, Bruxelles) au sujet de ces fascinantes images.
Francois Aubart Les phénomènes de « redécouvertes » d’artistes ont bien souvent des raisons. Dans le cas de Robert Heinecken on a vu presque en même temps apparaître des textes sur son travail dans les revues Artforum et Kaleidoscope ainsi que des expositions au Mamco de Genève, au MoMAde New York et au WIELS où tu en as assuré le commis-sariat. Par quel biais as-tu pris connaissance de ce travail et quelles raisons t’ont poussée à organiser cette exposition ?
Devrim Bayar J’ai découvert le travail de Robert Heinecken à la FIAC en 2011 sur le stand de la galerie Cherry & Martin qui y avait organisé une présentation solo de l’artiste. Quelques mois plus tard, je suis à nouveau tombée sur plusieurs Lessons in Posing Subjects dans une exposition de groupe à la galerie Jan Mot à Bruxelles. J’ai tout de suite été séduite par leur humour mordant et l’ambiguïté des clichés Polaroïd. Environ au même moment, le photographe américain Leigh Ledare préparait son exposition au WIELS et il nous a parlé de travail du Robert Heinecken qu’il admire.
En l’espace de quelques mois, le travail d’Heinecken s’est donc présenté à moi à plusieurs reprises. Ces coïncidences ont aiguisé ma curiosité et j’ai cherché à en savoir plus sur l’artiste. La galerie Cherry & Martin m’a alors informée qu’une série complète des Lessons in Posing Subjects, composée de 41 planches dont la plupart des copies ont été dispersées à travers le monde, appartient à une personne privée qui habiteà 150 km à peine du WIELS. J’ai donc pris ma voiture et je suis partie découvrir l’œuvre.
Les planches n’étaient pas encadrées et étaient stockées depuis trente ans dans une simple boîte.
Lorsque le propriétaire les en a sorties, j’ai été éblouie par la beauté des clichés photographiques et l’inventivité des textes, mais c’est surtout la contemporanéité du travail qui m’a fascinée. Le regard critique qu’Heinecken a porté au début des années 80 sur la codification des genres dans les images publicitaires reste d’actualité. De la même façon, on peut rapprocher les Lessons de la culture des selfies qui innonde les réseaux sociaux. Il m’est alors apparu évident que les Lessons, qui n’avaient plus été montrées dans leur ensemble depuis plus de vingt ans et jamais publiées dans leur totalité, méritaient une exposition au WIELS.
FA Tout cela apparaît quelques années après l’exposition très remarquée The Pictures Generation au Metropolitan Museum de New York. Celle-ci mettait en lumière le fait qu’une grande partie de la génération dite «post-conceptuelle», dont font partie Barbara Bloom, Ericka Beckman, Jack Goldstein, Matt Mullican ou David Salle par exemple, avait étudié à Los Angeles. The Pictures Generation mettait ainsi en avant l’importance de la scène de cette ville où John Baldessari, Allen Ruppersberg ou Guy de Cointet restaient dans l’ombre de New York. Ce projet participe-t-il à tes yeux d’une considération pour l’histoire de l’art de Los Angeles ?
DB Assurément. Et c’est d’ailleurs une des raisons pour lesquelles nous avons décidé de présenter le travail d’Heinecken au WIELS au même moment (et sur le même étage d’exposition) que celui d’Allen Ruppersberg. Lors de mes recherches à propos du travail des deux artistes, je me suis rendue compte que malgré le fait qu’ils aient vécu pendant de nombreuses années dans la même ville, les deux artistes ne se connaissaient pratiquement pas. Ils ont évolué dans des réseaux parallèles, constitués autour d’une école et d’un médium différent — UCLA et la photographie dans le cas d’Heinecken, CalArts et l’art conceptuel pour Ruppersberg. Pourtant, ils partagent un même goût pour la collecte d’images et la culture populaire américaine. En présentant ces deux expositions en parallèle, l’idée était de mettre en lumière deux pratiques artistiques issues de Californie et de tisser des liens entre elles.
FA Puisqu’on parle de redécouverte, on peut aussi envisager les raisons d’une éclipse. Dans les années 1960 Robert Heinecken était une figure importante de l’art contemporain angeleno. Son travail avait une visibilité non négligeable aux Etats-Unis. Penses-tu que le contenu même de ce travail où apparaissent de nombreuses imagesde femmes nues ait souffert d’une critique pour misogynie ?

Lessons in Posing Subjects/Simulated Animal Skin Garments, 1982.
Archives Robert Heinecken, Center for Creative Photography. © The Robert Heinecken Trust
DB Oui mais pas seulement. C’est vrai que le travail d’Heinecken a été taxé de misogynie par certains critiques, et c’est l’une des raisons qui expliquent que son travail ait été relégué dans l’oubli. Toutefois Robert Heinecken est resté une figure importante dans l’histoire de la photographie. C’est donc plutôt dans le champ élargi des arts plastiques que son travail a été davantage éclipsé.
Heinecken n’était pas un photographe au sens traditionnel. Au delà du fait qu’il ait rarement manié un appareil photo, il a réalisé des installations, des collages, des sculptures, des livres d’artistes, etc.Pourtant, il a toujours défini son champ d’action au sein de la photographie. C’est notamment lui qui a fondé le département de photographie à UCLA où il a longtemps enseigné et il était également un membre fondateur de la Society for Photographic Education, qui reste encore aujourd’hui une organisation importante dédiée à la photographie. Mais à cette époque, les disciplines étaient moins perméables qu’aujourd’hui…
Enfin, il y a également cette isolation géographique que tu viens d’évoquer.
FA Les images que Robert Heinecken choisit et le traitement qu’il leur accorde semblent issus d’une réflexion sur les normes comportementales que véhiculent ces images. Est-ce que tu sais comment il passe de ses premières recherches sur le hasard des apparitions dans les pages de magazine à quelque chose qui semble plus précisément en être une analyse ?
DB A partir de la fin des années 70, Heinecken fait en effet ouvertement référence à certains écrits théoriques dans ses œuvres. Les Lessons sont ainsi inspirées par l’étude du sociologue Erving Goffman, Gender Advertisements, parue deux ans plus tôt et qui analyse l’image de l’homme et de la femme dans la publicité. Selon moi, il ne s’agit toutefois pas du changement majeur qui s’opère à cette époque dans le travail de l’artiste. Heinecken a toujours eu une approche critique de la photographie. Ce qui me semble le plus étonnant c’est qu’à un moment bien précis de sa carrière, il décide d’utiliser un appareil photo alors que toutes ses expérimentations avec les images photographiques qu’il développe à partir du milieu des années 60 se passent de caméra.
FA Heinecken parlait à propos des publicités « d’expériences manufacturées ». Peux-tu en dire plus sur la façon dont il envisageait ces images ?

Lessons in Posing Subjects/Maintaining Facial Expressions (Female, Brunet), 1981.
Archives Robert Heinecken, Center for Creative Photography. © The Robert Heinecken Trust
DB Quand Heinecken parle « d’expériences manufacturées » à propos des médias de masse, c’est pour marquer la différence avec les expériences directes que nous pouvons faire de la réalité. Heinecken met ainsi en évidence le fait que les images véhiculées par les médias de masse sont fabriquées, même si elles donnent parfois l’impression d’être authentiques.
Dans les Lessons in Posing Subjects, Heinecken joue avec cet « effet de réel » (que Goffman nommait « réalisme commercial » dans son étude des images publicitaires) en utilisant un appareil Polaroid SX70, le premier appareil photo automatique qui produit instantanément des clichés en couleur.
Dans ces clichés soi-disant « instantanés », il insuffle une impression de spontanéité et de naturel à des poses tout à fait artificielles et stéréotypées qu’il trouve dans les magazines de vente par correspondance.
Il utilise donc une technologie alors nouvelle et extrêmement populaire pour démentir cette idée commune selon laquelle la photographie serait une fenêtre transparente sur le monde.
FA On est là très proche du travail de Richard Prince dans la forme (des photographies de publicité) mais aussi dans les termes, ce dernier parlait lui de « mémoires contrefaites ». Peut-on y voir un précurseur ?
DB Heinecken ne peut toutefois pas être considéré comme précurseur. Si on analyse les dates des œuvres, l’inverse serait même plus juste… Mais il est peu probable qu’Heinecken ait eu connaissance des œuvres de Prince. Non seulement les artistes travaillaient sur les côtes opposées des Etats-Unis, mais évoluaient également dans des cercles artistiques très différents. Sans compter qu’à la fin des années 1970, l’information circulait nettement moins vite qu’aujourd’hui.
Par ailleurs, à la différence de Prince, Heinecken ne rephotographie pas simplement des images trouvées.
Ses documents de travail témoignent d’un procédé laborieux de mise en scène : Heinecken découpe, colle et colorie des fragments de magazines pour obtenir la composition voulue.Il joue ensuite non seulement avec le cadrage mais aussi avec l’éclairage. Ce caractère « fabriqué » des images d’Heinecken les distingue des rephotographies de Prince.
FA L’approche d’Heinecken semble assez ambiguë. Elle est un peu narquoise et relève presque plus de la moquerie que de la critique. Cela, qui plus est, dans un contexte où la pornographie prend le pas sur la liberté sexuelle portée par les années 1960. Est-ce que Heinecken avait une position claire sur ces questions en son temps et sur les changements idéologiques de la fin des années 1970 et début des années 1980 ?
DB C’est vrai que l’humour d’Heinecken, parfois très caustique, n’a pas toujours été bien perçu, tout comme son usage répété d’images pornographiques. Je n’ai malheureusement pas eu la chance de rencontrer l’artiste, mais mes discussions avec ses anciens assistants, qui gèrent aujourd’hui son estate, m’ont appris que c’était un homme qui aimait assurément les femmes. Il était également obsédé par les magazines qu’il achetait en grande quantité et qu’il passait des heures à éplucher. Sa fascination, tant pour les femmes que pour les revues illustrées, transparait clairement dans son œuvre. Toutefois Heinecken a souvent qualifié sa pratique artistique de « guerilla ». Il était sans aucun doute un artiste engagé et son travail s’inscrit pleinement dans les mouvements contestataires de la fin des années 60. Si elles sont extrêmement séduisantes, comme les images publicitaires dont elles sont issues, les œuvres d’Heinecken n’en sont pas moins critiques et provocatrices. Elles nous rappellent que nous vivons dans une culture des doubles et des Doppelgänger : derrière chaque image se cache une autre image.

Lessons in Posing Subjects/Lingerie (Flowers), 1981.
Avec la permission de l’estate de l’artiste et de la Galerie Petzel, New York.