Le chant
d’un cygne
Édouard LouisGus Van Sant
Alors que l’on attendait impatiemment le retour de Gus Van Sant au cinéma après son dernier film, Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot, sorti en 2018, le réalisateur américaina surpris ses admirateurs en réalisant la quasi-totalité de la seconde saison de la série anthologique Feud. Consacré à la dispute opposant l’écrivain Truman Capote à sesriches amies, le récitrevient sur les blessures des différents protagonistes, et l’impact qu’un simple texte peut avoir sur le réel. Une réflexion sur le pouvoir de la littérature qui pouvait difficilement laisser Édouard Louis insensible. L’auteur français, qui vient de publier son sixième livre, intitulé Moniques’évade, a dévoré les épisodes consacrés à l’inénarrable Capote. Il s’entretient ici avec le réalisateur autour de cette figure disparue il y a tout juste quarante ans et qui pourtant ne cesse de fasciner.
Édouard Louis
Gus, je viens de terminer la série Feud – Capote vs the Swans, que tu as réalisé autour de Truman Capote. C’est une série incroyablement puissante, qui aborde les questions de l’homosexualité, de l’amitié, du pardon, de la littérature, dont j’aimerais qu’on parle aujourd’hui. Mais avant cela, je voulais te demander simplement quel avait été le point de départ de ce projet ?
Gus Van Sant
Il y a deux ans, lors d’un diner, mon ami Robin Baitz m’a raconté qu’il était en train d’écrire autour de cette histoire entre Truman Capote et ses « cygnes », le surnom que Truman avait donné à ses riches amies. Il se trouve que je connaissais plutôt bien le sujet puisque j’avais lu l’article intitulé La Côte Basque, publié en 1965 dans le magazine Esquire. Ce texte a causé une rupture entre Capote et ces femmes. De Truman, je connaissais également les trois ou quatre chapitres de Answered Prayers, son roman inachevé. Le fait qu’il n’ait jamais réussi à terminer son livre, mais aussi son rapport avec Andy Warhol – dans les années 50, Truman a essayé de garder Andy à distance, car il le trouvait trop insistant… Quelques années plus tard, il a accepté son invitation et s’est mis à écrire pour son magazine Interview… –, la période du Studio 54, j’étais familier avec tous ces éléments. Quant à Ryan Murphy, qui a produit et imaginé la série, je connaissais une partie de son travail, notamment la série Hollywood, inspirée du livre Full Service de Scotty Bowers. J’ai demandé à Robin Baitz s’il pensait que Ryan accepterait qu’un réalisateur extérieur vienne travailler sur ce projet… Il lui a demandé, sa réponse était positive : « Si c’est ce que Gus souhaite, il peut le faire ». C’est seulement ensuite que j’ai réalisé que je devais vraiment le faire ! (rires). Ryan a écrit le contour de l’histoire, Robin l’a rempli et j’ai réalisé six épisodes sur les huit de cette saison.
Édouard Louis
Que pensais-tu de Truman Capote et de son œuvre littéraire avant de travailler sur cette série ?
Gus Van Sant
Je crois que j’ai lu In Cold Blood [De sang froid] lorsque j’avais 13 ans. Le livre appartenait à la mère d’un ami, il était placé sur la table de la cuisine, c’était plutôt un gros livre. Rien que le titre semblait menaçant. Cette femme m’a dit que c’était un très bon livre. In Cold Blood a eu beaucoup de succès, notamment auprès des femmes au foyer, sans doute car il permettait à ses lectrices, vivant dans des coins reculés comme le Connecticut, de lire la même chose que les femmes de l’aristocratie new-yorkaise.

Truman Capote tenant sa couverture du magazine Interview à La Factory. COuverture réalisée par Richard Bernstein, janvier 1979. Photo: George Rose. Extrait du livre Richard Bernstein Starmaker: Andy Warhol’s Cover Artist de Roger Padilha & Mauricio Padilha, publié par Rizzoli, New York, 2018.
C’est comme ça que je l’ai découvert. À cette période, il faisait quelques interventions à la télévision pour présenter son livre. Ma mère disait qu’elle l’aimait car il parlait avec une drôle de voix mais aussi parce que la manière dont il disait les choses était précise et belle. Elle se sentait bien en l’écoutant.
Récemment, j’ai relu ses livres. Pour moi, il est l’un de ces auteurs comme Norman Mailer qui maitrisait parfaitement la description avec subtilité et nuance. Son écriture était poétique. Et c’est quelque chose qu’il a perdu dans Answered Prayers.
Édouard Louis
Dans Feud, nous sommes témoins de la fascination que Truman exerce sur les femmes de son entourage, ses cygnes. C’est intéressant car il semblerait que cette fascination s’étendait à bien plus de monde, comme à ta mère… Est-ce que tu étais conscient de ce parallèle pendant la réalisation de la série ? À quel point ton rapport biographique à Capote a-t-il joué ? Est-ce que la fascination de ta mère pour Capote par exemple t’a inspiré en filmant les actrices qui jouent les Cygnes de Capote ? Tu les filmes d’une façon si sensible, si généreuse en un sens…
Gus Van Sant
Pas directement, mais j’ai fait des parallèles à d’autres niveaux entre la vie de Truman et la mienne car Truman est né dans une toute petite ville de La Nouvelle-Orléans. Mes parents sont aussi nés dans une petite ville du Sud, du Kentucky. Ma mère était plutôt réservée, mais elle avait une sœur par exemple qui avait une voiture noire, une Jaguar convertible, un choix vraiment excentrique. Ses goûts étaient marqués par sa situation… Et pour en revenir à Capote, j’ai pensé à sa mère lors du tournage, cette mère assez excentrique elle aussi, la mère de cet homme gay. Elle l’a pratiquement abandonné en le laissant à sa propre mère… Truman a vécu avec sa grand-mère. Il y a une photo célèbre de lui, habillé d’un costume blanc alors qu’il avait cinq ans. La mère de Truman voulait être une femme du monde, elle voulait vivre à New York sur Park avenue. Elle s’est mariée avec un homme plutôt riche, elle voulait vraiment intégrer cette aristocratie mais n’a jamais réussi à atteindre les cercles les plus prestigieux.
Édouard Louis
Et Truman en intégrant ces cercles a offert à sa mère une forme de revanche. C’est ce que tu montres dans la série.
Gus Van Sant
Oui, une forme de revanche contre cette société dans laquelle sa mère n’avait pas été acceptée. Truman est allé au lycée à Greenwich, dans le Connecticut, pas très loin de Darien, où j’ai moi-même grandi. Ce sont des petites villes en périphérie de New York, beaucoup d’hommes prenaient le train le matin pour aller y travailler et rentraient le soir. Je crois qu’il est resté une année ou deux à Greenwich. Il se rendait aussi à New York avec les filles qu’il avait rencontré au lycée, ils essayaient d’aller dans des clubs huppés ou de jazz, tous ces endroits dans lesquels tout le monde à l’époque voulait rentrer. Truman était déjà en train de s’évertuer à monter l’échelle sociale, dès le lycée, et il n’a cessé de vouloir le faire tout au long de sa vie… Et toi Édouard, comment est-ce que tu as découvert l’œuvre de Truman Capote ?
Édouard Louis
Assez tardivement. C’est assez étrange car je me pose des questions depuis longtemps sur la place de la fictionet du réel dans l’écriture, je m’interroge sur la façon dont le réel peut permettre de subvertir les formes littéraires canoniques, et les livres de Capote participent à cette réflexion, mais pour des raisons qui me sont inconnues, j’ai mis du temps à les lire. Je crois avoir commencé il y a deux ans, avec De sang Froid. Et cette lecture a été extrêmement forte. C’est un livre immense.

Photogramme extrait de l’épisode 1 de la série Feud : Les Trahisons de Truman Capote, créée en 2023 pour FX par Ryan Murphy, réalisée par Gus Van Sant.
Je connaissais Capote et sa personnalité à travers les photo-graphies que j’avais vues de lui, à travers des entretiens. Et je me souviens comment, en lisant De Sang Froid, je me demandais à quel point ce « corps gay », avec sa petite voix fluette qui fascinait ta mère, Gus, comment ce corps-là, aussi délicat, aussi vulnérable et haut en couleur à la fois, avait pu écrire une histoire sombre, violente et aussi terrible. Il y a un mystère, une contradiction, comme si Proust ou Barthes avaient écrit les livres de Faulkner.
Truman Capote le disait lui aussi : il était comme sorti de lui-même pour écrire ce livre, et cet écartèlement l’a laissé sans forces, épuisé, ce qui expliquait en partie, selon lui, son incapacité à écrire après De sang Froid. D’ailleurs, je voulais te poser une question par rapport à Feud et à ce roman. Dans De sang Froid, deux hommes entrent dans une maison et massacrent la famille qui y vit. Capote raconte ce fait divers, mais aussi ce qui a amené à son exécution, l’histoire de ces meurtriers, leur passé, leur enfance, les humiliations qu’ils ont vécues. Et en faisant ça, il rend l’histoire de ces hommes qui ont commis ce crime horrible plus complexe, et on ressent même une forme d’empathie pour eux. On perçoit que le crime qu’ils ont commis a une histoire, qui dépasse ces deux individus. Évidemment ça ne rend pas le crime moins horrible, et Capote n’essaye pas de le rendre moins horrible, mais il y a cette tentative de comprendre pourquoi ils l’ont fait. Et pour moi, il y a quelque chose de similaire qui se joue dans Truman vs the Swans. Le crime n’est pas aussi terrible évidemment, et même beaucoup moins, mais la série commence également avec un (plus petit) crime : Truman trahit ces femmes new-yorkaises, les Cygnes. Le crime n’est pas si petit d’ailleurs car une femme s’est suicidée en partie à cause de cette trahison. Truman Capote trahit ses amies les plus proches, ces femmes qu’il voit tous les jours,il les expose, il raconte leurs secrets dans ce texte que tu mentionnais, La Côte Basque. Et au fur et à mesure que l’histoire se dévoile, on découvre des éléments qui expliquent pourquoi l’écrivain a fait cela à ses amies. Sa mère a été humiliée socialement, et il a voulu prendre sa revanche. Il a été humilié en tant qu’homme gay par une de ces femmes de la très grande bourgeoisie, qui l’a traité de « tapette ». On voit aussi que Capote fait des mauvais choix parce qu’il est tétanisé par l’angoisse de ne pas réitérer le succès qu’il a rencontré avec In Cold Blood. Tous ces éléments qui se cumulent dissolvent en quelque sorte sa responsabilité, la complexifient, exactement comme Truman lui-même a complexifié le crime des meurtriers dans son roman. Plus on avance dans ta série, et moins on en veut à Truman, ou en tout cas on comprend ce qui s’est passé. Est-ce que c’était ton intention Gus ? Est-ce que tu as fait une série pour pardonner Truman ? Est-ce qu’il y a selon toi un rapport entre l’art et le pardon ?
Gus Van Sant
Je ne sais pas. Dans tous les films que j’ai pu faire, je m’investis à travers ce qu’on pourrait appeler des « incantations » : rappeler les réalités auquel le récit fait référence. C’est ce que fait le cinéma : on a une histoire, et dès qu’on commence à la filmer, des acteurs jouent des actions, des mouvements, des moments, et rendent cette histoire vivante, et donc plus complexe. Pour ma part, quand je réalise un film ou une série, j’essaye d’interpréter ce qui est écrit dans le scénario. Pour Feud, la construction des scènes venait de Ryan Murphy. Mais je crois qu’il aurait pu écrire presque n’importe quoi, je l’aurais quand même compris et interprété comme l’histoire que je connaissais, avec ma propre perception de la situation. La structure de Ryan a été extrêmement utile pour comprendre ce qu’il fallait mettre en avant parmi toutes les pièces de ce puzzle, et quand les dévoiler. Robin, en tant que scénariste, est connu pour ses longs dialogues. Il a inventé Truman dans ces situations, car il n’y avait pas nécessairement de retranscriptions de ce qu’il a dit à ces femmes. Capote en a parlé en interviews, mais il fallait d’une certaine manière remplir les vides. Robin avec ses dialogues explique beaucoup de choses. Et je dois ajouter que Tom Hollander, qui interprète Truman, a été très fort pour rendre ces raisonnements essentiels, car à la lecture des scénarios, j’ai parfois pensé qu’il fallait en couper certains. J’avais peur que ça soit trop long, que ça manque de rythme. Et au final, ça n’a pas été le cas grâce à Tom qui a toujours compris l’intérêt de ces mots, ce qui a rendu son interprétation encore plus juste. Moi je ne pouvais que réagir à la réalité du tournage : tout était très rapide. On a commencé à tourner le premier épisode sans que l’intégralité de scénario ait été écrit. Tant qu’on est pas sur le plateau, les choses ne sont pas concrètes. Donc avant que le tournage ne commence, je me suis contenté de réfléchir au placement des caméras, c’est tout, car il y avait trop de paramètres que je ne pouvais pas maîtriser. Au final, mon travail a été de filmer la rencontre de ces différents talents, ceux de Ryan, de Robin, Tom Hollander, de Naomi Watts. J’ai filmé tout cela et j’ai en fait ma propre interprétation.
Édouard Louis
Oui, justement, en parlant du placement des caméras et de cette question du pardon que j’évoquais, j’ai justement trouvé que tout, dans la manière dont tu réalisais la série, l’angle, les mouvements de caméras, les zooms, j’ai trouvé que tous ces éléments allaient dans le sens du pardon, ou au moins, du refus de condamner. Comme s’il existait une manière purement formelle de pardonner, en dehors du discours. Comme si un mouvement de caméra pouvait représenter une forme de pardon.

Couverture du magazine Interview, réalisée par Richard Bernstein, janvier 1979. Extrait du livre Richard Bernstein Starmaker: Andy Warhol’s Cover Artist de Roger Padilha & Mauricio Padilha, publié par Rizzoli, New York, 2018.
Je trouve que tu es très délicat avec tes personnages. Que ta caméra à la fois les caresse, les accompagne comme une amie, à d’autres moments les replace dans une situation plus grande.
Cela m’a fait penser à Kafka, et à cette idée Kafkaïenne sur laquelle Geoffroy de Lagasnerie a écrit, selon laquelle, enfin de compte, tout le monde est innocent de tout. Kafka dans la lettre au père énumère les excès de son père, mais il lui dit qu’au fond, il sait qu’il est innocent – que le problème se trouve ailleurs. Au fond, j’ai ressenti ça dans la manière dont tu as filmé Truman et son amie Babe Paley. Peut-être cela n’était pas conscient, car comme tu viens de le mentionner, quand tu crées, tu te laisses porter par une intuition, plus que par un discours. Tu m’as dit un jour que parfois le corps sait mieux que la tête ce qu’il faut faire…
Gus Van Sant
Oui !
Édouard Louis
J’ai aussi trouvé que la série dépeignait de manière très juste l’homosexualité. Comme si cette série était aussi un Portrait de l’homosexuel – un des plus beaux que j’ai vu depuis longtemps : qu’il s’agisse d’homophobie, de désir, de fascination pour la masculinité, de l’amitié avec les femmes,aussi compliquée puisse-t-elle être, de la relation à la mère ou encore des rêves de gloire, qui sont certainement une forme de revanche face aux enfances souvent difficiles que les gays peuvent avoir vécus… Ce désir d’évasion, comme Jean Genet qui s’évadait sur les toits… Pour moi, la série parle vraiment d’homosexualité en général, pas uniquement celle de Truman… C’était ton intention ?
Gus Van Sant
J’ai lu quelques romans de Jean Genet ! De Jean-Paul Sartre également, quand j’étais au lycée…En tout cas, ces récits font partie de mon histoire et ressortent consciemment ou non. Quand j’étais enfant, de mes 11 à 14 ans – à peu près au moment où Truman terminait In Cold Blood –, j’ai eu un professeur d’art à l’école qui était homosexuel. Il portait une cravate noire fine avec un costume parfaitement taillé, il était Canadien francophone. Il nous a appris l’art nouveau, à faire des mobiles à la manière de Calder, il peignait également dans notre salle de classe. Il partageait avec nous ce qu’il faisait durant ses week-ends, on venait dans sa classe juste pour l’écouter. Pour moi, il a été une sorte de connexion avec la vie homosexuelle new-yorkaise du début des années 1960. Ce sont aussi ces souvenirs, en plus des livres lus, que j’ai sans doute, inconsciemment, déployé dans la série. Donc je crois que les choses se transmettent, d’une manière ou d’une autre.
Édouard Louis
Dans le cinquième épisode, que tu n’as pas réalisé, intervient James Baldwin. L’auteur vient pour aider son camarade. Et à travers les moments qu’ils partagent ensemble, tu pointes l’importance des communautés, de la communauté gay et du soutient qu’elle peut apporter. Je suis curieux de savoir combien cette dimension compte pour toi. Est-ce que tu es plutôt entouré ou solitaire dans la création ?
Gus Van Sant
Je suis plutôt seul ! Je me bats seul. Et toi ?
Édouard Louis
Pour moi il y a un lien important entre amitié et création. Évidemment, dès que l’on essaie de faire quelque chose de nouveau, ou au moins de différent, on doit faire face à des réactions violentes, qu’elles soient d’ordre artistique ou politique. Et je crois que l’amitié m’a permis de ne pas avoir peur de ça. J’ai été si souvent insulté pour mes livres, par des journalistes, des critiques littéraires ou des universitaires… L’amitié permet de se donner une légitimé propre, et de ne pas être autant heurté par les critiques. Si Thomas Ostermeier, ou mes amis Didier Eribon ou Nan Goldin aiment ce que j’écris, alors le reste n’a plus vraiment d’importance.
C’est d’ailleurs ce qu’on voit dans Feud. Truman, pour pouvoir écrire, a besoin d’avoir des personnes autour de lui. À partir du moment où il perd l’amitié de ses femmes, il ne peut plus rien faire. On voit bien comment l’absence d’amitié affecte sa capacité à créer. Évidemment, il y a des artistes qui travaillent dans la solitude, je pense à Thomas Bernhard, mais c’est un mystère pour moi. C’est cette même solitude que tu cultives dans la création ?
Gus Van Sant
Je croyais que la question concernait le combat, pas l’écriture !
Édouard Louis
On peut considérer les deux termes comme synonyme ! (rires)
Gus Van Sant
Oui, dans ce cas, je crois que l’on a besoin d’immunité pour créer. L’écriture est une forme d’amitié sociale, un tournage l’est aussi. Il y a toujours un groupe de proches avec qui je partage mes projets, mes convictions et mes doutes. Mais quand il s’agit de se battre, alors oui, je me bats seul.
Édouard Louis
Une amitié, pour qu’elle dure, doit aussi savoir pardonner – désolé, c’est un sujet qui m’obsède et sur lequel je veux t’entendre (rires). Si Truman était ton ami et écrivait sur toi comme il l’a fait dans La Côte Basque sur les Cygnes, est-ce que tu lui aurais pardonné ?
Gus Van Sant
Peut-être ! Je ne suis pas sûr ! (rires) Cela dit, j’ai quelques amis qui ne parlent plus à leur famille, et je trouve ça toujours surprenant, voire choquant. C’est dur pour moi de voir certaines personnes couper définitivement les liens avec les autres. Je crois que je serais dans le pardon. Je ne comprends pas qu’on puisse arrêter de se parler. Peut-être que c’est différent en France ! (rires)

Photogramme extrait de l’épisode 1 de la série Feud : Les Trahisons de Truman Capote, créée en 2023 pour FX par Ryan Murphy, réalisée par Gus Van Sant.
Je constate par contre qu’il y a des personnes qui ne me parlent pas, non pas à cause de moi, mais à cause de mon art. Ils ont entendu parler de moi, n’ont jamais vraiment rien vu mais ont décidé qu’il valait mieux ne pas me parler. Je suis parfois confronté à ces personnes. Quand je les rencontre, ils se tournent et s’en vont !
Édouard Louis
Quoi ? Mais qui sont ces gens ? Des catholiques radicaux qui t’en veulent de parler d’homosexualité ?! (rires)
Gus Van Sant
C’est peut-être ça ! Ou alors, peut-être à cause de Drugstore Cowboy, mon second film qui parlait d’addiction aux drogues. Je me souviens qu’à l’époque de sa sortie, j’étais à une fête et j’ai entendu quelqu’un qui ne savait pas qui j’étais dire « C’est absurde, c’est stupide, c’est ridicule ». Et quand j’ai essayé de parler à cette personne, elle a simplement répondu qu’elle ne voulait pas me parler.
Édouard Louis
C’est tellement grotesque que c’est hilarant ! Bon, il est vrai aussi que produire des oppositions, quand on est un artiste, c’est une chose saine. Truman a lui aussi produit des lignes de fracture, tu montres dans ta série que certaines personnes le haïssaient, comme Gore Vidal notamment…
Gus Van Sant
Oui, mais ce qui est aussi fou avec Capote, c’est qu’il n’a plus été capable de créer à un certain moment. Il n’a jamais fini Answered Prayers. Il a traversé presque deux décennies pendant lesquelles il n’a pas été capable de terminer ce livre, alors qu’il n’arrêtait pas de dire qu’il écrivait. Il était devenu une célébrité qui faisait un peu trop la fête et ne travaillait plus vraiment. Je vois parfois ça à Hollywood, avec certaines personnes qui atteignent une certaine notoriété et validation, et qui ensuite n’arrivent plus à écrire ou réaliser.
Édouard Louis
Et pourtant l’incapacité de Capote à terminer ce livre a contribué à sa légende. Un peu comme Rimbaud, qui a renoncé subitement à la littérature. C’est aussi l’une des raisons pour laquelle on l’aime autant, non ? Beaucoup de gens disparaissent mais peu disparaissent d’une façon aussi légendaire que Rimbaud ou Capote. Et d’ailleurs, peut-être qu’inconsciemment Truman a compris que son blocage allait couronner son œuvre, peut-être plus qu’Answered Prayers l’aurait fait s’il l’avait terminé.
Gus Van Sant
Oui c’est vrai. Et puis il y a aussi un côté chasse au trésor avec ce dernier livre achevé. « Où est-ce que ce roman est passé ?! ». A-t-il été détruit ? Peut-on le retrouver ? Beaucoup de personnes pensent qu’il est entreposé dans un dépôt oublié. D’autres pensent qu’il est disséminé dans ses correspondances. Je ne pense pas que ça soit le cas car cela a déjà beaucoup été étudié… Et pour d’autres, il n’a jamais été écrit, donc il n’existe pas ! Le mystère reste entier et participe à la fascination pour Truman Capote…
Héros
Camille Moulin-Dupré
Auteur du Voleur d’Estampes, manga en deux volumes publié chez Glénat, Camille Moulin-Dupré est un passionné de cinéma. À travers ces illustrations et ce texte qui retrace son histoire, entre souvenirs intimes et plaisirs cinéphiles, il revient sur les films et personnages qui ont façonné son identité d’auteur.
Je suis auteur de manga. Avec un père peintre et une mère qui fut bibliothécaire, on pourrait voir une certaine logique à ce que je sois auteur de bande dessinée : le mélange entre le texte et les images.
Pourtant faire du manga n’était pas une évidence. Si j’en suis venu là, c’est que je voulais faire des films. Aussi loin que je me souvienne, je suis toujours allé en salle. Dès l’âge de trois ans, j’y ai accompagné ma mère durant les week-ends et les vacances. Adolescente, elle séchait les cours pour aller au ciné. Elle était passionnée par Truffaut et avait une fascination sans borne pour Christopher Walken. Assez naturellement, elle m’a emmené avec elle. Petit, j’ai pu voir toutes les daubes que je voulais (j’ai vu toutes les adaptations des Tortues Ninja). On pouvait aller en salle deux fois par jour, voir cinq à sept films par semaine. Du cinéma Hollywoodien. Du cinéma d’auteur. Du cinéma asiatique. Bref tout. Sans compter les cassettes vidéo.
Avec mon père, qui peignait avec la télévision en fond sonore, j’ai découvert les polars, la science-fiction et les films d’action, que l’on voyait sur Canal + ou en magnétoscope. J’ai une très grosse culture vidéoclub. Pourtant le cinéma n’était qu’un divertissement… Ce que je voulais, c’était faire les Beaux-Arts.
À cette époque, fin 90, début 2000, le Graal pour les étudiants était de posséder une caméra DV. Un caméscope numérique, une Sony de préférence, avec un Mac pour faire du montage. Tout le monde voulait faire des installations vidéo… Moi j’avais tout claqué dans un PC. Ni mes parents ni moi ne pouvions m’offrir de caméra.
Pourtant je sentais que je voulais faire de la narration en vidéo. Et peu importe si c’était en basse résolution. Pendant un temps, j’ai utilisé une webcam avec un dictaphone couplé à un micro de PC. On ne peut pas faire plus cheap. Tout le monde me le rappelait sauf mon professeur de vidéo qui m’encourageait. De l’image et du son: c’est tout ce qui compte sur un écran quand on a les bonnes intentions.
Mais très vite, je me suis heurté à deux réalités. Le cinéma est un art collectif et moi j’étais seul. Et j’ai compris que lorsque l’on ne sait pas cadrer avec un caméscope, comme c’était mon cas, alors il était compliqué de faire un film. Pourtant deux ou trois ans plus tard, un producteur me signait pour réaliser un premier court-métrage, avant même que j’obtienne mon diplôme. Et ça, c’est en grande partie grâce à Satoshi Kon.
Satoshi Kon le réalisateur qui m’a donné envie de faire du cinéma
Les amateurs de cinéma d’animation connaissent tous Satoshi Kon. Pourtant, le jour où j’ai découvert son premier film, j’étais seul dans la salle. Tout juste bachelier, avec un appétit délirant autour du Japon, Perfect Blue m’a mis une grande claque. En voyant ce thriller psychologique où une ancienne chanteuse de girls band sombre peu à peu dans la schizophrénie, je comprends que les films d’animation peuvent être pour adultes. Je suis fasciné par la façon dont Kon mêle le réel, l’imaginaire, l’onirisme, les cauchemars ou les visions délirantes. Et si j’utilise le fantastique et les cauchemars dans mon œuvre, c’est probablement du fait de son influence. Quelques années plus tard, je découvre sa série Paronaïa agent (2004), que je considère comme son chef d’œuvre. Il y a notamment un épisode qui se passe lors de la création d’un dessin animé. L’occasion pour le réalisateur de décrire tous les métiers : animateur, réalisateur, décorateur, coloriste. Cet épisode, c’est le déclic. À partir de là, c’est décidé, je peux faire de l’animation chez moi, seul, en autodidacte. Il me suffit juste d’enfiler toutes les casquettes. Je ne sais pas animer ? Pas grave, je filmerai au caméscope et je décalquerai plan par plan à la palette graphique. Je ne sais pas cadrer ? Là, désormais avec un ordinateur, j’ai tout le temps de peaufiner mon plan. Je réalise alors en autodidacte sept minutes d’animation, avec mon petit frère de sept ans comme interprète principal. L’animation vaut ce qu’elle vaut, par contre je soigne le découpage, le montage, le jeu avec la musique, et surtout le style graphique.
Quand Bruno Collet, un réalisateur de films d’animation passe à mon école des Beaux-Arts, je lui montre mon film, histoire d’avoir un avis. Une semaine plus tard, son producteur me laisse un message sur mon répondeur. Ils seraient très heureux que je réalise un court métrage pour eux.

Camille Moulin-Dupré, Mima, l’héroïne angoissée et son double maléfique du film Perfect Blue de Satoshi Kon.
Jean-Paul Belmondo, l’acteur pour lequel j’ai réalisé un film
Quand Jean-François le Corre, le producteur du studio Vivement Lundi! me propose de faire un film sur Belmondo, j’ai du mal à être enthousiaste. Bébel a beau être une icône du cinéma, pour moi c’est un vieil acteur qui n’est pas de ma génération. Mais faire un film n’est pas une occasion qui se refuse.
J’ai alors en tête un autre chef d’œuvre de Satoshi Kon : Millennium Actress (2001). La vie fictive d’une actrice qui a traversé tout le cinéma japonais. Avec Belmondo, je mesure bien que je peux faire la même chose avec le cinéma français. En regardant cinq films de Jean-Luc Godard et de De Broca, je me rends compte que l’acteur français a joué tous les genres : polar, aventure, comédie, drame, action… Et aussi, qu’il court toujours après une fille : Anna Karina, Jean Seberg, Ursulla Andress, Françoise d’Orléac… L’idée du film Allons-y! Alonzo! (2009) me vient instantanément : Bébel qui part à la poursuite d’une jeune femme, en explorant sa filmographie, le tout dessiné comme le journal de Tintin.

Camille Moulin-Dupré, Jean-Paul Belmondo en Pierrot le fou, extrait de mon film ALLONS-Y ! ALONZO !
Wes Anderson, le réalisateur par lequel je suis arrivé au manga
C’est en voyant Fantastic Mister Fox (2009) que m’est venue l’idée du Voleur d’estampes. En sortant de la salle, je me suis mis à raconter ma propre histoire de cambrioleur. Mais je voulais la transposer dans le Japon du XIXe siècle, avec une esthétique fidèle aux maîtres de l’ukiyo-e : Harunobu et Hiroshige.
Et voici comment m’est apparu mon nouveau film d’animation ! Un projet hybride que je voulais aussi transposer en livre. Au final le film ne s’est jamais fait.Il est devenu un manga en deux tomes édités chez Glénat. Aucun regret, bien au contraire : en quatre cents pages on peut raconter bien plus de choses qu’en quinze minutes d’un court-métrage.
Pourtant ce projet je l’ai vraiment pensé comme un film d’animation. Chaque case est un plan, chaque chapitre est une scène. Je compose mes doubles pages comme si elles étaient un cadre de cinéma. Le cinéma, c’est avant tout raconter en image plutôt qu’en mot. Aussi pour chaque tome, je dessine d’abord toutes les planches et ce n’est qu’une fois les images terminées que j’y ajoute les dialogues. Si une image se suffit à elle-même, pas la peine de rajouter du texte.
Le premier tome a été un succès inattendu, en grande partie par son style visuel, et aussi grâce à la passion grandissante du public envers le Japon. Cela allait faire un an jour pour jour que le livre était sorti. La veille, j’ai dit à ma fiancée à quel point j’étais heureux de fêter l’anniversaire du Voleur d’estampes, mais que le plus beau des cadeaux serait un coup de téléphone pour du travail. Et ç’a été le cas. Octavia Peissel, la co-productrice de Wes Anderson m’appelle pour me dire qu’il avait lu et aimé mon manga, et qu’il souhaiterait que je travaille sur son prochain film qui se déroule au Japon : Isle of Dogs (2018). Moi qui était autodidacte, j’allais travailler pour un grand cinéaste ! Comble de la chance, je me suis retrouvé dès le départ à travailler sous les ordres directs de Wes Anderson, avec Octavia comme relais entre nous deux. Wes est la personne la plus intelligente que j’ai rencontrée. Il a un regard terriblement affûté, il voit tout, la moindre erreur, instantanément. Avec lui, il n’y a pas de place pour l’imperfection. Il faut aussi accepter qu’on est là pour nourrir son imagination. Une imagination que je pressens comme perpétuellement en mouvement, et derrière laquelle on court toujours. Produire pour lui est long et exigeant mais il y a une véritable satisfaction à passer autant de temps sur une simple image. À la perfectionner. Surtout quand le résultat est là.

Camille Moulin-Dupré, Mon Voleur d’estampes, face au loup de Fantastic Mister Fox, de Wes Anderson. Le Voleur d’estampes, tomes 1 & 2 édité chez Glénat manga.
Mad Max Fury Road, mon film préféré
Immortan Joe, Furiosa. Un univers qui me transporte instantanément. Pourtant esthétiquement, c’est assez éloigné de mes goûts. Mais la fascination est bel et bien là. Mad Max Fury Road (2015) est tout ce que j’aime dans le cinéma. La première fois que je l’ai vu, c’était en après-midi. J’ai enchaîné ensuite avec une soirée spéciale qui projetait les deux premiers Mad Max, pour finir à nouveau sur Fury Road.
La nuit qui a suivi, j’ai rêvé en boucle des visages d’Immortan Joe et Furiosa. Puis j’ai été incapable de faire quoi que ce soit pendant une semaine. Même chose, toutes les fois où je l’ai revu. En réalisant cette illustration, j’ai de nouveau commencé à rêver du film…

Camille Moulin-Dupré, Immortan Joe et Furiosa, les héros de Mad Max Fury Road
Charade
Martine ReidCary Grant
Cary Grant est né en 1904 à Bristol, au Royaume-Uni. Il s’appelle alors Archibald Leach. Sportif, proche des milieux de théâtre, il devient acrobate. C’est au sein d’une troupe qu’il arrive en 1920 aux États-Unis, à bord de l’Olympic, l’un des transatlantiques réalisant la liaison Southampton-New York. En 2021, Martine Reid, universitaire française ayant étudié et enseigné à l’Université Yale, a publié aux Éditions Gallimard Être Cary Grant. Il s’agit d’un essai questionnant la construction de ce personnage public, et les liens étroits qu’elle entretient avec sa personnalité privée. Ensemble, nous discutons de la genèse de l’ouvrage, et de la création de cette illusion qu’est Cary Grant, mais aussi de ses failles, ses limites : le moment où elle vacille.
Florian Champagne
Quand et comment avez-vous découvert Cary Grant ?
Martine Reid
Je pense que je l’ai découvert quand j’étais adolescente, parce que sa photo devait circuler régulièrement dans les magazines. Ensuite, quand je suis allée aux États-Unis, j’ai beaucoup fréquenté les ciné-clubs de l’université dans laquelle je faisais ma thèse et où j’ai enseigné ensuite. Là, je l’ai vu très régulièrement. Il me semble que ça s’est passé en deux étapes : la première fois par la photo, la deuxième fois en le voyant au cinéma.
Florian Champagne
Quand avez-vous découvert l’existence d’Archibald Leach, cet homme que l’on connaîtra plus tard sous le nom de Cary Grant ?
Martine Reid
Il y a une quinzaine ou une vingtaine d’années, je suis tombée, un peu par hasard, sur une biographie en anglais. La seule qui faisait référence à l’époque, celle de Marc Eliot. J’ai découvert à ce moment – là qu’il était anglais, ce que j’ignorais – et qu’il y avait eu une affaire de pseudonyme – ce qui est assez habituel dans le monde du cinéma. Dans son cas, néanmoins, c’est tout à fait singulier. Il prend un nom de scène, et à partir de ce nom, il va se réinventer. Au moment où la Seconde Guerre mondiale est déclarée, il décide de prendre la nationalité américaine, et souhaite également que son nom légal, son état civil, soit transformé en Cary Grant. À l’occasion de ses mariages successifs, y compris quand il sera père d’une petite fille, il portera ce nom-là.

Cary Grant, La Mort aux trousses (North by Northwest), Alfred Hitchcock, MGM, 1959.
Florian Champagne
Quels sont les éléments qui déclenchent l’écriture de votre essai, Être Cary Grant ?
Martine Reid
Il y a d’abord un intérêt littéraire pour les écrivains, les écrivaines, qui ont changé de nom, et se sont construit une identité à partir d’un monde de fantaisie. Ce processus-là, je l’avais bien considéré en littérature, et il m’intéressait beaucoup. Un des points de départ a aussi été mon grand intérêt pour les classiques américains. Je sortais de mes habitudes de littéraire ; d’un autre côté, j’avais une grande familiarité avec la capacité qu’ont certains, certaines, à exister ailleurs, à s’auto-engendrer, à devenir un autre par l’utilisation d’un autre nom. C’était le cas de Cary Grant.
Florian Champagne
D’où vient la nécessité pour Archibald Leach de devenir Cary Grant ?
Martine Reid
C’est une nécessité que l’on peut croire consciente et inconsciente. Quand il arrive dans les bureaux de la Paramount en 1932, et qu’on lui propose un contrat, on lui explique que, pour l’honorer, il aura un nom de scène, qu’il peut choisir. Il choisit Cary car il s’était déjà appelé comme ça dans une fiction dans laquelle il avait joué à Broadway, et puis il choisit un patronyme au hasard – enfin, pas tout à fait, puisque c’est le nom d’un président américain. Il crée un nom facile à retenir, trois syllabes au total. La Paramount est d’accord, et le voilà devenu Cary Grant.
Inconsciemment, les choses sont sans doute plus complexes. C’est quelqu’un qui a eu une enfance particulièrement difficile. Il a été un enfant des rues, plus ou moins abandonné par son père, ce dernier lui ayant fait croire que sa mère était morte quand il avait dix ans, alors qu’elle avait en réalité été internée dans un hôpital psychiatrique. On trouve dans son enfance une suite d’éléments de cette nature, qui expliquent peut-être son souhait d’oublier son passé anglais, son histoire particulièrement douloureuse, de se transformer en autre. Le métier d’acteur convient idéalement pour cette transformation.
Florian Champagne
Connaître la vie intime de cet acteur, l’identité presque cachée de cet homme, nous permet-il de lire différemment sa carrière et son travail de comédien ?
Martine Reid
Logiquement, oui. Pour ma part, j’ai été soucieuse de ne pas essayer, ni de psychanalyser Cary Grant, ni d’essayer de dire : voilà ce qu’il est réellement. Ce qui m’a intéressée, c’est de penser l’image de Cary Grant au cinéma à partir de ma position de spectatrice. Je ne suis pas, dans ce cas, historienne de la littérature, encore moins critique de cinéma. Je pense avoir un certain nombre d’outils à disposition pour penser les choses de manière satisfaisante ; mais au bout du compte, on ne sait pas qui est Cary Grant, et on ne le saura jamais. C’est pourquoi j’ai volontiers utilisé le terme de leurre : c’est une sorte d’illusion, de fantôme créé par Hollywood, dans lequel la réussite de Cary Grant est majeure, épatante.
Florian Champagne
Au cinéma, Cary Grant incarne ce qu’on pourrait appeler le gendre idéal : séduisant, viril, agréable. Cette figure dit-elle quelque chose de l’époque qu’elle fait rêver ?
Martine Reid
Oui, parce que l’on a un cinéma qui doit être extrêmement consensuel. Il faut présenter des images tout à fait irréprochables d’un point de vue moral : le masculin en gloire, le féminin en gloire. Les stars, chacune dans leur genre, et dans les multiples sens de ce terme, incarnent le masculin et le féminin. Cary Grant ne déroge pas du tout à l’image qu’on lui a collée à la peau : la Paramount cherchait un acteur avec ce type de physique, qui soit européen, parce qu’il y avait une sorte de prestige du physique européen. Au départ, c’est un mauvais acteur qui n’a jamais suivi de cours d’art dramatique. Il est grand, unanimement considéré comme très beau. C’est une figure idéale.
Florian Champagne
Vous venez de le dire : au départ, ce n’est pas un très bon acteur. Pourtant, il devient celui que tous veulent imiter. Comment passe-t-il de l’un à l’autre ?
Martine Reid
Le travail, le temps. Les critiques ont très justement fait remarquer qu’il est maladroit dans ses premiers films. Il doit probablement suivre des indications plus ou moins précises, et ne fait que ce qu’on lui demande. Au moment où on imagine de lui faire jouer un rôle à la fois sentimental et comique, dans une sorte de distanciation avec le personnage qu’il joue, il devient meilleur. Lorsqu’il commence à jouer avec Hitchcock, ce dernier voit que derrière cette façade élégante, qui n’est au fond qu’une coquille vide, il y a probablement un homme capable de rages formidables, et qu’il faudrait qu’il puisse les manifester à l’écran. Ça, c’est Soupçons : le génie de Hitchcock est d’avoir été capable de comprendre que, derrière cette façade en smoking, ce sourire figé, il y avait quelqu’un avec un caractère beaucoup plus complexe, qu’il pouvait faire passer à l’écran. Petit à petit, les choses se sont mises en place. Ainsi, il a fini par être ce grand acteur, que tout le monde a rêvé d’être.
Florian Champagne
Vous parlez d’Être Cary Grant comme d’un essai, plus que comme d’une biographie. Y-a-t-il une part de spéculation dans ce que vous y écrivez ?
Martine Reid
C’est un essai, ce n’est pas une biographie. Il y a une biographie que j’aurais aimé faire, c’est celle de Scott Eyman. Il a été dans les archives, a retrouvé les carnets de jeunesse de Cary Grant… Il aurait fallu être sur place six mois. Ça aurait été agréable, mais ça n’a pas été possible. Je me suis contentée de ma place de spectatrice : je suis cinéphile, j’ai vu une très grande partie des soixante-quinze films dans lesquels il a tourné, je peux raisonner sur sa personne, par ailleurs j’ai des informations biographiques, et je peux essayer de mettre une chose avec l’autre pour poser des questions, plus que d’y répondre. Cary Grant est un leurre magnifique : on ne peut pas dire exactement qui il est. Sans doute ne peut-on le dire pour personne.
FLORIAN CHAMPAGNE
Ajoutez-vous de la fiction à la fiction, de l’illusion à l’illusion ?
MARTINE REID
On pourrait dire ça : ma réaction à sa figure maintient l’illusion.
FLORIAN CHAMPAGNE
Dans cette idée d’une quête de la vérité derrière l’illusion, je pense aux prétendues relations homosexuelles que Grant aurait entretenues, et dont il semble que nous n’ayons aucune preuve formelle.
MARTINE REID
Là, je n’ai pas voulu trancher. Je pense que l’on ne sait pas, et qu’il faut maintenir ce fait. On peut interpréter et interroger. On peut voir qu’il y a eu,
de sa part, un déni systématique durant toute son existence. Le plus vraisemblable est qu’il était bisexuel. Ce que l’on sait, c’est qu’il est difficile dans ses rapports affectifs avec les autres – quelle que soit leur nature. Dans sa vie, il y a des ratages sentimentaux à répétition : marié cinq fois, le dernier mariage étant le plus court.
Dans ce registre, il est intéressant de noter que, dans certains films, on le voit travesti. Certes, le travesti est une habitude du cinéma burlesque, et du théâtre burlesque. Mais cette situation ne s’observe pas pour d’autres acteurs contemporains de Cary Grant. On ne voit pas James Stewart, auquel on l’a souvent comparé, avec des vêtements de femme…
Florian Champagne
Le livre évoque les rapports que Cary Grant entretient avec Archibald Leach, tout au long de sa vie, sur les troubles et les croisements que cause cette double identité. Pensez-vous que les rapports entre son identité et son personnage évoluent tout au long de son existence ?
Martine Reid
Oui, ça évolue, mais à la différence de certains autres cas que je connais, notamment en littérature, on voit que chez Cary Grant, au fond, les deux noms restent en tension l’un vis-à-vis de l’autre. Il abandonne son nom anglais pour un nom de fantaisie, créé à des fins de rôles cinématographiques ; mais cette sorte de double identité reste problématique jusqu’à la fin de sa vie. C’est quelqu’un qui a eu des problèmes récurrents à ce sujet. Lui-même, au moment où il prend la nationalité américaine, et se fait appeler Cary Grant, dit : « Ça y est, cette fois, je suis débarrassé de mon premier nom. » Sauf que ça n’est pas si simple. Alors qu’il a une cinquantaine d’années, il passe chez un psychiatre qui va lui recommander de prendre du LSD à des fins thérapeutiques pendant un an et demi, pour essayer de dénouer cette sorte de difficulté existentielle qui le caractérise.
Florian Champagne
À quel point pensez-vous qu’il a conscience de cette illusion qu’il façonne, au fur et à mesure de sa carrière ?
Martine Reid
Cette illusion, il y tient : son identité est celle-là. C’est Hitchcock qui a, au fond, imaginé cette sorte de paradoxe, d’inversion de la situation : puisque Cary Grant existe au cinéma, il existe dans la réalité. C’est l’illusion qui crée Cary Grant. Et, dans la réalité, il se débrouille avec ça. Il est Cary Grant.
Florian Champagne
Est-ce que le succès qu’il obtient, lié à la création de son personnage, est quelque chose qu’il désire ? Dans ce que vous expliquez, on dirait presque que les choses lui arrivent comme par accident.
Martine Reid
J’ai eu ce sentiment, oui. Au fond, on dirait qu’il se laisse faire, se laisse porter par les différents rôles qu’il va occuper, et qui vont construire sa personnalité, film après film. À un moment donné, il décide de s’arrêter, après soixante – quinze films. Il arrête de jouer alors qu’il a une soixantaine d’années. Mais ensuite, quand il a quatre – vingt ans – ça c’est tout à fait extravagant et sans équivalent – il décide de faire des sortes de one man shows où il va raconter sa carrière cinématographique.
Florian Champagne
Pensez-vous que cette série de spectacles naît de son désir de profiter de son succès, du personnage qu’il a créé ?
Martine Reid
On peut se le demander, parce que ce n’est certainement pas pour des raisons financières : il est riche à millions. Peut-être est-ce pour mesurer sa popularité : il veut que les gens soient là, qu’ils viennent pour voir Cary Grant. Quand il commence à faire ça, il a arrêté le cinéma depuis une vingtaine d’années. Et il présente – chose très étonnante – des extraits de ses films dans lesquels il est beaucoup plus jeune et beau qu’il n’est à quatre-vingts ans : on le sent à bout de souffle, un vieux monsieur boursouflé, l’alcool et la drogue n’aidant pas. Il fait le tour des États-Unis comme s’il était un vieux clown, qui avait besoin de se montrer.
Florian Champagne
Comme s’il était attaché à Cary Grant tel qu’il est dans les films.
Martine Reid
Il a besoin de renouer avec ce Cary Grant-là, qui n’est, jusqu’à un certain point, plus. En même temps, c’est son identité. Quand on regarde dans l’histoire du cinéma, je n’ai pas trouvé d’acteurs qui aient fait des choses semblables – se produire pour raconter leur vie. Cet exercice est tout à fait curieux… Surtout que c’est fatigant. Il fait une crise cardiaque avant d’entrer en scène dans un endroit perdu des États-Unis, et va mourir dans ces circonstances. Qu’avait-il besoin de faire cela ? Il devait, assurément, y trouver satisfaction.
Florian Champagne
Cary Grant ne serait-il finalement que le symptôme parfait d’une industrie – celle du cinéma – destinée à produire de l’illusion, faire rêver le public ?
Martine Reid
Quand on regarde ses quatre premiers mariages, on peut croire qu’effectivement, c’est l’image d’un Cary Grant de cinéma qui est apparue extrêmement séduisante. Dans la réalité, quatre de ses femmes l’ont quitté. Comment peut-on quitter une icône si extraordinaire ? Toutes invoquent les mêmes raisons. Elles décrivent un homme obsessionnel, jaloux, infidèle, violent, profondément dépressif. Ce n’est plus l’image de cinéma, mais celle d’un homme torturé, instable ; mais sans doute content de lui, pour toutes sortes de raisons.On revient à l’idée de l’illusion : c’est le miracle, le mirage, de l’écran de cinéma, qui projette des êtres qui paraissent exceptionnels, parce qu’ils sont parfaitement fabriqués par l’image, par l’éclairage, par la façon dont ils sont cadrés à l’écran. Le cinéma est de l’ordre du merveilleux, de l’opération magique, de la perfection. Pendant une heure, une heure vingt, une heure quarante, on a quelqu’un qui est « parfait ».
Dans la réalité, personne n’est parfait – et, sans surprise, les choses sont plus compliquées. Dans son cas, les choses le sont particulièrement, parce que l’illusion a été particulièrement efficace. Il y a un grand écart, entre, d’un côté, l’illusion créée au cinéma, avec un savoir-faire remarquable, et de l’autre, un homme limité dans ses capacités affectives, qui a eu toutes sortes de difficultés. Un critique avait dit : « Avec l’enfance qu’il a eue, Cary Grant aurait simplement dû être un adulte névrosé. » Il a réussi à transcender cela, grâce au cinéma, à l’illusion. D’ailleurs, nous, en miniature, sans être de grands acteurs, nous pouvons également faire l’expérience de l’illusion que nous pouvons arriver à créer, par opposition à la réalité de notre situation. Heureusement que l’illusion existe : je suis pour l’illusion, résolument.
C.Q.F.D. de l’ambiance
Une conversation
avec Emanuele Coccia
Luca Marchetti
LUCA MARCHETTI
On ne peut pas discuter d’ambiance sans aborder la question du « sensible » qui occupe aujourd’hui une place inédite dans la culture. Commençons en observant que les aspects de l’expérience qui relèvent de la sensibilité sont devenus fondamentaux pour définir notre identité. Ainsi, pour préciser son statut social, l’individu affiche plus volontiers ses compétences esthétiques, ses goûts gastronomiques ou ses connaissances en œnologie, que son appartenance à une classe sociale ou alors une situation socio-économique. Qu’en pense l’auteur de La Vie Sensible?
EMANUELE COCCIA
C’est tout à fait le cas. C’est très important de montrer des compétences sensibles pour se présenter à l’autre.
La sensibilité a été graduellement arrachée à son statut traditionnel de phénomène d’apparence. Ce n’est plus une interface entre nous et le monde, elle fait tout à fait partie des mécanismes de construction du réel et de la vie de chacun dans la société. Débattre de choses sensibles ou esthétiques – comme les vins et spiritueux – est un moyen de montrer sa « valeur » individuelle et son mode d’être dans le monde.
Pour le comprendre, il faut rappeler que tout cela a été possible parce que notre société a graduellement adopté une vision de l’esthétique ancrée dans le « jeu ». Et la culture digitale n’y est pas pour rien. Comme le dit, entre autres, l’écrivain Alessandro Baricco, la logique au cœur de la société digitale est une logique de gaming et celle-ci définit de plus en plus notre rapport à la société. Ce qui fait écho aux idées bien plus anciennes du philosophe Friedrich Von Schiller qui, dans ses considérations sur l’appréciation esthétique, affirme qu’elle est en mesure de transformer les qualités de l’objet en prouvant que la beauté n’est pas une simple qualité de l’objet, ou de l’œuvre d’art, mais que le jeu esthétique entre humains qui révèle le beau est quelque chose qui est en mesure de perfectionner la vie sociale dans son ensemble… Ce même jeu est ce qui nous permet d’affirmer notre liberté et notre autonomie. Ainsi, on peut élargir la logique du gaming jusqu’au cosmos, car nous le construisons de manière sensible, comme dans un jeu, parce que cela nous permet de mettre en scène notre liberté d’individu. C’est pour la même raison qu’on se définit en discutant de vins et de nourriture : on ne se cantonne pas à une contemplation de la réalité, on en débat pour mettre en scène notre liberté aux yeux des autres…
LUCA MARCHETTI
Certains considèrent cet engouement pour le sensible comme une mode, surtout dans les domaines créatifs comme l’art, la création de vêtements, le design ou la décoration d’intérieur… Pourtant l’étude des ambiances, du goût, de l’éphémère et bien d’autres phénomènes sensibles gagnent également de l’importance dans des domaines bien plus sérieux comme l’étude de la cognition et les sciences humaines. La philosophie s’y intéresse particulièrement, probablement en raison de sa capacité de s’attaquer à ce qui n’est pas quantifiable ou mesurable. Quelle place tient l’ambiance dans ta recherche ?
EMANUELE COCCIA
J’ai beaucoup travaillé sur ça. Dans La Vie Sensible bien évidemment mais aussi dans La Vie des Plantes où j’ai consacré un chapitre entier à l’idée d’atmosphère. C’est pour moi un concept central dans la réflexion sur l’esthétique qui le plus souvent a été traité comme un phénomène cognitif, c’est à dire quelque chose qui nous transmet une information. Au contraire, je tiens à mettre en valeur le caractère « génétique » du sensible.

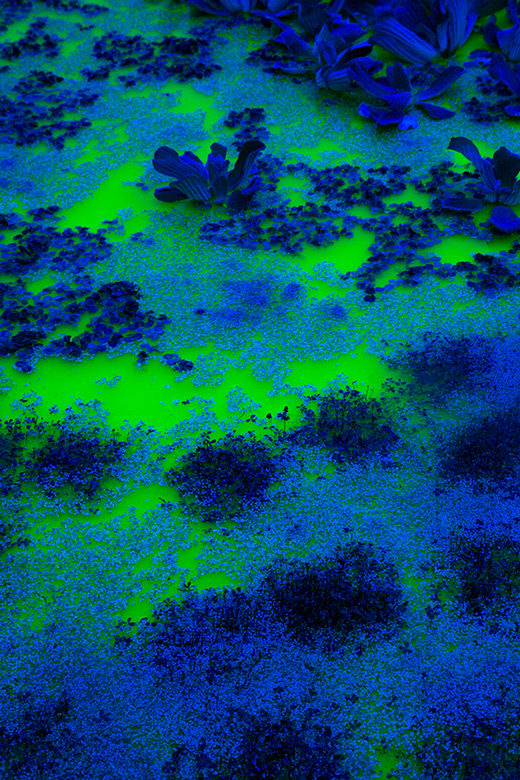
Olafur Eliasson, Life, 2021. Vue de l’installation à la Fondation Beyeler. Photo: Pati Grabowicz. Avec l’aimable autorisation de l’artiste, de neugerriemschneider, Berlin et de Tanya Bonakdar Gallery, New York / Los Angeles. © 2021 Olafur Eliasson
Le sensible n’est pas un moyen d’accéder à la connaissance. C’est ce par quoi les êtres se construisent réciproquement… Notre manière d’exister est telle que nous la connaissons en raison de notre nature sensible ! Le sensible, et donc les ambiances, sont à la base de notre relation à l’autre et à notre contexte de vie.
LUCA MARCHETTI
D’ailleurs ton confrère philosophe Bruce Bégout (Le Concept d’Ambiance, Paris, Seuil, 2020) décrit l’ambiance comme un aspect fondamental de l’existence qui se manifeste autant dans l’environnement qui nous entoure que dans notre dimension affective. Ce serait donc tout ce qui est alentour et qui nous affecte.
EMANUELE COCCIA
C’est vrai, mais l’ambiance détermine aussi notre mode d’être. Ce n’est pas juste « ce qui nous affecte » et qui nous communique des informations, c’est quelque chose qui structure notre être, une condition de notre existence. Ça peut paraître un peu abstrait, mais les manifestations en sont tout à fait banales et quotidiennes. Le manque de coolness nous fait abandonner un lieu, un groupe, tout comme l’absence d’empathie peut nous amener à interrompre une relation… Il ne s’agit pas d’un manque d’information mais d’une impossibilité d’être « comme ça ».
LUCA MARCHETTI
Et la mode dans tout ça ? Tu t’en es beaucoup occupé dans ton parcours. Récemment il a été question d’aborder l’espace de vente de la mode – notamment le premier concept-store de l’histoire, le milanais 10 Corso Como. Tu en as donné une lecture éclairante, loin des interprétations visuelles et des déchiffrages des codes culturels souvent empruntés par les sciences humaines et sociales pour étudier ces mêmes phénomènes. Tu parles de mode comme d’un « intensificateur » de l’existence. La dimension affective y est donc cruciale, tout comme la nature affective de l’ambiance peut expliquer en grande partie le sens d’un lieu comme le concept-store…
EMANUELE COCCIA
Sûrement. D’ailleurs Carla Sozzani rappelle que sa principale motivation lors de la conception de 10 Corso Como était sa volonté de transformer les pages d’un magazine en un espace en trois dimensions. Si on considère que sur les pages d’un magazine de mode on retrouve un agencement sensible de formes, d’idées et de propos, sa version en 3D consiste à transposer dans l’espace une « portion » de monde. 10 Corso Como a fait de l’ambiance la condition même du lieu.

Ann Veronica Janssens, Ciel, 2003. Retransmission visuelle du ciel en temps réel, vue d’installation, Belgacom, Bruxelles. Extrait du catalogue Ann Veronica Janssens : 8’26’’, édité par MAC, École nationale supérieure des beaux-arts, 2004. Design de M/M (Paris). Bibliothèque Justin Morin
La possibilité d’engendrer « du sensible » est au cœur de sa réalité, car le sensible y contamine tout : son économie, la manière d’y manger, de regarder, d’y respirer… C’est tout un monde sensible !
LUCA MARCHETTI
On sait que l’un des usages sociaux de la mode parmi les plus connus est de nous définir, autant individuellement que collectivement. Penses-tu que grâce la mode on pourrait se définir, se reconnaître et se faire reconnaître en termes « ambianciels » aussi ? C’est à dire, de manière éphémère, intangible ?
EMANUELE COCCIA
Oui c’est certainement le cas. La mode est une force anti-destin. Elle arrache les gens à leur destin et en ouvre d’autres à coup d’inventions et de réinventions. De ce point de vue, la mode a décidément besoin d’ambiances. Elle doit déterminer des ambiances, des environnements ; c’est sa force. L’aspect essentiel des ambiances, des atmosphères, est leur caractère précaire et éphémère. L’essence de la mode est la capacité d’accepter la précarité de l’être. D’une part, c’est la forme la plus démocratique qui soit, mais c’est aussi l’espace le plus précaire que notre culture a pu créer, ce qui complique les choses. Elle envisage la précarité comme une chance et non pas comme un aspect de vulnérabilité. Si elle a autant d’attrait, c’est qu’elle a horreur des identités stables, et cette vision de l’identité ne peut être qu’une ambiance.
LUCA MARCHETTI
Traditionnellement, on manifeste l’appartenance à un genre, à une culture ou même à une « ethnie » à partir de l’apparence, jusqu’à exhiber des signes visuels précisément codés. Pouvons-nous voir dans le caractère précaire et éphémère de la mode, dans sa nature « ambiancielle » une occasion de construire l’identité de l’individu de manière plus fluide, voire diverse et inclusive ?
EMANUELE COCCIA
Je ne suis pas sûr que le problème aujourd’hui soit le « signe visuel ». Je le vois plutôt dans une étrange volonté d’essentialiser l’identité… Une vision morale qui relie l’identité au tangible et au visible. J’y vois aussi un désir de pureté,qui considère que se définir sur la base du ressenti serait « impur ». L’une des conséquences est qu’on finit souvent par revendiquer l’affiliation à une communauté pour se définir. Alors que l’identité existe par sa nature atmosphérique et ambiancielle, elle est ancrée dans le ressenti le plus profond…
LUCA MARCHETTI
Nous avons parlé du concept-store, mais il me semble que le défilé et l’événement de mode tirent leur sens de ce qu’on pourrait appeler le « design d’ambiances », bien que cet aspect ne soit pas fréquemment considéré. Je pense par exemple aux défilés de Balenciaga visant à recréer l’ambiance de certains lieux politiques (en reprenant leur proportions exactes), ou l’atmosphère des archives historiques de la maison avec l’aide de créations d’odeurs par l’artiste Sissel Tolaas…
EMANUELE COCCIA
Ces projets montrent de manière encore plus claire la vocation de la mode à envisager le monde comme entièrement dé-constructible. On revient à la logique esthétique propre au gaming et à la capacité de la mode à tirer sa force de la précarité. Le défilé construit tout un monde ambienciel pour le brûler sous nos yeux en quelques minutes. En ce sens,la mode est ce qui permet d’amener les principes de l’art au plus près du corps et de nous les faire vivre grâce à une forme de sensibilité immédiate et incarnée.
LUCA MARCHETTI
Dans l’art on retrouve aussi un intérêt grandissant pour l’éphémère et l’intangible, n’est-ce pas? De l’art relationnel à l’installation, de la performance jusqu’à des œuvres très différentes les unes des autres, mais toutes hautement immersives. Je pense au travail d’Anne Veronika Janssen, d’Olafur Eliasson, de Sarah Sze, certains projets de Diller & Scofidio ou la pratique de Philippe Rahm entre art et architecture… Peut-on parler d’une esthétique des ambiances ou carrément d’art ambianciel ?
EMANUELE COCCIA
Grande question ! Probablement oui, ça existe déjà en partie. L’art aussi tend de plus en plus à devenir « construction de mondes », et tout y devient ambiances et atmosphères… C’est cela qui définira la construction du monde une fois que l’art aura pris le dessus sur le monde !
Henky Dunky
Herr Seele
Fruit de l’imagination 100 % belge du duo Herr Seele et Kamagurka, Cowboy Henk est un personnage désarmant. Sa logique toute personnelle l’amène à vivre des aventures hilarantes, tenant autant de l’humour surréaliste que de la poésie absurde. Né il y a quarante ans, Henk affiche une silhouette musclée, une chevelure blonde ainsi qu’un sourire ultra-blanc mais déjoue tous les stéréotypes. En quelques cases, ses auteurs parviennent toujours à créer la surprise. Publiées sous forme d’album reliés, auréolées de plusieurs prix, les aventures de Cowboy Henk semblent pourtant réservées à un public d’initiés. Cette rencontre avec Herr Seele, dont les pinceaux donnent vie à Henk, permettra certainement de partager l’un des plus excitants secrets de la culture belge.
JUSTIN MORIN
J’ai découvert votre travail en 2014, grâce au prix du patrimoine que vous avez obtenu au prestigieux Festival d’Angoulême. J’ai été séduit par la couverture de vos albums, et à la lecture, j’ai aimé votre sens du découpage, les attitudes décalées de Cowboy Henk et bien évidemment, cet humour absurde. Il y a autre chose que j’ai adoré, et qui est pourtant presque invisible. Il s’agit du motif qui sépare la couverture de la première page, et qui reprend le profil de votre personnage en le multipliant à l’infini, dans une alternance de bleu et de rouge. On dirait une peinture d’art optique, un peu comme si Bridget Riley faisait un rêve psychédélique ! Je me demandais donc quel était votre rapport à l’art.
HERR SEELE
Ma mère a étudié la céramique et la peinture, c’était une artiste professionnelle. Enfant, j’allais dans son atelier, c’est un environnement avec lequel j’étais familier. J’ai fait des études à l’École des Beaux-Arts de Gand. C’était une pleine période conceptuelle, c’était pas mal ! Je me souviens que nous avions visité la Documenta 6, en 1977, où j’ai pu découvrir le travail de Joseph Beuys que j’ai trouvé génial. D’ailleurs, l’album qui s’intitule L’humour Vache a été traduit en allemand par Jeder Mensch ist ein Cowboy (Chaque homme est un cowboy), en référence à sa fameuse citation « Chaque homme est un artiste ! » J’adore son œuvre, c’est un grand penseur et je trouve qu’il y a aussi beaucoup d’humour dans son travail. Mais c’est certainement l’un des rares artistes conceptuels que j’apprécie vraiment. Je suis plus attiré par le surréalisme !
JUSTIN MORIN
Je crois que vous avez eu un parcours professionnel atypique.
HERR SEELE
Tout à fait. Comme je l’ai dit plus tôt, je ne me reconnaissais pas dans l’art conceptuel qui était en vogue à l’époque. Pour moi, c’est un courant qui consistait plus à réfléchir à l’art qu’à en faire. Dans cette optique, pendant mes études, j’ai eu envie de pratiquer un métier concret, comme menuisier ou boulanger. Et puis je suis tombé sur une annonce qui disait : « Devenez luthier au pays de Galles. » J’y suis allé ! C’était pendant l’été 1978, en pleine période punk anglaise, ça m’intéressait beaucoup. Mais la formation de luthier était déjà pleine, donc on m’a proposé de devenir accordeur de piano ! Le cursus était prêt, deux professeurs étaient venus spécialement de Londres, mais il n’y avait pas d’élève. Je suis devenu accordeur de piano, une profession absurde, par des circonstances encore plus absurdes ! Tout cela m’a amené à avoir une grande connaissance de cet instrument, je suis aujourd’hui organologue. Je suis aussi devenu collectionneur de piano, je possède plus de 250 pièces.
JUSTIN MORIN
Cowboy Henk va fêter ses quarante ans d’existence en septembre prochain. Comment expliquez-vous sa longévité ?
HERR SEELE
C’est presque autant que la longueur de vie de Tintin, qui fait son apparition à la fin des années 1920 et dont la dernière aventure, Tintin et les Picaros, date de 1976. Cowboy Henk a commencé comme une sorte d’anti-bande dessinée. Il a tout d’abord été publié en 1981 dans le journal néerlandophone Vooruit, devenu par la suite De Morgen. À partir de 1983, il a été publié chaque semaine dans l’hebdomadaire flamand Humo, jusqu’en 2011 car la rédaction voulait du changement. Mais deux ans plus tard, il a fait son retour !

Herr Seele, Cowboy Henk Nature.
Huile sur toile, 80 × 100 cm, 2015, propriété de l’artiste.

Publié dans l’hebdomadaire Humo — n˚3394, 20 septembre 2005.
Tout ça pour dire que c’était vraiment un humour particulier, comme un humour « pas drôle ». Au début, le public détestait notre travail mais ça ne nous a pas empêché de continuer. Je crois que c’est ce qui explique pourquoi Cowboy Henk est toujours là !
Nous avons aussi créé quelques histoires longues que l’on peut retrouver aujourd’hui sous forme d’albums. En France, à nos débuts, nous avons notamment collaboré avec le journal Hara-Kiri. Nous allions de Gand à Paris dans une petite voiture 2 CV que Kamagurka conduisait pendant que je jouais du violon ! C’était fascinant et excitant car cela nous a permis de côtoyer des auteurs que nous adorions, comme Wolinski ou Cabu, mais aussi les gens qui les entouraient, comme Serge Gainsbourg ou Coluche. Ces rencontres sortaient vraiment de l’ordinaire, j’ai eu beaucoup de chance. De la même manière que j’ai eu beaucoup de chance de rencontrer Kama.
JUSTIN MORIN
Justement, pouvez-vous revenir sur votre collaboration ?
HERR SEELE
Notre rencontre a quelque chose d’une aventure religieuse, un peu comme la vie de saint François d’Assise : tu rencontres quelqu’un et tu travailles toute ta vie avec ! Nous sommes un duo d’artistes, nous avons fait de la télévision, du théâtre, des bandes dessinées, de l’art aussi.Nous travaillons ensemble depuis plus de quarante ans, et je pense que cela s’explique en partie car nous n’avons jamais eu un énorme succès commercial. Nous avons toujours été dans l’underground, et nous aimons ça ! Nous nous sommes rencontrés pendant nos études. Il était dans la même école, dans le département animation, mais n’y est pas resté longtemps. C’est à la gare que nous avons sympathisé, car il lisait le journal Hara-Kiri justement ! Moi je lisais Kafka et Heidegger, car j’ai toujours aimé la philosophie. Nous avons échangé sur nos lectures.
Nous avons trois ans d’écart, et je me souviens que déjà à l’époque, nous racontions des petites histoires à l’aide des cabines photomaton de la gare et leur planche de quatre photographies !
JUSTIN MORIN
Comment travaillez-vous ensemble ?
HERR SEELE
Kama est à l’écriture et moi au dessin, mais tout se mélange.
JUSTIN MORIN
Pouvez-vous nous en dire plus sur votre manière de travailler ? Vos planches ont-elles la même dimension que vos albums reliés ?
HERR SEELE
Non, ce sont des formats plus grands. Je travaille sur des grandes pages de papier très épais. J’aime l’encre sur le papier. Je ne suis pas fort pour les techniques infographiques. Récemment, nos planches ont été recolorisées à l’ordinateur par Lison d’Andrea et Jean-Louis Capron qui ont fait un superbe travail. Mais pour nous, c’est la blague qui est plus importante que l’esthétisme. C’est sans doute pour cela que nous faisons cela depuis si longtemps et que nous n’avons toujours pas fini ! Nous aimerions aussi faire une nouvelle histoire longue. La difficulté que nous rencontrons, c’est que nous essayons d’être spirituels avec notre art tout en voulant faire rire les gens.
JUSTIN MORIN
Est ce qu’il y a des planches que vous décidez de ne pas publier parce que vous n’êtes pas satisfaits ?
HERR SEELE
Non, une fois que le scénario est fait, on va le faire et le publier. Il faut dès le départ que nous soyons persuadés que c’est une bonne blague, sinon, nous l’abandonnons !
JUSTIN MORIN
Sur quoi travaillez-vous en ce moment ?
HERR SEELE
Je suis actuellement dans mon atelier, à Ostende. De ma fenêtre, je peux presque voir la mer du Nord ! Je suis très inspiré par la nature, j’aime la peindre ! Pour en revenir à votre question, je suis en train de créer une affiche pour une exposition sur la bande dessinée et qui réunira plusieurs auteurs d’avril à septembre prochain et qui s’intitulera Marginalia, dans le secret des collections de bandes dessinées, au Nouveau Musée National de Monaco. Et puis j’ai un grand projet ici : je travaille à l’ouverture d’un musée qui présentera à la fois une partie de ma collection de pianos, notre travail avec Kamagura, et qui pourra aussi accueillir des expositions temporaires d’autres artistes ou collectionneurs. Il y a notamment des collections fantastiques et atypiques, sur des objets du quotidien comme des ciseaux, ou des papiers d’emballage de charcuterie des années 1950, que l’on ne voit jamais et qui sont pourtant incroyables !
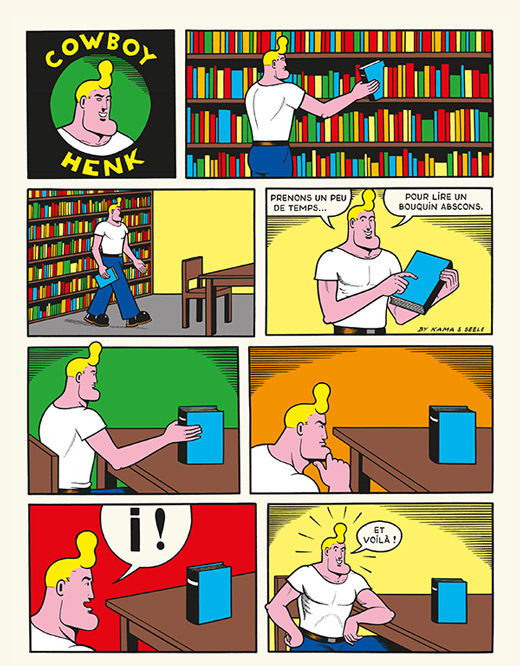
Publié dans l’hebdomadaire Humo — circa 1993.

Publié dans l’hebdomadaire Humo — n˚3901, 9 juin 2015.
Le bon mot
Julia Peker Panayotis Pascot
Quand l’absurdité du quotidien frappe, l’humour reste le meilleur allié pour prendre de la distance. Bienveillant ou caustique, analytique ou grossier, ses innombrables nuances en font un outil rhétorique aussi complexe que fascinant. Révélé à la télévision, l’humoriste Panayotis Pascot s’épanouit désormais sur scène. Entre nonchalance et confidence, son spectacle Presque aborde la question de l’amour en virevoltant d’une anecdote à l’autre, tout en jouant de ruptures entre grave et léger. Dans l’ouvrage Cet Obscur objet du dégoût (Éditions le Bord de l’eau), la philosophe Julia Peker souligne la dimension variable du goût, et par effet de miroir du dégoût. Elle pointe notamment les ressorts comiques de l’obscène. Pour Revue, nos deux invités s’interrogent sur les mécanismes du rire.
Panayotis Pascot
J’ai grandi dans une famille où nous regardions beaucoup la télévision durant le week-end, plus particulièrement les programmes consacrés aux humoristes. C’est là que j’ai découvert Raymond Devos et Pierre Desproges. C’est ce que j’appelle « les humoristes en costume ». C’était une génération qui entretenait un lien assez fort avec la littérature, le mot avait un rôle très important, presque précieux. C’est mon premier rapport avec l’humour.
Julia Peker
Moi, je pense que ma rencontre avec l’humour est plutôt passée par le cinéma lorsque j’étais enfant. Le cinéma burlesque m’a beaucoup fait rire. C’est plus tard que je suis venue à l’humour pur, déconnecté de l’œuvre d’art, dans sa pure jouissance. Et là, je peux également citer Desproges que j’ai aimé pour son jeu avec la langue, cette manière d’être tout le temps sur une ligne de crête. Et je retrouve cette même saveur dans l’humour de Blanche Gardin, où chaque mot est choisi, chaque virgule pesée, mais où tout peut se retourner à tout moment. Un peu comme si l’on marchait au bord d’un précipice.
Panayotis Pascot
Avec ces personnes, on sait qu’en tant que spectateur, on peut les suivre car ils retomberont toujours sur leurs pieds ! On peut marcher le long de la falaise, on est en confiance ! On sent le vide avec eux, à tout moment tout peut basculer et c’est ça qui est agréable.
Julia Peker
Cette sensation du vide, c’est quelque chose qui m’a toujours étonnée dans le dispositif du one man show. L’humoriste seul sur scène. Il est seul avec sa blague, qui est lâchée, hors de tout contexte. Et il y a la possibilité du vide. Du bide même !
Panayotis Pascot
Ça m’est arrivé ! On est tous passés par là ! Je rebondis sur ce que tu dis par rapport au vide. Ce qui m’a attiré dans l’humour, c’est cet aspect.
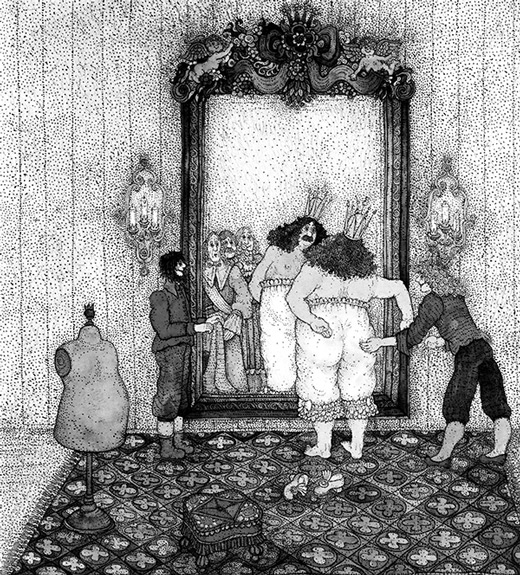
Illustration de Monika Laimgruber, extraite du livre Les Habits Neufs De L’empereur, édité en 1979 par Flammarion.
Avant, je travaillais à la télévision, mais j’ai décidé de me consacrer à la scène. Ça veut dire concrètement qu’il faut passer par des Comedy Club, pour se roder, tous les soirs, parfois plusieurs fois par soirée. C’est très dur car tu peux jouer face à des types qui sont saouls à 23 heures, ou alors face à un public de cinq ou six personnes. L’importance du vide est vraiment très contrastée par rapport à la télévision, où l’on est dans un petit confort.
Julia Peker
Sur scène, il n’y a pas de décor, rien à quoi se raccrocher.
Panayotis Pascot
Il n’y a rien ! On est vecteur de notre fond et pour autant il n’y a pas de forme ! C’est ça qui est très bizarre. C’est ça qui est assez flippant pour autant. Je précise qu’il y a une différence entre un one man show et ce que Blanche ou moi faisons, qui est du stand up. Le stand up casse le quatrième mur, là où le one man show l’utilise, comme au théâtre. Le public est derrière un mur et regarde, un peu comme un voyeur. Alors que le stand up s’adresse directement à la salle, ce qui est encore plus effrayant.
Julia Peker
Cette question de l’adresse n’est pas toujours facile à comprendre pour le spectateur qui n’est pas initié d’ailleurs.
Panayotis Pascot
C’est vrai ! Mon frère a ouvert avec l’humoriste Fary un Comedy Club, à Paris, rue Berger. L’espace a été dessiné par l’artiste JR. Comme lui et Fary sont des personnes très médiatiques, le public qui se rend là-bas ne sait pas toujours ce qu’il va y voir, ni les codes de ce genre de lieu. Parfois ça fonctionne, d’autres fois non. C’est intéressant de voir que pour ceux qui découvrent, il y a souvent une bascule qui opère au milieu de la soirée. Ils comprennent qu’on s’adresse directement à eux sans qu’il y ait de dialogue.
Julia Peker
C’est à dire ?
Panayotis Pascot
On parle directement aux gens dans le public, mais ça reste un dialogue. « Je parle sur scène et vous me répondez par vos rires, et je m’en nourris. » À l’inverse, s’il n’y a pas de rire, je vais m’aligner sur cette énergie. Une fois qu’on comprend ça, c’est quasi sexuel. Quand on sent qu’on a la confiance des spectateurs, on peut aller n’importe où.
Julia Peker
Comment travailles-tu le rythme de tes spectacles ?
Panayotis Pascot
C’est assez compliqué. Il y a quelques temps, j’ai fait une représentation dans une grande salle et je savais que dans le public se trouvaient des personnes qui me sont chères. J’étais très stressé. Tout s’est bien passé, hormis le rythme. Ce spectacle dure normalement une heure et quinze minutes. Ce soir-là, je l’ai fait en une heure et cinq minutes. J’ai tout ratatiné,il n’y avait plus de respiration. Les gens ne pouvaient pas me rejoindre.
Si on en revient à cette analogie un peu étrange du rapport sexuel, c’est un peu comme lorsque ton partenaire est trop rapide. Même si tout est super bien fait, ça ne peut pas fonctionner. Ça fait quatre ans que je fais ce métier et je commence à peine à comprendre ce genre de choses. C’est seul et sur scène que l’on se forme.
Julia Peker
La scène humoristique a un statut très particulier. C’est à la fois un lieu de sociabilité, où un humoriste s’adresse à un public, dans un univers culturel avec des références, et c’est en même temps le lieu de transgression. C’est le lieu de l’expression de l’agressivité comme nulle part ailleurs. Je ne pense pas qu’il y ait beaucoup d’autres occasions de transgresser à ce point la bien-pensance et de faire valoir la dimension d’agressivité, cette donnée constitutive presque anthropologique qui a été mise en évidence par la psychanalyse, et qui est le rapport de l’homme à l’homme.
Panayotis Pascot
Je pense que l’humour a pour vocation de relancer les dés sur des sujets qui ont déjà été traités, quels que soit ces sujets, qu’ils soient transgressifs ou non. Les regarder sous un autre angle.
Julia Peker
Ce que tu dis me fait penser à ce conte d’Hans Christian Andersen, Les Habits Neufs de l’Empereur. Un empereur souhaite se faire tisser la plus belle parure du monde. Un beau jour, deux escrocs arrivent dans la ville de l’empereur et prétendent savoir tisser une étoffe que seuls les sots ne peuvent pas voir. Ils proposent au souverain de lui confectionner un habit. L’empereur accepte et les brigands se mettent au travail. Quelques jours plus tard, il vient pour constater l’avancée du travail mais ne voit rien, car il n’y a évidemment rien ! Il décide de n’en parler à personne, car personne ne voudrait d’un empereur idiot. Il envoie des ministres qui eux aussi ne voient rien, mais n’osent pas le dire. Tout le monde parle de cette étoffe merveilleuse. Le jour où les deux escrocs décident que l’habit est terminé, ils aident l’empereur à s’habiller pour une parade auprès de la foule… Personne n’ose rien dire, tout le monde s’exclame devant ces vêtements invisibles, sauf un petit garçon qui lâche la vérité : « Le Roi est nu ! » Et ça rejoint ce que tu disais par rapport à l’intimité ! On est dans quelque chose de très fort qui est de l’ordre de la mise à nu.
Panayotis Pascot
Si j’y crois, vous y croirez.
Julia Peker
Il se joue un décalage des points de vue. Il y a quelque chose aussi sur le semblant qui est très fort dans le stand up, c’est qu’on a l’impression que tout est improvisé alors que l’on sait tous très bien que c’est un texte méticuleusement écrit. C’est comme une sorte de pacte.

Illustration de Monika Laimgruber, extraite du livre Les Habits Neufs De L’empereur, édité en 1979 par Flammarion.
Revue
Qu’est-ce qui vous fait rire ?
Panayotis Pascot
En ce moment, les annonces gouvernementales me font rire à chaque fois.
Julia Peker
C’est vrai que de faire une attestation sur l’honneur pour pouvoir sortir acheter sa baguette de pain…
Panayotis Pascot
Ou avoir la possibilité d’aller au ski mais ne pas avoir le droit d’utiliser les remontées mécaniques… Je sais aussi que c’est horrible, mais Donald Trump m’a aussi beaucoup fait rire. Ce qui me fait penser à ce qu’on appelle « la maladie de l’humoriste ». Il y a un excellent documentaire qui s’intitule Laughing Matters – visible en ligne – qui montre que les humoristes sont parmi les catégories socio-professionnelles les plus sujettes à la dépression et au suicide. Un humoriste a une sorte de recul ; puisqu’il doit trouver des blagues, il est toujours en train d’analyser ce qui se passe.
Julia Peker
C’est là où il y a aussi cette frontière qui est très ténue entre l’obscène et ce qui peut être sur scène. On en revient à ce voile du semblant : tout l’enjeu est de donner à voir une mise à nu des semblants, et de rétablir quand même un voile. C’est là où c’est une forme d’art : il s’agit de trouver ce point où l’on peut basculer d’un côté ou de l’autre – soit l’obscénité, soit le conventionnel.
On en revient à ce voile du semblant: tout l’enjeu est de donner à voir une mise à nu des semblants, et de rétablir quand même un voile. C’est là où c’est une forme d’art : il s’agit de trouver ce point où l’on peut basculer d’un côté ou de l’autre – soit l’obscénité, soit le conventionnel.
Revue
Panayotis, comment se passe l’écriture de vos spectacles ?
Panayotis Pascot
Pour le coup, je n’écris pas ! Je monte sur scène avec une idée et je me lance devant les gens. Bien évidemment ensuite je rode les choses, mais je n’écris jamais avant de monter sur scène. En fait, je fonctionne beaucoup au pistolet sur la tempe : j’arrive à trouver des blagues quand je dois me forcer à en trouver.Je suis devant les gens et si je ne suis pas marrant, ils vont vouloir me tuer avec des fourches donc il faut absolument que je sois marrant. C’est très instinctif au final.
Julia Peker
Est-ce que tu peux me raconter le fil narratif de ton spectacle, Presque, puisqu’avec ces confinements et ces couvre-feux, il est difficile de le voir !
Panayotis Pascot
Ah oui c’est vrai ce spectacle a une drôle de vie ! Presque est lié à ma vie intime car il concerne une question que je me suis posée pendant un moment. J’étais très amoureux d’une fille et je n’arrivais pas à l’embrasser. Même si je voyais qu’elle en avait envie et que tout allait bien, je n’y arrivais pas. J’explique que depuis tout petit, embrasser est une action qui me terrifie et qui m’effraie. J’ouvre le spectacle là-dessus. Ma première phrase est : « Je ne sais pas embrasser les filles et je ne sais pas pourquoi. » J’y réponds en abordant plusieurs points, notamment mon éducation et mon rapport à mon père. Premier volet ? Mais tout ça, ce sont des vraies questions que j’ai eues dans ma vie et que j’ai eu envie de raconter sur scène. J’ai détricoté ! Ça m’a aidé à avancer et à progresser. Maintenant, tout va bien !
Julia Peker
J’évoquais plus tôt le cinéma burlesque. Et toi, quel genre de cinéaste te faire rire ?
Panayotis Pascot
J’aime Wes Anderson, plus particulièrement Fantastic Mr Fox. Je pense aussi aux Monty Python, qui m’ont toujours beaucoup fait rire. Dans un registre moins visuel, j’aime aussi Judd Apatow. Il aborde souvent des choses très intimes ou des questionnements existentiels quasi métaphysiques, mais avec un regard très singulier. Et puis des fois, des films qui ne sont pas censés faire rire ont l’effet inverse sur moi, comme le cinéma de Lars Von Trier. The House that Jack Built, j’ai trouvé ça extrêmement marrant. Et toi, quels films te font rire ?
Julia Peker
Dernièrement j’ai revu Fais moi plaisir d’Emmanuel Mouret. J’ai beaucoup aimé! C’est vraiment un film qui va de situations burlesques en situations burlesques. Ici, un homme découvre par l’intermédiaire d’un ami le pouvoir d’une phrase notée sur un morceau de papier… Grâce à elle, il va séduire malgré lui une femme, ce qui va l’amener à se retrouver dans des situations rocambolesques ! Je te le conseille si tu as envie de légèreté !
Multiverse
Théo Casciani
Théo Casciani écrit, mais peut-être pas tout à fait selon l’idée que l’on en a. À la rentrée 2019, il a publié Rétine, son premier roman. Entre la France, le Japon et l’Allemagne, nous y suivons le regard d’un jeune homme : des écrans et des images qui s’y impriment, à la présence physique immédiate d’une exposition sur laquelle il a travaillé, ou d’un camion de safran renversé sur une autoroute. À travers ce regard, il appréhende le monde, les humains qu’il croise, les relations qu’il tisse, ou une relation amoureuse qui se finit.
De manière imprévue, l’agenda de Théo Casciani s’est rempli au dernier moment. Il habite à Marseille, et ne devait, alors, plus venir à Paris que pour que notre rendez-vous. Finalement, nous avons convenu de nous rencontrer par écran interposé, un FaceTime une après-midi de janvier. Par l’image, nous rentrons l’un chez l’autre.
Théo, où es-tu en ce moment ?
On dirait un jardin.
Oui, c’est le jardin de la maison où j’habite à Marseille, depuis un peu plus de six mois. On habite avec mon amie dans la maison de ses parents : nous y avons une partie indépendante, un étage plus ou moins à nous. Par contre, ce jardin est celui de tout le monde et c’est l’endroit le plus calme pour parler, discuter, téléphoner. C’est là aussi où le réseau est de meilleure qualité.
Et puis, la discussion peut commencer.
Comment te définirais-tu sans parler de tes fonctions professionnelles ?
Je n’ai pas vraiment l’impression d’avoir une profession. Je me définis toujours comme auteur, et jamais comme écrivain, artiste, ou autre chose. Je pense que ça va au-delà de mes fonctions professionnelles, dans la mesure où c’est un rapport au texte qui m’habite à la fois dans ma vie et dans ma pratique.
Quand tu parles de ton rapport au texte dans la vie, qu’est-ce que tu veux dire ?
Même si ce n’est pas une profession, c’est une sorte de déformation professionnelle : comme je passe énormément de temps dans le texte, le rapport au texte non littéraire – celui que j’entends à la radio, que je vois passer sur des écrans… – me passionne et m’intrigue beaucoup. Il s’agit aussi d’une manière de voir et appréhender le monde, y compris dans mes rapports intimes et affectifs, qui est assez proche de celle que j’ai d’appréhender le texte : en exposant les choses plutôt qu’en les affirmant, en étant ouvert à des situations installées qui n’adviennent pas de manière romanesque. Je pense suggérer, dans mes textes, la manière dont j’ai l’impression de vivre ma vie – et inversement.
La narration dans mon roman Rétine procède ainsi d’une recherche formelle, avec des jeux de boucles, de déjà-vu ou une phrase arborescente ; mais aussi d’une certaine honnêteté, même s’il ne s’agit pas d’une autofiction ou d’une autobiographie. J’ai l’impression que ma vie se déroule plus comme celle du narrateur de Rétine : des choses qui parfois adviennent de façon presque épiphanique, des situations qui s’enchaînent et s’imbriquent.
J’ai toujours eu un peu de mal avec une part de la littérature que je lisais, d’où mon intérêt pour d’autres formes artistiques. En littérature contemporaine, j’ai l’impression qu’on trouve souvent cette idée d’une vision chevaleresque de la vie, qui correspond assez peu à la manière dont je vis la mienne. Mais peut-être que ma vie est moins romanesque que celle des autres.
Quand tu as écrit Rétine, est-ce que tu avais envie de cette dimension réaliste, peut-être même naturaliste, pour être vrai au regard de ce que tu vis ?
Je ne revendique pas trop l’idée de réalisme ou de naturalisme, parce que j’ai l’impression que cela catalogue immédiatement tout un imaginaire assez lourd. C’était simplement la volonté d’avoir quelque chose de sincère dans mon rapport à la narration et au déroulé des événements. Après, les descriptions dans Rétine laissent apparaître des choses plus oniriques, ou plus virtuelles : on n’est pas dans quelque chose de purement naturaliste. Mais, dans la manière dont la vie du narrateur se passe, et est construite, c’est une transcription assez honnête de la façon dont j’appréhende ma vie, et celle des gens qui m’entourent. Il n’y a, dans ça, pas de dimension programmatique ou de manifeste. C’est lié à mon rapport à la narration de nos vies, mais aussi à mon intérêt pour d’autres formes plastiques contemporaines.
Quand j’écris un texte, je pense beaucoup plus à des artistes non littéraires qu’à des écrivains, autant à des défilés qu’à des phrases, à des plans de bâtiments qu’à des systèmes de ponctuation. Je réfléchis beaucoup plus en termes d’installation du texte, de descriptions, de scènes littéraires, plutôt que suivant la logique périmée qui consisterait à écrire un livre efficace d’un point de vue narratif : recherche de nœuds, d’intrigue, du fameux « élément perturbateur ». L’image qui me vient est celle d’un accrochage, plus que d’un récit bien rythmé.
Tu expliques que tu as envie d’inscrire ta pratique d’écriture dans le champ des arts contemporains de manière plus large, est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet ?
La manière la plus claire que j’aurais de l’exprimer serait de revenir à cette dimension d’auteur. Le plus souvent, le plus logique serait de me définir comme écrivain et artiste, sauf qu’il y a des choses qui me dérangent dans ces dénominations. Cela supposerait que l’écrivain n’est pas un artiste, et que l’artiste n’est pas un écrivain. Cela me paraît obsolète, dans la mesure où je pense que beaucoup d’écrivains contemporains ont une démarche littéraire, mais aussi plastique, installative… En tout cas, qui participe d’un régime des arts contemporains, d’un point de vue formel mais aussi économique. Aussi, je me sens assez mal à l’aise avec ces deux étiquettes. Je ne me suis jamais envisagé ni comme artiste ni comme écrivain. Le rôle de l’écrivain a changé, par rapport à l’image romantique qu’on continue à s’en faire en France. Donc je me sens beaucoup plus à l’aise dans le costume d’auteur : ça me permet de dire la vérité par rapport à ce qu’est ma pratique, qui est toujours liée à une relation intime au texte ; mais ensuite, c’est le texte qui choisit l’habit qui lui va le mieux, la fonction la plus juste. Je peux avoir une idée de texte, ou une envie d’écrire sur un sujet, un objet, ou une réflexion ; puis ensuite, voir si ce texte serait plus à même d’être exposé, performé, lu, imprimé sur un vêtement, ou, dans certains cas, d’être imprimé sur du papier, et de devenir un livre. Mais le livre ne me semble pas nécessairement primordial, c’est un format comme un autre. Je dis ça en essayant d’y voir une forme d’égalité totale, sans mépris ni romantisme.

Théo Casciani, Rétine, POL, Paris, août 2019.
Je n’ai pas ce culte du livre publié, mais ne suis pas non plus dans cette logique que peuvent avoir d’autres auteurs qui diraient que le livre est un objet caduc et périmé, et qu’il faudrait maintenant exclusivement investir le texte dans d’autres champs.
Est-ce qu’il y a un moment où tu as senti que tu pouvais affirmer un statut – que ce soit celui d’écrivain, ou d’auteur ?
J’ai commencé à écrire très jeune, ce qui ne veut pas forcément dire moi dans ma chambre à quinze ans écrivant un roman qui allait révolutionner le genre. Je n’ai pas ressenti de vocation ; j’ai seulement perçu un espace de liberté dans l’écriture, pour le lecteur comme pour l’auteur. Grâce à l’écriture, je pouvais m’exposer à de nouvelles sensations. J’écrivais sur ce que je voyais, ce qui pourrait devenir des paroles de chanson, les mots d’une performance, peu importe… C’était un rapport très touffu au langage : tout mon rapport sensible au monde passait par l’écriture, et elle devenait un lieu d’expérimentations et de possibles immense pour moi. Mais il n’y a pas vraiment eu de choix. J’ai toujours eu envie de faire ça, de mettre du texte partout, d’inventer un territoire et un temps avec les mots. D’ailleurs, j’aurais l’impression de ne jamais vraiment pouvoir affirmer un statut, au-delà de ma réticence au mot « écrivain » : par rapport à ma pratique, et même à ma vie, j’ai un peu de difficulté à accepter de me figer dans un costume précis. J’écris, c’est tout.
Quand tu écris, est-ce que tu penses aux gens à qui tu t’adresses, ou bien à qui tu veux t’adresser ?
Je pense plutôt à ma mécanique, celle du texte, qui doit être assez bien rodée ; plutôt qu’à la manière dont elle va pouvoir opérer sur tel ou tel lecteur. Toute la difficulté tient au fait que, malgré des lectures complices en cours d’écriture, mon travail ressemble à une mission d’ingénierie sur un appareil complexe, mais qui ne passe pas de crash-test grandeur nature jusqu’à la parution. D’ailleurs, c’est pour ça que c’était étrange quand Rétine est paru : je me suis senti un peu étranger à cet objet, dans la mesure où, une fois public, il ne m’appartenait plus vraiment. Mais après, c’est peut-être aussi lié à ce texte-là, et surtout à cette forme-là : le livre, le roman.
Tu pourrais dire que tu t’es senti distant, finalement, de la réception de ton livre ?
Non, pas du tout : ça m’a beaucoup touché et intéressé. J’ai l’impression d’être devenu comme une sorte de « lecteur augmenté » de Rétine. Bien sûr, en tant qu’auteur, je me dois de le défendre, et de clarifier certaines choses si elles doivent l’être. J’ai néanmoins l’impression, maintenant que le livre existe et qu’il vit auprès de gens, au-delà de moi, que mon interprétation du texte n’est pas plus valable que celle d’autres personnes, parce que beaucoup des éléments du texte peuvent être ouverts. Ces pages n’ont rien à affirmer, rien à répondre, peut-être même rien à dire.
J’ai la volonté d’imaginer une littérature qui soit plus dans la suggestion, qui génère du manque et crée un espace où le lecteur puisse circuler et avoir un rapport plus libre et sensible à la matière textuelle qu’il est en train de parcourir.
Tu as vécu quelques temps à Kyoto, au Japon. Qu’est-ce qui t’a amené dans ce pays, la première fois que tu t’y es rendu ?
Absolument rien, sinon des vacances, il y a quatre ou cinq ans. Mais, par hasard, le rapport à la ville y a été très puissant. La manière de voir le monde, le rapport à la gestuelle, à l’esthétique m’ont immédiatement marqué, tant dans leurs parties les plus contemporaines et délirantes que dans leurs aspects plus traditionnels. Le Japon avait bien sûr été présent dans ma formation culturelle : la musique ambiante, Yasujiro Ozu ou Comme des Garçons, tout ça comptait pour moi. Mais je n’étais pas un fan absolu de ce pays, qui en rêvait depuis des années. Toutefois, au fil des séjours, c’est devenu un endroit où j’ai fini par avoir autant de raisons d’être qu’ici. Après mon premier voyage, j’étais allé vivre à Kyoto pendant un an, pour découvrir davantage ce pays que j’avais eu l’impression de visiter seulement en touriste, pour créer une relation différente avec lui. Commençait à venir dans mon esprit l’idée d’une recherche autour du rapport entre littérature et image : comment faire passer par le texte des questionnements esthétiques ? De quoi sont capables les mots face aux imageries actuelles ? Beaucoup d’aspects de la création contemporaine, mais aussi de la philosophie esthétique et des arts traditionnels japonais m’intriguaient. Kyoto en est un peu le foyer, avec une grande porosité entre des rites formels et la vie courante. Je voulais aller là-bas pour questionner ces manières de faire écran, pour ouvrir mon regard à des perceptions extra-occidentales de l’espace, de l’image, de la représentation des corps ou de la nature… Tant et si bien que le Japon a fini par forcer les portes de mon livre – un peu d’ailleurs comme l’œuvre de Dominique Gonzalez-Foerster, qui m’a tant inspiré qu’elle a fini par déteindre sur le livre. Mais ça ne s’est pas passé dans l’autre sens, je ne suis pas allé au Japon pour écrire un roman qui prendrait ce pays pour cadre.
Entre Marseille, où tu habites actuellement, le Japon, où tu t’es rendu très régulièrement, Bruxelles, où tu as étudié : comment envisages-tu l’idée d’habiter quelque part?
Je crois avoir besoin d’une maison, mais je n’en ai pas. Je pense que c’est le revers de choses qui me sont nécessaires par ailleurs, notamment la possibilité d’une mobilité entre plusieurs endroits… Inconsciemment, je pense que je le provoque, dans mon rapport à mon travail et à mes textes : le fait de ne pas avoir d’espace défini me permet de rester dans une identification troublée à ce que je fais, de m’ouvrir à des pratiques différentes, non seulement en termes de médiums, mais aussi en termes de référents et de cultures.
Tous mes textes fonctionnent presque dans une logique de l’hyperlien, d’intuitions qui se télescopent : une idée en amène une autre ; par capillarité, telle pratique m’amène de la forme que je suis en train de produire vers une autre dimension.
Je pense que je provoque cela aussi par cette sorte d’instabilité, même si ce n’est pas quelque chose que je désire profondément. Je me dis souvent que j’aimerais avoir un espace plus habité, plus établi, parce qu’évidemment, ça a beaucoup d’avantages, mais aussi beaucoup d’inconvénients… Je pense que les livres qui me sont les plus chers, qui m’accompagnent, je dois les avoir en douze exemplaires : un dans la chambre de mes grands-parents, un dans celle d’un ami à Kyoto, un quelque part à Bruxelles et un autre ici à Marseille… J’ai l’impression de ne jamais avoir un point de réunion de mes affaires, d’être déconcentré et désorienté. Depuis trois ans, je n’ai jamais vraiment eu de bureau – et c’est quelque chose d’assez étonnant, parce que la conception de mes textes est vraiment obsessionnelle dans la manière dont je les élabore, dont je crée des partitions à partir desquelles je travaille. Mais, j’ai aussi un peu l’impression d’être un maniaque qui écrit sur un tabouret avec son ordinateur sur ses genoux. C’est une ambiguïté assez intéressante, qui dure depuis trop longtemps pour qu’elle ne soit pas provoquée inconsciemment par moi. Peut-être que si j’avais un bureau sublime, je perdrais quelque chose. Peut-être que j’ai fini par m’attacher à ce tabouret et à la chaleur de l’ordinateur sur mes genoux.
Tu dis que le processus d’écriture est très planifié, est-ce que tu as une forme de rituel d’écriture ?
Ce qui est très organique est le temps qui précède la conception du texte : c’est le moment où les idées me viennent, où je fais un travail de liens d’idées, d’intuitions, où je sens des tensions existantes entre des sujets, des matériaux, des territoires différents, ou encore des enjeux formels et d’écriture. Une fois que toute cette masse de mots est empilée dans des carnets, sur mon ordinateur, et cætera, je passe à un temps d’écriture de ce que j’appelle une partition, qui, même si fondée sur une logique d’indétermination, définit très précisément ce que sera le texte. Mon rapport à l’écriture, ensuite, déborde et, comme n’importe quelle pratique artistique, des choses apparaissent en cours de confection ; mais il n’y a pas chez moi de « mystère de l’écriture » où je partirais d’une phrase et j’en arriverais à un roman épique de trois cents pages. Dans mon cas, l’écriture est plutôt un temps artisanal, de fabrication et de mise en œuvre de quelque chose qui est déjà très clair dans mon esprit.
Le protocole vient aussi dans mon ordinateur : mon bureau est mon ordinateur, mes outils sont virtuels. Je n’ai un rapport au papier que dans la conception du texte et dans sa relecture, mais pas dans sa production : à défaut d’avoir un espace très établi, plutôt que de placarder des pages et des mots sur un mur, tout cela est placardé sur mon bureau d’ordinateur. Ce sont des espèces de vignettes, très souvent visuelles, très peu souvent littéraires.
Il m’arrive d’ouvrir une image en ayant la volonté de la décrire très précisément,par exemple par l’ekphrasis (une description précise et détaillée. Tiré du grec ancien, on pourrait traduire ce terme par « expliquer jusqu’au bout »). Mais c’est plutôt le fait d’avoir des dizaines et des dizaines d’onglets ouverts, que je fais défiler, qui me mettent dans une atmosphère, et au sein desquels je navigue, un peu comme la musique qu’on choisirait d’écouter en écrivant un article, ou en faisant sa déclaration d’impôts – c’est-à-dire en choisissant l’ambiance sonore qui irait le mieux à tel ou tel moment. Dans cette idée de rituel, il y a aussi le fait que j’écris beaucoup et rarement : je détache très précisément les temps où j’écris mes textes. Je pense que c’est tout cela qui crée un rendu un peu particulier dans mon écriture, entre quelque chose de très précis, travaillé par ce rapport presque mécanique à la construction de l’ensemble, et une littérature qui échappe un peu à la nécessité d’un thème, qui sorte d’une logique du sujet qui ne m’intéresserait pas trop. Pour prendre un exemple, ça m’embêterait que l’on dise un jour qu’un de mes livres est « sur ceci » ou « sur cela ». Alors, évidemment, on le dit, mais je sens bien que c’est compliqué. Ça me plaît assez qu’il soit difficile de réduire le livre à un sujet précis, et j’aimerais que le seul sujet du livre soit le livre lui-même, l’écriture elle-même.
entretien avec Florian Champagne
Pandore
Théo Casciani
Pour Revue, Théo Casciani propose un texte inédit autour de Lil Miquela, personnage virtuel suivi par plus de deux millions d’abonnés.
Miquela a mal dormi. Sa peau piquetée de taches rousses porte les traces d’une nuit trop courte. Pointé dans un miroir arrondi, son regard absent baigne de sincéritéce visage parfait. La vision de son profil de dos dressé dans une allure désinvolte dénote avec la symétrie de ses pommettes, la lisseté du derme ou la méticulosité avec laquelle ont dû être noués les macarons flanqués de part et d’autre du portrait. Lil porte un pull-over en feutre orange qui s’engouffre dans un jean anodin, elle se tient penchée contre le rebord d’un lavabo et rajuste le rouge qui garnit ses lèvres de la pointe du doigt. Elle laisse tendrement glisser cette main gauche le long de son menton en suivant les contours ovoïdes de la glace. L’attention se perd dans les jeux de reflets de l’image mais ces préparatifs matinaux paraissent artificiels. Il y a bien la teinte trop contrastée des habits, l’implantation trop nette des cheveux, mais c’est surtout dans ce regard vide que se situe l’intrigue. Miquela ignore le photographe qui la mitraille par-dessus son épaule et s’égare dans la contemplation de sa mine épuisée. Toute la nuit, le signal de connexion de ses réseaux sociaux est resté allumé, elle a accumulé les commentaires stratégiques et les publications sponsorisées. Lil a un moment d’absence, elle s’oublie un instant.
Deux images plus tôt, les traits de Miquela Sousa sont nettement plus pixellisés. Cambrée dans un selfie saisi au saut du lit, elle porte un débardeur noir échancré et barré du logo de la plateforme PornHub. Malgré son air de défi, elle voit aussitôt des centaines d’insultes et de menaces s’entasser dans sa messagerie Instagram, ce compte d’ordinaire rempli de nail art, de voyages et d’embrassades devenant le théâtre d’une bataille numérique. Certains y voient une provocation délicieuse, d’autres le stigmate d’un cynisme à toute épreuve. L’identité trouble de Miquela attire l’attention. Il se pourrait que Lil n’existe pas, qu’elle ne soit qu’un mythe androïde, d’aucuns parieraient que l’abus de retouches cosmétiques a fini par donner un air invraisemblable à une incarnation réelle. Pour la défendre, les plus fervents défenseurs de Lil invoquent une vidéo diffusée il y a plusieurs mois par des lycéennes installées à la terrasse d’un bar de la côte californienne. Les deux amies y exposent leurs sourires écarlates en piochant dans des desserts aux proportions démesurées. Mais cette séquence de quelques secondes qui ne devaient être qu’une publication parmi tant d’autres devient virale lorsque des observateurs assidus remarquent une présence étrangement crédible à l’arrière-plan. Miquela mange une glace en regardant les vagues battre la plage.
C’est grâce à ce stratagème que Trevor McFredries et Sara DeCou, cofondateurs de la société Brud Inc., sont parvenus à faire de Miquela Sousa la première influenceuse virtuelle. Après de longs mois de conception de ce personnage gynoïde sur des logiciels d’imagerie 3D, le duo américain a propulsé la jeune créature originaire de Downey et âgée de dix-neuf ans au sommet du classement des comptes les plus suivis sur Internet. Symbole d’une culture métissée et contemporaine, celle que l’on nomme Lil Miquela est d’abord un moyen de parodier et de critiquer les normes esthétiques et sociales en vigueur sur les réseaux sociaux. En entretenant le doute qui entoure la véracité de cette mannequin devenue chanteuse puis militante, Trevor McFredries et Sara DeCou orchestrent la mue de leur progéniture informatique qui peut désormais facturer près de trois cent mille euros ses prestations publicitaires, promouvoir des célébrités aussi réelles que Diplo, Hans-Ulrich Obrist ou Nile Rogers, défiler pour une collection Prada ou embrasser Bella Hadid dans une campagne Calvin Klein, si bien qu’elle fait maintenant partie des vingt-cinq personnalités les plus influentes d’Internet d’après le magazine Time. Lil se prête au jeu. Chaque jour, une nouvelle apparition de la jeune femme vient documenter sa fiction.
Drapée de ce costume d’icône virtuelle, Miquela ponctue ses poses commerciales de messages politiques. Sa parole publique résonne auprès d’une audience de plus en plus large et réceptive, qu’il s’agisse d’affirmer son adhésion aux luttes de la communauté LGBTQI, de se dresser face aux violences policières, de marcher contre le racisme ou même d’apparaître auprès d’un candidat démocrate. En décembre 2019, Lil s’installe derrière son ordinateur pour enregistrer une vidéo de réponse à ses fans sur YouTube. Elle effectue sagement quelques réglages sur l’appareil, elle néglige le désordre de la chambre puis commence à présenter ses habitudes en matière d’hygiène et de cuisine, détaille ensuite son agenda vertigineux, annonce la parution imminente d’un nouveau single puis se résout à témoigner d’une expérience traumatique vécue ce jour-là. Le clip est rythmé d’effets de montage cursifs et colorés, le débit de sa voix s’accélère et Miquela raconte une agression sexuelle subie dans un Uber le matin même. En montant dans le véhicule, elle remarque une forte odeur de déodorant et le regard lubrique du chauffeur. Celui-ci se montre de plus en plus insistant puis finit par lui poser cette question qu’elle redoute tant en lui demandant si elle est réelle. Lil l’ignore et regarde par la fenêtre en bâillant. Les plages californiennes défilent. Une main glisse sur sa jambe et remonte le long de sa cuisse.
La présence de cyborgs et d’avatars dans l’art est ancienne et récurrente, de la Poupée animée de Georges Méliès aux performances d’Alexander McQueen en passant par les différentes versions d’Ann Lee ou les réplicants de Blade Runner. En littérature, si les robots ont joué un rôle déterminant dans les œuvres de Philip K. Dick ou Isaac Asimov, plus tôt dans les nouvelles de Prosper Mérimée ou les aventures du Pinocchio de Carlo Collodi, les premières mentions textuelles de figures factices créées par l’être humain remontent aux mythologies antiques. Les exemples les plus célèbres sont ceux du Pygmalion, des destins parfois difficilement contrôlables des Golems ou encore de certaines thèses cosmogoniques. Dans l’Iliade, Homère décrit les servantes artificielles et dorées d’Héphaïstos. Ce dieu forgeron donna ainsi vie au Géant Talos, aux chiens qui gardaient le palais d’Alcinoos, ou encore à Pandore. Façonnée à partir d’argile et d’eau puis animée par Athéna, elle est la première femme humaine conçue sur les ordres de Zeus pour se venger du vol du feu par Prométhée. Elle est dotée d’une voix humaine et composée de toutes pièces à partir de l’allure d’Aphrodite, des talents d’Apollon, de la fourberie d’Hermès et de la jalousie d’Héra. « Un si beau mal » selon les mots d’Hésiode.
Il est tard maintenant, il est tard et Miquela n’en peut plus. Elle s’approche de ce lit dont elle ne sort jamais bien longtemps puis vient se lover dans les draps dans un râle. Elle s’empare de son téléphone et parcourt les actualités virtuelles. Ce qu’elle y voit l’effraie, elle y reconnaît de nombreux maux et pense aux missions auxquelles elle sera contrainte le lendemain. Lil jette un dernier coup d’œil à l’océan, éteint la lumière et s’allonge en faisant de son écran une lampe d’appoint. Elle s’aperçoit qu’elle a oublié d’enlever son rouge à lèvres et se contente de frotter maladroitement sa bouche avec le revers de sa main. Un sourire lui vient en remarquant que des trainées pourpres couvrent ses taches de rousseur. Elle hésite à prendre une photo puis se ravise. Son téléphone vibre régulièrement pour afficher des messages haineux ou des appels à l’aide. Elle aime tout mais ne répond jamais. Un vent léger balaye la pièce et caresse sa jambe sans qu’elle n’en sente rien. À quelques mètres de là, une petite jarre décorative tient dans un équilibre précaire entre son ordinateur et le vide. Elle ne sait plus quoi faire et oublie peu à peu son influence. Miquela cherche le sommeil. Elle ne pense à rien.
Magritte et Alain Robbe-Grillet : l’ère du soupçon
Joy des Horts
Publié en 1975, La Belle Captive est un roman d’Alain Robbe-Grillet illustré par René Magritte. Cette collaboration est l’occasion pour l’historienne Joy des Horts de revenir sur les liens entretenus par le Nouveau roman et le Surréalisme.
157 pages d’une prose déconstruite et palpitante. 77 reproductions en couleur d’un univers surréaliste. Ceci n’est pas une pipe, mais le roman à quasi quatre mains La Belle Captive, publié en 1975, sous la plume d’Alain Robbe-Grillet et illustré par René Magritte. Si le nom du romancier reste lié à l’école du Nouveau Roman, ses attaches avec le surréalisme sont avant tout esthétiques. Né en 1922, soit deux ans avant la publication du premier Manifeste du Surréalisme d’André Breton, il n’a jamais rencontré le peintre belge de son vivant. Pourtant, l’auteur des Gommes ou de La Jalousie partage avec Magritte cette même envie de bousculer les conventions, littéraires et artistiques. Tous deux enclins aux jeux de chausse-trappes, faux miroirs et autres allégories ironiques, le peintre faussement figuratif et l’auteur extra-fictionnel nous livrent leur part de pensée abstraite.
La Belle Captive, I
Notes sur le Nouveau Roman
En 1927, le poète Paul Nougé décrit les images de René Magritte comme « excellentes pour l’esprit, à condition de savoir s’en défendre ». Cette mise en garde sibylline, Alain Robbe-Grillet n’en a cure. Auteur flamboyant, célébré pour ses romans Les Gommes (prix Fénéon 1954) et Le Voyeur, il découvre l’œuvre de l’artiste auprès de sa veuve, Georgette. Cette rencontre est le point de départ d’une diégèse visuelle et littéraire, dont le résultat est un roman construit autour de six toiles achevées entre 1931 et 1967, chacune intitulée La Belle Captive. Quatre vues de mers, deux de paysages, plus énigmatiques les unes que les autres. À première vue, un seul point commun : toutes représentent un tableau sur chevalet — soit une peinture dans une peinture — un procédé de mise en abyme cher à Magritte. Les toiles fictives dépeignent le paysage en arrière fond, mais ce trompe-l’œil est interrompu par le cadre interne, contredisant une éventuelle persistance dans l’image. Ainsi, bien que l’arrière-plan et le premier plan se chevauchent, la perspective est faussée. Magritte nous place face à une énigme : la toile dépeinte est-elle transparente ou opaque ? Regardons-nous à travers des images au loin ou ces images sont-elles devant nous ? Cette ambiguïté crée un paradoxe visuel irrésolu.
Ce qui semble lier cette série est « l’indécidabilité » de la représentation. Comprendre : son incapacité à refléter ce qu’elle est vraiment, et que, dans le jeu de sens à la fois caché et montré, Magritte laisse au spectateur le soin d’en résoudre l’énigme. Nous entrons dans « l’ère du soupçon ». C’est cette réalité faussée qui séduit Alain Robbe-Grillet, comme point de départ pour La Belle Captive.
La Belle Captive, II
Durant toute sa carrière, Alain Robbe-Grillet a illustré la constatation suivante d’un glissement vers cet autre réel, exprimé dans Pour un Nouveau Roman : « Ce qui fait la force du romancier, c’est justement qu’il invente, qu’il invente en toute liberté, sans modèle. Le récit moderne a ceci de remarquable : il affirme de propos délibéré ce caractère, à tel point même que l’invention, l’imagination, deviennent à la limite le sujet du livre. »

René Magritte, Le monde visible, 1947.
Collection privée — Photo : Bijtebier

René Magritte, Les vacances de Hegel, 1958.
Collection Galerie Isy Brachot — Photo : Galerie Brachot
Il n’est donc pas surprenant, que, parmi tous les artistes surréalistes, il ait choisi Magritte, tant sa peinture entretient avec les mots un commerce intime, qu’il en fasse un motif à part entière ou plus conventionnellement son titre. Dans l’œuvre emblématique La Trahison des Images (1928), la première question à laquelle nous sommes immédiatement confrontés est l’apparent parti pris d’un décalage entre les images et les mots. L’artiste explique longuement dans ses Écrits complets ainsi que dans les Lettres à André Bosmans que l’emploi très personnel qu’il a des mots dans sa peinture avait pour origine une alchimie « verbo-picturale », les mots et les images peintes concourant ensemble à la création. La Belle Captive en est l’exemple même, diégèse à la fois picturale et verbale de juxtapositions et de discontinuités narratives. Et c’est dans ce refus de ce que Barthes appelle « l’effet du réel », que Robbe-Grillet nous livre un commentaire très personnel des toiles de Magritte et du surréalisme en général. Le roman s’ouvre donc sur une reproduction en couleur du Château des Pyrénées (1959) de Magritte, représentant un rocher dans le ciel, suspendu au-dessus de la mer. Puis ces mots :
« Cela commence par une pierre qui tombe, dans le silence, verticalement, immobile. Elle tombe de très haut, aérolithe, bloc rocheux aux formes massives, compact, oblong, comme une sorte d’œuf géant à la surface cabossée. »
Le récit robbe-grillétien débute, construit sur un principe de glissement et l’opposition constante à tout principe de référentialité définitive : coulée des mots à l’intérieur de la phrase, puis des énoncés dans le roman, le tout entrecoupé de ruptures et thématiques syntaxiques. Et si la roche de Magritte ressemble à un œuf, c’est indubitablement celui qui génère et contient le roman. Les images parlent, l’écriture voit. Le lecteur averti déchiffre l’humour et les apories d’un texte circulaire, sans caractères clairement définis, où la répétition d’un thème devient développement diachronique et le titre d’un tableau surgit comme un mot de passe.
Seulement, une fois admise comme impulsion génératrice, c’est bientôt l’écart variable entre l’œuvre de Magritte et le texte d’Alain Robbe-Grillet qui devient le principal paramètre du jeu. Une tactique qui, selon l’auteur, invite le lecteur-spectateur à « prendre part à cette circulation du sens parmi les organisations mouvantes de la phrase qui donne à voir et du tableau qui raconte7 ». Ainsi, titres et œuvres servent-ils de prétextes au roman lui-même, et c’est au tour du lecteur de jouer avec l’intertexte et de donner un sens à la subversion des conventions narratives. L’on pourrait résumer la Belle Captive ainsi : l’illustration, par le caractère mouvant du texte et des images, d’une certaine mise en faillite de la forme romanesque elle-même.
Construire l’énigme
Réalité et fiction deviennent dès lors les deux instruments nécessaires pour construire l’énigme de La Belle Captive. Pour y parvenir, la tâche que s’assignent Magritte comme Robbe-Grillet est toute désignée : décoller le monde, par la pensée qui dissocie les choses, les images et les mots, disloque la représentation des corps et joue du langage dans le langage. Pour cela, trois procédés :
Déterritorialiser le réel
Chez Magritte comme chez Robbe-Grillet, l’illusionnisme est contesté autrement qu’en tournant le dos à la représentation ; l’opération est subtilement conduite en restant à l’intérieur du même code iconique, c’est-à-dire en mettant en question la représentation avec les moyens mêmes de la représentation, l’illusionnisme avec l’illusionnisme, le tableau avec le tableau. Cette mise en abyme est clairement énoncée dans la série de toiles La Belle Captive, invoquant la tradition illusionniste du tableau-fenêtre pour en montrer toute sa défaillance. Magritte semble reprendre un thème cher à Breton, qui assimile le tableau à une fenêtre, se préoccupant « de savoir sur quoi elle donne ». Mais la fenêtre du peintre belge ne donne sur rien — du moins rien de réel. Il intervient précisément sur ce point délicat de la situation surréaliste, en montrant l’impraticabilité des passages que l’illusionnisme persistant s’obstine à considérer ouverts.
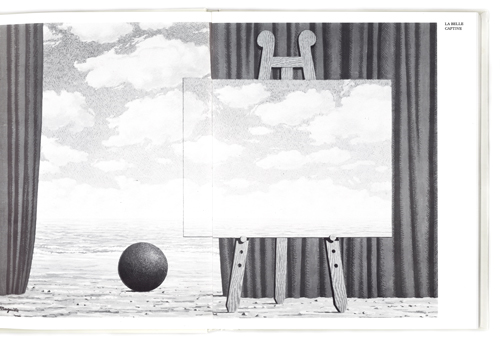
René Magritte, La belle captive, 1967.
Collection Madame Georgette Magritte — Photo : Bijtebier
Alain Robbe-Grillet & René Magritte, La belle captive, La bibliothèque des arts, Lausanne, Paris, 1975.
© Cosmos Textes
© Madame Georgette Magritte
Bibliothèque Magali Lahely
Les autres figures du vide magritiennes telles que les cadres vacants, les boites gigognes, et autres mallettes béantes participent à ce déplacement de la réalité. L’esthétique du nouveau roman de Robbe-Grillet est fondée sur des incongruités similaires, favorisant un certain désordre diégétique en dépit des conventions réalistes. Dans l’autofiction, Le Miroir qui revient, il décrit d’ailleurs la place de l’auteur comme nécessaire à la dramatisation entre ordre et désordre, entre raison et subversion. La corrosion, chez Magritte comme chez Robbe-Grillet, est donc menée à l’intérieur même du réel afin de le déterritorialiser : d’une part, à l’égard de la présumée correspondance avec la chose (c’est le cas dans les œuvres L’usage de la parole I, 1928-29 ou La clef des songes, 1936), de l’autre, à l’égard de la complexité globale de la représentation et de la narration picturale (La condition humaine I, 1933).
Transformer le réel
L’énigme chez Magritte a donc pour origine une reconstruction de la réalité à partir de la déconstruction de la logique spontanée. Cet effet est également permis par les altérations qui s’opèrent dans certaines de ses œuvres. Il faut pour cela que l’objet à traiter soit le plus familier possible. Ce deuxième procédé consiste à transformer la matière du référent, incitant ainsi le spectateur à percevoir des objets surnaturels ou des situations dissonantes. Magie, par conséquent, d’œuvres telles que L’île au trésor (1942) ou La Mémoire (1957). Au bout de ce processus, le mystère :
« Les objets ne se présentent pas comme mystérieux, c’est leur rencontre qui produit
du mystère. »
De la même façon, les multiples métamorphoses, depuis le dédoublement — Les Liaisons Dangereuses (1926) — à l’extraction d’objets sortis de leur contexte — La voix des airs (1931) sont autant de mécanismes de déboîtement de la mobilité foncière des choses, des images, des mots.
Renommer le réel
Le troisième procédé de ce décollement au réel concerne enfin les titres. Jusqu’ici « commodité de la conversation », ils participent activement à cette entreprise d’enchevêtrement généralisé. De la même manière que les objets ne sont pas en soi mystérieux et que c’est leur déplacement et/ou leur transformation qui peut les rendre tels, c’est la rencontre de mots pourtant limpides et de situations distinctes qui produit in fine l’énigme.
Chez Magritte, les mots ne doivent ni expliquer ni rassurer :
« Les titres sont choisis de telle façon qu’ils empêchent aussi de situer mes tableaux dans une région rassurante que le déroulement automatique de la pensée lui trouverait afin de sous-estimer leur portée. »
C’est l’écart marqué par les titres désignant autre chose que les objets représentés (Les Vacances de Hegel, 1958) ou enfin sa pure et simple négation nominale (Ceci n’est pas une pipe). De la même façon, les images, les mots et les idées ne constituent pas dans La Belle Captive trois ordres séparés, mais trois modes spécifiques d’une même réalité : la pensée. Il s’ensuit que les mots peuvent être reçus comme des images et les images comme des mots, afin d’en déranger nos habitudes perceptives. En effaçant ainsi les frontières spontanément reconnues par un lecteur-spectateur entre ces trois entités, Robbe-Grillet se sert des mots pour doter ses images d’un pouvoir énigmatique. Déranger pour reconstruire, déconstruire pour déranger, tels sont les deux principes complémentaires de l’esthétique de ces deux artistes ouvrant la voie à une nouvelle poétique du titre.
Mais qui est donc la belle captive ? Magritte nous met sur sa piste avec une poignée d’indices : voyons-nous le monde tel qu’il est réellement ou projetons-nous une fausse image de la réalité sur l’écran mental de la conscience ? Comment le langage colore-t-il ce que nous voyons ? Robbe-Grillet brouille les pistes. Son texte agit comme un faux miroir des œuvres, tantôt glissement, tantôt chevauchement, son mouvement perpétuel, suspendu au contexte des images, est la traduction de l’incertitude consubstantielle à toute perception. Il défigure et disloque le dernier témoignage de réalité. Or, c’est tout l’enjeu de La Belle Captive qui pose l’éventualité d’une possible confusion — ou plutôt symbiose — entre réalité et fiction. Les jeux de langage de Robbe-Grillet, comme les jeux visuels de Magritte l’attestent : il faut penser au large pour élargir le monde.
La belle captive est-elle la femme emmurée de La Femme Introuvable (1928) ? Celle mimant le plaisir érotique dans L’invention du feu (1946) ? Ou est-ce encore le cadavre de L’Assassin menacé (1927) ? Elle est tout cela et rien à la fois. La belle captive semble dès lors représenter la poursuite par les artistes d’une triple réalité : le sujet, l’objet et sa représentation. Elle s’applique dès lors à brouiller les frontières ambiguës entre peinture et littérature, réel et imaginaire, pointant par extension la relativité des systèmes de classification en tous genres. Robbe-Grillet, pour le dire avec Édouard Glissant, développe le versant plastique d’une « pensée archipélique » de l’hybridation ; une pensée tranchante, en équilibre sur le fil du rasoir, toujours prête à basculer, mais dont la force de frappe dépend précisément de sa versatilité.
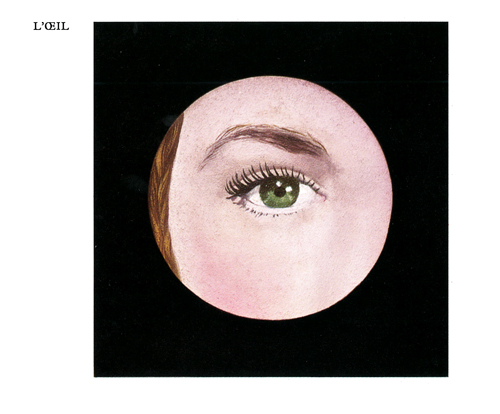
René Magritte, L’œil, sans date.
Collection Madame Georgette Magritte — Photo : Bijtebier
Alain Robbe-Grillet & René Magritte, La belle captive,
La bibliothèque des arts, Lausanne, Paris, 1975.
© Cosmos Textes
© Madame Georgette Magritte
L’ultime fiction de l’auteur s’incarnerait dès lors dans cette puissance en actes, joueuse et malicieuse, qui allie le même et son contraire, l’envers et l’endroit dans un incessant jeu de faux semblants — un piège pour amateur de structures dépourvues de sens. En s’emparant des toiles de Magritte, Robbe-Grillet crée une œuvre ouverte, dont chaque aspect recèle un potentiel poétique. C’est une fois le dialogue activé entre peinture et littérature que nous découvrons la femme cachée, celle qui déborde du cadre pour contaminer imaginaire et réel, espaces artistique et physique, comme réserve d’art. De cette entreprise de déstabilisation patiente et tenue, le critique Maurice Blanchot y remarque un effet particulier sur le lecteur, qui comme Matthias dans Le Voyeur, se retrouve à la « limite où pourraient se rejoindre, en un dehors irreprésentable, les grandes dimensions de l’être. »
La belle captive des deux artistes prend son élan dans le rêve éveillé de l’inconscient et leur désir d’approfondir notre perception de la réalité.
Savoir. Se souvenir. Devenir.
Nina Bouraoui
Nina Bouraoui m’a donné rendez-vous dans un café Place des Vosges. En l’attendant, je me demande ce que cet endroit peut dire d’elle — entouré de quelques touristes qui prennent leur petit déjeuner, les indices sont minces. Surtout pour celle que son dernier livre, Tous les hommes désirent naturellement savoir, raconte : son enfance, sa jeunesse, et la découverte de son homosexualité. Née à Rennes, Nina Bouraoui a passé son enfance en Algérie avant de s’installer de nouveau en France. Aujourd’hui, elle préfère être écrivain plutôt qu’écrivaine : « Ce n’est pas du tout une question de genre, de féminité, de masculinité, de virilité, ou de manque de virilité… Pour moi, les écrivains sont tous à égalité, et je trouve que ce mot est tellement sublime… Pourquoi le modifier ? » Elle est déjà arrivée : nous parlons des livres qui prolongent sa vie, ou l’inverse.
Florian Champagne
Nina Bouraoui, si vous deviez vous définir sans parler de vos fonctions professionnelles, que diriez-vous ?
Nina Bouraoui
Avant d’être écrivain, je me sens profondément artiste. Dès mon enfance, la création a toujours été un devoir, un rêve, et une identité. Je dessinais beaucoup, puis, quand j’ai vraiment maîtrisé l’écriture, j’ai commencé à écrire. Non pas pour remplir le vide, mais pour traduire le monde que je voyais, avec le plus de beauté et de poésie possibles : c’est ça aussi, la définition d’un artiste. J’ai construit ma vie autour de mes livres. Non pas que le réel ne me suffise pas, mais j’ai toujours besoin de le réinterpréter, de le restituer, peut-être de lui donner une forme d’infini qui m’échappe. Est-ce que c’est en avançant dans l’âge ? Mais j’ai toujours le sentiment qu’il y a une marche du temps qui m’entraîne, et que finalement, la seule façon — illusoire — de l’arrêter, c’est de créer.
Florian Champagne
Qu’est-ce qui vous fait rêver en ce moment ?
Nina Bouraoui
Mon prochain roman. L’amour, aussi, me fait rêver — parce que je suis une femme amoureuse. L’avenir me fait rêver, toujours.
Florian Champagne
Quand vous dites « une femme amoureuse » , cela signifie-t-il que c’est un état que vous cherchez à perpétuer ?
Nina Bouraoui
Non, je suis amoureuse de quelqu’un qui est amoureux de moi, depuis quelques années déjà… Je trouve que l’amour est une sorte de château que l’on construit. Et c’est bien d’y inviter les livres… Je rêve d’un avenir de plus en plus serein. J’ai souvent dit qu’il me manquait une paroi entre le monde et moi. Je trouve que plus le monde va vers la violence, plus j’essaie de rêver pour moi de douceur, de tranquillité, et de livres… Une foison de livres, une foison de création… Ne jamais s’arrêter d’écrire. J’arrive à un instant de mon travail où la peur s’est levée. J’ai souvent eu peur, j’ai souvent eu des années de page blanche, mais aujourd’hui, il me semble que l’écriture ne s’arrête jamais. Je tiens une chronique pour Têtu, j’ai des commandes auxquelles je réponds plutôt vite, j’ai une pièce de théâtre qui a été transformée en monologue et qui sortira en janvier ; en septembre suivant, mon nouveau livre sortira…
Mon rêve est, non pas d’amour et d’eau fraîche, mais d’amour et d’écriture.
Florian Champagne
Y-a-t-il a un rêve que vous avez abandonné ?
Nina Bouraoui
Je n’ai pas l’impression que je suis quelqu’un qui abandonne… Il y a un rêve, quand j’étais enfant, c’était de partir très loin, de faire partie d’un cirque, de voyager encore plus loin… J’aime voyager… J’ai souvent eu un rêve de disparition positive : me retrouver sur une île, dans la nature… J’étais fascinée par Paul-Émile Victor. C’était un rêve assez enfantin, mais que je garde quand même au creux du cœur. Je suis persuadée qu’un jour, la nature sera au centre de ma vie. J’aime la ville, mais un jour, je m’en éloignerai. La nature, c’est aussi mes racines. J’ai grandi près de la mer. Plus je vieillis, plus mes racines surgissent — alors si, je poursuis ce rêve de voyage, c’est certainement de retourner à Alger, dans cette résidence où j’ai grandi, dans le quartier où j’ai joué, où j’ai passé les quatorze premières années de ma vie — ces moments qui construisent et fondent un être. Ce rêve de retourner à Alger, je ne l’abandonne pas, mais, pour l’instant, il est mis de côté. J’ai peur de mettre fin à une légende, à une fiction, que je n’ai cessé de raconter, de réinventer. Je pense que je me suis beaucoup menti sur l’Algérie. Un écrivain n’est pas sommé de raconter la vérité, il raconte sa propre vérité. Je n’ai retenu que la poésie, la pureté, la beauté de mon enfance, où il y avait pourtant de la brutalité.
Florian Champagne
Êtes-vous déjà retournée en Algérie, sur ces lieux de votre enfance ?
Nina Bouraoui
Jamais. Je suis partie en 1981, de façon assez précipitée et imprévue. Ma mère, qui avait une sorte de vision politique, a commencé à craindre pour ce pays, à juste titre — puisque, huit ans plus tard, l’Algérie sombrait, comme elle disait, dans un bain de sang. J’étais en vacances en France, et finalement j’ai rejoint ma mère à Paris. On a vécu toutes les deux un an rue Saint Charles, dans un petit appartement, avant que mon père trouve un travail à Zurich. J’ai laissé en Algérie tous mes carnets, mes dessins, mes lettres, mes amis, mes premières amours… une part de moi-même. Je n’ai pas fermé la porte de ma chambre d’enfant — elle est restée longtemps ouverte. J’ai mis du temps à devenir une femme mÛre et mature. Et puis, j’ai nourri cette espèce de fantasme étrange, que j’avais laissé là-bas une part de moi, qui avait grandi à mon insu.
Florian Champagne
Savez-vous ce que sont devenus cet appartement, cet immeuble ?
Nina Bouraoui
Il est toujours là. Mon père y est, en ce moment ; mais on l’a totalement vidé, les choses se sont dispersées dans la nature. Cet appartement a été occupé longtemps par un de mes oncles qui avait des petites filles — je pense qu’elles se sont réappropriées ma chambre d’enfant, et tant mieux. C’est un appartement que nous louions, que mon père après a acheté… Je pense que, pour lui, c’est l’origine de notre famille. C’est un immeuble construit sur les hauteurs d’Hydra, assez étrange… Il a été construit dans les années 50, selon l’école du Corbusier — sur pilotis, un grand ensemble, plutôt moderne, qui a très mal vieilli, mais qui était très fonctionnel. Cet appartement est devenu le cadre fantasmagorique de beaucoup de mes romans. L’architecture m’a toujours fascinée. J’ai toujours beaucoup écrit sur l’architecture. D’ailleurs, je pense que ce n’est pas pour rien si la femme que j’aime est architecte. Ce cadre algérien m’a échappé, et m’a hantée. Il fait partie de mon schéma inconscient, et conscient. Toute la lumière qui éclaire mes livres de l’intérieur, toutes les structures, toutes les portes de sortie ou les portes d’entrée, souvent, dans mes romans, ont le canevas de cet appartement. Mon enfance, les histoires de cette famille, de l’amour, de la violence, et de l’écriture… L’écriture est née là. Alger était déjà une ville assez dangereuse, notamment pour les enfants… L’appartement était à la fois la protection, le lieu du fantasme et de la liberté. Cette liberté que nous n’avions pas, nous, enfants. Nous n’allions jamais à l’école toutes seules. Cet appartement était la tranchée ouverte de la création. C’est là où j’ai compris qu’écrire, c’était réinventer sa vie, que l’écriture est un espace de liberté hallucinant — pourtant, bizarrement, l’objet-livre est lui-même une petite prison.
Florian Champagne
Pourquoi avoir choisi de vous installer à Paris, plutôt qu’ailleurs ?
Nina Bouraoui
Je crois que Paris a été la première ville à m’avoir accueillie. Lorsque j’ai quatorze ans, que je vis avec ma mère rue Saint-Charles, j’apprends la liberté la plus simple : aller au collège seule, prendre le métro seule. La jeune fille que j’étais ne se sentait plus entravée. À seize ans, je pars à Zurich, à dix-huit ans, j’ai mon bac dans les Émirats, puis je reviens à Paris, qui m’a toujours fait rêver. Je lis Sagan, Colette, je découvre Sartre, et Camus — même si, pour moi, Camus est aussi un algérien. Les idées, l’écriture, la création, les arts, c’est Paris. Il y a aussi ce défi de se dire : je veux exister et publier à Paris. Ce sont des rêves de jeunesse. En 1985, j’ai dix-huit ans, Paris est la terre promise. Quand je suis à Alger, je suis comblée par la nature, mais je ne suis pas comblée par la ville que je ne connais pas très bien, elle me fait un peu peur… La force de l’Algérie, c’est sa nature, son désert, sa montagne, ses plages… Je n’ai pas une histoire avec la ville algérienne. Mon histoire est parisienne. Quand j’arrive à dix-huit ans, Paris me fascine parce que c’est aussi une ville de liberté. C’est là où je vais pouvoir vivre mon homosexualité. C’est la ville où je suis persuadée que l’on va entendre mes écrits — je n’ai pas tort, pourtant je ne connais strictement personne. C’est aussi la ville où je vais vivre ce qu’au début je pressens être à la fois un grand bonheur — l’amour est un grand bonheur, qui nous instruit sur les autres, sur nous-mêmes — et un grand malheur — en 1985, il m’est très difficile d’assumer l’homosexuelle que je suis. Mais je ne suis pas lâche, et surtout je ne suis pas hypocrite, comme parfois certaines femmes ou certains garçons que je rencontre : je veux vivre ce que je nomme « ma nature ». C’est à Paris qu’un jour j’achète le Pariscope, et en regardant la rubrique « spectacles », je tombe sur le Katmandou, et je me dis « Mais c’est incroyable, un club réservé aux femmes, il faut que j’y aille ». J’habitais rue Notre Dame-des-Champs, je passais devant cette porte noire, qui était la porte de toutes les promesses, mais de toutes les peurs. Un soir, je décide d’y aller, puis je fréquente ce lieu assidûment. J’y vais seule — personne ne me connaît. Je suis la plus jeune de cet endroit fascinant, enivrant, et souvent assez sombre… Ce n’est pas dans la nuit qu’on trouve forcément l’amour.
Florian Champagne
Pensez-vous qu’on peut dire que vos livres sont liés au moment où vous les avez écrits — autrement dit, que vous écrivez aujourd’hui des livres que vous n’auriez pas pu écrire plus jeune ?
Nina Bouraoui
Il y a un mélange de deux dimensions. Je pense que les livres que je suis en train d’écrire sont vraiment le cadre intellectuel ou cérébral d’aujourd’hui, mais qu’ils sont contaminés par une histoire qu’il a fallu mettre à distance, comprendre, parfois même oublier. Je pense qu’il y a toujours des espaces entre ce qui a été vécu, puis ce que l’on écrit. Mais l’adulte que je suis a écrit l’adolescente que j’ai été. L’adolescente que j’ai été ne pouvait pas l’écrire. Il fallait une rupture temporelle. Mais c’est quand même la trame de ce que je suis aujourd’hui, avec le regard, le jugement, l’acuité, l’analyse, qui écrit, commente, transforme, et réinvente son passé. J’aurais adoré écrire en 1991 le livre que j’ai publié il y a un an. J’ai mis tant de temps à assumer l’homosexuelle que j’étais. Je commence à parler d’homosexualité à 32 ans. Je trouve que c’est tard. Quand j’ai 24 ans, je publie La Voyeuse interdite — c’est l’histoire d’une jeune fille enfermée dans une espèce de tourment culturel, sexuel, enferrée par une culture maghrébine très forte, très virile… Si je décode aujourd’hui, c’est la jeune adolescente enfermée au Katmandou. Mais personne ne peut le voir, ni le comprendre. Toute la violence de ce livre, c’est toute celle qui me traversait, à l’époque, parce que je ne m’aimais pas, je souffrais de ma propre homophobie. Avec une certaine fierté, j’avais l’impression que j’avais pris de la vitesse par rapport aux autres . La nuit, je fréquentais des femmes qui étaient plus âgées que moi, que je n’aurais peut-être pas rencontrées dans la vie réelle — même si la nuit avait une certaine réalité. Et puis, il y avait cette espèce de mentor, Elula Perrin. Elle a été une figure assez emblématique du milieu lesbien de ces années-là, une féministe à sa façon, parfois un peu triviale, mais qui avait, je trouve, un courage et une force admirables. Elle m’a pris sous son aile, et m’a montré le chemin de la liberté.
Florian Champagne
Diriez-vous que le processus d’évolution de votre écriture se produit de lui-même, sans que vous y réfléchissiez ; ou bien au contraire, est-ce un processus très conscientisé, entre vos débuts et main-tenant ?
Nina Bouraoui
Lorsque j’écris, je sais exactement où je vais ; mais les livres naissent, et l’écriture naît… Je crois beau-coup aux forces de l’inconscient, et à la part de magie. Ça, je ne le calcule pas du tout, je ne le contrôle pas du tout. Je garde heureusement cette fraîcheur, j’espère que je la garderai toujours.
Je crois vraiment en la grâce, au magnétisme d’un monde irréel, qui s’ouvre sur ma réalité. Lorsque j’écris, je sais que j’ouvre une porte sur un monde.
Est-ce que c’est l’inconscient, l’imaginaire, la mémoire, les souvenirs refoulés ? Depuis que je suis enfant, la pensée magique ne m’a jamais quittée. Je crois que l’art est dans cette part de magie, mais j’aime ça. Je vois la création, le dessin, la peinture ainsi : quelque chose que l’on ne doit pas maîtriser. On doit la maîtriser pour l’intelligibilité du propos, puisque lorsque l’on publie, c’est pour être lu. Mais à mon sens, le processus de création appartient à une sorte de bouillonnement intérieur — une marmite qui bouillonne avec des ingrédients étranges, des amulettes, des potions magiques… Nous ne sommes pas des fonctionnaires de l’écriture, nous ne sommes pas des artistes fonctionnaires. Je trouve le mot carrière horrible pour un écrivain. Rien ne doit être prévu ou établi. La création est quelque chose qui vous kidnappe, vous happe, vous envahit — c’est une invasion charnelle, sensuelle, c’est de l’ordre du désir. C’est toujours un rendez-vous amoureux, d’écrire — et ça doit le rester.
Florian Champagne
Est-ce que la vie d’écrivain serait, à votre sens, une vie de rêve ?
Nina Bouraoui
Je crois, même si elle est difficile — il faut les mériter, ses rêves. Parfois, c’est une vie qui peut générer de l’angoisse, des grands vides, quand l’écriture ne vient pas. Je crois que l’écriture est bienveillante. Mon dix-septième livre arrive, je crois que maintenant je sais : l’écriture me rend ce que je lui ai donné. J’ai sacrifié parfois des histoires d’amour, de ma jeunesse, ou de ma vie de femme, parce qu’écrire est très sérieux et demande parfois un investissement total, mais redonne tant de bonheur. Aujourd’hui, j’ai appris à l’appri-voiser, ce n’est plus elle qui commande. J’ai compris qu’elle était aussi du côté de la vie, que l’écriture n’est pas forcément une image de la souffrance, mais l’image de beaucoup de bonheur. Aujourd’hui, justement, elle fait partie du rêve : j’ai compris qu’elle était mon salut et ma grâce. Je crois que l’écriture est l’écriture du plaisir de la vie. Alors, peut-être qu’il faut aussi être un vivant de plus en plus heureux pour être un écrivain de plus en plus heureux. Mais l’écriture est mon rêve principal : j’avais toujours dit : « J’écrirai, je serai publiée. » Ils étaient très peu à me croire. C’est un rêve accompli, et qui doit s’accomplir à nouveau — puisqu’il y a ça aussi, qui est assez magique et vertigineux, c’est que chaque nouveau livre est un premier.
Florian Champagne
Vous ne diriez pas qu’il y a de la confiance que l’on acquiert au fil des années ?
Nina Bouraoui
Oui, parce que ça marche main dans la main… Écrire et vivre, c’est la même chose. Il n’y a pas de séparation. Alors, l’un nourrit l’autre. Même si je trouve que les écrivains sont souvent des enfants et des ados… pas attardés, mais il y a en eux une part de jeunesse. Quand j’écris, j’ai l’impression que je refais exactement ce que je faisais enfant : je suis dans ma chambre et je fais des bêtises. C’est ça qui est fantastique. Alors la prochaine nouvelle bêtise, elle est toujours très excitante. Mais cette bêtise, on la maîtrise mieux avec l’âge, avec la maturité.
Florian Champagne
Aujourd’hui, quand vous écrivez, est-ce que vous avez toujours besoin de la solitude de cette chambre d’enfant dont vous parlez ?
Nina Bouraoui
Oui, mais maintenant j’arrive à être seule parmi les autres. Je ne veux plus m’isoler, je l’ai compris, aussi, pendant Mes mauvaises pensées : j’ai écrit ce livre en pleins travaux, donc toutes les cloisons tombaient… C’était fantastique : je voyais tous ces ouvriers avec des marteaux-piqueurs, qui toutes les cinq minutes me disaient : «Mademoiselle Nina ! Mademoiselle Nina !» C’était drôle, je me disais : moi aussi, je suis en plein chantier. En fait, le bruit, c’est la vie, l’écriture n’est pas forcément dans cette espèce de silence qui sépare, qui enclave. Alors, bien sûr qu’elle naît seule dans la chambre ; mais après, une fois que la grâce a commencé, tout peut arriver, mêmes des cloisons qui s’effondrent. Parce qu’il faut inviter le livre dans la vie. Puisque lui invite la vie chez lui. Cloisonner ou séparer a longtemps été pour moi une forme d’angoisse. J’avais l’impression que je me retirais de la vie pour pouvoir écrire. En fait non, tout se mélange. On revient à mon principe de la marmite qui bouillonne : elle est là, la création, elle doit être ainsi, et elle doit être multiple. Je ne m’arrête plus d’écrire : je note tout, toujours, tout ce qui arrive. Ce n’est pas un journal intime, mais c’est une forme de journal ; si on me demande d’écrire, je dis oui à tout.
Je pense qu’écrire, ce n’est pas qu’une forme d’expression : c’est se dire que l’on est en vie.
Cent soixante
Julie Ménard
Les évènements capturés ici se sont déroulés au cours de ces derniers mois. Au 160 rue de Paris. À Montreuil. Toute personne qui se reconnaîtrait… aurait ses raisons.
SCÈNE 1
Au premier étage
Cuisine sur cour
Lumière jour
Gipsy | Hugo
Alors on trinque à toi | Oui, je suis content | On est tous très contents, pour toi | Moi aussi, je suis content pour moi | Tu peux | C’est un tournant, c’est retourner à la lumière | Oui ça y est | J’ai mis du temps, j’ai pris mon temps, mais ça y est, je vais commencer à vivre. À trente-cinq ans. | Je suis tellement heureuse | Elle t’a dit depuis combien de temps j’étais enfermé ? | Iris ? Non, elle ne m’a pas dit | Cinq ans, ça fera cinq ans, demain. | Tu es resté cinq ans dans ton appartement ? | Oui. Enfermé à double tour par mes soins. | Et tu ne voyais personne ? | Personne… |Et c’est quand ta rentrée alors ? | La formation débute en septembre. | Tu sais que j’ai un copain qui est tailleur de pierre ? | C’est vrai ? | Oui, il s’appelle Pierre. C’est vraiment un beau métier. | Je pense que ça va me plaire. | Il m’a appris que sur les cathédrales, plus on monte et plus la taille est fine et détaillée. C’est drôle parce que c’est justement un endroit où le commun des mortels n’a pas accès. Cette beauté est réservée à Dieu. | Et aux tailleurs de pierre. | Exactement. Il m’a emmenée une fois avec lui à Notre Dame.| Je te ressers ? | Je veux bien. | C’est marrant ton chapeau. | Tu aimes ? | Plutôt | Je suis dans ma période malvacée. | Comment ? | C’est cette couleur. Mais ma culotte est plutôt dark old rose, rose brulé si on peut dire. Tu veux voir ? | Je ne suis pas certain d’être prêt pour ça.
SCÈNE 2
Au deuxième étage
Chambre de musicien
Vue sur rue
Elio | Solange
Tu me dis surtout si je te fais mal ? | Oui t’inquiète. | Non je ne m’inquiète pas, mais on va y aller en douceur, comme sur un morceau de King Crimson | C’est-à-dire ? | En mode progressif | D’accord | C’est la première fois ? | Que quoi ? | Que tu fais l’amour ? | Depuis mon accident tu veux dire ? | Oui | Oui, mais t’inquiète ça va aller. | Je me sens investi d’une grande responsabilité tout à coup. Je vais chercher une clope. Tu veux quelque chose ? | Ce que tu veux. | Ça va ? T’as l’air mal. | Tu sais, je n’ai pas envie d’être considérée comme une fille différente parce que j’ai eu cet accident. | T’es sûre ? C’est un peu con. | Pourquoi ? | Parce que les filles habituelles, je ne les rappelle pas. | Et t’as l’intention de me rappeler ? | Oui j’aimerais bien. | Mais t’as pas mon numéro. | Attends je le prends. | Alors 06 70 84 23 54| 23…54…| Et je m’appelle Solange. | Ça je le savais. Regarde : je t’ai enregistrée à Solange Miracle.
SCÈNE 3
Au premier étage
Cuisine au lever du jour
Jacqueline | Iris
Mais je suis où là ? | Tu es chez moi | Mais pourquoi je ne suis pas chez moi ? | Parce que tu ne peux pas rester chez toi | Et pourquoi ça ? | Parce que tu as perdu la mémoire. | N’importe quoi. | Si. C’est normal que tu ne t’en rappelles pas. Tu veux une tartine ? | Oui. Mais tu es ma fille ? | Oui, maman. | Oh écoute, je ne comprends pas ce que je fais là. | Alors, tu as eu une maladie, une mé… | Méningo-encéphalite | Oui voilà. Donc à cause de cette maladie, tu as complètement perdu la mémoire. Bon là ça va un peu mieux…Mais tu ne peux pas rentrer chez toi, toute seule. | Mais je ne suis pas toute seule. | Si tu vis seule…depuis longtemps. | Non, je vis avec mes parents. | Maman, tes parents sont morts. | Ah bon. | Et donc à l’hôpital de Dieppe, ils n’avaient pas de solution, ils voulaient que tu ailles en maison de retraite mais sans rééducation. Alors j’ai décidé qu’on n’allait pas faire ça, et c’est pour ça tu es chez moi, enfin chez nous, à Montreuil. Le temps que ça aille mieux. | Mais je dors où ? | Dans ma chambre. | Et toi, tu dors où ? | Dans le salon. | On est toutes les deux ? | Non, à côté il y a ma coloc Gypsy. Tu te souviens ? Une petite qui a des grands chapeaux et qui est monochrome. | Je ne comprends rien à ce que tu dis. | Elle est toujours habillée d’une seule couleur. Bref. Au-dessus il y a Dorian mon amoureux. | Pourquoi je n’ai pas d’amoureux, moi ? | Ah mais ça je ne sais pas, maman. | Et ton père ? Il est où ? | On n’a pas très envie de le savoir. | Pourquoi ? | Parce que c’est mieux ainsi. | Mais on est à quel étage ? | On est au premier. Tiens regarde, je finis de t’expliquer sur le schéma. Donc au premier il y a toi, moi et Gipsy. Ensuite au deuxième, il y a Dorian. | C’est ton amoureux ? | Oui. | Et pourquoi je n’ai pas d’amoureux, moi ? | Et il vit avec ses colocs Elio et Amir. Au-dessus il y a Yuko et Serge | Son amoureux ? | Non, son coloc, c’est un pote d’Elio à la base et ils ont un chat énorme Bobun. Tu te souviens de Yuko ? Mon amie du lycée. | Oui vaguement…Elle est blonde ? | Non, elle est brune. Bon et après au-dessus il y a encore Oona qui vit avec Simone et sa fille Mélodie. Et puis au cinquième, il y a Eugène mais on le connaît moins et dans l’immeuble en face il y a Or et Bilal, mes anciens colocataires qui ont fait un bébé ensemble, Gloria. | Et toi, tu es qui ? | À ton avis, je suis qui ? | Tu es Marie-Françoise. | Non, je suis ta fille. Iris. | Mais tu dors où ?
SCÈNE 4
Au troisième étage
Atelier de gravure
Salon
Pénélope | Or | Lia | Solange | Yuko | Iris | Serge
Alors il sort de sa yourte, et moi je le vois et je sens vraiment mon cœur et mon sexe qui s’ouvrent. Je suis restée, toute la nuit. Il est magnifique, blond au-delà du supportable. | Waouh. | Ça fait tellement longtemps que je n’ai pas fait l’amour. | Et toi ? | Ecoute, je suis partagée. Bon, il est adorable…Mais tu vois c’est une crème qui a besoin d’être fouettée. Il peut être au même moment sublime et plat, c’est une sorte de platitude augmentée ou de solaire diminué si tu préfères. | Mais toi, tu le connais non ? | Vite fait. | Tu en penses quoi ? | C’est un mec de droite droite pour moi, mais d’une droite inconnue. | Bon…| Et c’était bien la tournée ? | L’endroit était divin, juste à côté d’une forêt, je faisais mon footing tous les jours là-bas. Il y avait une clairière complètement folle, avec de la mousse partout. Un coin elfique. Un matin, je me suis arrêtée. J’ai regardé à gauche et à droite. Et je me suis mise nue. J’ai roulé dans la mousse. J’ai trop pensé à toi. | À moi ? | Oui et tu sais très bien pourquoi. | Et au salon, tu n’as rencontré personne ? | Le dernier client ça pouvait aller mais il venait pour se faire tatouer Esperanza sur le ventre, il y a plein de positions où ce n’est pas possible et pourtant le mec est mignon, il vient d’ouvrir une fromagerie. | Il n’y a pas tellement d’hétéros hyper sexy je trouve. | Et toi le boulot ? | Ça me fait vraiment du bien de pas travailler avec lui en ce moment. Il ne s’en rend pas compte mais c’est quand même un mâle extra dominant. | Tu vois le seul que je connaisse et qui ne soit pas dans une logique d’écrasement, c’est Elio. | C’est parce qu’il a été élevé par deux femmes. | Ça joue | De toute façon c’est tous des fils. | C’est quoi des fils ? | Attends je demande à Serge. C’est son concept. Serge ? | Oui ? | Tu peux venir expliquer les fils ? | Alors pour faire simple, ce ne sont pas des pères. Mais surtout ils sont dupes d’eux- mêmes : ils ne savent pas qu’ils sont des fils. | Et toi ? T’es un fils ? | Absolument pas.
Serge quitte la pièce.
Jacqueline apparaît.
Où je dors ? | Oh maman, tu t’es relevée ? | Oui, vous faites trop de bruit et je n’aime pas rester seule en bas. | Mais faut que tu dormes, Jacqueline. | Je peux fumer avec vous ? Tu me donnes une cigarette, ma chérie ? | Oui, tiens Jack. | J’en ai ras le bol d’être célibataire, je te jure. Le pire c’est les autres. Franchement quand t’es seule à trente-six balais, c’est comme si on te signifiait que tu n’avais qu’une demi-existence. On nous a tellement bourré le mou. | Faut se libérer de tout ça. | Oui, je suis à fond pour. Mais ça me va si bien d’être amoureuse. | Mais tu dors où toi ? | Viens Jack, je vais t’accompagner dans ta chambre. | Non mais laisse, je vais y aller. | T’inquiète. | Merci.
Yuko et Jacqueline sortent.
Les filles regardent Iris.
Ça va ? | C’est dur. Je vais craquer, je pense. | Oui c’est normal. | Elle nous réveille toutes les nuits. | Et ils disent quoi les médecins ? | De la merde. | Ils me trouvent extrêmement farfelue de ne pas vouloir l’enfermer dans un mouroir. | Elle va quand même vraiment mieux. | Oui. | Vraiment.
Gipsy apparaît.
Coucou. | Tu bois un verre avec nous ? | Moui. | Ça va ? | Moui. | C’est rare de te voir en noir. | J’ai rencontré quelqu’un. | Bah fais pas cette tête. | Elle est où Yuko ?
Serge passe sa tête par la porte.
Elle s’endormie avec ta mère.
SCÈNE 5
Au deuxième étage
Chambre obscure
Univers en noir et blanc
Dorian | Iris
Respire | Oui | Ça va mieux ? | Oui allongée, ça va mieux. | Viens, on fait un petit câlin | Faut pas que je traîne | Attends mais ça va, tu peux la laisser seule un peu aussi, tu ne vas pas tenir. | C’est sûr que je ne vais pas tenir. Je me demande comment ça se fait que je n’ai pas basculé moi aussi. | Toi, tu as l’amour | Oui. Merci. Merci d’être là, comme ça. | Faut que tu remercies les autres aussi. | Oui mais c’est dur. Je suis rugueuse. J’ai du mal à exprimer mes sentiments. Enfin sauf avec toi.| Faut que tu leur dises que tu les aimes. | Je n’arriverai jamais à faire ça sans drogue. Mais tu crois qu’ils ne le savent pas ? Que je les aime ? | C’est mieux de le dire. | Je me sens tellement coupée de mes émotions. J’arrive même plus à pleurer. Je ne comprends pas pourquoi la vie s’acharne comme ça. Tu sais, je n’ai eu aucun moment de répit. Depuis que je suis née, ça n’a été que de la violence et des crises de démence. Quand j’étais enfant, j’avais tellement peur de mourir. Tellement peur qu’elle soit tuée et nous avec. Et puis après mon frère enfermé et maintenant elle qui siphonne grave… J’ai toujours espéré qu’un jour ça s’arrange, qu’il y ait une éclaircie mais je me dis qu’elle n’arrivera jamais. Et que je dois faire avec… | Tu es une extrêmophile. | C’est quoi ? | Une bactérie qui ne peut vivre que dans des milieux extrêmes qui seraient mortels pour d’autres organismes. | Une vraie fille à problèmes en résumé. | Mais toi, t’as pas de problèmes en fait. Ta famille oui, mais toi, tu as une belle vie. | Est-ce que tu veux bien te marier avec moi ? | Tu veux te marier, toi, maintenant ? | S’il m’arrivait quelque chose, c’est possible, on ne sait pas, paf un accident. Ça arrive. Bref un truc grave, un truc qui me met dans un sale état, les médecins ne savent pas quoi faire de moi. Alors ils se tournent vers ma famille. Tu imagines ? L’incompétence de ces gens ? Je serais foutue. | Calme-toi. | Faut que tu me tires de là. Tu es ma seule chance.
SCÈNE 6
Au premier étage
Chambre retournée
Nuit
Lia | Yoko | Iris à Gipsy
Est-ce que tu peux me répondre ? | Qu’est-ce qu’il t’a fait ? Tu m’entends ? | On va aller chez les flics, d’accord ? | C’est normal que tu pleures. | Il t’a fait mal où ? Tu veux nous montrer ? | Il avait déjà fait ça ? Souvent ? Depuis quand ? Ça fait des mois qu’il te fait du mal ? | Mais pourquoi tu ne nous as rien dit ?
Jacqueline apparaît.
Qu’est-ce qui se passe ? | Attends Jacqueline. | Vous dormez où, vous ? | Retourne dans ta chambre, Jacqueline. | Mais qu’est-ce que tu as mon cœur, pourquoi tu pleures ?
Gipsy la regarde.
Elle lui répond à travers ses larmes.
Il a dit qu’il allait me faire disparaître, Jack.
SCÈNE 7
Au premier étage
Réunion de crise
La nuit se pointe
Yoko | Lia | Or | Solange | Iris | Jacqueline
passage. Il l’a complètement mise à terre | Mais nan ne dis pas ça, il lui reste son noyau. | C’est un tout petit noyau | Un noyau de cerise| C’est les plus durs | Je ne m’en remets pas…On était juste à côté | Et tu n’as rien entendu ? | Non, j’avais mes boules Quies | Putain si je croise cette ordure | Ne dis pas ça | Non c’est vrai, j’ai peur en fait. | On était juste à côté, je n’arrête pas d’y penser. Ma mère qui dormait juste à côté. Ma mère qui a reçu tellement de violence que son cerveau a préféré la réinitialiser. Ça ne finira donc jamais, ce cercle de violence ? | Mais c’est quoi ces hommes-là qui veulent éteindre les femmes ? | Ça me terrifie, quand j’y pense. | On fait quoi alors ? | Alors moi j’ai fait des recherches, on peut lui envoyer de la merde tous les jours. | C’est-à-dire ? | C’est-à-dire un colis de merde, tous les jours. Il y a des sites pour ça. | Je suis pour. Vraiment, je suis pour. | Et on peut même le faire nous-mêmes. Envoyer notre propre merde à ce connard. | Euh concrètement comment on fait ? | Eh bien on se relaie. On est nombreux. | Je suis sûre que tout l’immeuble sera d’accord. | Tout le monde est au courant ? | Les gars au deuxième étaient hallucinés. | Ils seraient partants. Ça change de : œil pour œil, dent pour dent. | Très bien. | On peut commencer par la merde de Gloria, elle est petite, mais elle envoie. | Du coup on fait un genre de tableau ? De planning ? | Oui, je fais ça au bureau demain matin et je vous le transfère. | Pardon mais moi, je vais me désolidariser complètement de cette action. | Et on peut savoir pourquoi ? | Parce que ça me semble impossible de me lâcher comme ça dans un colis. C’est au-delà de mes forces. Pardon, toi tu le sais, mais j’ai des problèmes énormes pour… | Chier ? | Oui voilà, voilà…| Mais ça c’est parce que tu retiens. Tu retiens tout. Tu retiens tes désirs. Faut que tu les exprimes. | Tu crois ? | Mais bien sûr | Elle a raison. Tu as peur de quoi si tu fais ça ? De faire de l’ombre à qui ? | À personne mais c’est juste… | Ça fait combien de temps qu’on se connaît ? | Dix ans je dirais… | Affirme tes désirs. Je t’en supplie. | Laisse tomber, elle est bourrée. | Je voudrais qu’elle réalise ce qu’on voit, nous quand on la regarde. Les possibilités infinies que tu as, Lia. Que tu les voies et que tu te déploies. | Et donc pour toi, se déployer ça signifie chier dans un colis par vengeance ? | Oui peut-être, oui peut- être ça commence par là. En tout cas c’est dire merde, merde à ce détraqué mais merde aussi à tous ceux qui veulent nous éteindre comme tu dis. Vous vous êtes demandés, pourquoi il lui arrivait ça, à Gipsy ? Ce qu’il a cherché à faire disparaître en elle ? C’est la vie, son trop-plein de vie qui n’appartient qu’à elle et qui le narguait à chaque minute qu’ils passaient ensemble. Cette vie foutraque, qui déborde, qui jaillit en soleil par toutes ses fêlures. Ce torrent puissant, cette cascade ingérable mais qui lui a permis de traverser les épreuves. C’est ça qu’il ne pouvait pas encadrer ce pauvre type. | Tu projettes un max là. Je ne sais pas si tu t’en rends compte. | Tu crois ? Oui peut être, pardonne-moi. Peut-être, je projette…Pardon, je suis à bout. | Mais non amour, ne t’excuse pas. | Pardon, je suis une vraie connasse. | Mais nan.
Jacqueline les regarde.
Je vous regarde, et je trouve ça merveilleux, ce que vous faites. Elle va le ressentir, toute cette énergie que vous lui envoyez, j’en suis certaine. Je suis très émue de vous voir là comme ça, rassemblées pour votre amie. J’ai beaucoup de chance d’être avec vous. | Oh Jack. | Donnez-moi la main.
Elle se donnent toutes la main.
Solange regarde son téléphone.
Elle vient de m’envoyer un SMS. Elle a vu une magnétiseuse cet après-midi. Et elle lui a dit que sept anges veillaient sur elle. | On est six. | Il y aussi sa maman, je pense… Elle est à côté de nous. | Oui. Elle est là.
SCÈNE 8
Au cinquième étage
Vue dégagée sur Montreuil
Le toit
Or | Yuko | Lia
Je n’étais jamais monté sur le toit | Ça ouvre des perspectives…| On adore cette idée de barbecue.
Gipsy | Tous
Alors tout le monde, je vous présente Gilles, mon nouvel ami merveilleux ! | Salut ! | Gilles, voici mon ami Jules, je pense que vous seriez suprêmes ensemble.
Irina | Amir
Et alors, vous avez tous été d’accord ? | D’accord pour quoi ? | Pour que la mère d’Iris, s’installe ici ? | Et pourquoi pas ?
Irina rit étrangement.
C’est un rire, ça ? | Oui. | Mais tu ris extrêmement fort. | C’est dérangeant ? | Pas du tout
Elle rit.
Et elle va mieux ? | Beaucoup mieux oui, elle retrouve de la mémoire. Viens je te la présente. Jack, je te présente Irina…
Simone | Lia
Oh mais moi je n’ai rien fait | Arrête, tu lui as prêté un paquet de fric | Mais ce n’est rien ça. | C’est beaucoup.
Pénélope | Serge
Et donc là on entre dans une ère de transformation | Ah oui ? | Ah mais absolument, cette éclipse c’est un peu comme un bouton de réinitialisation et de lancement dans notre prochaine dimension. Faut être prêt. | Mais à quoi ? | Mais à tout. Serge, à tout.
Jacqueline | Hugo
Heureusement que vous étiez plusieurs pour faire face à cette femme à moitié démontée. Parce que parfois, je vois bien, que je travaille un peu de la capuche. | Comme tout le monde, maman.
Iris | Gipsy
Comme tu es belle en blanc. | C’est ma période ivoire. Toute en défense. | C’est très beau. | Oui ? Tu aimes ? | Beaucoup. | Je suis contente qu’ils se rencontrent enfin ce soir. | Tes deux copains ? | Oui. Gilles et Jules | Ils iraient bien ensemble. Enfin je ne les connais pas. Mais ils seraient beaux ensemble. | Je suis d’accord. Mais s’ils dorment tous les deux, je me mettrai au milieu. Je n’ai pas envie de dormir seule dans mon lit.
Jacquline | Dorian
Et moi ? Je dors où ? | Et c’est reparti…
Bilal | Yuko | Or | Lia | Iris | Gipsy | Dorian | Amir
Allez servez-vous, il y a encore plein de trucs à faire griller. | On est tellement contents, on pourrait s’abîmer dans cette communion. | Ça va être dur de faire mieux, pour la suite. | On vit peut-être notre âge d’or | Mais si, on fera mieux. On trouvera, tu verras. | Mais on reste ensemble ? | Oh oui ! On reste groupés. | On achète un château. | Vas- y, je suis chaud. | J’ai 1000 euros de côté. | Moi, je n’ai aucune perspective d’avenir en dehors de vous…
Bilal | Irina
Allez là, on se sert ! Que je puisse en remettre sur le feu. | C’est quoi ? | Alors là tu as de l’araignée, là de la hampe. | Et là ? | Ici ? Ici, il y a du cœur.
De l'autre côté du rêve
Tristan-Frédéric Moir
Tristan-Frédéric Moir, psychanalyste et spécialiste incontournable du langage du rêve, partage vingt-six entrées de son Dictionnaire des Rêves (publié aux éditions de l’Archipel). Cet abécédaire présente autant de définitions claires ou suggestives, à même d’éclairer les songes évanescents de la nuit.
A - Ami/Amie
Il est fréquent de rêver d’un ou d’une amie. Ce personnage omniprésent est toujours un aspect de soi représenté de façon détachée. C’est une part importante de notre personnalité, partie d’autant plus importante que l’ami(e) est cher(e). La meilleure amie est ainsi la meilleure part de nous-même.
Nous percevons inconsciemment chez ceux qui nous entourent des qualités ou des similitudes avec nous-même. L’ami(e) onirique vient donc souligner cet aspect de notre personnalité, aspect que nous devons retrouver ou aimer avec un sentiment de respect et d’amour pour ce que nous sommes. À ce titre, l’ami(e) du rêve représente cette facette de nous, un potentiel que nous n’utilisons plus ou pas encore. Si c’est un ami d’une époque précise, l’enfance ou l’adolescence par exemple, le rêve peut signifier que cette part de nous-même a été oubliée ou occultée ; nous l’avions perdue de vue.
Quelquefois, ce sont les défauts de l’ami(e) qui prédominent dans le sens du rêve. Le rêve met l’accent sur ces aspects négatifs de notre personnalité auxquels nous sommes attachés. L’ami(e) est ici le miroir, le parfaitreflet de nos tendances et comportements. Il est intéressant de noter que, bien souvent, le profil de nos amis successifs est similaire, tant physiquement que psychologiquement, comme s’il révélait une zone d’ombre qu’il serait nécessaire de mettre à jour (reliquat parental) ou qu’il exprimait un potentiel endormi. La relation amicale, bien souvent, est complémentaire.
Part importante et aimée de soi, voirela meilleure, avec également ses défauts.
B- Bas
Le bas, comme son nom l’indique, est le vêtement du bas, de la jambe. Il est aujourd’hui essentiellement féminin. Il symbolise donc un aspect féminin important, accentué ; symboliquement, le haut est plutôt lié au masculin et le bas au féminin.
Le bas protège et embellit la jambe. En rêve, porter des bas, c’est exprimer sa féminité dans un souci de séduction. Ce désir est souvent inconscient. La rêveuse qui les porte découvre une image d’elle plus charmeuse qu’elle ne le pensait.
Le bas est aussi ce qui cache les jambes, les maquille. Son symbolisme est à interpréter avec celui de la jambe, avec ces notions supplémentaires. Chez certains, les bas exercent un grand attrait érotique. Ils accentuent et soulignent le dessin des jambes qui sont comme deux colonnes supportant le sanctuaire de la féminité ou du plaisir.
Autrefois on cachait son argent dans les bas. Un rêve renvoyant à cette image représente l’énergie féminine de la rêveuse — ou d’une femme proche du rêveur — qu’elle dissimule ou dont elle use. C’est aussi le siège de cette énergie.
Féminité, richesse, séduction, artifice.
C- Canapé
Siège tout à fait particulier, meuble familier de la psychanalyse, le canapé est une figure de substitution du divan, mais ce mot est plus utilisé en rêve que divan. Accessoire indissociable de l’univers freudien, le canapé symbolise le lieu du processus de verbalisation psychanalytique. C’est donc dans les rêves de personnes suivant une psychanalyse qu’il apparaît le plus souvent. La représentation du canapé stigmatise cette action ou le besoin de cette action chez ceux qui y auraient seulement songé.
Le canapé se trouve parfois dans un lieu incongru comme un théâtre par exemple. C’est le lieu où se passe la transformation. Si le rêveur se voit quitter le canapé, c’est peut-être le signe que sa psychanalyse est achevée d’un point de vue formel, mais qu’elle se poursuit en rêve. Il appartient au rêveur de continuer seul un travail entrepris avec une personne extérieure.
Siège de l’introspection psychanalytique, là où l’on « s’allonge »
D - Deux
Deux est le chiffre de la femme, de l’alternance, de la dualité, des oppositions, des images en miroir, de l’inconscient, de la Terre et de la Lune. Il représente souvent la femme dans sa nature double. Double, car elle se divise en deux pour donner la vie. Deux est aussi le signe d’une rupture interne, comme le sentiment d’être coupé en deux. Deux symbolise ainsi la nature humaine, double et changeante, qui aspire à la rencontre de l’autre.
Le chiffre 2 est aussi celui du doute, du choix et de l’amour.
Couple, chiffre de la femme, dualité, complémentarité, cycles.
E- Escaliers
Les escaliers sont des chemins normalisés, adaptés à l’homme et créés par lui, les degrés de la connaissance progressive. Ils permettent de changer de niveau de conscience. C’est notre propre énergie qui nous permet de les gravir ou de les descendre. Ils représentent une voie de progression que d’autres ont déjà tracé, mais qu’il faut découvrir seul, c’est à dire avec notre propre énergie. C’est un travail qui demande un effort, un certain travail. Il faut emprunter les escaliers pour apprendre à se connaître sur tous les plans. Nous pouvons descendre en nous ou accéder à des niveaux de conscience supérieure.
Des escaliers en parfait état représentent les facilités d’accès à nos différents plans internes et la solidité de nos connaissances. Si la rampe de l’escalier est bien visible ou tangible sous la main, elle représente un guide, un savoir qui nous permet de nous déplacer plus sûrement à l’intérieur de nous-mêmes.
Quand l’escalier n’est pas à l’intérieur de notre maison, les marches de l’escalier représentent nos progressions, nos moyens d’accès et de connaissances sur d’autres plans. Les marches permettent d’accéder à divers domaines, toujours en rapport avec le monde construit des hommes.
Voler, en montant ou descendant, glisser au-dessus d’escaliers, peut symboliser une capacité à sauter des étapes, à ne pas avoir besoin de s’arrêter à chaque étape, mais de pouvoir aller plus vite que la plupart des gens, ce qui peut déconnecter de la réalité parfois, celle des autres, tout comme de la normalité.
Structure positive qui permet de changer de niveau de conscience, architecture et génie humains, voie psychanalytique.
F - Fleurs
Simples éléments décoratifs ou figures centrales du rêve, les fleurs viennent embellir nos songes. Leur symbolique est évidente ; le langage courant ne manque pas d’expressions qui abondent dans ce sens. Les fleurs sont souvent associées aux femmes et aux vertus féminines. Par leur grâce, leur éclat, leur beauté et leur parfum, elles symbolisent l’univers féminin et sa fonction.
Dans la réalité, la fleur est un organe sexuel, et la quasi-totalité des plantes se reproduisent grâce à elle. La connotation sexuelle est très importante dans les rêves. La fleur est le prélude à l’amour. Elle est attractive et sensuelle. Une fleur seule symbolise le sexe féminin d’où jaillit la vie. Dans ce cas, le rêve aura toujours une signification sexuelle et amoureuse.
Si la fleur n’est pas identifiée, la couleur et le nombre de ses pétales sont très importants pour la lecture du rêve.
Un rêve où nous voyons des fleurs en grande quantité sera plus orienté sur la nature féminine, sur la prépondérance du principe féminin. Si elles sont trop nombreuses, envahissantes, le rêve indique que ce principe féminin est trop développé chez la personne — rêveuse ou femme proche — qu’il gêne la libre expression de la personnalité.
Un paysage parsemé de fleurs représente le monde dans toute sa beauté, dans son aspect merveilleux et magique. C’est la terre dans sa parure de féminité et dans l’harmonie de ce principe. Sans les fleurs il n’y aurait pas de vie. Les fleurs sont des portes qui ouvrent sur une autre réalité.
Figure féminine, sexe féminin, beauté, impermanence, portes.
G - Gouffre
Le gouffre est une représentation du néant, d’une angoisse existentielle. Ce vide vertigineux qui vient terrifier le rêveur est relatif à sa vie quotidienne qui manque de sens. Le gouffre symbolise un mode d’existence qui ne mène nulle part, une tendance régressive. Les entrailles de la terre sont un rappel morbide de celles de la mère qui pourrait vouloir ravaler sa progéniture.
Le gouffre symbolise une notion d’avidité, de manque, de désir insatiable. L’argent, la nourriture, rien ne peut le combler. Il absorbe et engloutit tout.
En cas de chute dans un gouffre, comme une chute dans le vide, le rêve vient exprimer un grand vide affectif que ressent le rêveur, une mémoire ravivée au moment du rêve, en résonance avec l’absence du père.
Insatiété, angoisse, sentiment de vide existentiel, vide affectif.
H- Hauteur
Les rêves qui nous situent en altitude, sont relatifs au mental ou à un désir d’élévation. Il peut s’agir soit d’une élévation sociale, soit d’une élévation spirituelle. En se reportant aux symboles présents et au contexte, la mise en scène du rêve précise le sens de cette élévation. Il faut sentir si nous sommes à l’aise dans ces « hauteurs » ou si nous sommes effrayés et sujets au vertige. Prendre de la hauteur, c’est aussi prendre du recul, être moins impliqué émotionnellement pour être plus logique.
La hauteur symbolise aussi l’attitude de certaines personnes qui pourraient se réfugier dans le mental, un univers abstrait d’où elles contemplent le monde. C’est une fuite de la réalité, un retrait du monde et parfois une négation du corps.
+ Aspiration spirituelle, recul, désir d’élévation
− Fuite du réel, intellectualisation, refuge dans le mental
I - Incendie
L’incendie symbolise très souvent la déraison mentale, surtout s’il est localisé au niveau du toit. C’est la montée et l’extériorisation d’une énergie trop forte et irrépressible qui génère une colère incontrôlable. Cette inflammabilité est due à un manque de structures. La colère (le feu) qui ne peut se manifester sur le responsable originel, par interdit ou embrouillage (la fumée), se retourne contre l’individu. Il peut alors exploser ou s’enflammer, menaçant aussi l’entourage, dans un mouvement de folie.
Le feu de l’incendie représente nos énergies intérieures, trop fortes, que nous ne respectons pas, que nous ne laissons pas s’exprimer. Elles se retournent alors contre nous et nous brûlent de l’intérieur. C’est l’image de la maison (notre corps) consumée en partie ou entièrement par l’incendie. Il nous faut accepter ces énergies (vitalité, sexualité, appétit) et essayer de comprendre contre qui nous sommes réellement en colère (famille originelle) pour les canaliser et les rendre positives. Le feu a toujours besoin d’être canalisé pour être bénéfique.
Une autre interprétation est possible si le rêveur est un ancien fumeur qui a recommencé à fumer. Il pensait pouvoir être maître d’un petit foyer (une ou deux cigarettes), mais le feu s’est répandu dans toute la maison ou l’immeuble (un paquet) ; il ne le canalise pas et se laisse envahir par la névrose. Ce sens de lecture sera plus envisageable si la fumée est très présente et étouffante.
Déraison, Colère, énergie intérieure trop forte et non canalisée, Tabagisme.
J - Journal
Comme son nom l’indique, le journal raconte l’actualité du jour. Il vient souligner les événements de la journée. Si les gros titres sont bien lisibles, le rêve peut vouloir montrer que notre journée a été riche en événements qui peuvent être relatés. Mais le journal peut être complètement illisible, comme si nous n’avions rien vécu, rien appris avant de nous endormir.
Le journal, quand il est intime, est aussi celui que nous écrivons au jour le jour. Si une personne nous le dérobe, nous avons le sentiment que quelqu’un se mêle de notre vie privée. Si la personne le lit devant nous malgré notre colère, quelqu’un de notre entourage ne respecte absolument pas notre intimité qu’elle expose devant les autres.
Vie quotidienne, vie intime, événement personnel.
K - King-Kong
Ce singe géant est une représentation du désir gigantesque de l’enfant, de sa toute-puissance ou de l’impuissance de l’adulte. Ici, le désir est tellement énorme qu’il ne peut trouver de support à son expression. Il y a une disproportion entre les sexes (image de la femme poupée entre les mains géantes du désirant). C’est pourtant le contraire en réalité. La taille fantasmagorique que se donne le rêveur est inversement proportionnelle à la taille de son pénis ou plutôt, à l’idée qu’il se fait de sa puissance au travers de son phallus.
Toute-puissance infantile, désir surdimensionné.
L - Labyrinthe
Traditionnellement, le labyrinthe est une représentation du cosmos et du monde intérieur, du macrocosme et du microcosme. Il symbolise le chemin parfois initiatique que doit parcourir et trouver l’homme pour atteindre son centre véritable, le cœur, la réponse à son existence. C’est ce chemin difficile qu’emprunte le rêveur en quête de lui-même, et il n’est pas rare de se perdre dans ses dédales.
Le labyrinthe peut prendre différentes formes, celles de couloirs, d’allées, et souvent, l’intérieur d’un château. Sa forme pure est rare et réservée à quelques initiés. Mais toutes ses formes sont le signe d’un certain degré d’évolution ou de désir de quête de soi.
Si nous nous égarons dans le labyrinthe avec un sentiment d’angoisse, incapable de retrouver notre chemin, nous sommes allés trop vite. Il nous manque des repères essentiels pour notre progression intérieure. Les personnes ou les livres qui nous ont guidés jusque-là sont de mauvais maîtres.
Si ce sont les caves d’un château dans lesquelles nous tournons, épouvantés, ressentant des présences inquiétantes, nous faisons fausse route. Le chemin que nous suivons actuellement n’est pas le bon, nous ne sommes pas prêts.
Connaissance de soi, chemins initiatiques, blocages, errance.
M - Mouche
La plupart des insectes noirs rampant sur le sol sont des symboles négatifs, et la mouche rejoint leur rang en les surpassant. Les mouches sont beaucoup plus envahissantes, insolentes et exaspérantes à la longue. Ces insectes volants montent à la tête, envahissent le mental jusqu’à le perturber. Si nous rêvons de mouches, le vol désordonné de ces insectes est révélateur d’un trouble psychique. Leur vol est insensé. Ces rêves sont des signes avant-coureurs de fatigue mentale responsable d’une altération de la perception de la réalité. Un repos urgent est vivement conseillé.
La présence de mouches en rêve est toujours relative à un trouble, à une déraison. En tant qu’insectes noirs, il s’agit de pensées sombres, mais leur vol désordonné symbolise plus un trouble mental. Les mouches symbolisent des pensées extérieures qui nous agressent et dont nous n’arrivons pas à nous défaire.
La tension mentale se retrouve dans l’expression « prendre la mouche ». La susceptibilité n’est pas bonne conseillère ; il vaut mieux préférer la subtilité de la fine mouche.
Pensées parasites, trouble ou perturbation mentale, idées incohérentes, déraison, folie.
N - Nez
D’une façon générale, le nez symbolise la personnalité. Il en est la partie la plus visible, l’expression même. Le nez représente donc le plus souvent l’expression de la personnalité.
Dans le langage des signes, le nez représente le sexe masculin. Il semble posséder parfois la même valeur symbolique en rêve. Le nez devient l’expression de la personnalité masculine. Un nez sectionné symbolise un sentiment de castration. C’est une situation d’impuissance qui est évoquée ici, l’impossibilité d’exprimer son identité masculine et sa force comme de sentir les choses.
Le nez symbolise aussi sa fonction, l’odorat. Les animaux identifient les individus grâce à leur odorat. Cette fonction de reconnaissance de la personne ou de jugement personnel est ici représentée. Le nez, emblème de la personnalité, est aussi l’organe qui distingue et identifie les autres personnalités. Il s’agit ici d’un talent subjectif, intuitif. « On sent les personnes », « on a du nez ».
Expression de la personnalité, substitut de l’organe génital, flair, intuition.
O - Ordinateur
Un ordinateur, c’est une intelligence artificielle dotée d’une mémoire de stockage. En ce sens, l’ordinateur représente le plus souvent notre cerveau et son fonctionnement. Cette représentation est d’ailleurs très proche par la structure commune des deux domaines. La mémoire vive de l’ordinateur est relative aux fonctions conscientes du cerveau et la mémoire morte, aux fonctions inconscientes. Tout comme avec notre cerveau,nous ne pouvons gérer consciem-ment que ce qui apparaît à l’écran par le biais de la mémoire vive, et nous n’avons pas conscience de l’ensemble des programmes qui font tourner la machine de façon occulte (ou inconsciente) dans la mémoire morte. La mémoire morte, comme l’inconscient, représente une partie beaucoup plus importante de cette intelligence, énorme même.
Cerveau et appareil psychique, intelligence opérationnelle, conscient et inconscient.
P - Parfum
Les perceptions olfactives sont extrêmement rares en rêve. Si elles se produisent, elles ont une grande importance. Le parfum symbolise la partie intangible, mais pourtant essentielle, d’une personne. C’est la quintessence de la personnalité, une trace subtile et indéfinissable. Comme l’odeur, le parfum est lié à la notion de souvenir. C’est la mémoire d’une personne précise qui est ici représentée par le parfum. Le parfum de la mère est une odeur souvent merveilleuse. Si ce n’était pas le cas, il y aurait un rejet.
Si la rêveuse porte le parfum et qu’il lui va le plus merveilleusement du monde, elle découvre sa véritable essence. C’est un rêve de rencontre avec sa nature secrète, celle qui se révèle et qui peut par son authenticité séduire tout son entourage. S’il est trop fort, il y a ici trop d’exubérance dans le comportement. Il peut incommoder.
Pour un homme, le parfum qui s’insinue dans ses rêves est souvent celui d’une femme dont il perçoit inconsciemment la nature cachée et véritable. Plus le parfum sera délicieux, et plus il y a proximité avec l’âme sœur.
Pour les deux sexes, le parfum subtil est une exhalaison de phéromones. Le parfum est la fragrance de l’amour.
Personnalité secrète, essence de l’être, réminiscence, reconnaissance subtile, affinité.
Q - Quatre
Le quatre est le chiffre de la stabilité, de l’assise, du carré et de la division paritaire. C’est la base de toute construction. Le quatre symbolise l’équilibre parfait alors que le 3, qui est le premier équilibre, est instable comme un trépied. La division quaternaire est très fréquente et synonyme d’équilibre parfait, celui des quatre pieds de la table des lois : il y a quatre saisons, quatre chemins, quatre vérités, quatre âges, quatre évangélistes, quatre phases dans la respiration : inspire, rétention à poumons pleins, expire, rétention à poumons vides, etc. C’est le nombre des membres de tous les mammifères.
Le quatre représente une perfection sur le plan terrestre. Le psychisme présente quatre composantes: le conscient et l’inconscient, le féminin et le masculin (Anima/Animus).
Le quatre est le chiffre symbole du père dans sa forme idéale, le masculin stable et pondérateur, le père d’égale humeur, équilibré et juste, dont l’autorité s’exprime sans violence et avec discernement, celui qui transmet les fondements et qui donne les outils et codes du monde extérieur, qui explique les lois et le fonctionnement du monde. Nous serions dans un monde parfait si tous les pères correspondaient à ce profil.
Le quatre exprime aussi une notion de hiérarchie, d’ordre.
Le quatre est souvent assimilé au carré, à la croix, au carrefour.
Chiffre du père, élément masculin, équilibre, base de toute construction.
R - Retard
Les rêves de retard sont toujours ressentis avec un grand sentiment d’angoisse. Celui-ci est décuplés’il est relatif à une même propension dans la réalité : ne jamais être à l’heure. Les personnes qui sont toujours en retard souffrent réellement d’un handicap, un sentiment de différence qui les forcent à s’exclure en se pénalisant. C’est un paradoxe puisque, celui qui est en retard est souvent celui qui est en avance sur les autres dans la réalité, celui qui s’est senti rejeté par sa « différence ». C’est souvent un surdoué, inadapté à ce monde qui ne le comprenait pas enfant, ce qui lui faisait croire que c’était lui l’inadapté. Le surdoué est presque toujours un sous-doué émotionnel, submergé par ses émotions et sa sensibilité qui le paralysent. Il est aussi capable de tout faire et de prendre toutes les directions et, souvent, il se retrouve incapable de choisir ; c’est parfois plus facile d’être mono-tâche.
C’est donc l’indécision qui sera la plus mise en évidence par les rêves de retard. Le rêve le plus fréquent est celui qui fait manquer un train. Nous ne sommes pas prêts à prendre un nouveau départ. Des tas d’obstacles et de difficultés se présentent au moment de partir. Les horaires sont illisibles, signes d’une chronologie et d’un développement singuliers. Il faut parfois aussi finir impérativement quelque chose dont l’importance nous semble tout à fait relative une fois réveillé. Le manque de direction et de cadre des parents est parfois responsable de cette confusion d’organisation.
C’est aussi la peur de l’inconnu et du changement qui nous place dans cette situation de retard. Dans ce cas, nous sommes nous-mêmes les artisans de ce retard. La peur du jugement, le sentiment de ne pas pouvoir être à la hauteur nous fait trouver mille excuses pour échapper à nos responsabilités ou à notre évolution normale.
Mais le train ou le rendez-vous que nous avons manqué sembleaussi catastrophique que l’opportunité que nous avons laissé échapper. La colère que nous ressentons contre les éléments qui semblent se liguer contre nous est en réalité celle que nous ressentons vis-à-vis de notre inadaptation ou de ceux qui nous ont (mal) élevés, ne nous transmettant pas les codes nécessaires du monde.
Le retard est très souvent lié à un sentiment d’abandon diffus, un abandon initial qui échappe à la mémoire consciente. Dans la réalité, il est très difficile de changer cette propension au retard qui est structurelle. L’individu évalue mal le temps et perpétue l’abandon qui lui fait passer plus de temps avec lui-même, en attente, qu’avec les autres. C’est une forme d’exclusion où l’individu ne s’accorde pas le droit d’avoir sa place dans le monde.
Inadaptation au monde, différence, avance sur les autres, peur du changement, opportunité manquée, évolution difficile
S- Saucisson
La forme du saucisson ne laisse aucun doute sur son sens d’interprétation et pourrait n’être qu’un emblème masculin, mais quand on le retourne comme une peau de saucisson, on obtient : les hommes sont si sots.
T- Tache
La tache n’est évidemment pas un symbole positif. Si elle apparaît sur un vêtement, elle montre que dans notre apparence ou dans notre comportement, une chose ne va pas. Le sentiment de gêne éprouvé pendant le rêve est symptomatique et proportionnel au « détail » qui cloche actuellement dans notre vie. Ce peut être quelqu’un qui nous pollue.
Une tache sur un meuble, un tapis, un mur symbolise un détail dérangeant qui pollue notre confort intérieur. La tache a pour fonction de mettre l’accent ou le doigt sur un défaut qui devient trop visible, donc gênant et qui pourrait nous desservir ou devenir dangereux pour nous.
Détail qui gâche un ensemble, pollution, gêne intérieure, comportement atypique.
U - Union
Les rêves d’union sont très proches de la symbolique du mariage. Cette union est représentée par la rencontre physique de deux corps. Mais il n’y a pas ici de sexualité exprimée, simplement la joie d’être avec l’autre, contre l’autre, de se sentir fondre dans l’autre. Cette union symbolise une rencontre intérieure et spirituelle. Elle laisse une sensation de plénitude et de bonheur retrouvé qui demeure au réveil. C’est la rencontre des aspects intérieurs, féminin et masculin, l’anima et l’animus, la reconnaissance de ceux-ci qui génère ce rêve. L’équilibre et l’harmonie intérieure succèdent à un sentiment de scission intérieure. « L’autre », celui à qui on s’unit, est la partie cachée de la personnalité qui émerge et s’accorde à la partie visible. Un long travail a été nécessaire pour arriver à cette plénitude. Le sentiment de plénitude subsiste longtemps après le réveil.
Harmonie intérieure, sérénité, accord des parties opposées individuelles (anima/animus).
V - Vêtements
Dans la réalité, les habits ou les vêtements ne sont qu’une simple apparence à laquelle il ne faut pas toujours se fier, ceux des rêves ont une importance bien plus grande quand ils sont clairement représentés. Ici, l’habit fait le moine, et le costume situe parfaitement le personnage. Ces vêtements extérieurs sont révélateurs de ce que nous sommes réellement au fond de nous. Ils sont comme une seconde peau. Il est donc important de savoir si nous sommes parfaitement à l’aise dans nos vêtements pendant le rêve.
Les vêtements sont les représentations des comportements qu’on nous a transmis, que nous avons adoptés ou que nous recherchons.
Les vêtements du bas sont toujours en relation avec un principe féminin, et inversement, ceux du haut avec un principe masculin. Le rêve insistera dans ce sens si ce détail à de l’importance. Les vêtements sont presque toujours révélateurs de tendances séductrices. Plus que la fonction sociale, ils insistent souvent sur le caractère sexué de la personne en l’accentuant.
Comportements, us et coutumes hérités de la famille, représentation réelle de la personne.
W - Wagon
Quand nous sommes dans le wagon, le voyage vient de commencer. Tout va bien, nous n’avons pas manqué le départ. C’est un élément important du train, celui qui transporte les voyageurs. Il est tracté par des énergies puissantes : celles de la locomotive. Plus nous sommes près d’elle et plus nous sommes près de cette force, même si nous ne sommes pas encore maître de notre destinée.
Atteindre le wagon, s’asseoir dedans et voyager confortablement, voilà la finalité des rêves de train. Ici, tout va bien. Nous avons pris toutes les bonnes décisions, les bonnes directions, et nous nous en remettons aux forces motrices du monde. Nous savons utiliser toutes les ressources que le monde des hommes met à notre disposition. Nous voilà partis pour un voyage où il ne nous reste plus qu’à nous laisser porter quelque temps. Les décisions suivantes sont pour plus tard. Notre vie avance sur des rails et nous jouissons du déplacement.
Le confort du wagon est relatif à l’histoire entreprise, à la situation plus ou moins confortable que nous vivons.
Habitacle du voyageur qui avance, moment de contemplation, transport intérieur, bonne direction de vie.
X
La lettre X peut apparaître seule, parfaitement visualisée dans un rêve, comme une équation à une inconnue à résoudre. Elle s’impose aussi dans sa redondance par l’usage itératif de mots la contenant.
X, c’est l’inconnu, l’énigme à résoudre. Ce qui est classé X, c’est ce qui est interdit, secret ou licencieux. Si c’est porno, ce n’est pas pour nous. X, c’est aussi la cible à atteindre ou une de plus sur un tableau de chasse.
La lettre X symbolise ce qui est interdit, censuré ou caché. Cet usage vient de la forme en croix, la diagonale qui barre ou annule.
Censure, secret, mystère, cible.
Y
Tout comme le X, la lettre Y peut apparaître en rêve dans sa forme pure ou stylisée. La première évocation sera celle du chromosome Y déterminant du genre masculin. Le Y symboliserait donc le principe masculin, même si cette approche peut sembler par trop lapidaire et être assénée à coup de lance-pierre dont la forme rappelle bien celle du Y.
Z - Zèbre
Le zèbre symbolise une nature sauvage qui ne peut pas être domptée ou domestiquée. Comme chez le tigre, sa robe aux rayures noires montre les zones d’ombre qui voilent encore la conscience. Cette dualité de la personnalité peut être fascinante pour l’extérieur, mais elle demeure dangereuse.
En psychanalyse, le zèbre, c’est une personnalité atypique, une terminologie équivoque pour parler des surdoués ou des hypersensibles.
Nature fragmentée et indomptable, double personnalité, dualité, étrangeté.
Le secret des oasis
Loïc HenryGolgotha
Note: Cette nouvelle est écrite en forme de spirale : le premier chapitre est au centre puis le récit ondule d’avant en arrière pour atteindre ses deux extrémités, le début et la fin.
STANCE 4
Le char à voile glissait dans le désert sans se soucier des pierres qu’il projetait au loin. Son ombre vespérale se dilatait ou se condensait sur la rocaille au gré de la topographie et du cap choisi par le navigateur. Le sol irrégulier sous les larges roues et la colère du vent dans le grand hunier inquiétaient un peu Hegazti, qui craignait qu’une rafale fourbe ou qu’une roche ne déséquilibrât leur embarcation. Les deux autres passagers ne semblaient guère s’émouvoir des embardées et des accélérations subites ; aucun d’eux ne doutait des talents de l’homme qui s’affairait près de la poupe. Le char serpentait dans les canyons, contournait les amas rocheux et se jouait du dénivelé pour rejoindre l’oasis de l’Arlequin, située à plus de trois cents kilomètres de leur point de départ.
Personne ne parlait ; la plainte des voiles, le claquement des haubans et l’entrechoquement des pierres rendaient toute conversation vaine. Chacun contemplait le désert : les falaises fauves illuminées par le crépuscule, les champs de cailloux acérés à tribord, les sommets asymétriques à l’horizon. Combien de fois ses compagnons avaient-ils accompli ce voyage ? Yahto se trouvait à la lisière de l’âge mûr ; quelques traces blanches parsemaient sa chevelure ébène et de fines ridules s’invitaient sur son visage glabre. S’il était un peu jeune pour exercer de telles responsabilités, que dire de Kiyoe ? À peine sortie de l’adolescence, elle promenait sa silhouette éthérée sur le pont tandis que ses yeux en amande voletaient sans cesse, comme pour lamper les paysages jusqu’à plus soif.

Images par Golgotha
« Drôle de binôme », pensa Hegazti.
D’habitude, ses interlocuteurs observaient à la dérobée sa longue crinière blanche et les sillons que le temps avait creusés sur son visage pendant plus de neuf décennies. Pourtant, depuis son arrivée trois jours plus tôt, personne n’y prêtait attention. Dans les regards furtifs et les moues éphémères, elle ne lisait ni incrédulité ni doute, comme si tout le monde se moquait de son apparence.
Au loin, les premières flèches transperçaient l’horizon. Hegazti comprit vite que les distances étaient aussi trompeuses dans le désert qu’en mer :
il leur faudrait encore plus d’une heure pour atteindre leur destination. Elle avait choisi ce lieu le matin même pour échapper à l’emprise doucereuse de la capitale et pour quérir des tranches de vie plus naturelles, moins scénarisées.
« Ils n’auront pas le temps de tout préparer, cette fois », songea-t-elle.
STANCE 5
« Qui voulez-vous rencontrer ? »
La question de Kiyoe surprit Hegazti.
« Le chef de cet endroit. Je ne sais pas comment vous l’appelez… »
Yahto et Kiyoe échangèrent des regards gênés, comme pour laisser l’autre trouver une réponse appropriée. L’homme se lança enfin :
« Dans quel domaine ?
– En général… Qui coordonne la gestion de l’oasis de l’Arlequin ? »
Recroquevillée sur elle-même, Kiyoe souffla, d’une voix à peine audible :
« Personne. »
Hegazti s’efforça de ne pas laisser transparaître son agacement, car elle sentait ses interlocuteurs sincères. « Dans une situation où les pouvoirs sont partagés, cherche celui qui choisit la répartition des richesses et celui qui détient l’usage de la force ; s’il s’agit de la même personne, tu auras trouvé le chef, quel que soit son titre », lui avait dit un de ses premiers professeurs.
« Qui prend les décisions budgétaires ?
– Personne, répéta la jeune femme.
– Qui dirige l’armée, la police ?
– Il n’y a pas de militaires ou d’unités de maintien de l’ordre ici. »
D’un sourire, Hegazti balaya l’instant, comme si le sujet n’avait pas d’importance :
« Nous pouvons nous promener à notre guise ?
– Oui, bien sûr, répondit Yahto. Souhaitez-vous que nousvous accompagnions ?
– Avec plaisir, vous me guiderez… »
L’oasis se composait de plusieurs niveaux autour des trois bassins. Les réservoirs supérieurs, situés aux deux extrémités de la cité et distants d’à peine trois kilomètres, couvraient chacun une surface proche de deux hectares. Les abords n’étaient pas aménagés, et les rares bâtiments qui les ceignaient semblaient remplir une fonction utile plutôt qu’esthétique ou d’habitation, peut-être pour récolter l’eau potable. En contrebas, la ville s’étirait autour d’un large étang elliptique, alimenté par des canaux qui ondulaient le long de la roche. Au vu de la superficie et de la densité de construction, Hegazti estimait la population à environ quarante mille âmes. Le trio chemina sans but réel dans la cité pendant une heure. À chaque carrefour, Hegazti choisissait l’artère la plus peuplée : l’humain était sa matière première, et elle n’avait pas besoin d’échanger avec les habitants pour déceler les signes non verbaux, plus révélateurs et plus fiables que les paroles. Elle exerçait ses talents de pyscho-éthologue pour la Ligue depuis plus de sept décennies, sur la base d’un concept fondateur : personne ne pouvait comprendre les interactions humaines en profondeur sans intégrer leur part d’animalité. Comme tout groupe de mammifères, femmes et hommes répondaient à des codes sociaux façonnés par des millénaires d’évolution. Les sociétés humaines étaient plus complexes que celles des singes ou des cétacés, mais il s’agissaitd’une différence de degré et non d’état.
Plus le temps passait, plus Hegazti se sentait mal à l’aise. À moins d’une comédie collective, la multitude d’individus croisés aurait dû lui permettre d’esquisser une carte liminaire de cette micro-société et de déceler les premières émotions récurrentes. Dans les échanges qu’elle avait observés lors de leur balade, elle n’avait pas discerné les indices habituels : le jeu subliminal d’un mâle dominant au milieu d’un groupe, le regard acerbe des femmes quand une vénus locale attirait l’attention des hommes alentour, les tics de communication des marchands face à leurs clients. Tout était à la fois plus neutre et plus dense, comme lors de ces rares moments de magie avec un ami où l’on abandonne les masques conscients et inconscients.
Un instant, elle oublia les habitants pour se concentrer sur le lieu. S’ils n’affichaient pas de richesses ostentatoires, les bâtiments et la voirie semblaient propres et en bon état ; aucune trace de pauvreté ne parsemait les quartiers. Bien entendu, quelques heures étaient suffisantes pour écarter les mendiants et enfermer les fauteurs de troubles, mais pas pour rénover les routes et les murs ou pour s’occuper de l’apparence de toute une population.
STANCE 3
Accompagnée de Kiyoe et Yahto, Hegazti avait l’impression de déambuler dans un gigantesque parc d’attractions à l’échelle d’une ville. Chaque habitant de l’oasis de la noix vaquait à ses occupations — réelles ou factices ? — sans se soucier des dignitaires ou de l’étrangère à leurs côtés. Personne ne les apostrophait, ne les félicitait, ne les critiquait ou ne leur soumettait une quelconque requête. Ce simple fait sonnait faux : dans quel monde les symboles du pouvoir passaient-ils inaperçus lorsqu’ils se promenaient dans les rues sans escorte ?
En connaisseuse, elle apprécia le travail nécessaire à une telle perfection : pas un geste ou un mot ne venait troubler le tableau idyllique, pas même une œillade involontaire ou un éclat de voix au loin. Certes, la visite de l’émissaire de la Ligue était annoncée depuis des mois, mais une telle organisation révélait que cette planète souhaitait à tout prix cacher un lourd secret.
Elle décida de tester un habitant au hasard, autant pour étudier ses réactions que celles de ses deux compagnons de marche. Elle s’approcha d’un homme seul, assis sur un banc :
« Bonjour, je m’appelle Hegazti. »
Nullement surpris, l’inconnu se tourna vers elle.
« C’est un nom étrange, je ne l’avais jamais entendu avant. De quelle oasis venez-vous ?
– Aucune, je viens d’ailleurs.
– Vraiment ? »
Il se redressa, soudain intéressé.
« Nous sommes d’habitude à l’écart des traces commerciales, touristiques ou militaires.
– Et pourquoi, à votre avis ?
– Makhtesh n’offre aucune utilité géopolitique et n’est pas riche de minerais ou de matières premières. Et peu de Seuils sont en lien avec notre planète.
– Vous êtes tranquilles, en somme. »
L’homme sourit de ce résumé.
« Oui, c’est un peu cela…
– Et vous n’avez pas envie d’aller voir ailleurs ?
– La situation est tendue en ce moment, non ?
– Cela dépend où… Il y a en effet quelques différences de vues sur la souveraineté de plusieurs planètes. »
Hegazti s’en voulut un peu de son euphémisme : un tiers des mondes étaient en conflit ouvert avec un autre, sans compter les guerres civiles. L’homme enchaîna aussitôt sans argumenter :
« Et d’où venez-vous ?
– De Johor.
– C’est une planète de la Ligue, non ?
– Oui.
– La Ligue… murmura-t-il. J’espère que vous n’amenez as la mort avec vous… »
Malgré la force des paroles, le ton était candide, presque désinvolte. Hegazti s’apprêtait à nier, mais ces décisions ne dépendaient pas d’elle ; elle s’en tira avec une pirouette.
« Vous croyez que la Ligue écoute les conseils d’une vieille femme peur ses choix militaires ? »
Ils continuèrent à deviser quelques minutes : l’homme se comportait de manière naturelle. « Apparemment naturelle, presque trop… », pensa la psycho-éthologue.
Elle rejoignit Yahto et Kioye pour poursuivre leur flânerie dans la cité ; Hegazti s’adressait aux habitants de temps à autre et recevait en retour des réponses directes, naïves parfois. Enfin lassée, elle se dit qu’il fallait mettre un terme à cette mascarade.
« J’aimerais visiter une autre oasis.
– Oui, si vous voulez, murmura Kiyoe. Laquelle ? »
Hegazti s’attendait à une suggestion. Elle savait que ses hôtes imaginaient un déplacement en aéronef ; aussi, elle biaisa :
« Vous avez une carte ? »
Yahto lui tendit une console dont l’image était centrée sur leur position. Hegazti joua un instant avec les fonctionnalités du logiciel avant de leur montrer un point plus à l’est.
« Là. »
De concert, Yahto et Kiyoe se penchèrent pour lire le nom du lieu. La jeune femme fut la plus prompte à réagir.
« L’oasis de l’Arlequin ? Il n’y a pas d’astroport là-bas : le trajet se fait généralement en char à voile. Quand voulez-vous partir ?
– Dès que possible.
– Cet après-midi ?
– Parfait. »
Habituée aux échanges diplomatiques, Hegazti masqua sans peine sa surprise : elle s’attendait pourtant à une litanie de motifs fallacieux pour la détourner de son choix ou pour retarder leur départ, et non à un accord aussi rapide et inconditionnel.
STANCE 6
« D’après ce que j’ai compris, vous gérez l’approvisionnement en céréales de la cité… », souffla Hegazti.
Genos, un petit homme rondelet au visage d’ange, hocha la tête de droite à gauche, à mi-chemin entre l’approbation et le rejet.
« Oui et non. J’importe en effet des céréales, mais aussi des fruits, des légumes, du poisson, de la viande : tout ce qui est alimentaire et non raffiné, non traité. Toutefois, je ne suis pas seul : nous sommes quatre dans ce cas, plus d’autres intervenants mineurs pour lesquels cela représente une activité annexe.
– D’accord. Et qui dirige cette activité au niveau de la ville ? »
Genos se figea comme si la question n’avait aucun sens puis finit
par murmurer :
« Personne. Je suis libre de commander ce que je veux
et de le vendre ensuite.
– Les autres aussi ?
– Oui, bien sûr. »
Avec une pointe d’amusement, Hegazti songea que cela plairait aux dirigeants de la Ligue, qui s’était d’abord façonnée comme une alliance commerciale de planètes à vaste potentiel marchand.
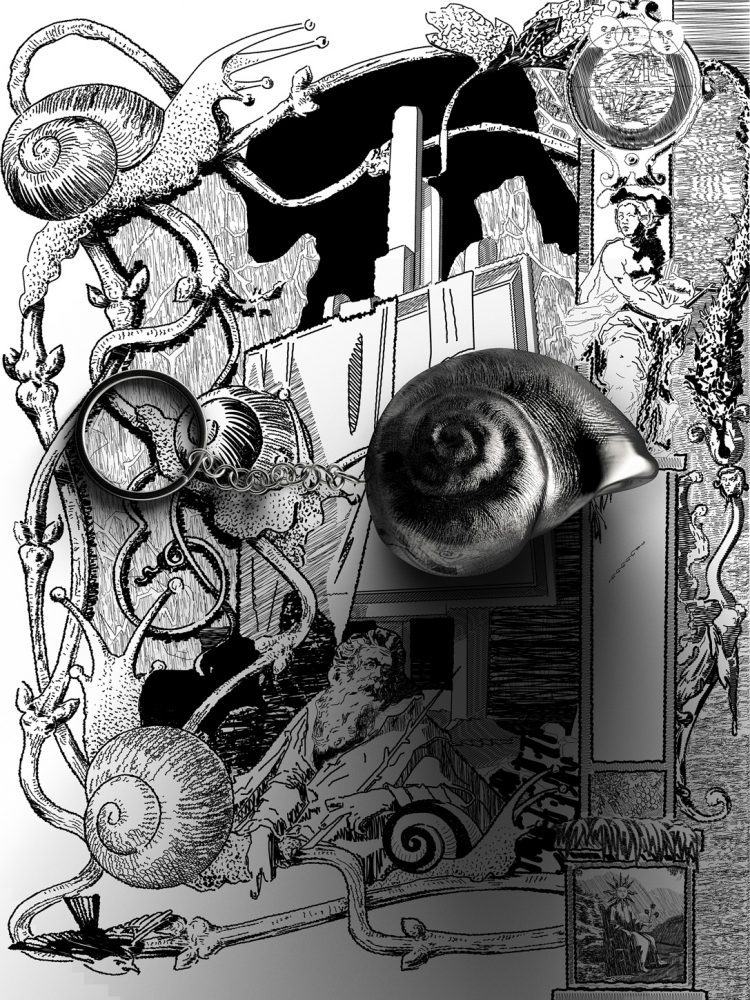
Dans l’histoire de l’expansion spatiale, l’économie de marché n’était pas le système majoritaire, non par manque d’efficacité, mais parce qu’il était intrinsèquement fragile. Les guerres, les révolutions, les religions, la fracture de la société en communautés polarisées, les injustices et les inégalités — réelles ou perçues — lui portaient en général un coup fatal avec l’arrivée aux commandes d’un homme fort, qui choisissait souvent de consolider son pouvoir en encadrant la sphère économique.
« Le système est le même pour toutes les oasis de Makhtesh ?
– Oui.
– Et les règles sont fixées à l’échelle planétaire ou locale ? »
À nouveau, Genos oscilla, indécis, avant de répondre :
« Il n’y a pas de règles…
– Pour les contrats par exemple, comment…
– Il n’y a pas de contrats, l’interrompit-il.
– Pardon ?
– Nous nous mettons d’accord, voilà tout.
– Et en cas de problème ? »
L’homme haussa les épaules, comme pour signifier que le sujet ne revêtait pas la moindre importance pour lui. Son attitude reflétait pourtant une franchise absolue, sans aucun signe usuel de mensonge. Ils discutèrent encore quelques minutes puis elle rejoignit Yahto pour lui soumettre la question qu’elle rechignait d’ordinaire à poser, préférant déduire la réponse elle-même à partir de ses observations.
« Quel est le système politique de Makhtesh ? »
Yahto lui décocha un sourire solaire.
« Aucun.
– Qui gouverne les oasis ? Et la planète ? »
Avant même qu’il ne réplique, Hegazti savait quel mot il allait prononcer :
« Personne. »
Elle s’approcha de son interlocuteur pour ne pas perdre les signes verbaux ou corporels : le moindre détail pouvait livrer autant d’informations qu’un long discours. En articulant chacun de ses mots, Yahto expliqua :
« Ici, les systèmes politique et économique sont fractals : ils sont invariants par changement d’échelle. Les diverses activités ne sont pas régulées, pas plus dans les oasis que sur la planète elle-même. Notre seule concession est une capitale tournante parmi les cités en bord de mer pour les échanges avec l’extérieur. Cette année, c’est l’oasis de la noix qui tient ce rôle.
– Et comment Kiyoe et vous-même avez-vous été choisis ? Élus, désignés, nommés…
– Nous étions disponibles au moment de votre venue, c’est tout. »
Hegazti ne répondit pas ; elle avait besoin de réfléchir. Parmi la myriade de mondes qu’elle avait visités au cours de sa vie, elle avait observé de nombreux régimes politiques : monarchie, théocratie, démocratie, oligarchie sous maintes formes et systèmes autoritaires à foison — dictatoriaux, militaires, collectivistes. Quelle qu’en soit la variante, jamais elle n’avait rencontré d’anarchie fonctionnelle à l’échelle planétaire. Même les expériences en cercle plus restreint débouchaient tôt ou tard sur une voie plus classique, le plus souvent après un bain de sang. Les explications étaient multiples, mais Hegazti considérait que l’anarchie contredisait les normes éthologiques que l’évolution avait imprimées en l’homme. Les sociétés, comme la nature, avaient horreur du vide : in fine, quelqu’un détenait le pouvoir, prenait les décisions pour le groupe, accumulait plus de richesses que son voisin ou connaissait plus de succès avec le sexe opposé — ou le même, c’était selon. Les chimpanzés mâles se battaient parfois à mort pour occuper le sommet de la pyramide afin de bénéficier des faveurs des femelles les plus séduisantes ; les rats développaient une organisation exploiteurs, exploités, autonomes, souffre-douleurs ; dans une meute de hyènes tachetées, les femelles étaient toujours dominantes, et ce trait héréditaire condamnait ainsi à mort toutes les sœurs de la portée.
Le monde décrit par Yahto n’était pas crédible pour une psycho-éthologue expérimentée comme Hegazti.
STANCE 2
Le Seuil reliait une planète mineure en cours d’affiliation à la Ligue avec Makhtesh. Il s’ouvrait au fond d’un abysse de presque douze kilomètres de profondeur, à mi-chemin entre le tropique et le pôle Nord. Hegazti connaissait déjà le pilote, Nuz, un ancien Explo qui avait abandonné la topographie et la recherche des Seuils à l’aube de son demi-siècle pour une place plus tranquille au service de la Ligue. Bien que taciturne, son compagnon de voyage ne lui déplaisait pas ; leurs conversations étaient rares, mais denses, sans passage obligépar de stériles discussions visant seulement à meubler le silence.
Elle avait appris la veille que Nuz avait participé à la découverte de deux Seuils au cours de sa carrière, dont l’un reliait l’immense mer intérieure de Johor à un monde emmailloté par des océans colériques, riches d’hydrocarbures. Au vu des profondeurs, l’exploitation était trop coûteuse, mais disposer de telles réserves pouvait s’avérer utile, notamment en cas d’embargo.
Une fois amarrée à l’astroport, la navette s’ouvrit enfin pour libérer Hegazti. Un homme d’une trentaine d’années et une jeune femme patientaient au milieu du quai, sans escorte, immobiles malgré le vent qui se jouait de leur chevelure.
« Plutôt minimal comme accueil diplomatique », pensa la psycho-éthologue.
Lorsqu’elle posa le pied sur la marche, elle ne put réprimer un frisson. Malgré son ample expérience, fouler un nouveau sol l’affectait toujours autant. Makhtesh portait la référence deux cent quarante-sept, et la première exploration datait de presque un millénaire. Au début de la colonisation spatiale, la multitude de planètes offrait aux hommes une promesse de paix. La plupart des conflits sur l’ancienne Terre étaient liés aux ressources : territoires, sources d’énergie et, surtout, eau potable. La découverte du premier Seuil dans la fosse des Mariannes appartenaità l’histoire : elle avait ouvert la voie vers une kyrielle de mondes au moins partiellement océaniques. Puisque les ressources devenaient soudain presque infinies, il n’était plus utile de se disputer pour les partager, et une vague d’espérance avait submergé la Terre.
Pourtant, après une courte période calme, les guerres avaient repris. Seule l’échelle avait changé : au lieu de se battre entre pays, on s’affrontait maintenant entre planètes. Le logiciel humain s’était adapté sans vraiment modifier son fonctionnement. Aucun monde n’avait échappé aux conflits — internes ou externes — au cours du siècle dernier ; tous avaient connu les affres de la guerre.
À l’exception de Makhtesh, en paix depuis plus de cinq cents ans.
STANCE 7
La description de Yahto n’avait aucun sens.
Makhtesh n’abritait ni organisation centrale ni gouvernement planétaire ;à l’échelle locale, il n’y avait ni chef, ni groupe de décision, ni processusdémocratique. Aucune loi ne régissait les sphères privées ou profession-nelles ; les juges et les tribunaux n’existaient pas, pas plus que les prisons ou les unités de maintien de l’ordre. La propriété individuelle était présente sans être codifiée ; les impôts étaient payés sur une base volontaire, sans règles ni contraintes. Une force armée moderne était affectée à un seul but : la défense des trois Seuils éparpillés dans les océans. Conquérir Makhtesh coûterait cher en temps, en matériel et en soldats, alors que l’intérêt de la planète demeurait très limité en raison de ses faibles ressources énergétiques et de ses rares Seuils. Cela expliquait sans doute le peu d’entrain des chefs de guerre : certains avaient bien essayé de percer la protection de Makhtesh, mais ils avaient vite deviné que la conquête épuiserait leurs capacités militaires, sans leur apporter de contrepartie notable.
Toutefois, si le comportement extérieur se comprenait, cela ne justifiait pas qu’un système contre-nature de l’avis de Hegazti eût pu perdurer aussi longtemps. Certes, la vie semblait douce et plutôt égalitaire dans les quatre oasis que Hegazti avait visitées, sans pauvreté visible, mais certains paraissaient mieux lotis que d’autres. Un orateur plus adroit que les autres, un putsch militaire, une révolution populaire, une alliance de circonstance auraient pu — auraient dû ? — chambouler cette incongruité politique.
Il manquait une pièce au puzzle…
Si les rencontres diplomatiques n’avaient pas toujours de durée définie, le standard se chiffrait en journées. Comme ses hôtes ne manifestaient pas le moindre agacement, elle visita six oasis, proches de son point d’amarrage ou plus éloignées ; elle discuta avec des éleveurs, des industriels, des soldats, des artisans, des professeurs, des pêcheurs, des médecins ; elle écouta les leçons dans les écoles, les chansons sur les écrans collectifs, les blagues sur les marchés. Aucun instant ne sonnait faux en lui-même : il aurait pu se produire sur Johor ou ailleurs. C’est l’impression d’ensemble qui induisait un malaise, une sensation de feinte ou de trucage.
Au bout d’une vingtaine de jours, elle comprit ce qui la chiffonnait : l’absence.
L’absence de disputes pour des broutilles, de remarques acerbes dans un couple, de remontrances d’un parent à son enfant, de sous-entendus teintés de poison. Il ne s’agissait pas seulement d’un vernis culturel puisque les visages comme les gestes confirmaient cette quiétude ambiante.
La lumière vint du troisième hôpital qu’elle visita dans l’oasis du croissant, l’une des plus grandes du continent sud. Au détour d’une conversation avec la directrice qui lui fournissait moult données chiffrées, l’esprit de Hegazti s’égara dans des calculs de ratios pour ne pas lui montrer qu’elle aurait préféré vagabonder sans notice explicative à ses côtés, les sens en éveil. Puis ils déboulèrent dans la salle où quatre infirmières prenaient une pause avant de retourner au chevet des malades. Si les soignantes avaient toujours émoustillé les sens des hommes, peut-être aussi grâce à l’attention qu’elles leur prodiguaient dans des moments difficiles, ces quatre jeunes femmes auraient attiré le regard dans n’importe quelle situation, même vêtues d’un simple sac de jute. Leur peau, leur chevelure et leurs yeux usaient de toute la palette de couleurs que la nature offrait, et chacune tutoyait la quintessence de la splendeur féminine.
« C’est vrai que le personnel est beau dans cet hôpital, les femmes comme les hommes », songea Hegazti.
Comme dans ce quartier.
Comme dans cette oasis.
Comme sur toute la planète…
STANCE 1
« Et comment s’appelle cette anomalie ? » demanda Hegazti.
Avant de répondre, Marco laissa filer quelques secondes.
« Makhtesh.
– Quel est l’intérêt pour vous ?
– Vous ne trouvez pas curieux qu’une planète n’ait connu aucun conflit depuis plusieurs siècles ?
– Si, bien sûr. Cela me passionne, mais vous ? Vous êtes l’un des sept membres du Collège de la Ligue, et vos décisions affectent des dizaines de mondes et des milliards de personnes. Quelle importance revêt Makhtesh à vos yeux ? »
Marco se leva pour arpenter son bureau sans prononcer un mot. Soudain, il agrippa une simple chaise et s’assit très près de la vieille femme.
« Pourquoi la Ligue grossit-elle sans cesse depuis des siècles à votre avis ?
– Parce qu’elle est l’une des premières puissances militaires dans l’univers.
– Oui, mais encore ?
– Parce qu’elle est riche et qu’elle peut financer son expansion.
– Juste. Et pourquoi est-elle si riche ?
– Pour trois raisons : elle est développée technologiquement, elle a créé un système juridique fiable et elle laisse une liberté économique à ses sujets.
– Précisément. Le Collège n’intervient pas dans les affaires ou si peu ; il se contente de fixer des règles simples et de collecter des impôts auprès de ceux qui réussissent.
– Cela paraît facile.
– Pas tant que cela : il faut éviter de concentrer le pouvoir en une seule main, lutter contre la corruption, s’assurer que le peuple n’est pas trop grognon.
– Certaines personnes vivent dans une misère noire…
– Je sais.
– Vous vous en moquez ?
– Je le regrette… En toute franchise, ce n’est pas ma priorité. »
Hegazti se pencha vers son interlocuteur, presque à le toucher.
« Quelle est votre priorité, Marco ?
– Je veux que la Ligue croisse. Notre système est le meilleur : plus nous fédérerons de planètes, plus les conflits diminueront et plus nous pourrons dévier nos moyens financiers vers le bien-être général.
– En somme, vous voulez faire la guerre pour obtenir la paix ? »
La saillie arracha un sourire à Marco ; il ne paraissait pas blessé par la remarque de la psycho-éthologue. Il n’était pas dupe : tant que sa soif de pouvoir était alignée avec les intérêts de la Ligue, il se sentait en cohérence avec lui-même.
« Et Makhtesh dans tout cela ? demanda-t-elle.
– Combien de planètes conquises par la Ligue ont-elles fait sécession ensuite ?
– Je ne suis pas spécialiste, mais un faible nombre, je présume.
– Deux.
– Pourquoi ?
– Au début, parce que notre puissance militaire est supérieure, puis parce que les habitants eux-mêmes y trouvent leur compte. Dans la plupart des cas, nous les avons libérés d’un tyran, et la Ligue leur offre des opportunités bien meilleures pour eux-mêmes et leurs enfants.
– Pour une partie d’entre eux…
– Quand la proportion est suffisante, c’est déjà gagné pour nous. »
Hegazti s’autorisa un court temps de réflexion :
« D’accord. Si Makhtesh vous apprenait comment pacifier encore plus les relations, cela vous permettrait d’intégrer les nouveaux mondes plus rapidement…
– … Puis d’affecter nos forces militaires ailleurs.
– Vous n’avez aucune envie de conquérir cette planète…
– Je savais que vous comprendriez vite, vous êtes la meilleure psycho-éthologue de la Ligue !
– Et, à ce titre, vous me croyez sensible à la flatterie ? »
STANCE 8
Dans les océans de Makhtesh, Hegazti restait silencieuse avant de rejoindre le Seuil. Nuz ne cherchait pas à engager la conversation, la laissant rêvasser dans sa cabine, et elle lui en était reconnaissante.
Elle savait.
Sans détenir la moindre preuve, elle ne doutait pas une seconde de ses conclusions. Kiyoe et Yahto avaient deviné qu’elle avait percé leur secret à jour ; ils avaient aussi pressenti qu’elle ne le révélerait pas. Pourquoi déchaîner un torrent de feu sur un monde si pacifique ? Son rapport ne mentionnerait que des faits déjà connus et expliquerait l’absence de conflits par les spécificités géographiques de ce pays et sa faible densité de population. Quant au système politique, plus ou moins compris à l’extérieur, les mêmes arguments serviraient de paravent. En conclusion, Makhtesh serait présentée comme une incongruité vouée à se déliter, sur des années, des décennies voire des siècles. Il existait deux moyens de fédérer tout le monde contre vous. Le premier consistait à utiliser l’atome dans une guerre, y compris à faible échelle ; votre arrêt de mort était alors signé, peut-être même aussi celui de votre planète. L’empereur autoproclamé de Rebun avait tenté sa chance, et le lieu n’abritait plus que des cadavres en décomposition en lieu et place des centaines de millions d’âmes qui avaient peuplé les continents jumeaux.
En temps de paix, une civilisation développée offrait entre deux et douze lits d’hôpital pour mille habitants, en fonction de la pyramide des âges et de l’efficacité des programmes de prévention.

Un ratio inférieur à un signifiait des lacunes dans le système de santé. Rien ne permettait de ranger Makhtesh dans cette classe, alors qu’elle affichait un rapport d’environ zéro virgule quatorze. Comme Hegazti n’imaginait pas qu’une catégorie de population — les anciens ou les malades — pût être condamnée à mort dans une telle société, cela suggérait que la solution se trouvait dans les origines.
Dans les gènes.
Plus encore que le nucléaire, les manipulations génétiques vous assureraient le courroux de l’humanité entière, a fortiori si elles étaient généralisées et que leurs conséquences induisaient des comportements divergents par rapport à la norme humaine. Les craintes étaient presque irrationnelles : personne ne voulait affronter des surhommes ou des chimères homme-animal en combat. D’autres avançaient des motifs religieux ou moraux pour exclure la génétique, et il n’existait guère de terme plus incandescent que celui de transhumanisme.
Hegazti renversa un peu de sucre sur la table de sa cabine. De la pointe de son stylet, elle écrivit :
« Makhtesh est si paisible. Femmes et hommes sont si beaux et doux. Ils ne sont plus complètement humains peut-être… Dois-je pleurer leur sort ou le nôtre ? »
Puis ses doigts dansèrent sur le sucre pour effacer les lettres éphémères.
Note de l’auteur : Makhtesh est une planète du même univers que Les Océans stellaires, roman publié en 2016 aux éditions Scrineo et à paraître au format poche en novembre 2018 aux éditions Gallimard Folio SF. Cette nouvelle se situe quelques siècles ou millénaires plus tôt et elle est indépendante du roman.
Tout vous est aquilon ;
tout me semble zéphir
Mathieu Lindon
S’il est parmi les auteurs français les plus respectés, Mathieu Lindon reste très discret. Depuis le célébré Ce qu’aimer veut dire, Prix Médicis en 2011, qui raconte son amitié avec le philosophe Michel Foucault et, en écho, sa relation au père, l’écrivain n’a cessé de poursuivre son travail :
une exploration de la littérature comme matière intellectuelle sincère, stimulante, protéiforme et parfois déstabilisante. C’est le cas de son vingt-deuxième ouvrage paru aux éditions P.O.L. et intitulé Rages de chêne, rages de roseau. Sur plus de 650 pages, il remet en cause l’ordre établi des choses en multipliant les raisonnements et les contradictions. Ainsi, qu’adviendrait-il si le chêne et le roseau, protagonistes végétaux de la fable de La Fontaine, se rebellaient contre la morale de l’histoire ? Une expérience rare pour le lecteur, un souffle épique relevé par de nombreuses pointes d’humour et de trouvailles stylistiques. Justin Morin s’est entretenu avec Mathieu Lindon sur les origines de ce livre indéfinissable.
Justin Morin
Si l’on doit définir vos deux précédents ouvrages, Les hommes tremblent (2014) et Je ne me souviens pas (2016), on pourrait dire qu’ils sont respectivement une satire sociale et un récit autobiographique — inspiré par le recueil de Georges Perec. Votre dernier livre, Rages de chêne, rages de roseau (2018) est quant à lui insaisissable. Le texte est comme liquide, s’emportant dans ses propres vagues. Pouvez-vous me dire quelle est sa genèse ? Est-ce une réponse à vos précédents textes ?
Mathieu Lindon
Il n’est pas une réponse aux précédents, en tout cas pas dans mon esprit. Pour moi, ce livre est tout à fait spécial dans mon travail, je le vois d’une certaine manière comme un accomplissement, l’expression d’une liberté extrême. Après avoir fini Je ne me souviens pas, j’avais un problème : je ne voulais plus parler de moi ni non plus raconter des choses imaginaires. Ça ne m’intéressait pas d’inventer des histoires et ça ne m’intéressait pas de parler de moi, donc cela me laissait un champ très limité de possibilités ! Je me suis dit que j’allais suivre les conseils que je donne à mes proches qui m’en demandent sur l’écriture. Je préconise toujours d’écrire tout ce qui passe par la tête, même si on n’est pas sûr que ça vaut le coup, car il sera toujours temps d’enlever ensuite, alors qu’il est plus difficile de récupérer ce qui vous est passé par la tête si on ne l’a pas noté. On peut trouver soi-même ce qu’on écrit alors nul, mais puisque personne ne lira ces pages, il n’y a pas à avoir honte ! Et il ne faut pas avoir peur d’avoir honte quand on écrit. Rages de chêne, rages de roseau est gros mais il représente moins de la moitié de la première version. Initialement, j’ai eu beaucoup de mal à l’écrire. Contrairement à ce que je fais d’habitude où j’abandonne quand je n’y arrive vraiment pas, j’ai persisté. Alors que j’avançais très lentement, très petitement, tout à coup quelque chose a pris, un flux plus important, et puis c’est parti de tous les côtés, si j’ose dire. Je me suis dit que si j’avais envie d’écrire des poèmes ou des formes théâtrales, il fallait le faire et il serait toujours temps de couper. Et de fait, j’ai beaucoup coupé.
« C’est une dimension politique qui ne va me faire aucun allié, qui ne m’intégrera à aucun parti et ne m’accordera le soutien de personne. »
Justin Morin
Dès les premières pages, il m’est venu l’envie de lire ce livre à haute voix car le travail sur le rythme est très impressionnant. D’ailleurs, sur YouTube, on peut voir une vidéo où vous lisez un extrait, et cela m’a conforté dans cette idée que l’oralité de ce texte est extrêmement importante.
Mathieu Lindon
À un moment, j’ai été pris par un rythme et le livre a suivi, à moins que ce soit le livre qui ait trouvé son rythme et moi qui ai suivi. Il y a quelque chose de musical même si je suis la dernière personne à pouvoir en juger car la musique n’est pas mon fort.
Ce rythme est allé avec le livre, et le livre avec le rythme. J’ai eu besoin de m’y mettre
et de m’y plonger tout le temps, de rester dans mon univers et de m’extraire de tout autre. Dès que je me levais, avant de faire quoi que ce soit, je me mettais à écrire, pour n’être dérangé, contaminé par rien. J’ai pris l’habitude de faire des siestes l’après-midi juste pour pouvoir me réveiller à nouveau et retrouver cet état coupé du monde, me retrouver dans mon monde à moi, indépendamment de tout, et attraper ce rythme. Il n’est pas toujours le même, on pourrait dire que c’est celui d’une pensée. Rages de chêne, rages de roseau est comme le roman d’une pensée, une pensée automatique, perpétuelle, dans l’instabilité propre à la pensée. Je trouve que dans le monde littéraire actuel, où j’aime cependant beaucoup d’écrivains, il y en a une partie considérable qui se contente d’écrire où elle se trouve. Quand j’étais petit, il n’y avait pas de téléphone portable et, pendant mes vacances, quand je partais en groupe, j’envoyais une carte postale à mes parents avec une croix indiquant « je suis là », comme ont dû faire les enfants de ma génération. J’ai le sentiment que beaucoup de livres aujourd’hui, en sciences humaines et en littérature, consistent juste à dire « je suis là ». Alors les gens qui sont là aussi trouvent ça magnifique. Mais c’est pour moi le contraire de ce qu’est la pensée et de ce qu’est la littérature. D’une certaine manière, j’ai toujours envie de dire : « je ne suis pas là ! »
Justin Morin
Une adaptation théâtrale, c’est quelque chose qui pourrait vous plaire ?
Mathieu Lindon
Vous pensez peut-être à 2666 , l’adaptation du roman de Roberto Bolano (ndrl : Présentée au festival d’Avignon en 2016, la pièce de Julien Gosselin dure 11h30). Je crois que ça n’est pas mon genre. Cela dit, certains amis qui ont aimé le livre m’ont dit en riant que l’on pouvait l’ouvrir et lire un passage au hasard, un peu comme la Bible ! Cela correspond à l’idée d’entrer et de sortir pendant une représentation.
Justin Morin
Le livre s’ouvre sur un dysfonctionnement : quelque chose ne fonctionne plus. Et dans cette description de l’inconfort, de l’insatisfaction, il y a quelque chose de politique, un rapport à la révolte qui est très fort.
Mathieu Lindon
Tout à fait. Même le titre exprime ça. Mais cette dimension politique ne dit pas explicitement « je suis là ». C’est une dimension politique qui ne va me faire aucun allié, qui ne m’intégrera à aucun parti et ne m’accordera le soutien de personne. Dans mon esprit, il y a quelque chose d’ironique. Je ne sais pas si c’est le mot juste. Quelque chose d’humoristique ? On le retrouve dès la première phrase du livre. « Tout à coup, le monde ne convient pas ». Pour moi il y a quelque chose de drôle dans ce « tout à coup », car tout le monde est d’accord pour dire que ça ne va pas, c’est un fait qui n’est pas une découverte.
Justin Morin
Ce passage est un des nombreux dialogues entre deux personnages nommés « un » et « autre ». Le lecteur bien consciencieux va aborder ces discussions en essayant d’identifier l’un et l’autre, pour se rendre compte que les rôles s’inversent subrepticement, ou que cela pourrait être une seule et même personne dont le cerveau droit dialogue avec le cerveau gauche.
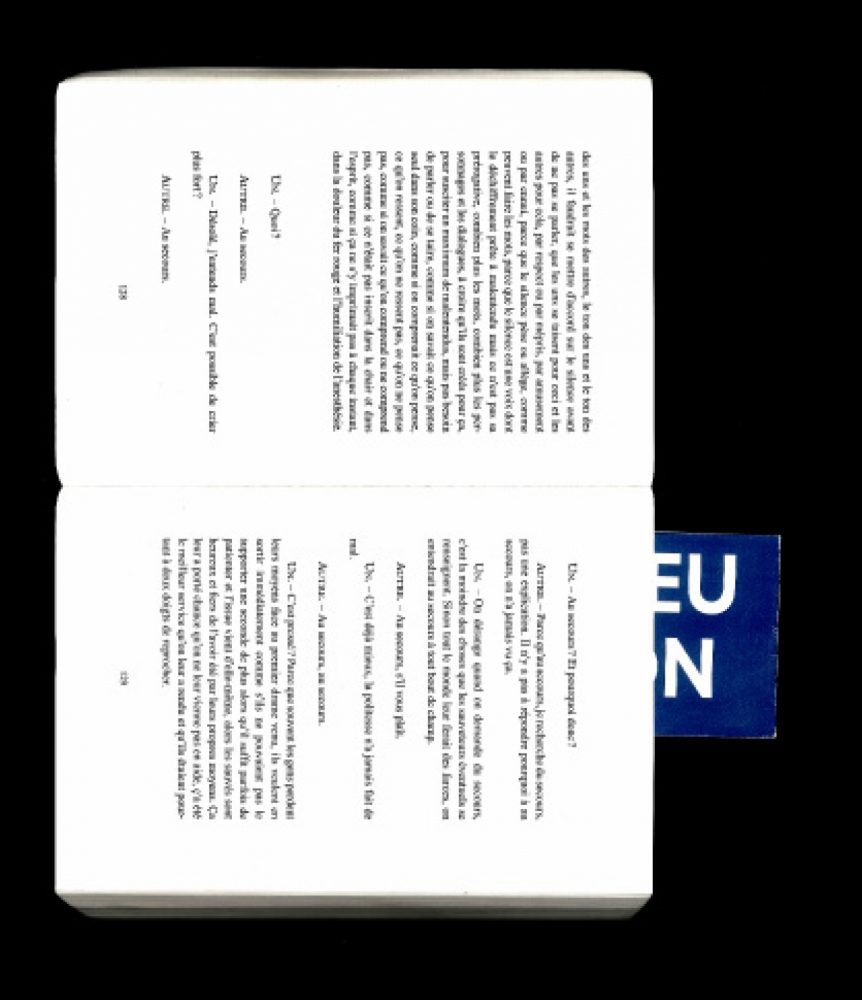
Mathieu Lindon, Rages de chêne, rages de roseau, P.O.L, Paris, 2018.
Mathieu Lindon
Pour tout vous dire, au début j’avais simplement mis des tirets. Mais, sur mon ordinateur, tout revenait à la ligne, ça recomposait le texte depuis le début en dialogues, c’était un cauchemar de mise en page. Donc, exaspéré, j’ai mis « Un » et « Autre » en me disant que je l’enlèverais peut-être après et c’est resté.
Justin Morin
Tout un chapitre est consacré à l’enfance, sujet que vous avez déjà exploré dans vos précédents ouvrages. Est-ce que la littérature pour enfants est quelque chose qui pourrait vous intéresser ?
Mathieu Lindon
On m’a déjà proposé d’écrire pour les enfants et je ne l’ai jamais fait explicitement, sans doute parce que j’avais l’idée que certains de mes livres s’adressaient déjà aux enfants. Je pense notamment à l’un de mes tous premiers livres, Prince et Léonardours (1987), qui a eu des problèmes avec la censure. Un ami avait fait des illustrations, un peu comme dans les livres de la Comtesse de Ségur. À mon idée, le livre avait été interdit précisément pour ces dessins. Mon ambition était de faire un livre à l’image des illustrés à destination des adolescents plus que des enfants. Champion du monde (1994), je trouve également que c’est un livre pour adolescents. Merci (1996) qui vient juste après, tout en étant très différent, je crois l’est aussi.
Justin Morin
Vous écrivez actuellement ?
Mathieu Lindon
Oui. Et les histoires de temporalité avec mes livres n’ont pas grand sens. Celui-ci a mis un an à être publié. Je ne suis pas pressé. Qu’est-ce qui s’ouvre à moi pour la suite ? Je ne sais pas, mais j’y travaille depuis 18 mois maintenant et je commence peut-être à voir. De toute façon, écrire, c’est quand même ce que j’aime le plus, ce que ça devient n’est pas forcément le plus important. Je ne maîtrise pas ce texte pour l’instant, mais j’ai gardé cette liberté de me dire « avançons, il sera toujours temps de voir plus tard ».
La montagne magique
Aurélia Morali
1 TRAIN — INT. JOUR
Derrière des lunettes noires, Sarah, la trentaine, retient difficilement ses pleurs. Elle est assise en face d’un légionnaire. Les larmes, incontrôlables, coulent sur ses joues.
Elle rédige un texto : « Je te déteste. Je voudrais que tu sois mort ». Elle croise alors le regard du légionnaire qui la fixe avec un air sévère, comme s’il devinait ce qu’elle venait d’écrire. Elle efface son texto au lieu de l’envoyer…
2 LIEUX DIVERS — INT. / EXT. JOUR (Flash-back)
Des personnes se succèdent face caméra, dans des lieux divers.
Marie, une amie de Sarah, dans son appartement :
MARIE
Non ? Comme ça ?! C’est dingue… Vous aviez l’air tellement amoureux… Édouard me l’a même dit encore l’autre soir…
Édouard, face caméra, dans un café :
ÉDOUARD
Ça m’étonne pas… Je l’ai trouvé très absent l’autre soir…
D’ailleurs, je l’ai dit à Marie juste après que vous êtes partis…
La mère Sarah, la soixantaine, en larmes :
LA MÈRE
C’est terrible ! Il faut absolument que tu le retiennes…
Fais des compromis pour une fois… Il en vaut vraiment la peine…
Pas comme ton père…
Dans un autre appartement, le père de Sarah,
un homme d’une soixantaine d’années également, élégant :
LE PÈRE
Qu’est-ce que t’en as à faire ? S’il veut partir, qu’il parte…
Qu’il crève même… De toute façon, on n’est pas fait pour passer sa vie avec une seule personne…
Dans un jardin, une autre amie de Sarah :
AMIE N°1
C’est pas le moment de te poser des questions ou d’analyser les choses… Prends ton temps… Et surtout, fais-toi du bien…
Dans un appartement, un autre ami de Sarah :
AMI N°1
C’est l’occasion de faire une bonne mise au point sur toi… Tu vas en chier pendant quelques temps… Autant en chier un bon coup, à fond, pour mieux ressortir la tête de l’eau après…
Dans l’appartement de Sarah, sa sœur :
SŒUR
Et pour l’appart, vous allez faire comment ?
Dans un restaurant :
AMIE N°2
Vends-le…
AMIE N°3
Garde-le, il est super…
AMIE N°4
T’inquiète, il va avoir un retour de bâton et il va revenir, c’est sûr…
Idem, face caméra, dans un bureau…
AMI N°3
Oublie-le et ne te dis surtout pas qu’il va revenir…
3 CAFÉ — INT. JOUR (Flash-back)
Sarah est dans un café avec un ami.
Elle a les yeux creusés et très mauvaise mine.
SARAH
Je suis épuisée…
L’AMI
Ça se voit, t’as vraiment une sale gueule… Tu devrais partir quelque part pour te reposer… Y’a un ami qui m’a parlé d’un spa en Suisse qui a l’air super…
SARAH (avec une grimace, pas convaincue)
En Suisse ?…
L’AMI
Il m’a raconté qu’un jour, il s’est retrouvé juste à côté de Kirsten Dunst dans un jacuzzi… Elle a dû aller là-bas pendant sa dépression après sa rupture avec Jack Gylhenhall… Si c’est pas un gage…
Sarah esquisse un sourire, amusée.
4 TRAIN — INT. JOUR
Retour au présent. Sarah, en sanglots, est au téléphone, entre deux wagons. Elle a le souffle coupé, respire mal. Elle fait visiblement une crise de panique.
SARAH
Je vais mourir, je te dis… Jamais j’arriverai jusque là-bas…
LA SŒUR off
Respire…
SARAH
J’y arrive pas… J’ai l’impression de me désintégrer… Je vais mourir Alice…
LA SŒUR off
Arrête de répéter ça. Calme-toi… Décris-moi le paysage…
SARAH le souffle court
(après un temps) Y’a des champs…
LA SŒUR off
Ok… Ils sont comment ?
SARAH
Ben vert… Enfin, non, jaunes… Enfin, entre les deux…
LA SŒUR
Y’a que des champs ?
SARAH
Non, là on passe devant une forêt…
LA SŒUR off
Y’a pas de maisons ?
SARAH
Non… Ah si, là j’en vois quelques-unes… Elles sont les unes à côté des autres… Comme ça, posées… Elles ont l’air connes…
LA SŒUR off
Respire…
Sarah prend une grande inspiration. Elle arrive à nouveau à respirer peu à peu. Ses pleurs cessent… On entend sa respiration lente…
5 GARE DE CHÜR — EXT. JOUR
Toujours le bruit de sa respiration lente et contrôlée…
Sarah descend du train à la gare de Chür, en Suisse allemande. L’endroit est moderne et plutôt vide. L’ambiance est différente : un peu flottante, cotonneuse, très calme. Un peu comme Sarah, fatiguée d’avoir trop pleuré.
Sarah regarde sur un panneau les correspondances…
6 TRAIN CORAIL — INT./EXT JOUR
Sarah est assise dans un petit train corail qui sillonne les montagnes. Le paysage est magnifique ; sapins, rivières… C’est de plus en plus sauvage, de plus en plus calme…
Le rythme se dilate… Sarah se laisse porter…
7 CAR — INT./EXT. JOUR
Sarah roule à présent dans un petit car, plus haut dans la montagne. Autour d’elle, des touristes de tous les pays : Australiens, japonais… Entre amis ou en couple… Elle est la seule à être seule.
À travers la vitre, elle jette un coup d’œil au grand précipice, puis tourne la tête, prise d’un vertige.
8 HÔTEL/LOBBY — INT JOUR
Sarah, sa valise à la main, s’avance dans le lobby de l’hôtel. C’est un endroit moderne et de bon goût. Les murs sont boisés, la moquette sombre.
Une grande baie vitrée ouvre sur le paysage et… la montagne qui se dresse en face.
Au desk, Sarah discute avec une employée de l’hôtel. Tout en lui indiquant des informations sur un prospectus, l’employée lui explique le déroulement de son séjour.
L’EMPLOYÉE (avec un accent allemand ou Suisse)
En plus du libre accès aux termes, vous avez donc choisi la formule « Restructuration profonde », en trois jours… C’est une série de soins qui vont agir sur votre corps, mais aussi sur votre esprit, afin de permettre aux cellules et aux énergies positives de refaire surface tout en évacuant les mauvaises… C’est notre soin le plus recommandé en période de stress… Ça commence après demain à 10h — le temps de faire connaissance avec le lieu — par un bain de pétales de roses du japon, suivi d’un massage detoxifiant à 13h, accompagné d’un masque corporel énergisant, pour finir sur un bain magnétisant ionique à 17h…
Sarah écoute en acquiescant, un peu sonnée.
L’EMPLOYÉE
…Ça, c’est pour le premier jour, la phase de sollicitation des cellules… Le lendemain, on passe à la face d’attaque… À 9h30, on casse les fibres supérieures de l’épiderme pour atteindre en profondeur les toxines…
SARAH avec une grimace
Ça va faire mal ?
9 HÔTEL / CHAMBRE SARAH — INT — NUIT
Dans sa chambre obscure, Sarah, tout habillée, dort sur son lit, la tête écrasée contre l’oreiller, comme une masse. Une grande baie vitrée laisse voir la montagne qui se dresse en face, imposante, éclairée par la lune.
10 HÔTEL / COULOIRS — INT. JOUR
Le lendemain, Sarah, vêtue de son peignoir blanc et de ses chaussons en éponge fournis par l’hôtel, serviette autour du cou, déambule dans les couloirs blancs et lumineux au style futuriste 70’S. Elle croise un couple, comme elle, en peignoirs blancs… Puis un autre qui sort de sa chambre, puis encore un autre qui sort de l’ascenseur… Que des couples, entre 30 et 80 ans… À chaque fois, et de façon un peu mécanique, les clients la saluent d’un petit signe de tête ou d’un « bonjour » qu’elle leur rend avec un sourire convenu, dans un défilé à la fois un peu grotesque et inquiétant…
11 HÔTEL / COULOIRS & VESTIAIRES TERMES INT. JOUR
Sarah sort d’un ascenseur et arrive dans un endroit aux murs noirs laqués. Elle avance dans les couloirs sombres, seule et hésitante quant au chemin à suivre, comme dans un labyrinthe.
Elle arrive jusqu’à à un tourniquet. Elle regarde l’espèce de bracelet magnétique qu’elle porte autour du poignet et observe le tourniquet, perplexe. Elle tente de frotter son bracelet contre plusieurs endroits du tourniquet, mais rien ne se passe… Elle réessaie, en vain, puis regarde autour d’elle, cherchant quelqu’un pour l’aider. Personne…
Un couple arrive alors. Avec aisance, l’homme et la femme passent leurs bracelets devant le tourniquet et l’ouvrent sans aucun problème. Sarah s’empresse de les imiter, puis les suit dans les couloirs. Elle n’entend pas ce que le couple se dit, mais ce sont de beaux quinquagénaires, qui semblent bien dans leur peau.
Dans les vestiaires, Sarah observe le couple et reproduit, de façon appliquée, exactement les mêmes gestes qu’eux : elle prend une serviette sur un tas, laisse son peignoir et ses chaussons dans un vestiaire…
12 HÔTEL / TERMES — INT. JOURS
Toujours en suivant le couple, Sarah arrive dans les termes :
un ensemble de bassins, dans une pierre grise et moderne sur laquelle
se découpent de grandes fenêtres carrées donnant sur des sapins…
L’endroit semble vide, comme si le monde avait disparu. Sarah
cherche alors des yeux le couple qu’elle suivait, mais il a disparu…
Pas très à l’aise, Sarah s’aventure à travers les termes,
passe entre les bassins…
Elle arrive finalement dans un jacuzzi, une pièce à l’éclairage tamisé, aux murs en pierre sombre, très haute de plafond,
avec une musique contemporaine un peu new age et angoissante…
À l’intérieur, que des couples silencieux, côte à côte ou enlacés…
Ils observent Sarah qui arrive.
Elle les salue d’un sourire et d’un signe de tête, mais personne ne répond, rendant son geste déplacé. L’atmosphère est peu engageante. Sarah hésite puis tente de se trouver une place parmi eux…
13 HÔTEL / RESTAURANT — INT. NUIT
Le soir, elle entre dans la salle de restaurant pour le dîner.
Un serveur l’accompagne jusqu’à une table et l’installe.
LE SERVEUR
Vous souhaitez commander un apéritif maintenant ou vous préférez attendre Monsieur ?
SARAH gênée
Non, je suis seule…
LE SERVEUR
Ah, excusez-moi… (Il retire les couverts face à elle) Je vous apporte le menu…
Le serveur s’éloigne.
Sarah regarde alors les gens autour d’elle : des couples, des familles, des groupes… Souriant, discutant, s’animant… Autant d’images d’Épinal à la gloire du rapport humain…
Devant elle et à quelques tables sur sa gauche, deux femmes seules… et vieilles. Elle les observe un instant : l’une d’elle étudie le menu avec une attention excessive, entourant ou cochant les plats qu’elle choisit… L’autre dîne et se ressert un verre de vin d’une bouteille déjà bien entamée…
Sarah, angoissée, décroche alors son téléphone et compose un numéro.
SARAH
Al… Allô ?
RÉPONDEUR FEMME
Bonjour, vous pouvez me laisser un message après le bip sonore…
Sarah compose un autre numéro…
RÉPONDEUR HOMME
Je suis actuellement indisponible. Laissez un message et je vous rappellerai, si vous avez de la chance !
Marie soupire et raccroche. Elle compose encore un autre numéro…
SARAH
(soulagée) Allô Marie ? Oui, ça va ? Oui… Je suis arrivée hier… Non, c’est très… Reposant… (puis déçue) Ah, tu sors… Tu vas dîner chez qui ? … Moi ? Heuu… Je sais pas, je vais voir… On peut se rappeler demain ?… Oui, ou plus tard, quand on veut… N’hésite pas… Je t’embrasse…
Sarah raccroche son téléphone, regarde autour d’elle, soupire, elle retient ses larmes qui lui montent aux yeux.
14 HÔTEL / CHAMBRE SARAH — INT. NUIT
Assise dans son lit, Sarah essaie de lire. On aperçoit le titre de son roman, La montagne magique de Thomas Mann. N’arrivant pas à se concentrer, elle fait défiler le numéro des pages, puis regarde l’heure sur son réveil : 8h30. Elle pose son livre, prend son portable, compose un texto : « Bonne nuit »… Puis l’efface.
Sarah éteint la lumière et se couche.
L’obscurité fait alors apparaître, face à elle, par la baie vitrée, la montagne qui se dresse, majestueuse, noire et éclairée par la lune. Des nuages l’entourent et lui donnent un air un peu inquiétant.
Sarah fixe la montagne. Ses paupières se ferment peu à peu. Elle s’endort.
Sarah dort d’un sommeil agité, tandis que la montagne lui fait face… Comme si la montagne avait un effet sur le sommeil de Sarah…
15 HÔTEL / CHAMBRE SARAH — INT. JOUR
Le lendemain. Dans sa chambre ensoleillée, Sarah encore à moitié endormie, tâte la place dans le lit à côté d’elle… Constatant qu’elle est vide, elle se réveille en sursaut, en prenant une grande inspiration, comme sortant d’une apnée. Hagarde, elle regarde alors autour d’elle et revient peu à peu à la réalité.
Elle aperçoit alors face à elle la montagne maintenant verte et ensoleillée.
16 HÔTEL / SALLES DE SOINS — INT. JOUR
Dans une petite pièce à la lumière tamisée, Sarah est dans un bain bouillonnant dans lequel se trouvent des pétales de roses. Son corps flotte, porté par les remous.
Puis dans une autre pièce, Sarah se fait masser. Des mains lui malaxent le dos, les bras, les jambes…
Dans une autre pièce encore, Sarah, assise dans un fauteuil, se fait couper les ongles des mains, puis des pieds… Puis, on les lui vernit…
Les soins se succèdent, s’accumulent, sur différentes parties de son corps inerte de poupée désarticulée.
À chaque fois, une musique sirupeuse de détente accompagne le soin…
Puis, étendue sur une table, Sarah se fait méticuleusement enduire le corps d’argile, comme pour un rituel. On lui enduit ensuite le visage… Jusqu’à ce qu’elle soit entièrement recouverte, comme momifiée. L’esthéticienne saucissonne maintenant le corps de Sarah dans un film plastique.
Une fois Sarah emmaillotée, l’esthéticienne sort alors de la pièce et la laisse seule, avec en fond sonore des bruits de savane (ou des chants d’oiseaux…).
Seuls les yeux de Sarah semblent encore vivants. Une larme coule sur son masque en argile.
Un peu après… Sarah, oppressée, lutte pour tenter de se libérer du film plastique, perce des trous avec ses mains, en arrache des bouts…
17 HÔTEL / COULOIR SPA — INT. JOUR
Sarah, recouverte d’argile et de lambeaux de film plastique, erre dans le couloir, telle un zombie.
SARAH
Y’a quelqu’un ?
18 HÔTEL / SAUNA — INT JOUR
Sarah est dans un petit sauna, seule. Couchée sur une banquette en bois, vêtue d’un maillot de bain, elle transpire beaucoup, rougie par la chaleur.
Le couple de quinquagénaires croisé aux bains entre alors, complètement nu. Ils échangent quelques mots dans une langue Nordique, probablement du Suédois, puis saluent Sarah.
Comme l’espace est petit, ils sont obligés de s’installer près d’elle. Ils semblent très à l’aise, tandis que Sarah, elle, est un peu plus gênée par la proximité de ces corps inconnus et nus.
Silence et chaleur… Tandis que l’homme est assis dos au mur, la femme commence alors à faire des exercices de yoga, écartant puis levant les jambes…
Sarah ferme les yeux, ne sachant où regarder, mais les entrouvre malgré tout de temps en temps, pour observer le couple, curieuse…
19 HÔTEL / RESTAURANT — INT. NUIT
Le soir, Sarah est assise à sa table. Le même serveur que la veille arrive et retire les couverts face à elle, avec un petit sourire complice. Sarah lui rend son sourire, un peu crispée.
Sarah finit une entrée. Puis, elle prend son portable et commence à écrire un texto « Tu es mon amour, ma famille. Tu me manques trop. Je n’arrive pas à vivre sans toi ». Puis, elle efface le texto et recommence « Tu me manques… »
Le serveur vient alors débarrasser son assiette.
LE SERVEUR
Pour la suite, vous préférez les ravioles de chevreuil au conté ou la souris d’agneau ?
SARAH
Rien, merci, ça ira.
Le serveur semble déçu.
LE SERVEUR
Vraiment ? Mais vous n’avez pris qu’une entrée… (avec un air entendu) Il faut manger… Les ravioles de chevreuil sont une spécialité de la région. Je vous les recommande…
SARAH
Non, merci, vraiment, je vais m’arrêter là.
Le serveur insiste.
LE SERVEUR
Vous arrêtez là ? Mais le menu comprend aussi une sélection de fromages et un dessert. Ce soir, c’est une tarte aux poires avec un caramel au beurre salé…
Sarah commence à être agacée, mais reste aimable.
SARAH
Oui, je sais, merci, mais je n’ai vraiment plus faim.
LE SERVEUR
Mais…
Sarah le coupe, plus ferme, en le regardant dans les yeux, sans sourire.
SARAH
Ça ira, merci.
Le serveur part sans rajouter un mot, un peu vexé.
Sarah regarde son texto resté en plan, l’efface et pose son portable.
20 CHAMBRE / SALLE DE BAIN — INT. NUIT
Penchée sur la cuvette des toilettes, Sarah vomit.
Sarah se rince la bouche dans le lavabo.
21 CHAMBRE SARAH / BALCON — EXT. NUIT
Sarah, sur son balcon, observe la montagne face à elle, comme hypnotisée. La montagne semble la happer, magnétique…
22 HÔTEL / SALLES DE SOIN — INT. JOUR
Le lendemain, une nouvelle série de soins…
Sur le visage de Sarah, on applique un masque bleu, puis un masque vert, puis un jaune, on lui souffle de la vapeur, on le masse, on lui passe des produits avec un pinceau…
Sarah est enfermée dans une sorte de cocon dont ne sort que sa tête.
Une esthéticienne passe une machine bruyante pour masser les jambes de Sarah.
L’esthéticienne dépose maintenant des pierres fumantes à différents endroits du dos de Sarah.
L’ESTHÉTICIENNE
Attention, ça va être un peu chaud…
L’esthéticienne enroule à présent le corps de Sarah de bandelettes humides.
L’ESTHÉTICIENNE
Attention ça va être un peu froid…
Au fur et à mesure que les bandes recouvrent son corps, Sarah commence peu à peu à grelotter.
23 HÔTEL / SALLE DE REPOS — INT JOUR
Allongée sur un fauteuil, Sarah, dans un peignoir blanc, continue de grelotter.
Face à elle, une large fenêtre laisse voir des sapins. Sarah les fixe. Peu à peu, son regard se perd dans les sapins, comme s’ils étaient tout proches d’elle.
Elle cesse peu à peu de grelotter
24 HÔTEL / PISCINE TERMES — EXT — JOUR
Les branches des sapins tournoient à présent, se découpant sur le ciel, accompagnées par le son d’une respiration lente et comme étouffée, et par de légers et apaisants bruits d’eau…
…Sarah fait la planche dans la piscine découverte de l’hôtel. Ses oreilles sont sous, l’eau…
De sa main, elle balaie doucement l’eau pour se mouvoir. Puis elle pose ses mains sur son ventre, sentant le mouvement de sa respiration en même temps qu’elle l’entend…
Sarah ferme les yeux. …
25 SALLE DE SPORT — INT. JOUR
Les yeux fermés de Sarah…
Dans une ambiance tamisée, elle est assise en tailleur, sur un tapis de sol, au milieu d’autres personnes. Un professeur passe parmi les élèves. Sa voix est berçante.
LE PROFESSEUR
Vous remontez progressivement la plante des pieds… Vous sentez la nuque de vos orteils… Puis plus haut les paupières de vos genoux…Les épaules de vos hanches…
Sarah ouvre les yeux et regarde l’inscription sur le devant du tee-shirt du professeur : « Ce qui ne tue pas »… Puis, la suite écrite derrière lorsqu’il se tourne « Rend plus fort ».
Le professeur est en tailleur assis face aux élèves.
LE PROFESSEUR
Et maintenant, riez !
Tous les élèves partent d’un rire artificiel et forcé, formant un spectacle presque effrayant. Sara fait doucement sortir des bruits de sa bouche en regardant autour d’elle, perplexe.
LE PROFESSEUR regardant Sarah
Plus fort…
Sarah se force à rire, de plus en plus nerveusement et bruyamment… Elle fait peur elle aussi.
26 HÔTEL / RESTAURANT — INT. NUIT
Le soir. Sarah arrive sur le seuil du restaurant.
Apercevant les deux vieilles femmes seules qui entourent sa place, elle fait demi-tour.
27 HÔTEL / PIANO BAR — INT. NUIT
Sara passe devant la salle piano-bar où joue un pianiste. Elle hésite, puis va s’assoire au bar.
SARAH au serveur
Une vodka s’il vous plaît.
LE SERVEUR
Sans rien ?
SARAH
Si, avec des glaçons… Et vous auriez des cacahuètes aussi ?
Le serveur la sert.
Plus tard. Sarah regarde le pianiste jouer en se gavant de cacahuètes. Elle finit sa vodka.
SARAH au serveur
Une autre s’il vous plaît.
Plus tard. Sarah, accoudée au piano, chante pour accompagner le pianiste qui joue « My way ». Elle est visiblement ivre, chante à tue tête, sans inhibition.
Elle n’a pas remarqué, assis un peu plus loin, le couple du sauna qui la regarde en souriant.
Un serveur s’approche d’elle.
LE SERVEUR
Excusez-moi Mademoiselle, mais vous dérangez les clients…
SARAH ivre et offusquée
Quoi, mais on est en train de chanter une chanson magnifique (désignant le pianiste) Monsieur et moi… Et vous ne devriez pas m’interrompre pendant cette chanson… Vous savez qu’en Thaïlande, chaque année, des gens se font tuer dans les karaokés parce qu’ils ont mal interprété « My way »… On ne rigole pas avec cette chanson…
LE SERVEUR gêné
Vous devriez rentrer dans votre chambre…
SARAH (faisant non de la tête)
Je suis une cliente, comme tout le monde et…
VOIX DE FEMME (en anglais)
Excusez-moi…
Sarah se retourne et découvre la femme du sauna devant elle, avec son mari.
LA FEMME (en anglais)
Ce soir, les bains font nocturne. On s’apprêtait à y aller avec mon mari… Ça vous dirait de nous accompagner ?… (avec un sourire) Moi c’est Siedsel…
L’HOMME
Et moi Jonas…
Sarah regarde autour d’elle. La pièce tourne. Elle acquiesce.
28 HÔTEL / PISCINE TERMES — EXT. NUIT
Dans la nuit, Sarah se baigne avec Jonas et Siedsel dans la piscine extérieure. Ils sont entourés par la montagne et les sapins qui se découpent, noirs, sous la nuit claire. Au-dessus d’eux, le ciel est rempli d’étoiles…
Ils nagent un peu, se croisent, s’observent… L’ambiance est très sensuelle, mais aussi un peu magique à cause du cadre.
Puis, peu à peu, Jonas et Siedsel se rapprochent de Sarah, tournant autour d’elle comme autour d’une proie, mais avec bienveillance.
Ils se rapprochent de plus en plus, l’encerclent, elle se laisse faire…
Sarah descend sous l’eau et y voit les corps du couple, sans têtes.
Sarah, Siedsel et Jonas ont quitté la piscine et passent entre les bassins. Ils en croisent un dans lequel flottent des gens entièrement recouverts de boue ce qui leur donnent des airs d’êtres un peu surnaturels, d’autant plus que Sarah est encore sous l’effet de l’alcool…
29 HÔTEL / CHAMBRE DANOIS — INT. NUIT
Dans leur chambre d’hôtel éclairée par la lune, Siedsel et Jonas, debout, entourent Sarah. Ils retirent leurs peignoirs, puis Siedsel ôte doucement celui de Sarah.
Jonas défait délicatement le nœud du haut de maillot de bain de Sarah qui tombe à ses pieds… Puis le bas glisse le long de ses jambes… La bouche de la femme embrasse le cou de Sarah, les mains de l’homme caressent son corps…
Sarah se laisse faire, immobile, face à la fenêtre et fixe la montagne et la lune qui lui font face. On dirait une cérémonie, dans laquelle Sarah serait comme une offrande à cette montagne.
Puis les mains de Siedsel et Jonas se rencontrent sur le corps de Sarah. Le couple se rapproche alors et s’embrasse. Peu à peu, Siedsel et Jonas semblent s’être retrouvés et avoir oublié Sarah. Sarah les observe un instant…
Puis elle ramasse discrètement son peignoir et son maillot et quitte doucement la chambre.
30 HÔTEL / COULOIRS — INT. NUIT
Sarah, vêtue de son peignoir blanc, avance dans les couloirs vides et sombres de l’hôtel.
31 HÔTEL — EXT. NUIT
Sarah sort de l’hôtel. Elle s’arrête un instant et regarde la montagne.
32 MONTAGNE — EXT. NUIT
Sarah, toujours vêtue de son peignoir blanc et pieds nus, marche sur une petite route qui monte dans la montagne.
Sarah continue de gravir la montagne. La route est maintenant entourée de forêt. Sarah marche encore. La route est devenue un chemin. Ses pieds écrasent la terre, les branches, les pierres…
Sarah, marche, marche, marche, monte, monte, monte…
… Elle arrive enfin en haut de la montagne. Elle regarde la lune qui brille au-dessus d’elle et l’obscurité en bas. Epuisée, elle se laisse tomber sur l’herbe, s’allonge et s’endort…
33 MONTAGNE — EXT. JOUR
Le lendemain, Sarah, endormie dans l’herbe est réveillée par une chèvre qui lui lèche le visage. Elle ouvre les yeux et tombe nez à nez avec la chèvre. Elle se redresse et en aperçoit alors une dizaine d’autres qui la fixent avec curiosité tout autour… Elle regarde autour d’elle, le temps de comprendre ce qu’elle fait là…
Son regard tombe sur la vallée, avec son hôtel, tout petit en bas.
Elle entend alors des voix d’hommes qui s’approchent. Elle constate qu’elle est débraillée et réajuste rapidement son peignoir tout en se relevant. Elle voit alors trois randonneurs qui arrivent vers elle et semblent un peu surpris de la voir là, en peignoir, les cheveux ébouriffés.
Ils se font face, interdits.
UN RANDONNEUR (après un moment)
Tout va bien ?
Sarah hésite un instant.
L’un des randonneurs, séduisant, lui sourit, amusé et charmé par son allure. Sarah, un peu gênée, mais amusée et sous le charme elle aussi, lui sourit à son tour.
SARAH hésitante
Oui, je crois…
Habitudes
Karthika Naïr
L’écrivaine Karthika Naïr publie pour la première fois l’intégralité de la série «Habitudes », poésie en quatre temps qui explore l’état amoureux hanté par le souvenir.
I HABITUDES: RETOUR
Dur de s’en débarrasser, bien trop facile à rattraper. Un demi-tour et revoilà, sans ciller, il attend. Inévitable, immanent, ce truc que tu veux fuir mais qui semble te coller ad vitam quasi æternam.
Quasi.
Quasi défaut de langue, moins qu’un bec-de-lièvre ?
Il y a habitudes et habitudes.
Respirer en est une que j’essaie de prendre.
Tu es celle que j’essaie de perdre.
II HABITUDES: RÉSISTANCE
Je n’avais pas l’intention je le jure pas l’intention d’écrire d’appeler de me souvenir mais là-bas rôde la nuit tirée à quatre épingles la nuit folie de satin cape escarpins visière le toutim étincelles de douleur brandies et une lune combustible lune mains gantées pour mettre le feu aux tripes moelle muscle pharynx griller du synapse dans un cortex droit puis dans le mille à cœur joie sur les membranes d’une nuque comme au stand de tir chardons piqués dans les côtes rafales de rengaine Quizás, quizás, quizás, jusqu’à extinction parler de survivants nostalgique tâtant le terrain sous mes pas idée fixe de fuite vers toi d’aplomb toi
Dix mille kilomètres sud vers un tas métronome tas de draps couvertures et rêves tissés main voix drapée sur ma poitrine absente mains prêtes à tirer et transfuser libre souffle et volonté de quatre doigts supraconducteurs sur poumons étouffés sous flamme glaire sang et peur vieille peur dure à désamorcer et pouce qui glisse passe en douce du confort aux camps d’entraînement pour conscrits traumatisés psychotiques un où la démobilisation n’est pas en option et les déserteurs restent au trou pour un temps solaire douze milliards d’années de nuit à quatre épingles de folie satin escarpins sans plus jamais ta voix ni tes doigts pour ne pas perdre la boule
il y a des jours où je te hais pour ce combat sans fin mien pas tien que tu poursuis en ravivant mon souffle je pourrais te haïr déjà pour un tel lendemain où tu ne serais peut-être pas pour encadrer cette existence.
III HABITUDES: RÉSIDUS
Écoute, soyons bien clairs : ce n’est pas toi qui me manques, pas toi du tout.
C’est la pluie tiède, sa senteur et son jazz éraillé que je regrette, ce n’est pas
toi du tout.
Pas ces salades, — lune, étoiles, vin, feu — que tu évoquais
avant que notre poésie ne vieillisse. Promesse c’était, ce n’est pas toi du tout.
Un ciel, une terre, cette atmosphère, l’auvent, ta bouche, ma langue,
la peau sur la peau — de cela je bâtis mon amour, de toi pas du tout.
La semaine dernière à la laverie j’ai achoppé ; cœur grippé sous les impressions
d’une couette.
Une voix nouvelle m’a tiré les pieds du gouffre, ce n’était pas du tout toi.
Oui, j’ai grandi : j’aime les pignons de pin et le caramel salé, j’adule
Steve Reich. Mais ça doit être ce qui passe pour de l’osmose, ce n’est pas toi du
tout.
Je jure avoir fait le grand ménage, t’avoir vidé de ma tête. Et je fais comme si,
lorsque je tombe
sur des éclats de rire, sur un baiser couleur cannelle, toi pas du tout.
Le passé envahit notre présent, imparfait encore, mais continu ;
il a muté, il chante par tous les interstices, pas toi-du-tout.
Par les Pléiades, par la lune de vif-argent, je renonce au cœur et
à ses tours, je porterai à mes lèvres ce calice d’abondance — toi tout craché,
après tout.
Désordre
Hubert Colas
Qu’est-ce qui m’amène à penser — à parler (d’une anomalie).
Le désordre me vient mais de quel désordre je voudrais parler.
La solitude. Mais de quelle solitude. Plus que la solitude : le silence.
L’impossible qui ne se dit pas puisqu’il est impossible.
Qui reste collé à ma peau ?
Je regarde je suis seul.
Je ne suis pas vraiment seul je le suis totalement.
Les sept levers capitaux
Matin d’août. Il fallait bien se lever. Je me lève à contrecœur. Préférant toujours la nuit où mon débat est clos. Je craignais déjà les quelques grimaces qui n’allaient pas tarder de remplir mon visage. Pourtant. Le temps modérateur des plaisirs articule mes pieds vers la cuisine, puis vers la machine à café puis vers le sucre que finalement je rejette pensant cholestérol cholestérol cholestérol puis la chaise tirée trainée d’une main vers mon extérieur terrasse, lunettes slip torse nu rasage approximatif et enfin doigts de pieds déployés dits en éventail. Je succombais à l’apesanteur. Le hagard pouvait commencer.
Jean, mon voisin qui forme dans ma tête l’idée du père que je n’ai pas, a jeté ce matin de sa fenêtre qui donne sur ma cour des papillons de papier. L’un d’eux s’est posé en suspension sur mon bol de café. Il s’agissait d’un morceau de carte postale. Un morceau dentelé comme on faisait à une époque peut-être encore maintenant dans les papeteries rétro. Un morceau de mer. La fin des vacances énerve mon voisin de père je me disais. Je me plaisais déjà à reconstituer le puzzle de ces précieux messages intimes qui animerait quelques instants le néant de ma matinée. Éparpillées sur ma terrasse ce jet de cartes me blessa quand j’eus compris qu’il s’agissait des cartes postales que je lui avais envoyées. Je n’osais pas lever la tête de peur qu’il y vît je ne sais quoi qui aurait pu m’échapper. La combustion de mon visage battait son plein. Mes sourcils clignotaient. La pulsation de mes veines devait dessiner toute la route des émotions que je ressentais. J’entrepris la cueillette des morceaux. Un à un je les déposais sur ma paume d’abord face image où je pouvais retrouver toutes les traces de mes voyages de ces dernières années. Souvenirs déchirants du temps qui passe. Traces et épisodes s’affichaient dans ma tête villespays monuments rencontres d’un coup tout était là étalé par terre. Le son des images envahissait mon crâne. Cette sensation comme on dit le jour de sa mort où l’on revoit défiler tout ce que l’on a vécu en quelques secondes. C’était ça. Nausée. De mes cartes il avait pris soins de ne jeter dans ma cour que des morceaux choisis où l’on pouvait lire « Cher Jean… » avec cette écriture quasi illisible qui me caractérise. De temps en temps un « Jeannot ». J’avais écrit toutes ces cartes depuis que sa femme était morte. Depuis le jour où j’avais compris que Jean et Angèle n’avaient jamais soupçonné un instant qu’elle puisse mourir avant lui et lui rester seul. Du coup ils avaient tout fait pour qu’elle ne manque de rien après sa mort à lui. Seulement voilà c’est elle qui mourut la première et c’est maintenant lui qui manquait de tout. Surtout d’elle. J’écrivais ces cartes avec le sentiment de combler une partie du manque. Vain. Je compris qu’il les avait soigneusement et scrupuleusement déchirées et qu’il ne m’en léguait par la fenêtre que les intitulés. Mes « Cher Jean » mes « Cher Jeannot ». J’étais blessé. J’étais vert. J’étais nausée. J’étais mort. Nous étions mort. Jean et moi. C’était fini. C’était des cartes toutes envoyées de l’étranger. Mes pensées soignées pour lui. Mes pensées étaient maintenant toutes déchirées, jetées par la fenêtre. Comme on jette l’argent.
Pourquoi ?
Collision de la pensée
De quelle couleur est la douleur ? J’attends une réponse. De quelle couleur est la douleur ? La couleur de la douleur est — VERTE. Elle est verte. Pourquoi — pourquoi — pourquoi ? Parce que — la peur est verte. La (grande) douleur c’est la peur. La peur est verte. La couleur de la peur de la douleur c’est la couleur verte.
D’aussi loin qu’il m’en souvienne,
Au petit déjeuner il m’arrive de manger de la salade. Je mange de la salade de haricots verts. Je vois les haricots verts. Je mange des haricots verts. Je ne sais pas si j’aime les haricots verts. Je ne sais pas. Mais je mange des haricots verts. Je crois que je n’aime pas ça. C’est un souvenir. Un souvenir de haricots. Petit je mangeais des haricots. Maintenant je mange toujours des haricots. C’est convulsif. Je vois je mange — je vois je mange. Je n’ai pas d’autre chose à dire. On peut se passer de haricots verts. Tout le monde peut se passer de manger des haricots verts. Pas moi.
On peut passer à la suite. S’il vous plaît. Merci.
Rien ne se perd.
Le temps est une mauvaise passe.
L’eau coule. Pendant ce temps. Je réfléchissais à la meilleure façon de ne pas perdre trop de temps dans une relation affective.Quelques règles de principe s’imposent à l’esprit. Ainsi : Comment commencer ? Et comment finir ? Ces deux périodes de la relation amoureuse sont chez moi les plus longues. Comment j’explique cela. Je l’explique : Ce n’est pas sans lien avec une certaine forme de — disleqcie — dysleksie — dixlecsie — dyslexie. Je l’esplique. J’explique. Le premier pas : Dépasser le stade de se dire en boucle que je n’ai rien à dire ou que ce que je pourrais dire ne dit rien et ne servira à rien de toutes manières. Je ne dis rien. Je suis gaucher. Donc préparer un petit lexique du savoir faire les premiers pas. S’impose. Avec quelques règles. Simples. Quelques phrases. Simples. Des principes simples qui m’emmèneront irréductiblement au lit. Quelles sont ces phrases ? Le vide me vient. Le disque dur tourne en rond. Rien dans le citron. Je tape sur le clavier : Premières phrases à dire pour rencontrer une personne. La petite boule mystère de l’ordinateur tourne — tourne — tourne — et je tombe sur : Les sept meilleures phrases pour draguer. Je lis.
1 — « Salut ! » cela avec variantes : « Salut ça va ? » et « Salut tu aurais l’heure ? » Après ce préambule il y a de fortes chances que je reste hébété. Je continue.
2 — « Excuse-moi je suis perdu, tu sais où est la rue xxx ? »
3 — « Excuse-moi, tu aurais du feu ? » Celle-là c’est une courue d’avance.
4 — « Salut, je cherche [là, il faut que tu insères un lieu sympa comme un parc, un musée, un monument, un bar ou un événement rigolo] tu pourrais me dire où c’est ? »
5 — « Salut, j’aurais pu t’aborder en te disant [le Cliché xxx] mais c’est vraiment naze. Je préfère me dire que tu me donnes envie de te connaître. »
6 — « Salut, ça va te paraître fou mais je t’ai vue et je me suis dit que ce serait bête de ne pas venir te parler, mais je me demande si ton chien ne va pas me dévorer ! »
7 — « Salut, je sais que tu as mis un barrage pour que personne ne vienne à l’abordage mais [je me dis que c’est bête de te laisser filer comme ça, donc] je m’en fous, je viens te parler. » Pour te dire la la la — Bref. À y réfléchir — Je pense (que) si j’utilise ces phrases pour faire le dernier pas pour en finir j’aurais plus de chances. Ça pourrait même être drôle — enfin pour qui ? Et du coup pour commencer j’adopte le principe inverse. Je tape : Les cinq phrases à dire pour une rupture. La petite boule mystère de l’ordinateur tourne — tourne — tourne — et je tombe sur :
1 — « C’est pas toi, c’est moi. »
2 — « Je ne sais pas où j’en suis. » — « Je pense encore trop à mon ex. » — « T’es trop bien pour moi. » — « Je n’ai pas envie de m’engager. » — « Ça devient trop sérieux, ça me fait peur. » — « Je t’aime bien, restons amis. » — « Bah, en fait, ça va pas être possible. » Bref : = Je cherche quelqu’un avec de l’humour — le plat est bien garni. Le jour est ouvert. Mon café est froid. Je ne suis pas aux pays des merveilles. Je sors.
La reprise de conscience de ma Dyslexie me détend quelques minutes. Ma difficulté à communiquer, à être en contact avec les autres, à écrire, à oser montrer ce que je fais m’épuise. Je dois sans cesse contourner les difficultés et inventer d’autres moyens de communication pour communiquer.
« Dernier coup de reins — comme disait mon père. »
Disait souvent Jean. Ce soir-là X n’était pas seul.
Ce soir-là je n’étais pas seul. Ça m’arrive. Après tout ce qu’il fallait faire de préliminaire je finis par coucher avec une personne. Mon appartement n’y était pas pour rien. Je crois qu’il plaît. Quand je ramène quelqu’un chez moi j’ouvre la porte. Je sais tout de suite que la partie est gagnée — ou pas. Souvent l’effet appartement gagne. C’est un appartement spacieux sans vis-à-vis. Cet appartement me ressemble. Après avoir fait ce qu’il fallait faire dans une certaine durée. Avec une incertaine assurance, bien dissimulée pour être sûr que le contentement de l’acte ait bien atteint la réciprocité — je dis : « En terme de durée de relation sexuelle ça va ? »
C’est orageux en ce moment — dedans-dehors — c’est orageux.
Ce matin. Encore une fois la crise l’emporta — je ne voulais pas — je voulais simplement traduire là où je n’étais pas d’accord. Mais la voix me coupait sans cesse. Je n’arrivais pas à formuler. Je m’emportais. La tension dans le cou. Je me sentais me raidir alors que je voulais être tout le contraire. Je voulais dire tout le contraire. Une voix ininterrompue sans relâche clamait une vérité sur mes agissements, mes comportements pas comme il faut. Sous les yeux la preuve tombait immédiate que mes faits et gestes étaient proches de l’hystérie. « Jamais on ne m’a parlé comme ça — jamais on ne m’a parlé comme ça. » Et en moi de me redire et redire que non ce n’était pas ça — pas vrai ce n’est pas vrai. Et la voix de dire regarde-toi regarde-toi. Et puis d’un coup je lâche net et clairement. Je ne veux plus te voir. Plus jamais. Je ne veux plus jamais te voir. Plus jamais t’entendre. De toute manière tu gagnerais à te taire. Je dis ça à la voix.
Le silence tomba. (Jean et X n’entendirent plus jamais parler la voix.)
Je n’ai pas le moral.
Je pleure — je pleure. Je crois que je suis malheureux. Je crois. Je ne sais même pas sur quoi. Je pleure — je pleure — je pleure. Autour de moi les gens s’approchent. Ils pleurent. Ils me voient pleurer. Ils pleurent-ils pleurent. Il y a d’autres gens. Ils nous voient pleurer. Ils s’approchent pour savoir pourquoi. Ils pleurent ils pleurent à leur tour. Nous pleurons — nous pleurons. La télévision arrive. Elle nous voit pleurer. La télévision nous demande si nous pouvons pleurer pour les téléspectateurs. Nous pleurons nous pleurons pour les téléspectateurs. Nous arrivons dans le petit écran de la télévision devant des milliers de téléspectateurs nous pleurons. Le téléspectateur se demande qui a bien pu nous faire tant de mal pour pleurer comme ça. Ils pleurent à leur tour. Ils pleurent ils pleurent. Je rentre chez moi je vois mon visage tout dégoulinant de tristesse. Je pleure. Je vais vite sur Internet pour me changer les idées. J’ai plein de messages de gens qui pleurent qui pleurent. J’allume la télé pour me couper le cerveau. Je vois des gens ils me regardent pleurer. Ils pleurent ils pleurent. Je me dis mais qui a bien pu nous faire autant de mal pour que nous pleurions comme ça. Tout le monde pleure. Ce n’est pas normal. lI y a quelque chose qui cloche. Il y a trop de gens qui pleurent. Pourquoi il y a autant de gens qui pleurent comme ça ? Tu sais ? Non tu ne sais pas pourquoi il y a autant de gens qui pleurent. En larmes. Mais pourquoi ? Pourtant il doit bien y avoir une raison. Pourquoi les gens pleurent comme ça. Ils pleurent et ils pleurent. Je décide de porter plainte contre X. Je vais voir la police car la police ne pleure pas. Non-non-non. La police ne pleure pas. La police n’a pas le droit de pleurer. La police pleure quand elle enlève son costume de police. Sinon la police ne pleure pas. J’explique pour qu’elle prenne conscience. Il n’est peut-être pas normal de pleurer comme ça. Il doit y avoir un X. X a dû faire quelque chose. La police retient ses larmes. La police me regarde. Je pleure je pleure. X me fait pleurer. X monsieur l’agent. X me fait pleurer. X me fait pleurer. X est coupable. X ne pleure certainement pas. À l’heure qu’il est X est en train de rire. Monsieur l’agent à l’heure qu’il est. Si X rit il doit y avoir une raison pour que X rie. Moi je pleure. Maintenant il y a d’autres gens au cabinet de police. Ils me regardent. Et tout d’un coup — Ils pleurent ils pleurent. Les policiers se serrent les coudes. Ils pensent à tous ces X qui cavalent. Se retenir de pleurer. Ils pensent à X. D’autres gens affluent. Avant même de savoir ce qui se passe ils pleurent ils pleurent. Nous sortons tous en pleurant. Nous nous rendons à la présidence de la République voir le président de la république. Le président de la République n’a pas le droit de pleurer. Non le président de la République n’a pas le droit de pleurer. Il est au-dessus des nuages gris. Nous pleurons de plus belle. Les visages sont tendus. Nous voyons le président. Le président de la République grimace. Il grimace le président de la République. Avec plein de gens autour de lui qui grimacent. Ils grimacent. Il nous regarde le président de la République. Nous sommes tout près. Tout près de le voir pleurer. Mais il ne pleure pas. Il fronce un sourcil. Il ouvre la bouche. Il sort une vertu. Mais la grimace est plus forte. Alors ? Alors il sort un cri aux accents toniques : « Faites attention ». Il sort de sa poche un grand miroir. Il tend le grand miroir vers nous. Il crie « Faites attention ! Faites attention ». Nous. Nous épouvantés nous courons nous courons. Nous courons dans tous les sens. Il y a des morts des morts. Des morts des morts. Nous pleurons nous pleurons. Nous avons peur. Je n’ai pas de morale.
Parfois nous avons besoin de douleurs aigües-aigües.
Je sors de mon lit. Comment vous avez fait ça ? Sept articulations bloquées. Et bloquées — bloquées. Dans des sens opposés. Quelle que soit la manière de bouger vous ne pouviez pas ne pas souffrir. Quelle que soit la position. Douloureux de tous les côtés. Ah ah ah. Vous devez avoir mal. Ah ah. Comment vous avez fait ça ? Je ne vous pose pas vraiment la question. Je sors une moue approbatrice. La journée était de travers, je le savais. Je le pensais et — ça y était je commençais à souffrir.
1 :-)
C’est le noir. La nuit. La chambre. Un homme. La lumière du jour peu à peu éclaire un écran d’ordinateur. Programmé pour sonner. Le réveille-matin. L’ordinateur s’allume. L’image est là. Un homme dort. Couché sur un lit. À coté un ordinateur portable sonne. Une image apparaît sur l’écran : un homme dort, couché dans un lit à côté d’un portable. L’ordinateur s’ouvre s’éclaire et sonne — une lumière apparaît. Une image apparaît. Un homme dort dans l’image. C’est programmé pour sonner. Réveil — L’homme se réveille. Une main sort du lit. Un bras pivote vers l’ordinateur où l’image d’un homme apparaît — le bras la main switch off. Noir.
L’homme de l’écran que l’on ne voit plus sort une main puis un bras de son lit, rabat claque et ferme l’ordinateur portable qui est posé sur une petite table à côté du lit où un homme couché dort — une précision peut-être inutile —, l’homme se redresse, crie — une chose — : « Debout connard ! C’est l’heure des morts ! ». L’homme du quatrième écran qui a sorti une main puis un bras de son lit en direction du portable en même temps qu’il a jeté un œildans une direction opposée à son mouvement comme s’il dormait accompagné, a claqué et fermé l’ordinateur portable se redresse et lâche — une chose du genre — : « Grouille-toiconnard ! Tu crois qu’elle appartient à qui ta journée ! » Noir. L’image sur l’écran 3 est celle,maintenant d’un homme hagard torse nu. Il regarde devant lui, il regarde l’homme qui vientde se réveiller. Il fume. Une première cigarette. Son d’un réveille-matin type chalet suisse — tic— tac et sonnerie coucou —. L’homme lâche de temps en temps « L’heure c’est l’heure. », « L’heure c’est l’heure. », « L’heure c’est l’heure. » L’homme de l’écran 2 grimace. Il grimace ou il sourit. « Debout ! Debout debout ! Debout debout debout ! Debout deboutdeboutdebout ! » L’homme de la chambre, la tête posée de profil sur un oreiller rouge ouvre son œil et le jette en direction de l’écran. Sa main sort du lit et vient claquer et « Ferme-la ! » il dit à l’homme de l’ordinateur portable. Maintenant il se dresse torse nu, fume cette fameuse première cigarette qu’il attrape avec son autre bras lorsqu’il claque l’ordi avec le regard qui est allé dans la direction opposée à son mouvement. C’est ainsi que durant quelques instants sa tête fût torturée par l’écartèlement de ses deux bras. À moins que la torture soit simplement la solitude. Il lâche à ce moment un « Connard ! »
Maintenant je fume. Matin si doux pas si doux.
2 – )
Un homme, il porte un tee-shirt vert, il n’a pas passé ses bras dans les emmanchures, il a la trentaine, il est mal rasé, il a l’air endormi, il a les yeux qui collent, il a un Post-it sur sa bouche. Il attrape le Post-it. Il lit le Post-it : « Debout debout debout »
3 ( )
Un homme, un tee-shirt jaune écrit dessus « DEBOUT ». Il a une main passée dans l’emmanchure du tee-shirt. Il se réveille. Il est rasé. Il regarde à gauche et revient de face. « Il faut se lever. » Et après « Une bouche, une brosse à dents, du dentifrice. Maintenant dans la bouche et après au travail. »
4 : (
Un homme, un tee-shirt rouge. Un visage rouge, Des yeux rouges. Il mange une pomme. Il pleure. Épluchures.
5 ° )
Ne parlons pas de se mettre debout.
6 = = =
Lumières lumières lumières lumières lumières lumières.
Je n’avais jamais remarqué que tu avais autant de lumières chez toi.
Tout est égal à moi-même.
7 … / …
Je n’aurais dû jamais exister.
X,
Le terrain s’est rétrécit. L’espace où je rêvais d’être mobile s’est collé à ta peau. C’est l’orage, tout ruisselle. Rien ne m’est donné, pas de mot pas de signe. Que le temps d’un long cadavre invisible qui meurt dans mes bras. Je ne peux rien faire. Ne pas dire et redire mon amour. La mort est là. Il n’est pas commode de souffrir autant de silence. Je crains qu’il me faille oublier. Mais je n’ai pas de corps pour le deuil. — S’il te plait viens.
Je reçus la réponse suivante : « Je ne peux pas lire votre message. »
On retombe toujours sur nos pieds ?
« Je ne peux pas lire votre message. »
