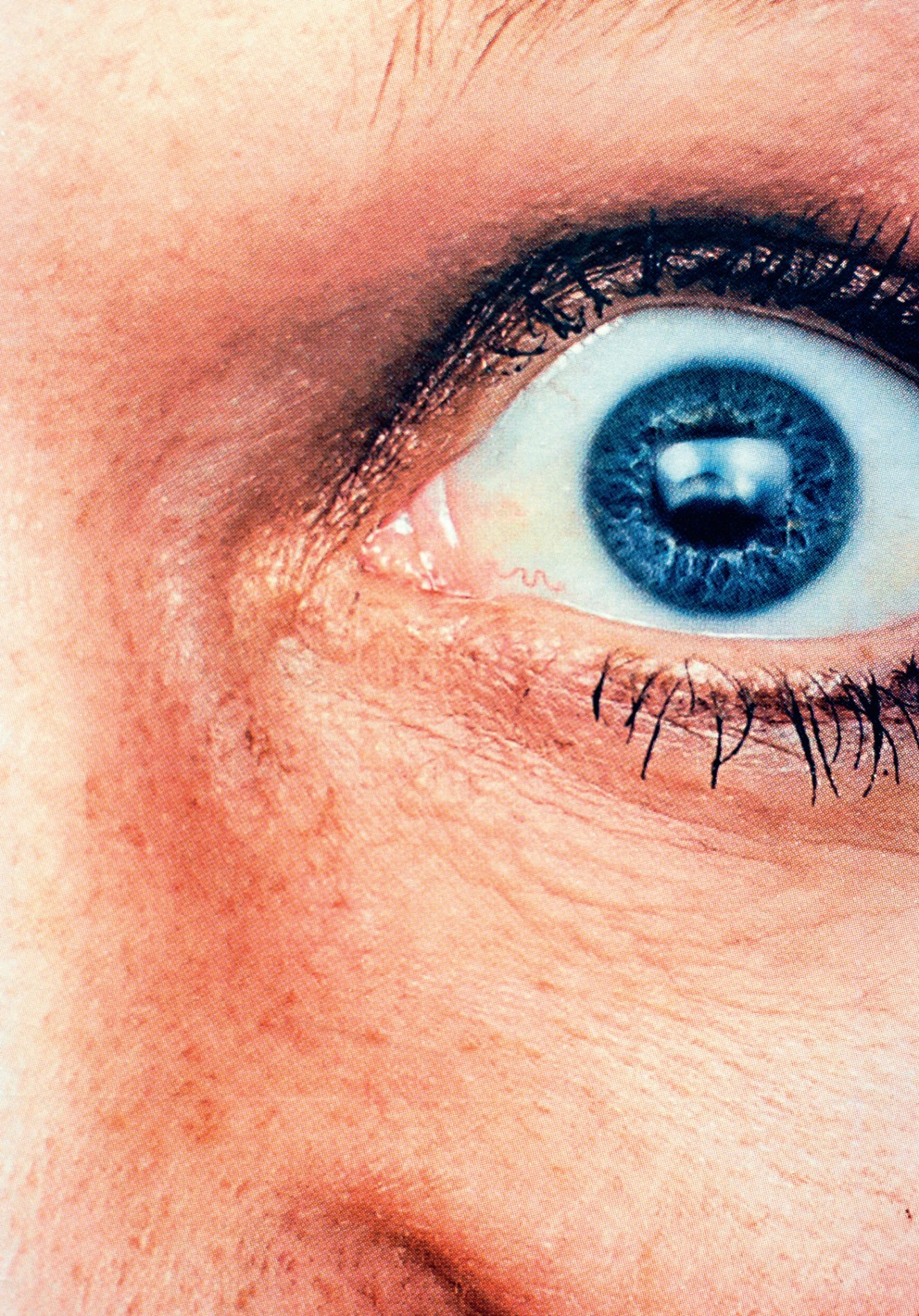Maître du jeu
Iida Kazutoshi
Alors que le contexte actuel limite les déplacements de chacun, réduisant ainsi les moments de convivialité et de découverte, le jeu vidéo offre une alternative réjouissante. Si le succès de certains titres a permis aux consoles de s’intégrer dans de nombreux foyers et de dépasser – enfin ! – le discours infantilisant sur les dangers des mondes virtuels, il faut saluer le travail de créateurs qui ont fait du jeu vidéo un medium à part entière, nourri d’arts visuels, de sons et de narration. Iida Kazutoshi est de ceux-là. Rencontre avec un auteur aussi discret qu’inventif.
S’il est une figure respectée et connue des amateurs, il est pourtant peu probable que vous ayez déjà joué aux jeux d’Iida Kazutoshi. Toutefois, son approche innovante a permis de redéfinir les contours de l’expérience vidéoludique contemporaine. Né en 1968, Iida voit son adolescence marquée par l’arrivée de la borne d’arcade Space Invaders, les débuts de la saga Star Wars au Japon et de l’éclosion du punk rock. Ces trois cultures l’ont profondément marqué et ont nourri son esprit iconoclaste, avide de mondes nouveaux. À la fin de son adolescence, il décide de suivre une formation dans une école d’art où, grâce à l’arrivée des premiers ordinateurs, il se forme aux logiciels de dessin, subjugué par la liberté qu’ils offrent et leur rapidité d’exécution. Ce goût pour l’infographie amène ensuite à intégrer le monde du jeu vidéo.
Première particularité d’Iida, il n’a créé que trois jeux ; une parcimonie qui en dit long sur sa position face à la relation qu’entretient l’industrie du jeu vidéo avec la créativité et la surproduction. Sorti en 1995 sur PS1, la première console de Sony, Aquanaut’s Holiday nous met dans la peau d’un plongeur qui parcourt les profondeurs de l’océan pour le cartographier et échanger avec la vie sauvage, et ce, sans aucune limite de temps ou d’ennemis à affronter. Dans cette étendue bleue, sans repères ni actions claires à effectuer, les joueurs habitués aux quêtes linéaires sont décontenancés. À nos collègues du média Archipel, Iida Kazutoshi déclare : « Être face à un jeu que l’on ne comprend pas, mais au final apprendre à se connaître en jouant, voilà le type de jeu contemplatif que je voulais faire. » Suivra en 1996, et toujours sur PS1, Tail of the Sun. Alors que les critiques avaient qualifié son premier jeu d’élégant et de minimal, le concepteur décide de prendre le contrepied et met en scène un homme des cavernes qui lutte pour sa survie. Là aussi, la variété des actions que peut effectuer le joueur prime sur une narration autoguidée. Enfin, c’est en 1999 que paraît Doshin the Giant, sur la console N64 de Nintendo. Le joueur y incarne Doshin, le Géant de l’Amour dont la taille varie en fonction de ses actions et de l’affection que lui portent les villageois qu’il protège. À l’occasion de notre rencontre, Iida pointe le trait commun de ces trois titres aux univers très différents :

Iida Kazutoshi, Doshin the Giant, croquis préparatoires, 1998. Avec l’aimable autorisation d’Iida Kazutoshi. © Iida Kazutoshi
« Je pense que les jeux vidéo sont l’art de l’élaboration des règles. Avec mes propositions, l’idée était de minimiser les restrictions ressenties par les joueurs. »
Et il est vrai qu’un vent de liberté souffle sur ses jeux. De manière indéniable, ils ont ouvert la voie à de nombreux jeux au succès incontestable, d’Animal Crossing à la quête en « monde ouvert » Breath of the Wild, récente variation de la licence Zelda. On peut également citer Death Stranding, création d’Hideo Kojima sortie en 2019 sur PS4, proposition hybride entre jeu expérimental et blockbuster au casting hollywoodien (Léa Seydoux, Norman Reedus, Mads Mikkelsen ou encore Guillermo del Toro incarnent les différents protagonistes). La complexité de son scénario est équilibrée par les actions limitées du héros, que l’on pourrait résumer, non sans malice, à une « randonnée musclée ». Que pense Iida de ces variations autour du concept d’exploration libre ? « Si Aquanaut’s Holiday explorait le point de vue à la première personne en nous mettant dans la peau d’un océanographe, Tail of the Sun est directement lié au monde ouvert tel qu’on l’entend aujourd’hui puisqu’il met en scène des personnages avec qui on peut réellement interagir. À l’époque, la notion de ‹ monde ouvert › n’existait pas mais j’étais convaincu que les jeux vidéo allaient évoluer dans cette direction. Depuis, de nombreuses œuvres sont apparues et ont confirmé mon intuition, je me sens rassuré ! »
Aujourd’hui enseignant dans le département vidéo de l’Université Ritsumeikan de Kyoto, Kazutoshi Iida partage sa connaissance du milieu du jeu vidéo. Dans son cours intitulé « Game Making Practice », il fait intervenir des professionnels du kamishibai, terme que l’on peut traduire par « pièce de théâtre sur papier », un style narratif japonais qui prend la forme d’une scène miniature et ambulante, proche du théâtre de Guignol, mais où les marionnettes sont remplacées par des images. Contrairement à la page tournée d’un livre, chaque nouvelle séquence du kamishibai apparaît en s’intégrant dans la précédente. On comprend aisément l’intérêt de ces techniques narratives rudimentaires mais ingénieuses dans la construction d’un récit. Iida demande ensuite à ses élèves de développer une histoire, de dessiner les images correspondantes, puis d’imaginer un contenu interactif. Il est également en charge d’un cours intitulé « Exercices de base du dessin ». Il y est question d’aiguiser son sens de l’observation afin de traduire au mieux les attitudes et expressions visuelles des différents composants d’un jeu, qu’il s’agisse des décors ou des personnages. Une fois ces éléments maîtrisés, que faut-il pour rendre une œuvre unique ? À cette question, Kazutoshi Iida développe :« Les jeux vidéo sont à la fois un art visuel et une expérience. Aujourd’hui, l’expérience est biaisée par le display, c’est à dire l’écran et les interfaces qui nous permettent de jouer. Je pense que les dix prochaines années vont vraiment être consacrées à repenser ces dispositifs. Récemment, de nombreux sujets importants ont fait leur apparition dans le jeu vidéo. Si le parallèle n’est pas évident, le titre Detroit: Become Human prédit l’intensification du mouvement Black Lives Matter. Red Dead Redemption 2 a pour personnage principal un hors la loi, en 1899, qui a conscience des règles morales et dont les actions, qu’elles soient bonnes ou mauvaises, ont un impact sur le déroulé du récit. The Last of Us 2 est un autre très bon exemple. En fusionnant de grands sujets sociétaux, quasi littéraires, aux interactions qu’offrent le médium du jeu vidéo, une nouvelle forme d’expression artistique est en train d’émerger. » Évidemment curieux, Iida aime autant jouer aux titres issus des premières générations de console qu’aux récentes grosses productions. À ceux qui n’ont pas la culture du jeu, il recommande ceux précédemment cités, mais également le très populaire Grand Theft Auto V (sorti en 2013 sur PS3 et Xbox 360) :



Extraits du jeu Doshin the Giant (Kyojin no Doshin), développé par Param et Nintendo, sorti au Japon le 1er décembre 1999. Designer : Kazutoshi Iida.
« Il est fantastique ! Dans ce jeu à monde ouvert, vous pouvez avoir le sentiment de devenir une ville plutôt qu’une personne, et c’est assez incroyable. » Devant les écrans, puisque tout est permis, évadons-nous !
TEXTE DE JUSTIN MORIN
Henky Dunky
Herr Seele
Fruit de l’imagination 100 % belge du duo Herr Seele et Kamagurka, Cowboy Henk est un personnage désarmant. Sa logique toute personnelle l’amène à vivre des aventures hilarantes, tenant autant de l’humour surréaliste que de la poésie absurde. Né il y a quarante ans, Henk affiche une silhouette musclée, une chevelure blonde ainsi qu’un sourire ultra-blanc mais déjoue tous les stéréotypes. En quelques cases, ses auteurs parviennent toujours à créer la surprise. Publiées sous forme d’album reliés, auréolées de plusieurs prix, les aventures de Cowboy Henk semblent pourtant réservées à un public d’initiés. Cette rencontre avec Herr Seele, dont les pinceaux donnent vie à Henk, permettra certainement de partager l’un des plus excitants secrets de la culture belge.
JUSTIN MORIN
J’ai découvert votre travail en 2014, grâce au prix du patrimoine que vous avez obtenu au prestigieux Festival d’Angoulême. J’ai été séduit par la couverture de vos albums, et à la lecture, j’ai aimé votre sens du découpage, les attitudes décalées de Cowboy Henk et bien évidemment, cet humour absurde. Il y a autre chose que j’ai adoré, et qui est pourtant presque invisible. Il s’agit du motif qui sépare la couverture de la première page, et qui reprend le profil de votre personnage en le multipliant à l’infini, dans une alternance de bleu et de rouge. On dirait une peinture d’art optique, un peu comme si Bridget Riley faisait un rêve psychédélique ! Je me demandais donc quel était votre rapport à l’art.
HERR SEELE
Ma mère a étudié la céramique et la peinture, c’était une artiste professionnelle. Enfant, j’allais dans son atelier, c’est un environnement avec lequel j’étais familier. J’ai fait des études à l’École des Beaux-Arts de Gand. C’était une pleine période conceptuelle, c’était pas mal ! Je me souviens que nous avions visité la Documenta 6, en 1977, où j’ai pu découvrir le travail de Joseph Beuys que j’ai trouvé génial. D’ailleurs, l’album qui s’intitule L’humour Vache a été traduit en allemand par Jeder Mensch ist ein Cowboy (Chaque homme est un cowboy), en référence à sa fameuse citation « Chaque homme est un artiste ! » J’adore son œuvre, c’est un grand penseur et je trouve qu’il y a aussi beaucoup d’humour dans son travail. Mais c’est certainement l’un des rares artistes conceptuels que j’apprécie vraiment. Je suis plus attiré par le surréalisme !
JUSTIN MORIN
Je crois que vous avez eu un parcours professionnel atypique.
HERR SEELE
Tout à fait. Comme je l’ai dit plus tôt, je ne me reconnaissais pas dans l’art conceptuel qui était en vogue à l’époque. Pour moi, c’est un courant qui consistait plus à réfléchir à l’art qu’à en faire. Dans cette optique, pendant mes études, j’ai eu envie de pratiquer un métier concret, comme menuisier ou boulanger. Et puis je suis tombé sur une annonce qui disait : « Devenez luthier au pays de Galles. » J’y suis allé ! C’était pendant l’été 1978, en pleine période punk anglaise, ça m’intéressait beaucoup. Mais la formation de luthier était déjà pleine, donc on m’a proposé de devenir accordeur de piano ! Le cursus était prêt, deux professeurs étaient venus spécialement de Londres, mais il n’y avait pas d’élève. Je suis devenu accordeur de piano, une profession absurde, par des circonstances encore plus absurdes ! Tout cela m’a amené à avoir une grande connaissance de cet instrument, je suis aujourd’hui organologue. Je suis aussi devenu collectionneur de piano, je possède plus de 250 pièces.
JUSTIN MORIN
Cowboy Henk va fêter ses quarante ans d’existence en septembre prochain. Comment expliquez-vous sa longévité ?
HERR SEELE
C’est presque autant que la longueur de vie de Tintin, qui fait son apparition à la fin des années 1920 et dont la dernière aventure, Tintin et les Picaros, date de 1976. Cowboy Henk a commencé comme une sorte d’anti-bande dessinée. Il a tout d’abord été publié en 1981 dans le journal néerlandophone Vooruit, devenu par la suite De Morgen. À partir de 1983, il a été publié chaque semaine dans l’hebdomadaire flamand Humo, jusqu’en 2011 car la rédaction voulait du changement. Mais deux ans plus tard, il a fait son retour !

Herr Seele, Cowboy Henk Nature.
Huile sur toile, 80 × 100 cm, 2015, propriété de l’artiste.

Publié dans l’hebdomadaire Humo — n˚3394, 20 septembre 2005.
Tout ça pour dire que c’était vraiment un humour particulier, comme un humour « pas drôle ». Au début, le public détestait notre travail mais ça ne nous a pas empêché de continuer. Je crois que c’est ce qui explique pourquoi Cowboy Henk est toujours là !
Nous avons aussi créé quelques histoires longues que l’on peut retrouver aujourd’hui sous forme d’albums. En France, à nos débuts, nous avons notamment collaboré avec le journal Hara-Kiri. Nous allions de Gand à Paris dans une petite voiture 2 CV que Kamagurka conduisait pendant que je jouais du violon ! C’était fascinant et excitant car cela nous a permis de côtoyer des auteurs que nous adorions, comme Wolinski ou Cabu, mais aussi les gens qui les entouraient, comme Serge Gainsbourg ou Coluche. Ces rencontres sortaient vraiment de l’ordinaire, j’ai eu beaucoup de chance. De la même manière que j’ai eu beaucoup de chance de rencontrer Kama.
JUSTIN MORIN
Justement, pouvez-vous revenir sur votre collaboration ?
HERR SEELE
Notre rencontre a quelque chose d’une aventure religieuse, un peu comme la vie de saint François d’Assise : tu rencontres quelqu’un et tu travailles toute ta vie avec ! Nous sommes un duo d’artistes, nous avons fait de la télévision, du théâtre, des bandes dessinées, de l’art aussi.Nous travaillons ensemble depuis plus de quarante ans, et je pense que cela s’explique en partie car nous n’avons jamais eu un énorme succès commercial. Nous avons toujours été dans l’underground, et nous aimons ça ! Nous nous sommes rencontrés pendant nos études. Il était dans la même école, dans le département animation, mais n’y est pas resté longtemps. C’est à la gare que nous avons sympathisé, car il lisait le journal Hara-Kiri justement ! Moi je lisais Kafka et Heidegger, car j’ai toujours aimé la philosophie. Nous avons échangé sur nos lectures.
Nous avons trois ans d’écart, et je me souviens que déjà à l’époque, nous racontions des petites histoires à l’aide des cabines photomaton de la gare et leur planche de quatre photographies !
JUSTIN MORIN
Comment travaillez-vous ensemble ?
HERR SEELE
Kama est à l’écriture et moi au dessin, mais tout se mélange.
JUSTIN MORIN
Pouvez-vous nous en dire plus sur votre manière de travailler ? Vos planches ont-elles la même dimension que vos albums reliés ?
HERR SEELE
Non, ce sont des formats plus grands. Je travaille sur des grandes pages de papier très épais. J’aime l’encre sur le papier. Je ne suis pas fort pour les techniques infographiques. Récemment, nos planches ont été recolorisées à l’ordinateur par Lison d’Andrea et Jean-Louis Capron qui ont fait un superbe travail. Mais pour nous, c’est la blague qui est plus importante que l’esthétisme. C’est sans doute pour cela que nous faisons cela depuis si longtemps et que nous n’avons toujours pas fini ! Nous aimerions aussi faire une nouvelle histoire longue. La difficulté que nous rencontrons, c’est que nous essayons d’être spirituels avec notre art tout en voulant faire rire les gens.
JUSTIN MORIN
Est ce qu’il y a des planches que vous décidez de ne pas publier parce que vous n’êtes pas satisfaits ?
HERR SEELE
Non, une fois que le scénario est fait, on va le faire et le publier. Il faut dès le départ que nous soyons persuadés que c’est une bonne blague, sinon, nous l’abandonnons !
JUSTIN MORIN
Sur quoi travaillez-vous en ce moment ?
HERR SEELE
Je suis actuellement dans mon atelier, à Ostende. De ma fenêtre, je peux presque voir la mer du Nord ! Je suis très inspiré par la nature, j’aime la peindre ! Pour en revenir à votre question, je suis en train de créer une affiche pour une exposition sur la bande dessinée et qui réunira plusieurs auteurs d’avril à septembre prochain et qui s’intitulera Marginalia, dans le secret des collections de bandes dessinées, au Nouveau Musée National de Monaco. Et puis j’ai un grand projet ici : je travaille à l’ouverture d’un musée qui présentera à la fois une partie de ma collection de pianos, notre travail avec Kamagura, et qui pourra aussi accueillir des expositions temporaires d’autres artistes ou collectionneurs. Il y a notamment des collections fantastiques et atypiques, sur des objets du quotidien comme des ciseaux, ou des papiers d’emballage de charcuterie des années 1950, que l’on ne voit jamais et qui sont pourtant incroyables !
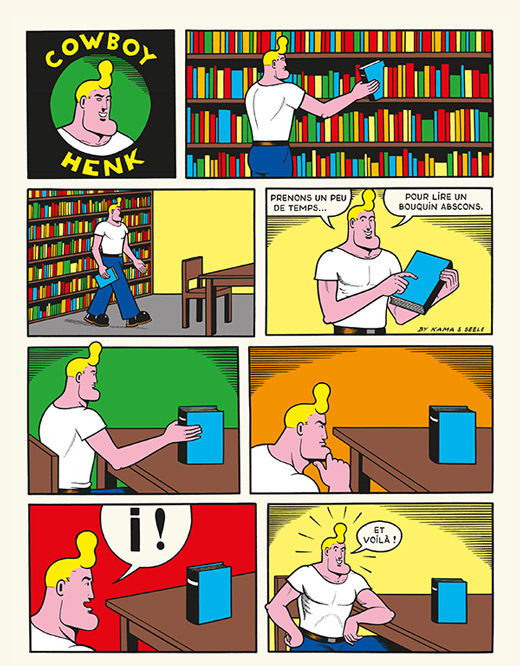
Publié dans l’hebdomadaire Humo — circa 1993.

Publié dans l’hebdomadaire Humo — n˚3901, 9 juin 2015.
EXPLORER REVUE
C.Q.F.D. de la texture
Luca MarchettiRyoko Sekiguchi
« Texture is the new colour » déclarait dans une interview récente le designer néozélandais David Scott. Et cela ne s’applique pas que dans le domaine du design. Un simple tour d’horizon, de l’univers gastronomique jusqu’à l’industrie cosmétique, révèle que les effets de texture sont en train de s’imposer dans l’imaginaire esthétique contemporain en tant que code de communication indispensable lorsqu’on souhaite véhiculer la notion d’intensité, voire de raffinement. Reste à comprendre ce qu’est la texture.
J’en ai discuté avec Ryoko Sekiguchi, auteure interculturelle et experte de gastronomie, lors d’un échange d’une après-midi, à l’intersection des cultures française, japonaise et italienne.
Comme nombre d’autres notions d’usage commun, celle de « texture » est aussi fréquente dans le langage quotidien que difficile à décrire. Si l’évocation de la texture nuageuse d’une génoise ou celle, moelleuse et fluide, de pommes mousseline, relèvent de l’évidence, il est moins évident de comprendre qu’il ne faut pas faire bouillir l’eau du thé car l’oxygène qui s’en échappe priverait l’infusion finale de la texture nécessaire à magnifier les arômes. Roland Barthes a écrit sur le « grain de la voix» (« Le grain de la voix », dans L’obvie et l’obtus. Essais critiques III, Paris, Seuil, 1982, p. 238-243) et – plus ardu encore – l’écrivain Alessandro Carrera a consacré tout un livre à la « consistance de la lumière » ( La Consistenza della Luce, Milan, Feltrinelli, 2010.) car, oui bien sûr, la lumière a elle aussi une texture, pour insaisissable qu’elle puisse paraître.
Les réflexions philosophiques de Gilles Deleuze nous viennent en aide. Dans le livre Le Pli – dont le sujet textile n’est pas sans lien avec la question de la texture – , l’auteur parle du réel comme de l’ensemble des différents degrés d’agrégation d’une même substance : du plus dense jusqu’au plus évanescent, des matières jusqu’aux idées. Pouvons-nous alors décrire la texture comme un état de consistance ? Certainement, mais sans oublier que pour la ressentir, il faut parfois la conscientiser et la soustraire au caractère ineffable des perceptions les plus subtiles (pour ne pas dire « sublimes »).
Ryoko Sekiguchi, qui présente son dernier opus Sentir (Avec Hervé Deschamps, Pierre Gagnaire et Marc Jeanson, Paris, JBE Books, 2021.) en quatrième de couverture par la phrase « goûter est un acte qui permet d’assimiler le monde extérieur dans notre corps », suggère que la texture est tout d’abord un fait d’assimilation. Pour la percevoir dans toutes ses manifestations, y incluant les plus extrêmes, il faut la reconnaitre, l’accueillir et la laisser agir en nous. Elle devient alors une forme de connaissance non-langagière à la croisée de nos cinq sens, de la corporéité et de l’esthétique particulière qui en découle.
Texture / Corps
L’expérience des textures est probablement celle qui, parmi toutes les autres, nous rend conscients de la désidérabilité d’un aliment, d’un produit, ou encore de notre propre corps. Car, la texture nous fait non seulement apprécier la corporéité du monde, mais elle nous indique également à quel degré celle-ci est souhaitable ou pas.
Curieusement, nombre de termes nés pour qualifier la texture s’appliquent autant à ce que l’on mange, ce que l’on touche ou ce que l’on ressent. Comme l’adjectif sòdo que l’on utilise en italien principalement pour qualifier la consistance de l’œuf cuit à point par ébullition. Bien qu’en français on traduise uovo sodo par « œuf dur », sòdo signifie justement « bien ferme », mais pas dur. Cet état idéal de l’œuf cuit se distingue par une consistance agréable à sentir en bouche et à palper. Non dépourvu de connotations charnelles et esthétiques, l’adjectif sòdo s’utilise aussi dans l’univers de la beauté pour décrire la consistance voluptueuse des rondeurs corporelles, l’épithélium du visage dans sa plénitude juvénile ou alors une peau mûre dont la tonicité reste intacte. D’ailleurs, à l’époque à laquelle bien vieillir est considéré plus cool que rajeunir, les produits cosmétiques qui promettent un effet rassodante (raffermissant) ne se comptent plus, toutes cultures confondues.
Texture / Promesse
Ayant consacré plusieurs écrits aux motifs du nuage et du fantôme entre culture visuelle et gastronomie, Ryoko Sekiguchi me rappelle que la texture de ce qu’on introduit dans notre corps, que cela soit par la peau ou par la bouche, est en soi une anticipation de son effet sur nous. Si en cuisine, la vision d’une gelée, puis le contact avec sa texture, agissent comme une promesse de jouissance gustative, en cosmétique le plaisir visuel et haptique qui accompagne la découverte d’un gel, agit comme une promesse de l’efficacité du produit. C’est si beau et si bon qu’il nous rendra beau. Aucun slogan ou métaphore textuelle ne saurait être aussi persuasif que l’association paradoxale entre la transparence, la légèreté, la fermeté et la densité que ce que la texture gélatineuse communique par simple incarnation.
Sekiguchi observe qu’en cuisine et en pâtisserie un tel effet de surprise se reproduit sur maintes préparations qu’on dirait réalisées en cristal teinté et qui procurent une sensation de solidité alors qu’on ne mange « presque rien ». Donner du corps, densifier, tout en gardant l’impression d’inconsistance, comme lorsqu’on goûte au tokoroten. Ce dessert venant du Japon est composé d’une gélatine fluide à base d’algues, fondamentalement sans saveur, mais essentielle en tant que support au glaçage. Ce dernier, fait de kinako, cette fine poudre de soja grillé, recouvre le gel qui n’aurait, à lui seul, aucune consistance. Pour le néophyte, savourer ce délice né d’une symbiose entre un corps presque sans saveur et une saveur presque sans corps, est une expérience en soi, tellement sa texture fluide et glissante exige une dextérité toute particulière !
Texture / Expérience
À ce propos, mon interlocutrice observe que dans la cuisine gastronomique dite « de luxe », plus encore que les ingrédients rares et précieux, c’est le fait de pouvoir goûter le bon aliment dans les bonnes proportions, à la température idéale et selon une temporalité exacte que l’on paie cher. C’est lorsque ces conditions sont réunies que la texture des mets rend pleinement disponibles leurs propriétés gustatives ; et cela ne dure qu’un temps très limité. La texture nous guide à travers l’expérience de la dégustation, comme lorsqu’on consomme cette autre invention nipponne qu’est le mochi, une pâte de riz cuit et battu à la consistance molle et légèrement élastique, qui se sert sucrée ou salée, fraîche ou chaude, sous forme de beignet ou en soupe. Manger le mochi c’est faire l’expérience de la métamorphose, car cet aliment se transforme sous nos dents, au contact du palais et selon l’action plus ou moins rapide de la langue, en passant graduellement d’un état de fluidité extrêmement malléable à quelque chose de beaucoup plus gluant et dense. C’est sa texture qui module la dégustation. Elle fixe aussi, quelques instants durant, l’état idéal de ce mets, quand sa température, sa consistance et sa couleur atteignent l’effet mochi-mochi. Une fois de plus, voici une expression aux connotations aussi sensorielles qu’esthétiques qui s’emploie fréquemment dans le vocabulaire de la beauté et de la cosmétique pour qualifier une peau aussi claire, translucide et douce que celle d’un bébé.
À bien y réfléchir, si dans le cas du design on a longtemps proclamé que function follows form (la fonction découle de la forme), dans notre cas il y a de quoi penser que l’expérience découle de la texture. D’autant plus que cette exploration avec Ryoko Sekiguchi a commencé autour d’une table sur laquelle étaient posés deux cafés et quelques gâteaux sablés. Et que cet effet de texture – sablée – a été le déclencheur du débat en commençant par les termes qui se réfèrent à la texture issus de l’imaginaire marin qui, le plus souvent, décrivent un « entre deux ». C’est également le cas dans la langue italienne. En pâtisserie, le terme « sablé » est utilisé en français, mais plus généralement, sa variante en langue locale fròllo indique un état hybride entre le consistant et le friable, et évoque une consistance granuleuse et humide, facile à émietter. La pâtisserie italienne offre tout un florilège de préparations à base de pasta fròlla, mais l’aspect le plus intrigant de ce terme dérive de sa forme originale, restée indéterminée. Peut-être marine (il s’agirait d’une évolution du terme fluidus), ou plus probablement terrestre (à partir du terme frale, “fragile”), mais qui se réfère aussi bien à la viande, tendre et fondante, qu’à la chair dans ses connotations les plus sensuelles.
Que la vue de la carne frolla puisse donner simultanément envie de toucher et de manger fait sourire, mais cela nous rappelle surtout que la texture est l’une de ces interfaces essentielles entre nous et le monde qui réunissent « langage » et « sensorium » dans un tout, et qui nous permettent de connaître sans dire, par la forme de rencontre la plus simple et immédiate qui soit : le contact.







Photographe: Marvin Leuvrey
Décoratrice: Chloé Guerbois
Styliste culinaire: Anna Dotigny
En rose et noir
Daniel Roseberry
Nommé à la direction artistique de Schiaparelli en 2019, l’américain Daniel Roseberry a réveillé la belle endormie en quelques collections. Fidèle au surréalisme de la Maison, ses créations conjuguent avec brio l’extravagance à un sens rigoureux de la coupe. Les bijoux sculpturaux complètent des silhouettes audacieuses, sans pour autant tomber dans l’excès. Si les images sont fortes, les vêtements le sont tout autant et se mettent au service d’une femme plurielle. Rencontre avec un créateur à l’univers enchanteur.
Justin Morin
Vous êtes diplômé du Fashion Institute of Technology de New York et avez passé votre enfance au Texas. Quel était alors votre relation avec l’art et la mode ?
Daniel Roseberry
J’ai grandi en étant obsédé par Disney. Pendant des années, j’ai souhaité travailler dans l’animation. Je me souviens avoir réalisé un projet entier et l’avoir envoyé à Glen Keane, l’un de mes animateurs préférés qui a notamment travaillé sur La Belle et la Bête, Pocahontas et bien d’autres. Grâce à ce dossier, ma famille et moi avons été invités à nous rendre aux studios Disney pour une visite privée !
Justin Morin
Quel âge aviez-vous ?
Daniel Roseberry
J’avais douze ans ! Je crois que j’avais treize ans quand j’ai commencé à dessiner de la mode. Je me souviens du mariage de mon frère ; lorsque j’ai vu la robe de mariage de ma belle-sœur, j’ai été si inspiré. Plus tard, à mes seize ans, ma mère m’a inscrit à un cours de dessin vivant. J’ai toujours été fasciné par l’anatomie. Depuis, dessiner a toujours été ma manière de faire passer mes idées.
Justin Morin
Par de nombreux aspects, votre travail est sculptural. Comment passez-vous de la planéité du dessin aux volumes de vos créations ?
Daniel Roseberry
J’ai commencé à mélanger mes dessins à des collages digitaux. J’en suis arrivé à inventer cette technique alors que je cherchais à faire mes croquis sur ordinateur. Mais en réalité, le dessin n’est qu’une manière de lancer le processus de création. À partir du moment où nous commençons à travailler physiquement avec mon équipe, tout peut changer.
Il y a dix ans, j’étais vraiment appliqué dans la réalisation de mes dessins, je cherchais à rendre au mieux les lignes et les silhouettes. Aujourd’hui, il s’agit plutôt de définir le volume global. Je trouve ça intéressant car le travail du flou est vraiment quelque chose qui se met en place lors des sessions de travail avec l’atelier. Le tailoring est quelque chose qui se traduit plus facilement par le dessin. Les deux approches se complètent.
Justin Morin
Comment approchez-vous la matérialité de vos créations ?
Daniel Roseberry
J’ai travaillé pendant onze ans aux côtés de Thom Browne. Nous étions très limités en termes de silhouettes, ce qui fait que créativement, les tissus étaient très importants. Presque chaque tissu, qu’il s’agisse d’un tweed ou d’un jacquard, provenait d’un nouveau développement. Ici, c’est l’opposé ! Je préfère avoir un choix limité de tissus que j’affectionne et ne pas avoir à y penser constamment. Il y a probablement une quinzaine d’étoffes sur lesquelles je reviens tout le temps. Mais j’aime les extrêmes ! Si c’est un taffetas, je veux qu’il soit le plus léger,le plus sec et craquant que l’on puisse trouver. Je crois que j’ai une sensibilité américaine par rapport aux tissus. Je ne fais jamais de nettoyage à sec. Je porte du denim presque quotidiennement. J’aime que la soie lavée soit aussi douce et confortable que du coton. Il n’y a pas de préciosité, on peut voyager avec ces vêtements, ils sont faciles à vivre. Pour moi, le luxe est de ne pas avoir à s’inquiéter de ce genre de chose.
Justin Morin
Parlons de l’essence de votre travail chez Schiaparelli. L’héritage de la maison est spectaculaire et pourtant, vous avez réussi à proposer votre propre interprétation. A-t-il été difficile de concilier cet imposant passé avec le futur que vous développez ?
Daniel Roseberry
Je crois que la réponse courte serait non ! Je n’ai jamais été obsédé par l’histoire de la maison. J’ai un immense respect pour elle, mais je veux aussi en être détaché. Il y a cet aller-retour constant entre cette envie de se sentir libre et la volonté d’être créatif pour soi, et je crois que c’est ce qu’Elsa Schiaparelli souhaiterait d’un directeur artistique aujourd’hui. En même temps, on ne peut pas échapper à la beauté de cette maison. Schiaparelli n’est pas une machine industrielle, ce n’est pas un poids lourd du luxe. Et je pense que cela correspond bien à la conception d’Elsa. Donc pour moi, c’est vraiment agréable de travailler dans ces conditions et de pouvoir créer ces vêtements.
Justin Morin
Certaines de vos créations transforment le corps, qu’il s’agisse d’effets de trompe-l’œil ou d’anatomie redessinée. Il y a un aspect performatif qui se dégage de votre proposition. Pour la collection couture du printemps 2021, vous avez notamment réalisé un très beau bustier en cuir qui révèle la structure du corps, jouant à la fois sur son aspect féminin et sa musculature, produisant un saisissant contraste. Est-ce que le genre a un rôle important dans votre démarche ?
Daniel Roseberry
Certainement. Je viens d’un milieu où le genre et la sexualité n’ont jamais été discutés pendant mon enfance et adolescence. Ces discussions n’ont jamais eu lieu.
Justin Morin
Vous venez d’une famille très religieuse n’est-ce pas ?
Daniel Roseberry
Tout à fait. Mais même chez Thom Browne, je n’avais pas la liberté de montrer le corps de la manière dont je le souhaitais. Je crois que c’est pour cela que j’ai aujourd’hui une vraie excitation à explorer ce territoire avec un regard presque enfantin, joyeux. Revoir nos idées et jugements à propos du corps. C’est ce que j’aime dans le travail d’Elsa Schiaparelli : ce qu’elle faisait n’était ni macabre ni lourd.
C’était curieux et léger, et j’adore cette approche. Je déteste le cynisme. Je cherche à m’amuser avec tous ces critères. Il s’agit moins de faire une déclaration politique que de poser des questions.
Justin Morin
Comment avez-vous développé cette collection ?
Daniel Roseberry
Nous l’avons réduite à cinq grandes idées, comme « silhouette colonne » ou « stretch couture » et travaillé l’abstraction. Mais à y bien réfléchir, j’ai travaillé dans une grande solitude. Je n’ai pas vraiment de vie sociale à Paris !
Justin Morin
À cause de la pandémie ou de la barrière de la langue française ?
Daniel Roseberry
C’est une combinaison vicieuse des deux ! Mais ça n’est pas une mauvaise chose. Ça m’a permis de me concentrer sur ce qu’est le langage de la marque. La couture a développé ce rapport fantasmé au réel où le baroque, les proportions, les broderies sont poussés au maximum.
Justin Morin
À ce propos, vous avez introduit le prêt-à-porter chez Schiaparelli. Était-ce votre idée ou un désir dicté par vos supérieurs ?
Daniel Roseberry
Dès le départ, c’était un but commun. Nous n’étions pas forcément d’accord sur ce à quoi il devait ressembler. Mais les retours sur la couture ont été si incroyablement positifs que j’ai envisagé le prêt-à-porter comme une réponse. Je ne voulais surtout pas qu’on le considère comme la petite sœur moins belle ! Il s’agissait de faire une ligne tout autant intense, mais de parler du réel plutôt que de l’imaginaire.
Justin Morin
Puisque nous parlons de l’imaginaire, je me demandais où vous puisez votre inspiration ?
Daniel Roseberry
Pour être honnête, je n’ai jamais été une personne qui se rend dans les galeries ou les musées pour trouver l’inspiration. Je ne fonctionne pas comme ça. Je ne suis pas non plus quelqu’un qui cherche dans le cinéma. Pour moi, tout se passe quand je m’assois et que je dessine en écoutant de la musique.
Justin Morin
Est-ce que vous êtes du genre à écouter le même album en boucle ou plutôt à découvrir de nouveaux musiciens ?
Daniel Roseberry
Je me fais des playlists ! C’est marrant parce que ces derniers temps, et c’est évidemment lié à la pandémie, je cherche le réconfort. Ça se traduit notamment par le fait d’écouter la musique avec laquelle j’ai grandi. Je roulais jusqu’à l’école en écoutant les Dixie Chicks – ce qui n’est vraiment pas une réponse cool ! Je regarde de nouveau la série Frasier ! Je recherche des choses réconfortantes…
Justin Morin
Mais donc, qu’est-ce qui vous inspire ?
Daniel Roseberry
Je suis vraiment inspiré par la relation qu’entretient un performer avec son public.
Justin Morin
Est-ce que vous parlez de performance musicale ou artistique ?
Daniel Roseberry
Tout type de performance. Je ressens vraiment cet échange d’énergie que je trouve fascinant. Lors de ma première présentation pour Schiaparelli, j’étais sur scène, en train de dessiner, alors que les mannequins défilaient autour de moi. J’étais très à l’aise dans cette position. Comme vous le disiez, il y a une dimension performative dans mon approche, et c’est ce que je trouve particulièrement motivant. J’aime que mes pièces soient des véhicules pour se mettre en scène, mais qu’elles portent aussi en elles une qualité « intime » qui fait qu’on peut se les approprier.
Corps à cœur
Regina DeminaFrançois Chaignaud
Naviguant entre plusieurs champs artistiques, au croisement de la danse, du chant et de la performance, les pratiques de François Chaignaud et de Regina Demina hybrident joyeusement les formes pour mieux faire valser les étiquettes. Habitué des collaborations, interprète caméléon, le chorégraphe François Chaignaud se réinvente à chaque nouvelle proposition en puisant dans l’Histoire, qu’il s’agisse de celle de la danse, de la musique ou du féminisme. Regina Demina dessine quant à elle une mythologie personnelle, déployant ses récits à travers des vidéos, des installations et la scène, dans un captivant jeu de miroirs où tout semble se répondre. Pour Revue, les deux artistes reviennent sur leurs parcours et leur conception du beau.
Regina Demina
Je t’ai vu pour la première fois dans Radio Vinci Park, ta collaboration avec l’artiste Théo Mercier. Ce spectacle m’avait subjuguée. Ce que tu es capable de faire, ce que tu dégages, ça m’a vraiment marquée. Un peu plus tard, je t’ai revu sur la scène du Cabaret de Madame Arthur, et là aussi, j’ai été impressionnée par ta présence scénique.Je n’ai pas fait le rapprochement immédiatement tant les deux personnages que tu incarnais étaient différents. Ça n’est qu’après que j’ai compris que c’était la même personne qui m’avait procuré toutes ces émotions !
François Chaignaud
Je crois que nous avons échangé pour la première fois à l’occasion du spectacle d’Aymeric Bergada, chez Madame Arthur, où tu avais un rôle de policière ! On s’est ensuite écrit sur les réseaux sociaux ce qui m’a permis de découvrir ton travail musical, même si je n’ai jamais eu le plaisir de te voir en live. Ça nous a amené à discuter sur la méditation, une pratique qui peut sembler éloignée des contextes très extravertis dans lesquels on s’est rencontrées !
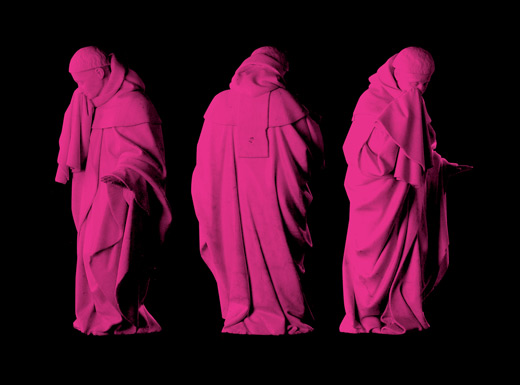
Sophie Jugie, The Mourners: Tomb Sculpture from the Court of Burgundy, Yale University Press, FRAME, Musée des Beaux-Arts de Dijon, 2010. Photographies de François Jay.
Ça m’a amusé de pressentir qu’on partageait ce goût à la fois pour ce qui scintille et ce qui discipline, ce qui élève et ce qui maquille !
Il n’y a d’ailleurs pas nécessairement d’opposition entre ces mondes, entre ces intentions : il s’agit toujours d’explorer, de dévoiler différentes dimensions, différentes versions de soi ! Je crois que tu fais beaucoup de yoga aussi, n’est-ce pas ?
Regina Demina
Oui. Et de la méditation alliée au chant. Parfois je chante en méditant et d’autres fois je médite en écoutant des chants. Même si ça peut paraître ridicule, le principe d’alignement des chakras fonctionne très bien pour moi ! Je suis quelqu’un d’assez dispersé, et dès que je visualise ces formes symboliques, ça m’aide à me concentrer et à m’apaiser !
François Chaignaud
Es-tu nerveuse avant de monter sur scène ?
Regina Demina
Juste avant, oui. Mais je suis nerveuse de nature ! Je sais que le temps de préparation est important, mais il ne faut pas qu’il soit trop long car plus j’attends, et plus je suis impatiente. J’ai juste envie d’être sur scène. Et toi?
François Chaignaud
Je ressens de la nervosité surtout avant d’entrer en répétition ou en création : le moment de fabrication, avant qu’un spectacle n’existe, est la phase la plus déstabilisante, un miroitement inconfortable. Mais avant d’entrer en scène et surtout si c’est un spectacle déjà créé et joué, je ne me sens pas nerveuse, plutôt concentré et éparpillée à la fois, excité aussi car c’est en jouant, en étant sur scène que mon art s’active, s’accomplit. Je me sens comme avant un date avec un.e amant.e que je connais : il y a de l’inconnu, et de la promesse, du focus et de la légèreté, la visualisation d’un script détaillé et l’ouverture à ce qui peut arriver !
Regina Demina
Je comprends ! J’aime les formes perfectibles car elles me rassurent, elles permettent de se rôder tout en laissant une place à l’improvisation, une liberté de se réinventer sans tomber dans quelque chose de mécanique. Moi je viens de la performance. J’ai commencé par faire une école de théâtre et de danse et pour me payer cette formation, je travaillais en tant que go-go. Même si ça n’est pas un public classique, ça reste une audience qu’il faut appréhender. J’ai ensuite été acceptée au Fresnoy, une École Nationale qui est axée sur la production audiovisuelle et numérique. Et toi, quelle a été ta formation ?
François Chaignaud
Pour moi, c’est un peu différent car j’ai eu un parcours très académique. J’ai commencé la danse à l’âge de sept ans au Conservatoire à Rennes. À quatorze ans, je suis monté à Paris au Conservatoire supérieur et j’en suis sorti alors que j’avais à peine vingt ans. J’ai tout de suite travaillé avec les chorégraphes de la génération 2000, comme Alain Buffard, Boris Charmatz, Emmanuelle Huynh ou encore Gilles Jobin. Ma pratique a été sculptée par cet aspect à la fois académique et institutionnel qui est lié à la façon dont la danse « professionnelle » s’est structurée historiquement en France. J’ai vite eu conscience qu’accéder à ces lieux (conservatoire, centres chorégraphiques, institutions) est une sorte de privilège : ce sont des studios, des moyens, de la visibilité. Mais qu’il y a aussi le risque de se laisser aveugler par ces contextes, d’oublier qu’il existe plein d’autres manières et de raisons de danser ou de faire de l’art qui n’ont rien à voir avec les conservatoires et les scènes nationales ! Je trouve très important d’essayer de se connecter à d’autres motivations qui peuvent passer par des aspects différents, des motivations plus spirituelles, plus festives, plus rituelles ou plus intimes. Tu parlais de go-go ; à l’époque, quand j’ai commencé à travailler avec Cecilia Bengolea, elle faisait beaucoup de strip-tease et moi un peu d’escorting. Ça me paraissait très important de retisser les proximités entre la danse, la mise en scène de soi et le travail du sexe ! J’aime beaucoup confronter mes pratiques à d’autres types d’expressions, qui ne sont pas issues du monde un peu spéculatif de la danse contemporaine ! En ce moment, je suis très attirée par la collision entre des motifs très réels, très performatifs et des langages, des références, des évocations issues d’archives très anciennes, du haut moyen âge !
Et toi, tu reviens de Poitiers je crois. Qu’est-ce que tu y présentais ?
Regina Demina
C’est à la fois une exposition personnelle et un spectacle qui ont lieu au centre d’art le Confort Moderne. Dans ma pratique, tout est lié. Mes installations ou mes sculptures sont souvent des traces de performance ou de scénographie. Le projet s’intitule CRAUSH, c’est la contraction des mots « Crush » et « Crash ». J’y développe sous une nouvelle forme Alma et Crush for Crash, deux pièces existantes, ainsi que Phaeton, en les liant par le film et l’installation ASMR-Sick of Love et Rdoll-AsMR. Tout se complète, il y a des allers-retours entre les formes et les propositions. Pour résumer ce projet, je dirais qu’il s’agit d’un cycle de pièces qui questionne l’origine de la violence.
François Chaignaud
Est-ce que la matière sonore de ces pièces va devenir un album ?
Regina Demina
L’album que j’ai sorti en juin 2020 est né de cette manière. C’est un mélange de morceaux que j’avais réalisés pour différentes pièces et qui ont été retravaillés. Je pense que je procéderai différemment pour le prochain, sur lequel je réfléchis déjà. Il y aura certainement un ou deux titres qui arriveront avant, en introduction.
REVUE
Quelles images sont pour vous synonymes de beauté ?
François Chaignaud
Ah ah ! C’est une question piège, non ? Évidemment il n’y a pas d’art qui ne problématise pas cette notion de beauté ! Et la danse moderne puis contemporaine a beaucoup mis en crise cet aspect décoratif, ornemental, superficiel… Pourtant avec cette période de théâtres fermés, et de débat sur l’art essentiel, je rêve de plonger profondément dans l’ornementation, comme promesse d’une abstraction et d’un au-delà ! J’adore ce mot « ornementation » qui évoque d’ailleurs la souveraineté de l’interprète dans la musique baroque ou jazz. Je pense aussi aux phrasés : quel que soit le geste, le phrasé rééquilibre la tension entre maîtrise et abandon, et peut produire une forme de beauté, quelle que soit la forme !
Regina Demina
Ça serait des gestes qui ont une grâce.
François Chaignaud
Oui, à propos de grâce, j’ai récemment commandé plein de livres sur les pleurants des tombeaux des ducs de Bourgogne – un ensemble de statuettes réalisées au cours du XVe siècle. On y voit des pleurants tout petits, dans toutes sortes d’attitudes de déploration, avec des drapés de marbre, des grosses ceintures, des accessoires magnifiques. Il y a de très beaux gestes, comme la manière de détourner les yeux ou d’épauler la tête. Je regarde aussi beaucoup les représentations des résurrections de Lazare, j’aime scruter les personnages qui se pincent le nez.
Regina Demina
Pourquoi se pincent-ils ?
François Chaignaud
Car Lazare ressuscite et pue ! J’adore cette présence organique de la charogne, de la puanteur dans ces images de grande beauté !
Regina Demina
Je pense qu’on se rejoint car je suis très attirée par le romantisme morbide.
Je suis touchée par une forme de beauté souffrante. Je pense que c’est lié à mon enfance. Je suis russe, fille d’immigrés, j’ai grandi en banlieue. Si ce terme ne dit pas grand-chose, je me retrouve malgré tout dans ce que l’on appelle le « white trash », même si c’est souvent décrit comme une esthétique du moche. J’aime les choses que l’on qualifie de mauvais goût.
Pour autant, j’aime la joliesse pour la joliesse. J’aime par exemple les photographies de Guy Bourdin, où les femmes sont comme des sublimes poupées. Quand je suis émue ou troublée par quelque chose, c’est souvent parce que je trouve ça beau.
François Chaignaud
Ce qui me plaît dans la danse, c’est lorsque l’on peut produire une image de grâce tout en ne masquant pas l’effort qui est nécessaire à sa construction. J’aime beaucoup ce type de beauté où l’effort nécessaire à son avènement est aussi partagé.
Regina Demina
Je suis d’accord.
François Chaignaud
Dans Radio Vinci Park, il y a plein de moments où, quand je suis à bout de souffle, je laisse ce temps exister. Je ne masque pas la difficulté. Je me sens moins proche de l’idéal classique – ou capitaliste on pourrait dire – de la facilité, de la fluidité : comme lorsqu’on achète un iPhone, on ne voit pas la fabrication, efforts et injustices… beaucoup de formes d’art plus classiques gomment le labeur, la difficulté : il faut que les choses aient l’air faciles, effortless… Ne pas masquer l’effort, c’est ouvrir la promesse de plus d’empathie avec le public…
Sinon y a-t-il des artistes avec qui tu aimerais collaborer ?
Regina Demina
Ma liste est loin d’être exhaustive mais en chorégraphe, je suis admirative de Gisele Vienne qui a une approche totale. J’adorerais aussi rencontrer Kim Petras et faire de la musique avec elle ! Je suis fan également du cinéma d’Abel Ferrara et de celui de Dario Argento. Côté musique, j’aime les artistes du label PC Music, comme Hannah Diamond. Et toi ?
François Chaignaud
En t’entendant, je réalise que si la collaboration est au cœur de ma pratique, elle ne naît jamais d’un désir strictement personnel, mais d’une rencontre. Mais j’admire cette démarche qui est d’aller chercher les gens ! J’adore la danse et le spectacle vivant, qui sont des pratiques de la consumation, mais j’ai souvent aussi le rêve de tresser mon art à des médiums moins fugaces ! D’ailleurs cet été, j’ai enregistré la musique de mes deux derniers spectacles pour en sortir des disques ! Mais ce sont des musiques très anciennes, médiévales ou baroques ! J’ai aimé cette dynamique de l’enregistrement, comme j’aime celle du film. Je vais bientôt tourner pour la réalisatrice Marie Losier, et c’est aussi quelque chose qui m’excite. J’ai envie de faire plus d’images, de cinéma, de films. Pour en revenir au son, je trouve génial la manière dont tu articules ton travail de performance avec la musique.
Regina Demina
Tu sais, je t’ai entendu chanter une version de « Mwaka Moon », le titre de Kalash avec Damso, et il faudrait que tu l’enregistres car je l’ai adorée, j’en parlais encore récemment ! Elle est mieux que l’originale !
François Chaignaud
Pourquoi pas ! J’adorerais faire une chanson pop, mais pas forcément une reprise.
J’ai toujours utilisé la musique dans un rapport historique, pour véhiculer quelque chose de fantomatique. J’ai hâte d’écrire mes propres musiques, je sens que c’est sur le bout de ma langue !
Enfant, j’écrivais beaucoup ! J’ai écrit et enregistré cinq albums!
Regina Demina
Comment ça?
François Chaignaud
J’avais un petit synthétiseur, je faisais la voix principale et les chœurs, j’enregistrais sur cassette !
Regina Demina
Ça serait bien de faire quelque chose avec si tu les as encore !
François Chaignaud
Ça sonnait un peu comme… du J. LO champenois !
Regina Demina
Mais c’est fantastique, tu attises ma curiosité, j’ai envie d’entendre ces anciens morceaux… et ceux à venir !
Abramascara
Ines Alpha
Des tentacules irisés, des perles évanescentes, un lierre serti de fleurs colorées… Ces éléments incongrus, un brin féériques, l’artiste Ines Alpha les emploie pour proposer un maquillage digital. Elle sculpte une parure en mouvement qui apparaît, transforme le visage et disparaît en un clic. Pionnière, elle a inventé un langage visuel qui bouleverse les codes de la beauté traditionnelle. Grâce à la technologie, elle offre la possibilité de se voir différemment. L’expérience qu’elle propose ne se contente pas d’embellir, mais de questionner les frontières qui séparent sublime et laid, réel et virtuel, identité et représentation. Et ce, tout en gardant la légèreté et l’enchantement propre à l’art du maquillage.
Justin Morin
Votre pratique mélange plusieurs notions qui semblent de prime abord incompatibles, comme le réel et le virtuel, le maquillage et les nouvelles technologies. Votre univers brasse des références très variées, qui vont du monde végétal à l’esthétique kawaii, en passant par le jeu vidéo. D’où vous vient cette envie d’hybride ?
Ines Alpha
J’ai fait une école d’arts appliqués à Paris qui a malheureusement fermé depuis. C’était initialement une école de marionnettes ! Pendant ces années d’étude, je me suis initiée au cinéma d’animation en stop motion, j’étais inspirée par les films de Tim Burton. C’était un enseignement diversifié qui m’a permis de toucher à la scénographie, au web, aux arts plastiques. Je ne me trouvais pas très bonne en dessin. À la fin de mes études, j’ai eu la chance de faire un stage chez Olivier Kuntzel et Florence Deygas où j’ai énormément appris. Mon travail consistait de faire vivre Cap et Pep, les deux chiens qu’ils avaient créé pour le concept store Colette. Je faisais des petits collages de ces mascottes pour des magazines. J’ai ensuite intégré l’Institut Français de la Mode en management. Je ne me considérais pas comme une artiste, je ne me sentais pas assez créative. Le management me semblait être une manière de travailler avec ces personnes créatives. Quant à la mode, c’est un milieu qui m’a toujours attirée. J’ai ensuite accepté un stage dans une agence de publicité où j’ai travaillé pendant sept ans en tant que directrice artistique, puis directrice de création. La publicité reste un milieu où les inégalités persistent entre les hommes et les femmes. J’avais un look particulier, je portais des couleurs pastel et me maquillais, et cela suffisait pour recevoir un regard condescendant. À certaines réunions, on s’adressait au garçon à mes côtés alors que j’étais sa supérieure. Cette attitude, ces petites remarques, touchent aussi bien les hommes que les femmes, ce qui prouve bien qu’il y a encore un gros travail d’éducation à faire.
Justin Morin
Sur quel type de projets travailliez-vous alors ?
Ines Alpha
Un peu de tout : Maison Margiela Parfum, le champagne Piper Heidsick… J’ai également travaillé sur des campagnes de maquillage ou de crème de soin, notamment pour Nocibé ou Lierac. Même si l’image de ces marques n’est pas prestigieuse, j’ai aimé ces projets. J’ai grandi avec une obsession pour le beau qui est passée par le maquillage. Je suis obsédée par la peau, par ses grains. J’aime la beauté totale, celle qui se dessine selon les canons. Mais à force d’être abreuvée de toutes ces mêmes images parfaites, j’avais aussi envie de montrer une beauté différente. Les imperfections peuvent être belles ! Les pores de la peau, les textures, une cicatrice… Je suis fascinée par tout cela. Il faut assumer ces détails.
Justin Morin
Est-ce que le maquillage a toujours fait partie de votre quotidien ?
Ines Alpha
Comme toutes les adolescentes, j’ai mis le khôl noir de ma mère ! J’ai ensuite essayé de mettre des couleurs, mais à l’époque, il n’y avait pas tant de marques qui proposaient ce genre de choses en France, hormis Bourjois. J’adorais leurs couleurs aux touches iridescentes, proche de l’holographie. À la vingtaine, alors étudiante, je me suis retrouvée avec des personnes très différentes, aux personnalités et aux looks différents, et cela m’a permis de m’affirmer avec un maquillage moins classique.



© INES ALPHA
Justin Morin
Quand avez-vous commencé à vous exprimer à travers vos projets personnels ?
Ines Alpha
Alors que je travaillais toujours en agence, j’ai rencontré le musicien Panteros666. Nous avons commencé à collaborer, que ce soit pour ses clips, ses concerts ou sa communication. C’est une rencontre très importante pour moi car il m’a poussée à m’exprimer, il a réveillé en moi cette envie de faire des choses plus artistiques et personnelles. Moi qui pensais ne pas être créative, j’ai réalisé que j’avais besoin de mener mes propres projets. C’est à ce moment-là que j’ai commencé à toucher à la 3D, ce qui coïncidait également avec le moment où les programmes devenaient plus accessibles. Je me suis initiée au logiciel Cinema 4D, que j’utilise aujourd’hui encore. Sur Instagram, j’ai découvert des artistes comme Vince Mckelvie dont le travail me fascine. Très rapidement, j’ai compris que ce qui m’intéressait, c’était d’ajouter à notre réalité des éléments en trois dimensions. J’ai commencé par les superposer sur des images de paysage.
Justin Morin
Comment êtes-vous arrivée à cette idée du maquillage virtuel ?
Ines Alpha
Un peu par accident ! J’avais une collection de photographies « beauté » qui me servaient pour mon travail en agence. Je les utilisais pour des collages, pour tester des éléments de composition, j’y ajoutais des couleurs. Puisque je travaillais tous les jours sur ces visages, je me suis naturellement demandé ce que pourrait être du maquillage en trois dimensions ! Mes premiers essais datent de 2016. J’ai expérimenté l’image en mouvement à partir de mon propre visage, je me suis formée à partir de tutoriels partagés sur Internet, en détournant certaines explications et en les appliquant à mes idées. Il n’y avait pas encore d’application pour «tracker» le visage, alors que c’est aujourd’hui quelque chose de plus commun. Mais très rapidement, puisque je testais tout ça sur mon propre visage, j’ai eu la sensation de tourner en rond. C’est comme ça que j’ai commencé à collaborer avec des make-up artists, des drag-queens, des musiciens, des peintres…
Justin Morin
Vous avez été la première à imaginer ce « selfie du futur ».
Ines Alpha
Certaines personnes pensent que mon travail consiste à faire des filtres, et ça n’est pas tout à fait ça. Je réalise du maquillage 3D. La plupart du temps, c’est fait en postproduction. Les avancées technologiques font que nous pouvons aujourd’hui faire des filtres qui supportent le temps réel. Certes, les détails ne sont pas aussi développés, c’est une version moins pointue, mais l’écart se réduit. La réalité augmentée m’a permis d’adapter mon travail et de le mettre à disposition du plus grand nombre. Quand les filtres sont apparus sur Instagram, ils étaient très limités et peu nombreux. C’est intéressant de voir la rapidité avec laquelle ils se sont multipliés et complexifiés.
Justin Morin
Que pensez-vous de cette nouvelle génération de performers qui utilisent le maquillage de manière atypique ?
Ines Alpha
C’est extrêmement inspirant. Des personnes comme Hungry transforment littéralement leur visage. Ils utilisent du maquillage, mais aussi des lentilles, des prothèses, des bijoux, pour se transformer. C’est une vision différente de la beauté que celle que nous voyons dans les magazines traditionnels, ou même au cinéma. Je suis dans le même courant, mais contrairement à ces artistes, je n’utilise pas de poudre, de rouge à lèvres ou de peinture, mais la 3D ! Aujourd’hui, je suis obligée de passer par un logiciel, mais prochainement, nous n’aurons qu’à utiliser nos doigts sur un écran pour maquiller virtuellement nos visages. En 2020, j’ai fait un projet, intitulé Supermorphia, en collaboration avec l’artiste Marpi et Eliza Struthers Jobin sur ce même principe. À travers un écran, les gens pouvaient s’appliquer trois types de textures : une espèce de liane en fleurs, des bulles ou des cristaux. Pour moi, c’est ça le maquillage du futur : un design interactif, qui n’est pas statique mais mouvant, et aussi facile à appliquer qu’un geste sur un écran tactile.
Justin Morin
C’est une idée qui n’a jamais autant semblé d’actualité, puisque nous passons tous beaucoup de temps derrière nos écrans à enchaîner des rendez-vous sans vraiment pouvoir sortir… La réunion digitale s’infiltre peu à peu dans notre quotidien. Est-ce que vous voyez une tendance émerger ?
Ines Alpha
Les gens n’osent pas encore. Nous ne sommes pas encore dans un monde où tout le monde assume son alter ego digital. Si je m’applique un filtre lors d’une réunion digitale, la réaction sera plutôt de l’ordre du rire ou de la gêne. C’est encore un acte qui semble anecdotique, voire décrédibilisant, et bien évidemment, ça n’est pas comme ça que je conçois les choses. Mais tout cela évolue très vite.
Justin Morin
De nombreuses marques vous ont approchée pour des collaborations. Je pense notamment à Dior Make-up et à Peter Philips, son directeur de l’image et de la création.
Ines Alpha
Oui, j’étais très enthousiaste car c’était un rêve de travailler avec une maison comme celle-ci, et Peter est l’un de mes make-up artist préférés. Nous avons réalisé une vidéo, déclinée par la suite en filtre.
Justin Morin
Comment travaillez-vous ? Passez-vous par une étape de croquis ?
Ines Alpha
Très rarement, ou alors lorsque je collabore pour une marque et que l’on me demande des explications.
Mais j’aime « sculpter la matière maquillage »directement dans mes logiciels. L’expérimentation a une grande place dans mon processus, je suis attentive à mes erreurs car elles peuvent m’emmener là où je n’imaginais même pas aller.
Justin Morin
Quel est votre rapport à la beauté standardisée ?
Ines Alpha
Je pense que la variété est jolie. Les réseaux sociaux et leurs algorithmes nous font voir les mêmes images, les mêmes formes, et tout le monde finit par se ressembler. Comme je le disais plus tôt, je trouve que ce que l’on considère comme des défauts est souvent très beau. Dans mon travail, j’essaye à ma manière d’apporter de la diversité.
Justin Morin
En un sens, les filtres ont permis de libérer l’approche du maquillage. Que l’on soit jeune ou âgé, que l’on se considère comme masculin ou féminin, on peut se voir instantanément transformé. Considérez-vous votre maquillage virtuel comme genré ?
Ines Alpha
Non, ce n’est pas du tout dans mon intention. J’aime l’idée que mon travail puisse plaire à tout le monde, et pas uniquement aux femmes car il s’agit de maquillage. Je veux juste que chacun puisse se l’approprier. C’est une opportunité de se voir différemment, de se redécouvrir.

EXPLORER REVUE
Odorama
Chapitre Deux
Teddy Lussi-ModesteJacques Brun
Débutée dans le précédent numéro de Revue et initiée par le réalisateur et scénariste Teddy Lussi-Modeste, la série Odorama revisite l’histoire du cinéma en l’associant à différents parfums contemporains. Notes de tête, de cœur et de fond se superposent aux aventures de ces personnages fictifs et pourtant si incarnés.
Cuir Cavalier
MDCI
Nez : Nathalie Feisthauer
Il roule vite. Très vite. Il ne sait pas rouler autrement. Lui qui a traversé le désert du Néfoud n’a peur de rien et certainement pas du panneau qui indique le danger. À cheval sur sa moto, il fend les bocages de la campagne anglaise. À quoi pense-t-il la vitesse caressant son visage ? Au chameau sur lequel il a changé l’histoire d’un peuple ? Le parfum qu’il a gardé de cette époque le fait vivre dans ses souvenirs. Il repense à ce jour où le plus noble des Harith a brûlé sa tenue d’officier pour le revêtir de la tenue traditionnelle : ghutra, bisht et même ce poignard au fourreau orfévré : le jambya. À l’écart du groupe, le vent passant entre les dunes, soulevant les multiples étoffes blanches, il se vit comme un Bédouin, lui, le plus anglais des Arabes ou le plus arabe des Anglais. Il sera désormais appelé El Lawrence par son nouveau peuple. Dans les étoffes soyeuses et fabuleuses vit le plus beau des parfums, un parfum de cavalier, un parfum de majesté, un parfum de densités, où le safran, tour à tour miellé, irisé, cuiré, oudé, vanillé, constitue le tuteur autour duquel viennent s’enrouler toutes les notes à la manière d’une treille ou d’un agal. Il fallait être parfumé ainsi pour convaincre Auda, chef des Howeithat à se joindre aux Harith. Il fallait ce parfum pour conquérir Aqaba et prendre Damas. Seuls les Bédouins et les Dieux peuvent vivre dans le désert. El Lawrence,vêtu de ce parfum, est un peu des deux.
Inspiré par Lawrence d’Arabie de David Lean
L’homme idéal extrême
Guerlain
Nez : Pierre Guillaume
Une femme. Deux hommes. Rosalie. César et David. Rosalie a du mal à choisir : entre la fougue maladroite de César et la discrétion élégante de David, son cœur balance. Ces deux hommes sont si différents qu’il devient possible pour une femme de les aimer, sincèrement, honnêtement, tous les deux en même temps. La compétition du début, celle qui conduit les deux hommes à se doubler sur la route, laisse place à la complicité. Chacun, parce qu’amoureux de Rosalie, comprend que l’autre puisse l’aimer. La jalousie devient amitié, amitié virile, amitié presque amoureuse. Trio. Trouple. Quand Rosalie s’absorbe en sa mélancolie, dans cette belle maison bretonne aux volets bleu, c’est César qui va chercher David. Car il sait qu’il ne peut pas lutter contre l’imagination. Le rêve est toujours plus fort que la réalité pour le sujet amoureux. Si David est là, Rosalie ne pourra pas rêver d’une autre vie. Les deux hommes portent le même parfum mais si les notes en sont les mêmes, le pH de leur peau, le pH de leur personnalité, font ressortir les notes cuirées pour César, les notes hespéridées pour David, tabac boisé pour César, fruits épicés pour David. Et, chez les deux, une belle amande, renforcée par l’héliotrope à l’odeur amandée. César sera toujours César, David sera toujours David. Mais César aime Rosalie en la voulant, la tient en la prenant, l’amène en l’emportant. David aura l’élégance de s’effacer devant César qui souffre et aime plus fort. Quelle émotion que de le voir regarder César regardant Rosalie dans la dernière image.
Inspiré par César et Rosalie de Claude Sautet
Mixed Emotions
Byredo
Nez : Jérôme Epinette
Cannes approche de l’été et Naïma de ses 16 ans. Sofia, sa mystérieuse cousine, apparaît comme par enchantement le jour de son anniversaire. Elle a un cadeau pour elle : un sac luxueux et, à l’intérieur, un parfum qui l’est aussi. Son nom résume à lui seul l’été que Naïma s’apprête à vivre – si ce n’est la vie elle-même : Mixed Emotions. Naïma veut ressembler à Sofia dont le mode de vie l’attire : les voilà sur la croisette, sac, marinière et parfum. Bientôt, Naïma se fera tatouer dans le creux du dos la même injonction que celle qui orne le dos hâlé de la cousine magnétique : Carpe diem. Le halo parfumé qui émane de leurs points de pulsation, chauffés par le soleil azuréen, séduit les garçons et les filles qui passent dans leur orbe. Quand Naïma vaporise le parfum au creux de son cou ou – lorsqu’elle crée une brume sous laquelle elle passe, une puissante note de cassis – apporte fraîcheur et acidité. Mais elle perçoit immédiatement une oscillation entre cet afflux fruité, soutenue par le maté et le thé, invisibilisant presque les délicates feuilles de violette, et des notes plus âpres, plus âcres, de bouleau et de papyrus. Une sensation tactile, presque râpeuse, émane de ce parfum si innocent en apparence. Et quand la proue fuselée du yacht entre dans le champ, avec à bord Andrès et Philippe, le désir peut s’emparer du quatuor comme un parfum musqué, et enivrant. L’aventure commence.
Inspiré par Une fille facile de Rebecca Zlotowski

Mixed Emotions
Byredo
Les jeux sont faits
Jovoy
Nez : Amélie Bourgeois
Il doit voir ceux qui ne veulent pas être vus. Il circule dans un Paris nocturne, brumeux, liquide, dans un costume parfaitement cintré, posé sur un col roulé parfaitement roulé. À mi-chemin entre le flic et le voyou, il passe de bar en club et de club en bar. Il croise des patrons qui ont tous quelque chose à dire et quelque chose à cacher. Il écoute et démêle le vrai du faux. Qui dépasse les limites ? Qui a trop d’appétit ? La nuit est un écosystème fragile sur lequel il doit veiller, fermer les yeux sur les délits pour les ouvrir grand sur les crimes. Qui est en train de lui faire un travail ? En sortant de chez lui, en allumant sa première cigarette, il sent le danger. Il a une nuit pour empêcher que le piège ne se referme sur lui, un piège tendu par un ami, lui-même pris dans un piège. Héritier des héros en noir et blanc des années 1960, Roschdy Zem prête sa silhouette longiligne, son torse solide, sa nuque raide, son regard perçant et sa virilité mélancolique au commandant Weiss. Il en impose à toutes et tous. Il est puissant comme ce parfum dont il se revêt avant de sortir. C’est un parfum qui a les épaules larges, de celles qui rassurent hommes et femmes. C’est un cuiré aromatique, légèrement gourmand, légèrement animal. C’est une liqueur dont les matières ont été taillées à la serpe et assemblées dans un geste rapide : la fraîcheur de l’angélique et du petit-grain est immédiatement contrebalancée par des arômes de rhum et de gin, par des feuilles de tabac cuminées et du patchouli cacaoté. Oh que c’est bon ! Que c’est bon ! Les jeux sont faits ! On est séduit, attiré, attrapé. Pour Simon Weiss, les jeux aussi étaient faits, mais il a réussi à piper le dernier dé.
Inspiré par Une nuit de Philippe Lefebvre

les jeux sont faits
Jovoy
Animal Mondain
Pierre Guillaume Paris
Nez : Pierre Guillaume
Les riverains de West Egg sont aussi riches que ceux de East Egg mais leur fortune est plus récente, plus tapageuse, et, de ce fait, un peu vulgaire, un peu douteuse. Pourtant, de ce côté-ci de l’île, vit un mystérieux individu dont les fêtes grandioses vident New-York de ses plus beaux noceurs. Y vit aussi celui qui va nous raconter sa tragique histoire : Nick Carraway. Si Jay Gatsby organise ces fêtes somptueuses c’est pour attirer la femme qu’il aime et qu’il ne peut oublier : Daisy, désormais Daisy Buchanan, puisqu’elle est hélas mariée avec un homme riche et rustre. Un rayon vert relie la demeure de Daisy à celle de Gatsby et peut-être ce dernier a-t-il fait construire sa demeure face à celle de sa bien-aimée pour l’attirer comme la lampe attire le papillon. Il y a tant de rumeurs qui circulent sur Gatsby : il aurait tué un homme, il fréquenterait la pègre, ce serait un bootlegger. Intermédiaire entre Gatsby et sa cousine Daisy, artisan de leurs retrouvailles, Nick entre dans le secret des lieux. Gatsby lui fait visiter sa demeure et, en s’approchant de l’homme, Nick découvre un sillage en parfaite métonymie avec le décor. Le parfum de Gatsby sent l’acajou et le miel. Le miel ou plutôt la cire, cette même cire qui sert d’encaustique pour nourrir le bois et faire briller les marqueteries. Les feuilles de poirier apportent une fraîcheur aussi fugace que ces nuits d’été. Elles se fondent rapidement dans le tabac et le foin, dans l’iris et le castoréum. Parfum de mondanité, mais aussi parfum d’intimité. L’animal se déplace avec souplesse de l’une à l’autre.
Inspiré par The Great Gatsby de Baz Luhrmann
Promise
Frédéric Malle
Nez : Dominique Ropion
Sauvé des eaux, il est élevé par Pharaon et devient le frère de Ramsès. Ils ont la belle vie et nagent dans l’opulence. Mais l’Éternel a prévu un autre destin pour Moïse : le prophète doit délivrer son peuple. C’est ce qu’ordonne Yahvé sous la forme d’un buisson en feu qui ne brûle pas. Moïse doute, mais sa femme, la belle Tsippora, peau brune, cheveux noirs, l’exhorte à écouter Dieu. Moïse quitte cette oasis, sise au milieu du désert, et l’exode commence. Il conduit son peuple sur la Terre promise, dans le pays de Canaan, là où coulent le lait et le miel. Un immense parfum descend des cieux en même temps que la manne : il s’ouvre sur des notes de pomme. L’immense corbeille de fruits semble avoir été distillée et même quintessenciée. Ça sent l’essence. Pas celle de la pomme, mais l’essence proprement dite : celle du pétrole après son raffinement. Ces notes terpéniques sont suffocantes de beauté. Tout est en surdose dans ce parfum qui réjouira le cœur de ceux qui aiment la force. Le poivre rose et le romarin qui accompagnent la pomme laissent place à l’éclosion de deux variétés capiteuses de rose : celle de Turquie et celle de Bulgarie. Le fond, oriental, offre une architecture boisée-ambrée à la senteur. Le patchouli et le ciste sont boostés, comme si ce n’était pas déjà suffisant, par les notes animales du castoréum et celles musquées de l’ambroxan. Ce parfum, qui répond au nom de Promise a le beau visage de Tsippora et celui de cette terre offerte par Dieu.
Inspiré par Le Prince d’Égypte de Brenda Chapman, Steve Hickner & Simon Wells
Pétroleum
Histoires de parfums
Nez : Gérald Ghislain
Elles n’y retourneront plus. Hors de question de se retrouver encore une fois esclaves de ce shlagueux d’Immortan Joe. L’Imperator Furiosa profite d’un ravitaillement pour s’enfuir de la Citadelle. Les épouses saines du harem d’Immortan Joe se cachent dans les entrailles du 38 tonnes tandis que les War Boys, armés de perches explosives, rêvent de mourir en héros pour rejoindre le Valhalla. Immortan Joe lance son armée à la poursuite du convoi et de ses cinq épouses. La course-poursuite peut commencer et elle va durer tout le film. Les femmes seront aidées par Max, le globulard de Nux, qui parvient à se libérer de ses chaînes et de la perfusion qui le relie au War Boy en fin de demi-vie. Dans la cabine du camion, son volant à tête de mort sous les mains, Furiosa appuie de toutes ses forces sur l’accélérateur. George Miller invente le road-survival. HISTOIRES de PARFUMS invente Pétroleum, un parfum saisissant d’originalité tout en étant parfaitement portable. Le nom pourrait faire peur sauf à ceux qui aiment l’odeur entêtante des stations-services. La fragrance est complexe : le oud, pourtant présent à toutes les étapes du parfum, reste plutôt discret. Certainement induit par la rencontre entre les aldéhydes et la bergamote, quelque chose de minéral, de iodé, d’ozonique, se répand immédiatement. Quelque chose de savonneux aussi. Et de terreux. Comme si le parfum tentait de rejoindre un territoire plus chypré avec le fond de rose-patchouli. Cette odeur va bien à Furiosa qui deviendra le nouveau leader de la Citadelle. Le temps de la matriarchie est venu. Hey, Max, witness-her !
Inspiré par Mad Max Fury Road de George Miller

Pétroleum
Histoires de parfums
Cologne française
Celine
Dans son appartement parisien comme à la Colinière, le marquis promène son élégance sans malveillance, sa confiance sans orgueil, sa supériorité sans mépris. C’est un Français tel qu’on le rêve, capable d’inviter dans son château de Sologne l’homme amoureux de sa femme et la maîtresse qu’il vient de quitter. Le parfum qu’il porte lui est aussi naturel que son beau costume cintré et ses mots d’esprit. Il l’accompagne à la chasse comme dans les bals costumés dont il est le maître de cérémonie. Cette Cologne qu’il porte après les ablutions matinales semble sortie de la boutique d’un apothicaire qui aurait travaillé et mélangé jeunes pousses et racines diverses. Dans ce philtre, la verdeur de la feuille de figuier, presque camphrée, prend en tête le pas sur le néroli que l’on retrouvera plus tard, quand la Cologne aura vécu quelques heures et que la peau l’aura chauffée. L’équilibre est maintenu par la mousse de chêne qui chypre la fragrance et lui donne un prestige aristocratique. Le beurre d’iris enveloppe l’ensemble et donne une rondeur délicieuse à la Cologne. « Ce La Chesnaye ne manque pas de classe et croyez-moi ça devient rare… » L’esprit français n’est pas mort. Il vit encore chez quelques hommes et dans ce flacon épuré. Joie.
Inspiré par La Règle du jeu de Jean Renoir
Accord particulier
Givenchy
Nez : Nathalie Lorson
C’est, chaque matin, le même rituel. Vincent doit se faire passer pour Jérôme et frotte la moindre partie de son corps pour en faire tomber les peaux mortes. Les squames, filmées en gros plans, sont comme de gros flocons de neige. Dans ce monde ultra-sécurisé, le moindre cil peut vous confondre. Vincent est un pirate génétique. Pour atteindre son rêve, lui l’enfant du destin, lui dont le cœur est défaillant, est obligé de tricher. Être un autre, passer du statut d’invalide à valide, est nécessaire pour rejoindre Titan, la treizième lune de Saturne. Jérôme, handicapé depuis un malheureux accident de voiture, lui donne chaque matin les fluides nécessaires à son imposture : urine et sang. Les deux hommes partagent ainsi un profil génétique quasiment parfait, noté 9,3. Ils partagent aussi ce parfum qui semble sortir, comme le monde du film, d’un futur proche. Dandy qui aime les beaux restaurants et les bons vins, Vincent ne sort jamais sans cet accord particulier pulvérisé sur ses points de pulsation et ses beaux costumes. Au début, l’odeur est si abstraite qu’on se croit atteint d’anosmie et puis quelque chose se déploie avec une finesse impressionnante. L’ambroxan musque la fragrance et laisse passer de douces vagues chargées de rose damascena, de patchouli et de vétiver. Une impression de chic et de propreté fusionne avec la peau. C’est rien de moins que l’odeur de la perfection. La belle Irène ne peut que succomber à ce parfum qui épouse la peau comme une chemise blanche parfaitement ajustée.
Inspiré par Bienvenue à Gattaca d’Andrew Niccol

Orphéon
Diptyque

Rouge
Comme des garçons
Poids plume —
poids lourd
Marc Berthier
Avec une carrière d’architecte et de designer couvrant un demi-siècle, Marc Berthier a fait de la légèreté le leitmotiv de sa vie et de son œuvre : à la recherche de l’apesanteur certes, mais sans sacrifier l’esprit. Son héritage multiculturel familial a inspiré et guidé son travail jusqu’à la recherche de la maison idéale. Intitulée la maison Belvédère, ce projet de vie inspiré de son histoire familiale concrétise quarante ans d’une carrière centrée sur l’autonomie et la flexibilité. À l’image de l’Homme Modulor, élevé à l’éducation physique et à l’excellence, Marc Berthier intègre le concept « Mens sana in corpore sano » dans ses œuvres. Si son objectif est de produire de l’imagination, le résultat doit être évident, cohérent et séduisant. Rencontre avec un homme loquace et aux mille créations.
Syra Schenk
Vous êtes architecte de formation, comment en êtes-vous arrivé au design ?
Marc Berthier
Chez les architectes, je passais déjà pour un designer. Pour les designers, je n’étais surtout pas designer, puisque j’étais architecte… J’ai également été professeur d’éducation physique à mes débuts (j’ai fait l’École Nationale d’Éducation Physique). Ceci a prêté à confusion ! Je viens d’une famille très nombreuse, nous sommes onze enfants. Le grand-père de ma mère, ingénieur entrepreneur, a inventé et déposé un brevet pour un parpaing. Mon arrière-grand-père maternel, Jules Briola, orphelin, devint jeune « tambour » durant la guerre de 1870-71. Il avait racheté une source jaillissante sur les hauteurs de Saint-Clément-lès-Mâcon qui alimentaiten contrebas un étang avec une bambouseraie et un moulin à roue à aubes. Mais ce n’est pas tout. Jules Briola, avant Frank lloyd Wright, a construit au-dessus de la cascade un pavillon d’été pour ses quatre filles, alimentant ainsi un réservoir et le moulin. Marthe, Louise, Félicie et ma grand-mère Irma s’y reposaient en prenant un sorbet à la fraîche. La maison, qui s’appelait Le Moulin Piccoli, devient pour ma génération la grande Maison de Famille. Tout fonctionnait en autonomie, il a fait la première maison complètement écolo. Pendant la guerre, nous avons eu la chance de nous y réfugier.
Mon autre arrière-grand-père paternel Mazuire, dont on a longtemps pensé qu’il était forgeron – nous étions fiers d’avoir un artisan dans la famille – était en réalité maître des forges ! En fait nous avons appris lors des noces d’or de mes grands-parents maternels que notre arrière-grand-père était maître de forge dans le Creusot et fabriquait des outils et des machines agricoles.
Syra Schenk
Pas tout à fait le même métier !
Marc Berthier
Non absolument pas, il dirigeait plus de deux mille ouvriers… Ensuite il a produit des pièces de voiture pour Schneider, voiture avec laquelle sous le numéro 14 mon grand-père Maurice Toussaint gagna le Tour de France Automobile en 1924. Maurice, après avoir fait une carrière de pilote et pilote d’essai pour Schneider a gagné d’autre courses, jusqu’au Grand Prix des 6h en 1941. Il se passionnait pour les véhicules de sport et de tourisme à tel point qu’il fit recouvrir de cuir la carrosserie de sa voiture pour que la projection des graviers n’abime la peinture. Il dessinait aussi ses accessoires, y compris ses lunettes en aluminium fondu et bordé de cuir pour conduire son Cabriolet par temps de pluie. Il a ensuite participé à des concours d’élégance avec ma grand-mère, pour lesquels il avait fait peindre sa voiture avec un motif de pied de poule. C’était un type élégant, je lui ressemblais un peu, et j’imagine qu’il m’a inspiré. Je suis rentré aux Beaux-Arts en architecture à Paris, puis aux Arts Déco pour rejoindre Marie-Laure Hermann qui y était élève. Marie-Laure a créé le plus grand bureau de style de l’époque aux Galeries Lafayette. Nous nous sommes mariés en 1959 et notre fille Élise est née 9 ans plus tard.
Marie Laure m’a fait venir aux Galeries Lafayette pour créer un studio dédié au design, où j’étais en charge des aménagements et de la décoration mais où je dessinais aussi des produits, comme du mobilier ou de l’art dela table. Ce que je veux dire, c’est que mes relations avec la mode et le style m’ont apporté une sensibilité différente, bien au-delà de ma formation d’architecte. À partir de ce moment-là, je me suis placé réellement comme designer. De 1986 à 2000 j’ai dirigé une Unité Pédagogique à l’École Nationale Supérieure de Création Industrielle. Mon enseignement du design à l’ENSCI a eu pour objectif de produire de l’imagination et d’en maîtriser la réalisation. En revanche, jusqu’à ce que nous fondions Elium Studio, en 2000 avec ma fille Élise, également designer, Frédéric Lintz et Pierre Garner, j’ai plus fait d’architecture que d’objets.

Marc Berthier, Ozoo 600, chaises & table, 1967. Photo: Studio Marc Berthier.

Marc Berthier, Ozoo 700, banc, 1970. Photo: Studio Marc Berthier.
Syra Schenk
La série Ozoo a été faite en plastique. Que feriez-vous aujourd’hui ? Quel est le matériel que vous choisiriez aujourd’hui, qui serait tout aussi facile d’emploi, aussi économique, et aussi malléable, mais plus écologique ?
Marc Berthier
Par rapport à sa conception et fabrication, le plastique reste une évidence. Pour changer de matériel,il faut changer d’objet. Par exemple, vous êtes actuellement assise sur le prototype de la chaise Aviva, sortie à 10 000 exemplaires par an pendant plusieurs années chez l’éditeur italien Magis. Elle est constituée de deux sections de bois de 50 × 50cm. Nous avons fait plusieurs essais afin de trouver l’épaisseur minimale qui résiste encore au poids et au mouvement, dans le but d’utiliser le moins de bois possible et donc d’être économe. Le principe de la chaise est cinématique, elle se replie à plat et les accoudoirs et les pieds se déploient d’eux-mêmes lorsque l’on l’ouvre.
Syra Schenk
Pourquoi l’idée du produit économique ?
Marc Berthier
Je pense que j’y réponds quand je décris mon concept de légèreté, qui est selon moi un alliage de liberté, de mobilité, de modernité, d’économie, d’écologie et de technologie. L’économie, c’est l’économie de moyens, d’énergie, de matière. Quand vous faites quelque chose de léger, comme cette table de la série Aviva, tout est calculé pour que l’on puisse monter dessus si on le souhaite. Elle est livrée à plat et se déplie.
Syra Schenk
Pouvez-vous nous expliquer le principe derrière les Mecanotubes, que vous avez créé au milieu des années 70 ?
Marc Berthier
Il s’agit d’un mobilier scolaire modulaire en tube qui permet à l’enseignant et à ses élèves de créer leur espace selon leurs besoins et leurs imaginations. Quand nous sommes allés filmer en maternelle les comportements des enfants avec le petit bureau d’enfant OZOO crée en 1967, c’était amusant d’observer les petits attraper leur bureau sur les côtés. On voyait les petits pieds dépasser en dessous des tables, ils marchaient avec ! Mon idée derrière les Mecanotubes se place dans l’investissement affectif et culturel que vont mettre les élèves dans la réalisation matérielle de leur environnement qu’ils n’auront plus la tentation de détruire.
Syra Schenk
Avec Thyko, vous avez réinventé l’objet radio, qui était devenu désuet. Si vous deviez réinventer un objet aujourd’hui, que serait-ce ?
Marc Berthier
La Thyko radio est l’archétype de la radio transistor que j’ai connue lors de la guerre d’Algérie, où j’étais déployé et sur laquelle j’écoutais les nouvelles. Avec internet, l’objet radio était devenu un objet superflu – sauf dans la salle de bain, où tout le monde apprécie d’écouter les nouvelles le matin. J’ai eu l’idée de l’envelopper d’élastomère. Aujourd’hui je travaille sur un skiff – un petit bateau rameur pour une seule personne. Je faisais beaucoup de natation jeune, j’ai été sélectionné en équipe de France, j’ai été maitre-nageur, nageur de combat dans l’armée, mais je n’ai pas fait de commando ! Dans le milieu des architectes je passe pour un grand sportif, mais ça n’est pas le cas au sein de ma famille. Ma mère a habité à l’âge de 90 ans dans un village lacustre sur pilotis à Bora Bora pendant dix jours toute seule. Cet endroit n’était accessible qu’à la nage ou en bateau ! C’était une grande nageuse. Elle a aussi fait partie du premier ballet nautique. Un jour, elle nous a inscrit, mon frère et moi, au club d’Aviron de la Basse-Seine. Nous y sommes allés avec mon père – les skiffs étaient accrochés sur les tablettes et la Seine passait juste derrière. Tout d’un coup, nous avons vu passer quelques gros rats. Mon père a décidé qu’il était hors de question que nous nous entrainions dans cette eau noire infestée de rats. Je n’ai donc jamais fait de skiff et l’objet est resté un fantasme !
Syra Schenk
Y a-t-il un objet dont vous auriez aimé être l’auteur ?
Marc Berthier
C’est la plus difficile des questions car je vais paraitre prétentieux. J’ai fait plus de cent produits par an pendant cinquante ans, que n’ai-je pas déjà dessiné ? Mais il est vrai que j’admire la Vassily Chair de Marcel Breuer.
Syra Schenk
Les casiers Ruches sont votre système modulaire. Est-ce que chaque designer cherche à créer son rangement idéal ?
Marc Berthier
Le Corbusier avait effectivement également dessiné un système de rangement en cases. La Ruche était un système de boîte dans la boîte dessinée pour le plus grand nombre par l’éditeur DF2000. Nous avons touché énormément de gens avec ce système grâce à la grande distribution par plusieurs réseaux dont Prisunic. Je n’ai jamais dessiné de meubles meublants, j’ai dessiné des sièges, des lits, des bibliothèques, du rangement, du fonctionnel. Car l’homme passe sa vie à travailler, manger, et dormir. J’ai donc créé des produits à cet escient.
Syra Schenk
Ceci m’amène à une autre question. Vous avez dit qu’il n’y a pas de création si le design est subordonné au marketing. Qu’entendez-vous par là ? N’y a-t-il pas un stimulus créatif additionnel lorsque l’on travaille avec des données posées ?
Marc Berthier
On peut être créatif dans les limites d’un cadre, mais ce n’est pas de l’innovation à ce moment-là. Vous avez raison : dire qu’il n’y a pas de création, c’est un peu fort. Ce n’est jamais de l’innovation.

Marc Berthier, Ozoo 700, banc, 1970. Photo: Studio Marc Berthier.
Pour les gens, innover c’est créer quelque chose de nouveau. Pour moi, c’est faire quelque chose qui est surprenant parce qu’on ne l’a jamais vu, mais qui s’impose comme une évidence.
C’est la discussion que j’ai eu récemment lors d’une table ronde intitulée « Imaginer les icônes de demain », à l’occasion du salon Maison & Objet en janvier 2021. On ne créé pas des icônes, l’œuvre devient par elle-même une icône si elle le mérite.
Syra Schenk
Vous pensez également que la légèreté permet d’éloigner l’obsolescence.
Marc Berthier
Bien sûr ! L’obsolescence est ce qui se démode. La légèreté n’est pas la recherche d’apesanteur, c’est la recherche de l’esprit. Prenons l’exemple des fonctions aujourd’hui en électroménager : il y en a tellement que l’on n’utilise jamais. Plus les techniques avancent, plus on augmente l’obsolescence. Et puis, il y a bien sûr l’obsolescence préméditée pour que les objets ne durent pas. Là c’est un sujet éthique. On peut également évoquer les choses primaires : j’ai dessiné des objets de petite électronique où l’on m’a reproché la légèreté de l’objet. On me disait que cela faisait « cheap » et donc certaines pièces ont ensuite été lestées. Le même objet alourdi est vendu deux fois plus cher.
Syra Schenk
Avez-vous eu du succès car vous aviez un parti-pris ?
Marc Berthier
Si j’ai eu une certaine réussite, c’est parce que je travaille dans la confrontation, avec des arguments. On m’a d’ailleurs dit tu ne feras jamais fortune. Bon, je n’ai pas fait fortune, mais j’ai fait et ferai des choses intéressantes !
Une beauté radioactive
Antoine Bucher
Des produits « miracles » aux « principes actifs », les discours autour de la beauté ont l’habitude de mobiliser des imaginaires empruntant à la magie et aux sciences. Si les hommes et les femmes de 2021 sont familiers de cette rhétorique, les publicités des cosmétiques des années 1920 et 1930 peuvent tout de même encore surprendre les lecteurs d’aujourd’hui. En 2016, trois projets publicitaires de l’illustrateur emblématique des années folles Bernard Boutet de Monvel sont dispersés lors des ventes aux enchères de sa collection personnelle. Ces esquisses destinées à promouvoir les poudres Thoria ne promettent rien moins que « l’éternelle beauté par l’éternelle jeunesse ». La source de jouvence mentionnée sur ces compositions est tout simplement la radioactivité.
Les travaux des époux Curie ont en effet permis dans les premières décennies du XXe siècle de mettre en lumière le rayonnement de certains éléments dont l’uranium mais aussi le radium et le thorium. La curiethérapie qui utilise le radium pour la destruction de certaines tumeurs donne à ce métal une aura curative importante dont se saisit naturellement le monde de la beauté. De nombreux acteurs du monde des cosmétiques décident alors d’incorporer du radium dans leurs compositions et vantent ses vertus depuis l’emballage jusqu’aux panneaux publicitaires. La lecture des magazines des années 1930 est ainsi l’occasion de croiser de nombreuses publicités pour ces produits « enrichis ». Les visuels d’une marque retiennent notamment l’attention, ceux de la marque Tho-Radia. Si le nom même de la société repose déjà sur le thorium et le radium, le fondateur a la brillante idée de s’associer avec un médecin homonyme des Curie, le docteur Alfred Curie. Les formules des crèmes, des poudres, des rouges à lèvres sont ainsi labellisées du patronyme des récipiendaires du Prix Nobel. Sur les présentoirs des pharmacies, les affiches ou encore les nombreux encarts qui paraissent dans la presse, le visuel accompagnant le discours de la marque embrasse lui aussi l’idée de la radiation. Créée par Tony Burnand, l’image emblématique de Tho-Radia représente une jeune femme éclairée par un faisceau lumineux provenant du bas de l’image, comme si les produits Tho-Radia émettaient un rayonnement. Le visuel est tellement lié à la marque que les photographes de Vogue l’intègrent dans une composition concernant ses produits pour un portfolio consacré à la beauté en juillet 1936.
En baptisant le métal Thorium en hommage au dieu du tonnerre Thor, le chimiste Berzelius avait déjà ouvert la voie à la dramatisation ! La réglementation française à partir de 1937 limite l’utilisation du radium et du thorium et renforce la signalétique indiquant la toxicité de ces métaux. Privée de radioactivité, l’industrie de la beauté trouvera d’autres moyens de rendre les femmes radieuses.
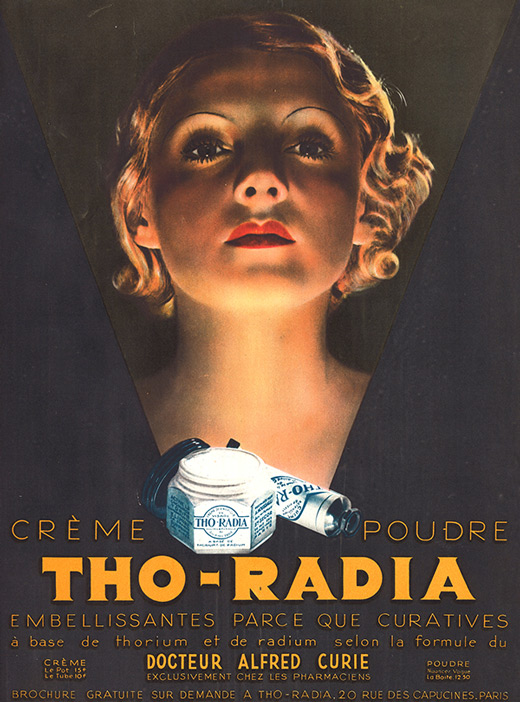
Tony Burnand, Illustration publicitaire pour la crème Tho-Radia, publiée dans le journal L’ILLUSTRATION, 16 décembre 1933. Bibliothèque Revue

Bernard Boutet de Monvel, Projet d’illustration publicitaire pour la poudre Thoria, produit de beauté radioactif, circa 1920. Librairie Diktats
Le bon mot
Julia Peker Panayotis Pascot
Quand l’absurdité du quotidien frappe, l’humour reste le meilleur allié pour prendre de la distance. Bienveillant ou caustique, analytique ou grossier, ses innombrables nuances en font un outil rhétorique aussi complexe que fascinant. Révélé à la télévision, l’humoriste Panayotis Pascot s’épanouit désormais sur scène. Entre nonchalance et confidence, son spectacle Presque aborde la question de l’amour en virevoltant d’une anecdote à l’autre, tout en jouant de ruptures entre grave et léger. Dans l’ouvrage Cet Obscur objet du dégoût (Éditions le Bord de l’eau), la philosophe Julia Peker souligne la dimension variable du goût, et par effet de miroir du dégoût. Elle pointe notamment les ressorts comiques de l’obscène. Pour Revue, nos deux invités s’interrogent sur les mécanismes du rire.
Panayotis Pascot
J’ai grandi dans une famille où nous regardions beaucoup la télévision durant le week-end, plus particulièrement les programmes consacrés aux humoristes. C’est là que j’ai découvert Raymond Devos et Pierre Desproges. C’est ce que j’appelle « les humoristes en costume ». C’était une génération qui entretenait un lien assez fort avec la littérature, le mot avait un rôle très important, presque précieux. C’est mon premier rapport avec l’humour.
Julia Peker
Moi, je pense que ma rencontre avec l’humour est plutôt passée par le cinéma lorsque j’étais enfant. Le cinéma burlesque m’a beaucoup fait rire. C’est plus tard que je suis venue à l’humour pur, déconnecté de l’œuvre d’art, dans sa pure jouissance. Et là, je peux également citer Desproges que j’ai aimé pour son jeu avec la langue, cette manière d’être tout le temps sur une ligne de crête. Et je retrouve cette même saveur dans l’humour de Blanche Gardin, où chaque mot est choisi, chaque virgule pesée, mais où tout peut se retourner à tout moment. Un peu comme si l’on marchait au bord d’un précipice.
Panayotis Pascot
Avec ces personnes, on sait qu’en tant que spectateur, on peut les suivre car ils retomberont toujours sur leurs pieds ! On peut marcher le long de la falaise, on est en confiance ! On sent le vide avec eux, à tout moment tout peut basculer et c’est ça qui est agréable.
Julia Peker
Cette sensation du vide, c’est quelque chose qui m’a toujours étonnée dans le dispositif du one man show. L’humoriste seul sur scène. Il est seul avec sa blague, qui est lâchée, hors de tout contexte. Et il y a la possibilité du vide. Du bide même !
Panayotis Pascot
Ça m’est arrivé ! On est tous passés par là ! Je rebondis sur ce que tu dis par rapport au vide. Ce qui m’a attiré dans l’humour, c’est cet aspect.
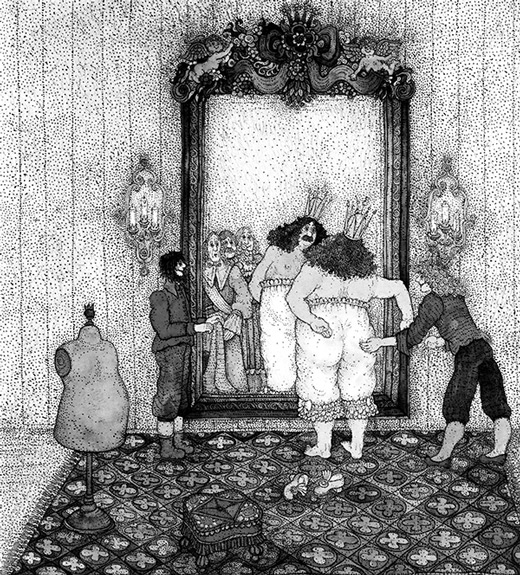
Illustration de Monika Laimgruber, extraite du livre Les Habits Neufs De L’empereur, édité en 1979 par Flammarion.
Avant, je travaillais à la télévision, mais j’ai décidé de me consacrer à la scène. Ça veut dire concrètement qu’il faut passer par des Comedy Club, pour se roder, tous les soirs, parfois plusieurs fois par soirée. C’est très dur car tu peux jouer face à des types qui sont saouls à 23 heures, ou alors face à un public de cinq ou six personnes. L’importance du vide est vraiment très contrastée par rapport à la télévision, où l’on est dans un petit confort.
Julia Peker
Sur scène, il n’y a pas de décor, rien à quoi se raccrocher.
Panayotis Pascot
Il n’y a rien ! On est vecteur de notre fond et pour autant il n’y a pas de forme ! C’est ça qui est très bizarre. C’est ça qui est assez flippant pour autant. Je précise qu’il y a une différence entre un one man show et ce que Blanche ou moi faisons, qui est du stand up. Le stand up casse le quatrième mur, là où le one man show l’utilise, comme au théâtre. Le public est derrière un mur et regarde, un peu comme un voyeur. Alors que le stand up s’adresse directement à la salle, ce qui est encore plus effrayant.
Julia Peker
Cette question de l’adresse n’est pas toujours facile à comprendre pour le spectateur qui n’est pas initié d’ailleurs.
Panayotis Pascot
C’est vrai ! Mon frère a ouvert avec l’humoriste Fary un Comedy Club, à Paris, rue Berger. L’espace a été dessiné par l’artiste JR. Comme lui et Fary sont des personnes très médiatiques, le public qui se rend là-bas ne sait pas toujours ce qu’il va y voir, ni les codes de ce genre de lieu. Parfois ça fonctionne, d’autres fois non. C’est intéressant de voir que pour ceux qui découvrent, il y a souvent une bascule qui opère au milieu de la soirée. Ils comprennent qu’on s’adresse directement à eux sans qu’il y ait de dialogue.
Julia Peker
C’est à dire ?
Panayotis Pascot
On parle directement aux gens dans le public, mais ça reste un dialogue. « Je parle sur scène et vous me répondez par vos rires, et je m’en nourris. » À l’inverse, s’il n’y a pas de rire, je vais m’aligner sur cette énergie. Une fois qu’on comprend ça, c’est quasi sexuel. Quand on sent qu’on a la confiance des spectateurs, on peut aller n’importe où.
Julia Peker
Comment travailles-tu le rythme de tes spectacles ?
Panayotis Pascot
C’est assez compliqué. Il y a quelques temps, j’ai fait une représentation dans une grande salle et je savais que dans le public se trouvaient des personnes qui me sont chères. J’étais très stressé. Tout s’est bien passé, hormis le rythme. Ce spectacle dure normalement une heure et quinze minutes. Ce soir-là, je l’ai fait en une heure et cinq minutes. J’ai tout ratatiné,il n’y avait plus de respiration. Les gens ne pouvaient pas me rejoindre.
Si on en revient à cette analogie un peu étrange du rapport sexuel, c’est un peu comme lorsque ton partenaire est trop rapide. Même si tout est super bien fait, ça ne peut pas fonctionner. Ça fait quatre ans que je fais ce métier et je commence à peine à comprendre ce genre de choses. C’est seul et sur scène que l’on se forme.
Julia Peker
La scène humoristique a un statut très particulier. C’est à la fois un lieu de sociabilité, où un humoriste s’adresse à un public, dans un univers culturel avec des références, et c’est en même temps le lieu de transgression. C’est le lieu de l’expression de l’agressivité comme nulle part ailleurs. Je ne pense pas qu’il y ait beaucoup d’autres occasions de transgresser à ce point la bien-pensance et de faire valoir la dimension d’agressivité, cette donnée constitutive presque anthropologique qui a été mise en évidence par la psychanalyse, et qui est le rapport de l’homme à l’homme.
Panayotis Pascot
Je pense que l’humour a pour vocation de relancer les dés sur des sujets qui ont déjà été traités, quels que soit ces sujets, qu’ils soient transgressifs ou non. Les regarder sous un autre angle.
Julia Peker
Ce que tu dis me fait penser à ce conte d’Hans Christian Andersen, Les Habits Neufs de l’Empereur. Un empereur souhaite se faire tisser la plus belle parure du monde. Un beau jour, deux escrocs arrivent dans la ville de l’empereur et prétendent savoir tisser une étoffe que seuls les sots ne peuvent pas voir. Ils proposent au souverain de lui confectionner un habit. L’empereur accepte et les brigands se mettent au travail. Quelques jours plus tard, il vient pour constater l’avancée du travail mais ne voit rien, car il n’y a évidemment rien ! Il décide de n’en parler à personne, car personne ne voudrait d’un empereur idiot. Il envoie des ministres qui eux aussi ne voient rien, mais n’osent pas le dire. Tout le monde parle de cette étoffe merveilleuse. Le jour où les deux escrocs décident que l’habit est terminé, ils aident l’empereur à s’habiller pour une parade auprès de la foule… Personne n’ose rien dire, tout le monde s’exclame devant ces vêtements invisibles, sauf un petit garçon qui lâche la vérité : « Le Roi est nu ! » Et ça rejoint ce que tu disais par rapport à l’intimité ! On est dans quelque chose de très fort qui est de l’ordre de la mise à nu.
Panayotis Pascot
Si j’y crois, vous y croirez.
Julia Peker
Il se joue un décalage des points de vue. Il y a quelque chose aussi sur le semblant qui est très fort dans le stand up, c’est qu’on a l’impression que tout est improvisé alors que l’on sait tous très bien que c’est un texte méticuleusement écrit. C’est comme une sorte de pacte.

Illustration de Monika Laimgruber, extraite du livre Les Habits Neufs De L’empereur, édité en 1979 par Flammarion.
Revue
Qu’est-ce qui vous fait rire ?
Panayotis Pascot
En ce moment, les annonces gouvernementales me font rire à chaque fois.
Julia Peker
C’est vrai que de faire une attestation sur l’honneur pour pouvoir sortir acheter sa baguette de pain…
Panayotis Pascot
Ou avoir la possibilité d’aller au ski mais ne pas avoir le droit d’utiliser les remontées mécaniques… Je sais aussi que c’est horrible, mais Donald Trump m’a aussi beaucoup fait rire. Ce qui me fait penser à ce qu’on appelle « la maladie de l’humoriste ». Il y a un excellent documentaire qui s’intitule Laughing Matters – visible en ligne – qui montre que les humoristes sont parmi les catégories socio-professionnelles les plus sujettes à la dépression et au suicide. Un humoriste a une sorte de recul ; puisqu’il doit trouver des blagues, il est toujours en train d’analyser ce qui se passe.
Julia Peker
C’est là où il y a aussi cette frontière qui est très ténue entre l’obscène et ce qui peut être sur scène. On en revient à ce voile du semblant : tout l’enjeu est de donner à voir une mise à nu des semblants, et de rétablir quand même un voile. C’est là où c’est une forme d’art : il s’agit de trouver ce point où l’on peut basculer d’un côté ou de l’autre – soit l’obscénité, soit le conventionnel.
On en revient à ce voile du semblant: tout l’enjeu est de donner à voir une mise à nu des semblants, et de rétablir quand même un voile. C’est là où c’est une forme d’art : il s’agit de trouver ce point où l’on peut basculer d’un côté ou de l’autre – soit l’obscénité, soit le conventionnel.
Revue
Panayotis, comment se passe l’écriture de vos spectacles ?
Panayotis Pascot
Pour le coup, je n’écris pas ! Je monte sur scène avec une idée et je me lance devant les gens. Bien évidemment ensuite je rode les choses, mais je n’écris jamais avant de monter sur scène. En fait, je fonctionne beaucoup au pistolet sur la tempe : j’arrive à trouver des blagues quand je dois me forcer à en trouver.Je suis devant les gens et si je ne suis pas marrant, ils vont vouloir me tuer avec des fourches donc il faut absolument que je sois marrant. C’est très instinctif au final.
Julia Peker
Est-ce que tu peux me raconter le fil narratif de ton spectacle, Presque, puisqu’avec ces confinements et ces couvre-feux, il est difficile de le voir !
Panayotis Pascot
Ah oui c’est vrai ce spectacle a une drôle de vie ! Presque est lié à ma vie intime car il concerne une question que je me suis posée pendant un moment. J’étais très amoureux d’une fille et je n’arrivais pas à l’embrasser. Même si je voyais qu’elle en avait envie et que tout allait bien, je n’y arrivais pas. J’explique que depuis tout petit, embrasser est une action qui me terrifie et qui m’effraie. J’ouvre le spectacle là-dessus. Ma première phrase est : « Je ne sais pas embrasser les filles et je ne sais pas pourquoi. » J’y réponds en abordant plusieurs points, notamment mon éducation et mon rapport à mon père. Premier volet ? Mais tout ça, ce sont des vraies questions que j’ai eues dans ma vie et que j’ai eu envie de raconter sur scène. J’ai détricoté ! Ça m’a aidé à avancer et à progresser. Maintenant, tout va bien !
Julia Peker
J’évoquais plus tôt le cinéma burlesque. Et toi, quel genre de cinéaste te faire rire ?
Panayotis Pascot
J’aime Wes Anderson, plus particulièrement Fantastic Mr Fox. Je pense aussi aux Monty Python, qui m’ont toujours beaucoup fait rire. Dans un registre moins visuel, j’aime aussi Judd Apatow. Il aborde souvent des choses très intimes ou des questionnements existentiels quasi métaphysiques, mais avec un regard très singulier. Et puis des fois, des films qui ne sont pas censés faire rire ont l’effet inverse sur moi, comme le cinéma de Lars Von Trier. The House that Jack Built, j’ai trouvé ça extrêmement marrant. Et toi, quels films te font rire ?
Julia Peker
Dernièrement j’ai revu Fais moi plaisir d’Emmanuel Mouret. J’ai beaucoup aimé! C’est vraiment un film qui va de situations burlesques en situations burlesques. Ici, un homme découvre par l’intermédiaire d’un ami le pouvoir d’une phrase notée sur un morceau de papier… Grâce à elle, il va séduire malgré lui une femme, ce qui va l’amener à se retrouver dans des situations rocambolesques ! Je te le conseille si tu as envie de légèreté !
EXPLORER REVUE
Microcosmos
Anicka Yi
Difficile de décrire l’œuvre d’Anicka Yi tant la pratique de l’artiste se déploie à travers des médiums variés et peu conventionnels. Au croisement de la science, de la parfumerie et de l’installation, ses propositions bousculent les sens. Mais au-delà de la surprise qu’elles suscitent, elles donnent surtout à revoir nos conceptions de notions importantes comme le vivant, l’éphémère, le genre ou encore le visible et pointent les paradoxes que suscitent certaines définitions. Si son approche conceptuelle et plastique est célébrée par le monde de l’art depuis plusieurs années, la pandémie actuelle offre un éclairage particulier, plus ample et aigu, à ses recherches. Organismes vivants, mutations, frontières, autant de questionnements artistiques qui se reflètent avec persistance dans notre quotidien bouleversé. Elle s’entretient ici avec Hamid Amini autour des différents axes de son travail.
Vous avez mentionné que vous n’êtes pas « accablée par les paramètres historiques de l’art », et en effet votre travail – et votre trajectoire en tant qu’artiste – est, faute d’un terme mieux adapté, unique. Sachant cela, comment vivez-vous le fait que vos créations soient interprétées et historicisées par les critiques contemporains ?
Quand je donne à voir une de mes créations, j’accepte qu’elle vive sa propre vie, qu’elle devienne un organisme à part entière. Je ne contrôle pas vraiment la façon dont elle sera interprétée ou reçue, donc j’accepte cette part d’incertitude et de mutation dans la création artistique. Un de mes rêves est de proposer mon travail en open-source. N’importe qui pourrait le télécharger, l’ajouter à sa propre création artistique et lui donner une nouvelle vie. Je m’intéresse beaucoup à ce type de pollinisation artistique croisée. Bien que je ne contrôle pas le contexte dans lequel mon art est reçu, il y a selon moi une relation symbiotique entre la réception et la production de l’œuvre artistique. Mon travail répond à un contexte donné et vice versa. Il y a donc une sorte de réciprocité évolutive.
Une grande partie de ce qui définit votre pratique – la collaboration, l’amitié, l’hygiène, le théâtre et l’odeur – a été complètement bouleversée par la pandémie de Covid-19. L’odeur en particulier (ou l’absence d’odeur) est une caractéristique majeure du virus. Certains de vos projets actuels répondent-ils à ce sentiment de privation sensorielle et sociale ? Votre projet pour la salle des machines de la Tate, annoncé en mars 2020, a été mis en suspens. Ressemblera-t-il à ce que vous aviez imaginé avant la pandémie ? Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet ?
Oui, en fait, le projet pour la salle des machines de la Tate s’intéresse directement à l’air en tant que substrat matériel pour la sculpture dans un site vecteur d’un discours politique, social et économique. La pandémie de Covid-19 nous montre comment les molécules présentes dans l’air et les molécules d’odeur transmettent des informations invisibles et microscopiques entre les êtres humains, les autres organismes et l’environnement.

Anicka Yi, -30,000 yr pleistocene park, 2018. Mousse haute densité, résine, peau de serpent et cadre. 129 × 104 × 6,3 cm
Le monde invisible des molécules dans l’air peut exciter notre appétit, déterminer notre choix de partenaire ou nous rendre gravement malades. L’air contient nos tensions et nos angoisses. Nous tenons pour acquise notre capacité olfactive et nous ne comprenons pas comment l’odeur modifie notre perception du monde. L’air qui nous entoure comporte un risque social et un risque biologique. Mais je crois que c’est dans le risque que la création artistique s’épanouit.
Les modifications que nous avons faites dans l’œuvre sont assez subtiles. Nous avons surtout dû adapter notre façon de travailler afin d’être plus flexibles et de nous coordonner à distance. Les idées de départ, pré-pandémiques, peuvent parfaitement s’appliquer, peut-être même davantage aujourd’hui. Mais les thèmes du projet de la Tate sont très pertinents et il est nécessaire de les aborder, avec ou sans pandémie.
J’aimerais en savoir plus sur votre pratique en atelier, êtes-vous confinée dans un espace clos ? Comment naviguez-vous physiquement entre les aspects cliniques et les aspects naturels (l’odeur étant abondante dans la nature) de votre pratique artistique ?
Notre atelier est plus décentralisé maintenant, nous avons une organisation moléculaire plus dispersée. Comme notre équipe de base est très réduite, nous ne pouvons pas prendre le risque que plusieurs membres tombent malades en même temps. Heureusement, j’ai conçu l’atelier de façon à ce qu’il soit très souple et adaptable. Je n’ai jamais été une fan de l’intelligence consanguine ou trop ciblée. Avec les conditions de travail du XXIe siècle, nos compétences sont fragiles et nous devons constamment basculer, passer à des compétences plus vastes et acquérir des connaissances complexes. C’est pourquoi le travail à distance, numérique, la collaboration intime entre continents avec différents fuseaux horaires, est l’une des compétences que nous avons acquises cette année.
Vous avez travaillé comme styliste de mode à Londres. Comment pensez-vous que le temps s’écoule actuellement dans votre création ? Considérez-vous votre ligne de parfum Biography comme une œuvre d’art ? Il est intéressant de savoir comment vous envisagez la fusion des deux…
J’aborde le parfum Biography de la même manière que mes autres projets artistiques. Biography est né de mon questionnement philosophique sur la subjectivité et la féminité. Pendant des années, j’ai été obsédée par Fusako Shigenobu, ce mystérieux personnage historique dont l’identité changeante et le rôle politique défiaient les genres, les frontières nationales et les normes de la moralité. Elle m’a semblé être la métamorphe par excellence, celle qui défiait les frontières le plus radicalement. En développant les idées autour de Biography, j’ai analysé avec de plus en plus de précision la perméabilité des frontières : entre la nature et la culture, entre les espèces, et entre l’individuel et le collectif.
Je n’ai aucun contrôle sur le fait que Biography soit perçu comme de l’art, mais pour moi, il n’y a pas de réelle distinction puisque ce parfum et mes œuvres relèvent du même processus de création. Avec Biography j’espère rendre l’œuvre d’art plus accessible, permettre à des personnes extérieures au milieu des collectionneurs d’en posséder chez elles. Les bouteilles d’eau de parfum sont des sculptures uniques et elles sont proposées en différentes éditions. Nous ne sortirons pas deux fois le même flacon. Chaque nouvelle version sera une sorte de série limitée.
Dans le numéro précédent de Revue, nous avons eu une discussion avec Barnabé Fillion. Pouvez-vous nous expliquer la nature de votre collaboration ? Comment travaillez-vous ensemble ? Pourriez-vous également nous expliquer le concept qui sous-tend votre ouvrage 6 070 430 K of Digital Spit ?
Barnabé et moi avons collaboré à de multiples installations au fil des ans. Nos projets commencent toujours par de longues discussions philosophiques. Nous discutons ensemble de différentes idées comme celles qui précèdent et nous soulevons de nouvelles questions. Quelle est l’odeur de l’apatridie ? Ou quelle est l’odeur du pouvoir des personnes gender fluid ? Nous discutons pendant des heures, puis nous nous efforçons de traduire ces idées sous forme matérielle et moléculaire. Nous échangeons généralement de nouvelles idées, des composés odorants et des prototypes de parfums au cours du processus.
Avec 6 070 430 K of Digital Spit, j’ai voulu proposer un livre « burn after reading » tel que je le conçois. C’était ma première monographie et je n’avais pas envie qu’elle illustre ma pratique artistique comme un processus figé. Cela me semblait trop réducteur. J’ai donc voulu créer une archive éphémère et provisoire. J’ai essayé de saisir l’odeur des sept dernières années de mon travail, qui est libérée lorsqu’on brûle le livre. De cette façon, on peut lire l’œuvre, la sentir et la laisser redevenir immatérielle. Il s’agit de transformer la matière.
PROPOS RECUEILLIS PAR HAMID AMINI

Anicka Yi, Your Face Tomorrow, 2013. Savon glycérine, résine époxy, perles déshydratantes, tube en vinyle, peinture acrylique, tige acrylique, silicate de sodium, crème hydratante Prada, boîte de Petri, cellophane, feuille d’acétate, peinture en aérosol. 116 × 86 × 3,8 cm.

Anicka Yi, Beyond Skin — Volume 3, 2019.Acrylique, parfum et insectes. 12,5 × 5,4 × 2,6 cm

Anicka Yi, Lung Condom, 2015. Savon, peinture, acétate, résine et tube caoutchouc. 45 × 35 × 5 cm
Effet et Optique
Tauba Auerbach
Tauba Auerbach et moi nous connaissons depuis presque 20 ans. Je l’ai rencontrée à l’époque où elle était étudiante à l’université de Stanford, ou peut-être à l’époque où elle travaillait à la galerie Luggage Store à San Francisco. Dans cette conversation, j’ai eu envie de me concentrer sur différents aspects de sa pratique actuelle. Après une formation en peinture et en dessin, le design et l’artisanat ont toujours été essentiels dans ses créations. C’est dans ce contexte qu’est né son intérêt pour la symbologie, les mathématiques, la science et les systèmes de logique en général,et l’expérimentation en atelier. Cette confluence de compétences et de curiosité l’amène à explorer des concepts qui viennent nourrir ses créations empreintes de poésie. En parallèle de son travail en atelier, Tauba Auerbach a fondé Diagonal Press (en 2013), où elle propose des livres, des caractères typographiques inédits, et divers objets. Elle vit et travaille à New York.
Bob Linder
Nous nous sommes rencontrés pour la première fois quand tu vivais dans la région de la baie de San Francisco. Je me souviens avoir vu tes premiers lettrages exposés au Luggage Store, chez Adobe Books, à la Jack Hanley et à Needles and Pens, ainsi que les travaux de ton exposition d’étudiante de premier cycle à l’université de Stanford.
Tauba Auerbach
Je me souviens aussi de toi à cette époque… Je me rappelle avoir vu Total Shutdown à plusieurs reprises, dans trois des quatre endroits que tu as mentionnés, je crois. Je me souviens aussi de ton étonnante vidéo au Luggage Store lorsque j’y travaillais le vendredi.
Bob Linder
Quand on observe tes créations, il est difficile de ne pas y voir un modèle d’abstraction. Je pense en particulier aux œuvres Fold, Grain, et Extended Object sur toile. Je ne pense pas que l’expressionnisme abstrait d’après-guerre soit important pour toi, mais je suis curieux de savoir comment l’abstraction elle-même (au sens phénoménologique ou littéral) se glisse dans l’œuvre, et quel rôle elle joue .
Tauba Auerbach
J’aime l’abstraction parce qu’elle est utile et généreuse. Elle est utile comme l’algèbre – on peut transformer des détails en concepts universels ou en théories. Un nombre est remplacé par x, qui peut représenter n’importe quel nombre, et à partir delà on peut étendre son raisonnement, à partir de tous les nombres possibles à la fois. Je sais qu’il y a là une raison vraiment théorique d’aimer l’abstraction, qui peut sembler un peu froide, mais cela me réchauffe vraiment le cœur de penser que ce processus est applicable dans n’importe quel domaine. Je pense aussi que l’abstraction est féconde, car elle ne nous dit pas ce que nous devons penser, et qu’elle offre de nombreuses possibilités à la fois.

Tauba Auerbach, HA HA 1, 2008. Gouache sur papier. 76,2 × 55,9 cm. © Tauba Auerbach. Avec l’aimable autorisation de Standard (Oslo), Oslo.
Bob Linder
Je crois comprendre que les mathématiques et la science sont une source d’inspiration fondamentale pour toi, mais peux-tu nous parler un peu de la façon dont les événements actuels tels que la pandémie, la naissance du mouvement Black Lives Matter, et la politique en général influencent tes créations artistiques ?
Tauba Auerbach
Je dirais d’abord que la science et les mathématiques sont très présentes dans les questions sociétales dont tu parles. Les données relatives à la pandémie et à l’élection offrent deux exemples de mathématiques extrêmement politisées. Le racisme se manifeste dans la pratique de la médecine, dans les essais de bombes, dans la programmation d’algorithmes prédictifs…
Je ne veux pas mettre la science et les mathématiques de côté quand j’observe ce qui se passe dans le monde sur le plan social.
Mais pour répondre à ta question, je suppose que l’actualité de cette année s’est manifestée dans mon travail sous forme de cartes. Je suis surprise d’avoir une réponse aussi claire à cette question ! Mais il ne s’agit pas d’une trajectoire directe, c’était la convergence de plusieurs directions de mon travail.
Avant la pandémie, je m’intéressais à la projection des sphères, en observant différentes images de sphères représentées à plat. Il existe de nombreuses façons de procéder, toutes cohérentes d’un point de vue mathématique, mais toutes déformées. Il est impossible d’aplatir une sphère sans déformer la direction, l’échelle, la forme ou la distance. Il suffit de choisir. C’est ce qui ressort de la cartographie du globe terrestre.
En parallèle, je voulais mener des recherches sur l’histoire du terrain sur lequel est construit mon atelier – je suis propriétaire du rez-de-chaussée d’un petit bâtiment dans le Lower East Side et j’ai des sentiments partagés quant à la privatisation de l’espaceet à la propriété foncière en général. Je voulais récolter le plus d’informations possibles sur ce lieu et la manière dont il a été utilisé, cultivé et dessiné au fil du temps. Qu’est-ce qui fait sa valeur ? Au début du véritable confinement, j’ai essayé de trouver des activités qui permettraient à mon unique employée à plein temps de travailler à distance, alors j’ai décidé de lui demander d’entamer cette recherche (merci, Allison !). Pendant plusieurs mois nous avons travaillé en « ping-pong » sur un document en le complétant au fur et à mesure de nos découvertes. J’ai bien entendu étudié beaucoup d’anciennes cartes de Manhattan. J’ai appris que le premier propriétaire connu de cette parcelle était un ancien esclave affranchi à qui on avait offert quelques terres pour avoir été un bon « capitaine », en 1647. Une douzaine d’autres personnes réduites en esclavage ont reçu au même moment leur « liberté partielle » et des terres de la part des Hollandais dans une bande de terre qui traversait Manhattan d’est en ouest. Ces fermes et leurs habitants noirs servaient de tampon entre la colonie hollandaise au sud et le peuple Lenape au nord, que les Hollandais avaient repoussé de la pointe de l’île. En effectuant quelques recherches, on comprend le potentiel extrêmement violent de la cartographie – la manière dont elle est utilisée pour déplacer, effacer et voler. J’ai commencé à suivre des conférences sur la cartographie critique et la cartographie queer.
Cet été, j’ai regardé beaucoup de conférences de Ruth Wilson Gilmore et, en tant que géographe, elle aborde souvent la relation entre racisme et localisation dans l’espace. Je dois dire que la notion de « lieu » avait toujours été très vague pour moi, mais quelque chose dans la pandémie – l’expérience du confinement dans un endroit unique, tout en partageant cette expérience à l’échelle mondiale – l’a fait apparaître sous un jour nouveau pour moi.
Je pense que tout cela a changé mon intérêt pour la projection des sphères en intérêt pour la projection du globe terrestre. C’est une des rares fois où je suis passée du général au spécifique, en fait. Nous sommes habitués à un nombre réduit de représentations de l’image de la Terre. La projection la plus courante, celle de Mercator, fausse considérablement l’échelle et donne l’impression que le Groenland a presque la taille de l’Afrique (ce qui est très loin d’être vrai). Mais comme je l’ai dit, aucune projection n’est exempte de distorsion, et chaque cartographe apporte ses priorités et ses préjugés sur la table à dessin, et ceux-ci sont immédiatement traduits dans la géométrie (ainsi que dans la dénomination et tout autre choix opéré au cours de son travail).
Un autre élément important à prendre en compte quand on s’intéresse au globe terrestre, c’est le découpage. On doit découper la surface de cette sphère pour pouvoir l’aplatir, et l’endroit situé de part et d’autre de la section est non seulement fractionné mais aussi poussé vers les bords de la carte, qui sont généralement les plus déformés. La subjectivité d’un cartographe s’exprime à nouveau dans le positionnement de cette coupe.
Au cours de mes recherches, je suis tombée sur le merveilleux travail de l’océanographe et géophysicien Athelstan Spilhaus qui a réalisé des cartes où la priorité était donnée aux océans. Il opérait le découpage le long des frontières naturelles, les littoraux par exemple, plutôt que sur une ligne droite au milieu d’un océan ou d’un continent. Il effectuait plusieurs projections selon différentes rotations, puis les assemblait à des endroits où elles coïncidaient stratégiquement, c’était extrêmement astucieux. Je voulais reconstruire ses cartes pour vraiment comprendre comment les projections étaient orientées et alignées les unes par rapport aux autres sur la carte, puis les assembler, etc. J’ai donc entrepris ce travail tout en réalisant beaucoup de projections inhabituelles, de mon cru, qui brouillent généralement de manière significative le regard qu’on porte sur la Terre. Je l’ai fait à l’aide d’un logiciel que j’ai commandé à un programmeur qui proposait déjà un outil similaire sur son site web (merci Jason Davies !). J’en ai peint une partie à la main pour une exposition à Oslo cet automne, et j’en ai imprimé beaucoup d’autres sur papier, que je livre pliées, à la manière d’une carte, via Diagonal Press.
Je ne pense pas être qualifiée pour réaliser des cartes politiques qui abordent par exemple les questions de frontières de pays contestées, mais je peux peut-être proposer du matériel qui change la façon habituelle (produit d’un endoctrinement ? de la colonisation ?) de voir le monde et aide à percevoir la Terre d’une façon nouvelle.
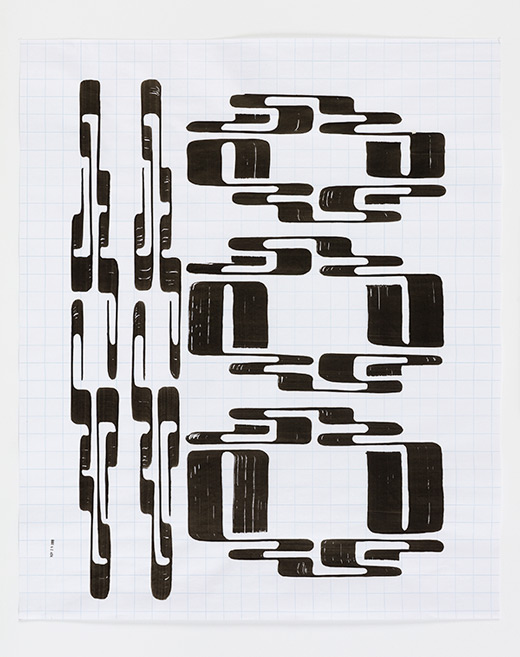
Tauba Auerbach, Ligature Drawing, 24 November 2019, 2019. Encre sur papier avec tampon dateur. 81,3 × 68,6 cm. Photo: Steven Probert. © Tauba Auerbach. Avec l’aimable autorisation de Paula Cooper Gallery, New York.

Tauba Auerbach, Untitled (Fold),, 2010. Acrylique sur toile. 121,9 × 84 cm. © Tauba Auerbach. Avec l’aimable autorisation de Paula Cooper Gallery, New York.
Bob Linder
Le son et la musique s’intègrent dans ton travail de nombreuses façons, à grande comme à petite échelle – dans Auerglass, l’harmonium à deux musiciens créé en collaboration avec Cameron Mesirow, dans The Safety Curtain de l’Opéra d’État de Vienne ou encore dans la composante audio de ton exposition collaborative avec Éliane Radigue au MOCA de Cleveland, ainsi qu’à travers plusieurs pochettes de disques. Je peux même voir un flux musical se glisser, ou s’introduire, dans tes lettrages et certaines séries de tableaux comme Grain works ou Extended Object (mes préférés). Je suis curieux de connaître ta relation avec la musique et avec les musiciens. La musique t’inspire-t-elle ? Écoutes-tu de la musique lorsque tu travailles ? Exerce-t-elle, selon toi, une influence sur ton activité créatrice ? As-tu déjà pensé au son en tant que matériau ?
Tauba Auerbach
La musique me touche plus facilement que les arts visuels. J’ai pratiqué des instruments et chanté quand j’étais enfant, mais je déteste jouer. Je me suis donc progressivement éloignée de la création musicale et je suis maintenant une auditrice heureuse. Je crois que je compte plus de musiciens que d’artistes visuels parmi mes amis. J’aime bien collaborer avec eux ou participer à leurs créations en réalisant des illustrations pour leurs albums. J’ai dessiné des tracts pour la station de radio de mon université… Je suppose que peu de choses ont changé ! Par exemple, depuis mes 14 ans, la plus grande partie de ma vie sociale consiste à assister à des concerts. Cela me manque vraiment dans le contexte de la pandémie. Et je m’inquiète beaucoup pour mes amis qui gagnent leur vie en donnant des concerts ou en travaillant dans des clubs !
J’écoute souvent de la musique pendant que je travaille, mais j’ai parfois besoin d’un silence total, quand j’écris, par exemple. En fait j’aime bien dessiner en musique. Récemment, avec celle d’Ocrilim, Ka Baird ou Mulatu Astatke par exemple. La musique peut vraiment modifier notre état, et une grande partie de la création artistique consiste à se mettre dans un état propice à la réalisation de ses projets. J’ai voulu travailler avec Éliane parce que sa musique m’a beaucoup appris sur l’écoute, la patience, la mise au point et le respect de la matière première.
Cependant, je ne considère pas le son comme un matériau en soi – et je pense que tu donnes à ce mot un sens différent de celui dans lequel je l’ai utilisé tout à l’heure –, mais j’ai l’impression que je perçois le son avec tout mon corps, qu’il passe par ma peau autant que par mes oreilles.
Bob Linder
Qu’écoutes-tu en ce moment ? Que lis-tu ? Est-ce que ce sont des plaisirs coupables ou est-ce qu’ils trouvent leur place dans ton travail ?
Tauba Auerbach
Aujourd’hui, j’ai écouté Phew, Milford Graves, qui vient de décéder récemment, plusieurs cassettes de mon amie Bunny Jr, et un peu d’opéra.
Je suis en train de lire Leonora Carrington et Karen Barad.
Bob Linder
Le magazine Revue, qui publie cette interview, est avant tout un magazine de mode. J’ai toujours su que tu t’intéressais à la manière dont on se présente aux autres. J’aimerais savoir comment la mode peut intervenir dans tes créations, les améliorer ou les parfumer. C’est peut-être un point de rencontre entre l’esthétique, le design et la pratique conceptuelle ?
Tauba Auerbach
En fait, je ne réfléchis pas vraiment à ce que je porte. Mais je crée de manière compulsive et j’ai toujours fabriqué moi-même une grande partie de mes bijoux et de mes vêtements. J’aime les tissus, donc au fil du temps, je me suis constitué une garde-robe(pour l’instant réduite) qui sort de l’ordinaire. Mais j’aime créer des objets que les vêtements permettront de diffuser – ce que j’appelle des « sartorial marginalia » [notes de marge vestimentaires] – pour Diagonal Press : des broches et des objets qui ornent le corps ou qui suivent ses contours. Je viens de créer des chaussettes. Les dessins proviennent d’ornements, de motifs existants ou de concepts mathématiques qui donnent à voir d’autres aspects de mon travail. Ça peut paraître idiot, mais j’ai conçu les chaussettes avec la même sincérité et le même sérieux que quand je crée un tableau. J’ai développé un réel dégoût pour la « mode » entre guillemets, mais j’aime vraiment les vêtements et je pense qu’ils peuvent avoir beaucoup de sens, à bien des égards. J’entends par là que si un rectangle sur un mur peut avoir du sens, une paire de chaussettes le peut aussi. Et que « sous la forme d’une chaussette » (hahaha), je pourrais faire passer le concept de chiralité ou de « main » géométrique directement sur un corps, ce qui me semble encore plus approprié.
Bob Linder
Peux-tu nous parler de ton intérêt pour les archives ? Ton dernier catalogue S v Z (conçu pour accompagner ton exposition rétrospective, reportée, au Musée d’art moderne de San Francisco) couvre 16 ans de ta carrière. Un des aspects fascinants de ce catalogue (en dehors de sa beauté sculpturale et de sa typographie énigmatique), c’est la façon dont tes précédents ouvrages y sont représentés, comme un dossier documentaire, refermé ou aplati, comme si l’objet lui-même était absent et que ce qui reste, pour ainsi dire, ce sont les données.
Tauba Auerbach
Je n’avais jamais fait d’exposition rétrospective auparavant et examiner tous mes anciens travaux pour les organiser s’est avéré être un vrai défi. J’ai beaucoup de mal à ordonner mes idées, en général. Elles semblent toutes se connecter en réseau, de manière détournée. Le processus a été très instructif. Et cette année de réflexion supplémentaire due à la Covid m’a vraiment permis de franchir une nouvelle étape.
Tu as raison de dire que choisir des travaux pour les réunir dans un livre peut être un défi – on doit en quelque sorte les montrer de plusieurs manières – on doit voir à la fois la couverture et une partie du contenu. C’est l’une des raisons qui m’ont incitée à proposer deux sections dans le catalogue qui retrace ces années de travail. Dans la première, tout est présenté de façon très claire et dans l’intégralité de sa conservation. Et dans l’autre, je propose des gros plans, des ouvrages connexes ou du matériel de recherche connexe, et si c’est un livre, on voit quelques pages intérieures et des détails de la reliure.

Tauba Auerbach, Shatter I, 2008. Peinture acrylique et poussière de verre sur panneau, 162.56 × 120.65 cm © Tauba Auerbach.
Bob Linder
Je suis curieux de connaître ta relation avec Internet.
Tauba Auerbach
Une relation amour/haine, probablement assez banale. Je n’ai jamais eu Facebook. J’aime Instagram environ 25 % du temps, mais je ne peux pas non plus me donner la peine de l’utiliser régulièrement, alors je le consulte quand j’en ai envie. Certes je suis connectée toute la journée, je fais des recherches au fur et à mesure que des questions se présentent, mais je n’ai pas pris l’habitude de poser des questions sur Internet avec des phrases complètes.
Bob Linder
Je sais que tu travailles avec des fabricants et des assistants, mais tu es une artiste très manuelle. Ton atelier est-il un lieu d’expérimentation ou crées-tu de manière plus systématique ?
Tauba Auerbach
Pas du tout systématique, probablement à mon détriment. L’atelier comporte beaucoup d’espaces différents entre lesquels je navigue,et il contient beaucoup d’outils, d’équipements et de tables couvertes de piles de livres, de dessins et de boîtes.
J’ai une employée à temps plein qui porte plusieurs casquettes, mais qui m’aide surtout à ne pas me perdre au niveau administratif, et j’ai aussi une employée à temps partiel responsable de la production pour Diagonal Press. Ce sont des personnes merveilleuses et talentueuses (merci Allison et Kathleen !), mais je n’aspire à rien d’autre en tant que « patronne ».
Je ne veux pas « diriger une entreprise » et je veux fabriquer moi-même mes œuvres autant que possible, donc en ce qui concerne la collaboration avec des fabricants, je sous-traite le moins possible.
En général, il s’agit de travail du métal ou de découpes sur une machine à commande numérique (merci Michael DeLucia !). Si je peux apprendre à fabriquer un objet moi-même et faire en sorte de pouvoir le réaliser dans mon studio, je le fais. Après avoir commandé une pièce en verre, j’ai appris à travailler au chalumeau pour pouvoir sculpter le matériau moi-même. Je viens d’installer un four à verre dans mon sous-sol, c’est super !
Je veux surtout être seule dans mon atelier pour pouvoir réfléchir. Je passe beaucoup de temps à faire des recherches et à créer des choses que je ne montrerai jamais à personne ou qui n’ont pas de finalité précise. Je viens de passer des heures à rédiger un document détaillé sur un processus de tissage, que je n’ai envoyé qu’à cinq personnes. Je crois beaucoup à ce genre de travail en tant qu’investissement dans le développement de la pensée, et « être productif » peut signifier beaucoup de choses. De plus une idée mérite-t-elle d’être tenue à une distance critique ?
Bob Linder
Peux-tu donner aux lecteurs une idée de tes projets pour 2021 ?
Tauba Auerbach
Une série d’interviews – dans lesquelles je poserai les questions !