Odorama
Chapitre quatre
Teddy Lussi-ModesteJean-Marie Binet
Le réalisateur et scénariste Teddy Lussi- Modeste continue son exploration olfactico-cinématographique débutée il y a trois numéros déjà. Avec Odorama, il associe une fragrance à un film, faisant se rencontrer ses souvenirs de spectateur et les ingrédients qui composent cette collection de parfums. Entre western d’auteur, biopic et anticipation, entre notes de jasmin, d’oud ou de cuir, ce quatrième chapitre raconte au-delà des formules.
Recedere
Arpa Studio
Nez : Barnabé Fillion
Il n’est pas sûr d’être Kane. Elle n’est pas sûre d’être Lena non plus. Que sont-ils devenus après avoir pénétré la zone délimitée par le miroitement, cette paroi moelleuse et iridescente ? Qu’ont-ils trouvé dans ce phare à partir duquel se déploie la lumière prismatique ? Plus ils s’en sont rapprochés, lui et son équipe masculine de militaires, elle et son équipe féminine de scientifiques, plus leur ADN s’est mêlé à celui des fleurs et des animaux dont l’ADN lui-même s’était déjà mêlé à toutes les espèces environnantes. Dans cet écosystème, les cerfs ont des bois fleuris, les crocodiles des dents de requin, les ours la voix des êtres humains qu’ils ont dévorés. Kane et Lena sont restés homme et femme mais ils sont devenus autres, Adam et Ève d’une nouvelle espèce, ni bien ni mal intentionnés, mais voulant simplement persévérer dans son être. Recedere est un parfum qui nous vient du futur. Il est si puissamment fougère qu’il semble devenir minéral. Certaines notes sont si poussées qu’elles semblent quitter leur famille olfactive pour en épouser une autre. La fragrance a l’odeur d’un rocher chu d’un autre monde, ou d’un désastre obscur, sur lequel sont venus pousser de l’armoise et de la sauge, de l’hiba et de l’iris. Autorité et austérité exhalent de ce parfum résolument vert et pointu.
Inspiré par Annihilation d’Alex Garland
Bourrasque
Le Galion
« Marcel ! MARCEL ! » La grand-mère est inquiète. La santé de son petit-fils est si fragile. Marcel trouve pourtant son bonheur en barbotant dans les vagues qui viennent lécher la côte normande, là où se dresse, splendide, ce lieu de villégiature de la bonne société parisienne, le Grand Hôtel de Balbec. Répondant à l’appel angoissé, voici Marcel qui sort de l’eau, innocent et naïf, des ancres brodées sur son maillot de bain, pour rassurer l’aïeule. C’est là que surgit le baron de Charlus qui attendait, tel un fauve, la possibilité d’un échange retors et fielleux : « Mais on s’en fiche bien de sa grand-mère, hein, petite fripouille. – Mais comment, Monsieur, je l’adore ! » C’est alors qu’a lieu une leçon de mondanité, leçon suffisamment cuisante pour qu’elle forge une personnalité : ne jamais parler avant d’avoir pénétré le sens caché de toute chose. Le frêle adolescent écoute subjugué l’arbitre des élégances dont les mots autant que le parfum l’impressionnent. Le si bien nommé Bourrasque vous parvient par vagues poussées par le vent. Tour à tour cuiré, chypré, animal, épicé, floral, c’est un parfum aux multiples facettes. Toutes les notes sont si bien mêlées les unes aux autres qu’il est difficile de les identifier. C’est un parfum complet et complexe, ou plutôt : qui dissimule sa complexité derrière sa complétude. Marcel saura désormais ce qu’il risque quand il parle avec un monsieur aussi bien parfumé.
Inspiré par Le Temps retrouvé de Raul Ruiz

Bourrasque
Le Galion
Cuir de Russie
Chanel
Olivier Polge
« Where the fuck I am ? » Elle ne croit pas si bien dire cette femme qui a tant de mal à trouver sa place. Elle roule dans la campagne anglaise et ne trouve plus sa route alors qu’elle a grandi ici, près de Sandringham House, et que l’épouvantail croisé sur le chemin porte toujours la veste de son père. Elle sera en retard pour les célébrations de Noël et ce ne sera que le début d’une longue liste d’impairs impardonnables aux yeux de la famille royale. L’étiquette est pesante : on a décidé pour elle quelle robe elle devait porter à chaque moment de la journée. Même les beaux tuyaux de la douche dessinent autour d’elle une prison cuivrée. Si cette femme portait un parfum, ce serait Cuir de Russie dont le chic ne cesse de briller à partir de sa formule ancienne. L’ouverture du parfum, résolument hespéridée, puis florale, contraste avec une assise grasse et obscure. Difficile d’imaginer sans l’avoir éprouvé soi-même, sur sa peau, ce chemin que la fragrance va parcourir. Le bouleau, le cuir et le tabac recouvriront la bergamote et la mandarine, puis le jasmin, la rose et l’ylang-ylang, laissant sur la peau une épaisseur cuirée et légèrement fumée, parfois piquée de notes plus fraîches. Présenté comme une eau de toilette, ce parfum est dense comme un extrait. Cuir de Russie réconcilie puissance et élégance, esprit vintage et modernité.
Inspiré par Spencer de Pablo Larraín

Cuir de Russie
Chanel
Habdan
Parfum de Marly
Il lui faut remonter la rivière pour être véritablement seul et se baigner à l’écart des jeunes garçons de ferme qui batifolent dans l’eau claire. Là, il pourra sortir ce bout d’étoffe blanche siglé des initiales de Bronco Henry. Comme la selle qu’il cire et lustre chaque soir, ce tissu hérité du maître est une relique. « Phil et son frère sont les Rémus et Romulus de ce loup qui les a faits hommes », dit fièrement cet ancien étudiant en lettres classiques devenu cow-boy viriliste et toujours recouvert d’une crasse honnête. Qu’il sent bon ce bout de tissu dont il caresse son visage, qu’il porte à son torse et à sa nuque lors de ce bain lustral. Il porte l’odeur puissante de cet homme qu’il a aimé et auquel il fut lié comme l’éromène à son éraste. C’est un parfum de cavalier, à la fois ultra-masculin et ultra-sensible. C’est une fougère puissante orientalisée par les notes de safran et d’oliban, par celles aussi de myrrhe et de caramel. Monte parfois de ce tourbillon boisé une odeur de pomme – parfois crue, parfois cuite – parfois chaude, parfois froide. C’est cette odeur que Phil aimerait laisser en héritage à Peter, ce garçon sensible qu’il a commencé par humilier avant d’en tomber amoureux.
Inspiré par Le Pouvoir du chien de Jane Campion

Habdan
Parfum de Marly
Santal Pao Rosa
Guerlain
Nez: Delphine Jelk
Jamais spectateur ne fut aussi bien accueilli par un film. Cette indienne exécute pour nous, à même le sol, après avoir délayé de la farine de riz dans de l’eau,un rangoli fait de points et de pétales. Puis le récit commence sur ce fleuve qui prend sa source dans l’Himalaya et vient se jeter dans le Golfe du Bengale. C’est ici que vivent, dans une belle maison, Harriet et toute sa famille. Leur vie à tous est bouleversée par l’arrivée du capitaine John, ancien militaire ayant perdu une jambe à la guerre. Trois jeunes filles tomberont amoureuses de John : Harriet, mais aussi Stephanie et Melanie. Mais pourtant aucune ne l’épousera. Il ne sera question pour toutes que d’un premier amour. « Toutes les histoires d’amour se ressemblent mais ici elle a un parfum particulier dit la voix off », Elle a ce parfum jailli de Melanie lorsqu’elle danse en sari pour Krishna, devenue elle-même Lady Radha, dans le conte inventé par Harriet sur son petit cahier. La densité de Santal Pao Rosa est aussi enthousiasmante et prodigieuse que cette danse séculaire. Tout ici est en surdose : le santal, bois indien aussi doux et lacté qu’un lassi, la cardamome et ses éclats de fraîcheur, le oud, la myrrhe, mais aussi la figue qui semble mieller le jus déjà bien épais. Porter ce parfum est un délice, pour les autres et pour soi.
Inspiré par Le Fleuve de jean renoir
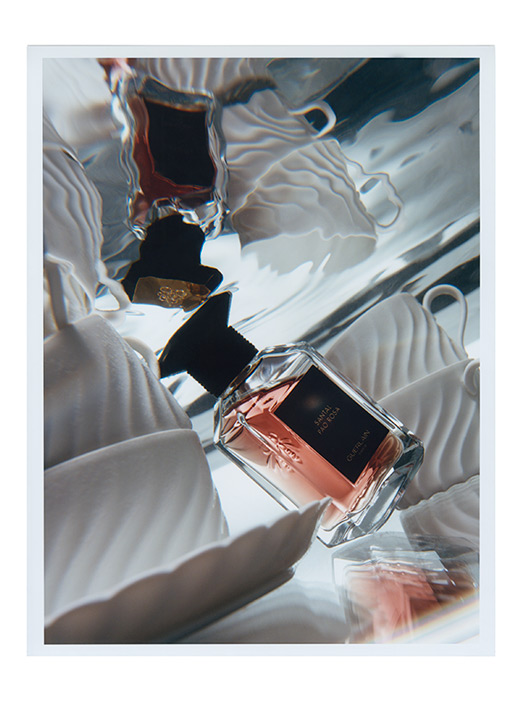
Santal Pao Rosa
Guerlain
Nero Oudh
Tiziana Terenzi
Nez: Paolo Terenzi
Il n’en est pas le protagoniste et pourtant c’est son nom à lui que porte la série. Il faut attendre quelques scènes dont Will Graham, profiler empathique, est le héros, avant de le voir apparaître enfin. La caméra filme le dessous de la table en verre, saisit une grenade et des fraises – nature morte – puis remonte lentement vers le visage d’Hannibal Lecter. Gourmet, il apporte à sa bouche un morceau de viande délicatement coupée et sur lequel il pose une pointe d’agrume. « Vous et moi sommes pareils,il n’y a rien de terrifiant en nous », ose-t-il dire à Will qu’il est censé aider, lui le plus doué des psychiatres de Baltimore. Au visage de Will, traversé par des émotions contradictoires et douloureuses, Hannibal oppose un visage parfaitement granitique. Le dandy cannibale, toujours en costume trois pièces et cravate en soie, ne peut porter qu’un parfum puissant et vénéneux. Nero Oudh – Oudh Noir en italien – nous fait plonger dans la noirceur et l’humidité de l’ingrédient éponyme qui,parfois, laisse éclore et mûrir des notes plus vives de fleurs et de fruits. Mais le oud indien reste le soleil noir qui brille d’un éclat terreux et animal au fond de la fragrance. Comme Hannibal, Nero Oudh, imposant et mystérieux, en dit – mais en cache aussi – beaucoup.
Inspiré par la série Hannibal développée par Bryan Fuller

Nero Oudh
Tiziana Terenzi
Oud Satin Mood
Maison Francis Kurkdjian
Nez: Francis Kurkdjian
Elle a une réputation à tenir. À Rome, ses bains, ainsi que ses mœurs, sont célèbres. Quand l’aveugle qui lui récite des vers de Catulle lui annonce l’arrivée imminente de César, elle fait de la mise en scène. Allongée lascive sur une méridienne, ses servantes affairées autour d’elle – l’une lui peint les ongles, l’autre la coiffe, l’une danse devant elle, l’autre joue de la harpe –, elle reçoit le général romain avec nonchalance alors qu’elle doit négocier avec lui sa place sur le trône d’Égypte. César, revêtu de sa plus belle armure, s’approche, conquis par la beauté de la fille d’Isis. Le parfum de la déesse-femme est si puissant que César en est cueilli dès qu’il pénètre dans le gynécée. Oud Satin Mood est un parfum royal où se mêlent la rose de Damas et celle de Turquie, la violette et l’ambre, la vanille et cette matière autour de laquelle toutes les notes s’assemblent : le oud. Francis Kurkdjian est allé chercher aux quatre coins du monde les plus belles matières qui soient. Ce parfum est aussi doux et épais que cette étoffe – du satin ? – qu’une servante replace sur la cuisse adorable et laiteuse de la reine. Il fallait en effet la dissimuler aux yeux séduits du futur amant qui récite à son tour quelques vers de Catulle : « Donne-moi mille et mille baisers… ».
Inspiré par Cléopâtre de Joseph L. Mankiewicz

Oud Satin Mood
Maison Francis Kurkdjian





Photographe: Jean-Marie Binet
Décorateur: César Sebastien

Faux-semblant
Brice Dellsperger
Se plonger dans l’œuvre de Brice Dellsperger, c’est revisiter un pan de l’histoire du cinéma à travers les films fétiches de l’artiste. S’il a consacré certaines de ses pièces à David Lynch, Gus Van Sant ou encore Paul Verhoeven, son réalisateur de prédilection reste Brian de Palma, cinéaste de l’outrance et de la citation dont la filmographie fait d’incessants allers-retours avec celle d’Alfred Hitchcock. En récréant des scènes qui ont marqué sa mémoire de spectateur, l’artiste français leur rend hommage tout en soulignant les thèmes qui les traversent, dessinant ainsi les contours de sa propre réflexion. Identification, genre, artifice, les sujets de réflexion sont nombreux sans pourtant être convoqués solennellement puisqu’ici, tout s’apprécie à travers le plaisir pop du cinéma.
C’est en 1995 que Brice Dellsperger signe la première vidéo de sa série Body Double. D’une durée de quarante-huit secondes, diffusée en boucle, il y rejoue le rôle de Kate Miller, interprété par Angie Dickinson dans Dressed to Kill (1980) de Brian de Palma. En se travestissant pour se glisser dans la peau de cette femme au foyer, le vidéaste place le je et le jeu au cœur de sa pratique. C’est à la fois sa mémoire de spectateur et ses interprétations qui seront traitées à travers ces re-créations tout aussi rigoureuses dans leur mise en œuvre que ludiques dans leur réception. En 2020, Brice Dellsperger présentait son 37ème Body Double (de nouveau consacré à l’inépuisable Dressed to Kill).Ce nombre conséquent permet d’affirmer une chose : si le principe du remake est la ligne directrice qui sous-tend son travail, Brice Dellsperger ne s’impose aucune règle qui viendrait étouffer sa créativité. Dans Body Double 31, célébrant le Basic Instinct (1992) de Verhoeven, le personnage de Catherine Tramell affirme : « I don’t make any rules, I go with the flow. » (Je ne fixe aucune règle, je prends les choses comme elles viennent.) Une prise de position que l’artiste semble s’approprier. Y aurait-il pourtant quelques éléments qui viendraient contrarier cette liberté ? Brice Dellsperger répond :

Brice Dellsperger, Body Double 5, 1996, 5’40. Acteur : Brice Dellsperger. Production : Brice Dellsperger. Avec l’aimable autorisation de l’artiste et des galeries Air de Paris (Paris) & Team Gallery (New York).
« Le travail se construit sur les relations avec les gens avec qui je collabore, et bizarrement, j’ai parfois plus de retenue envers eux que l’inverse. Mais la limite la plus importante reste matérielle. Dans mes films, je ne construis que ce que l’on voit dans l’image. »
Évoquer l’œuvre de Dellsperger amène à aborder la question de l’interprète. S’il a commencé à jouer lui-même dans ses vidéos pour des raisons pratiques, il a également fait appel à d’autres comédiens, professionnels ou non. On retrouve notamment l’artiste Jean-Luc Verna, connu pour sa pratique décomplexée du dessin : « Il fait partie de mon cercle d’amis. Et puisqu’il est en permanence en train de jouer des personnages,cela me semblait assez naturel de lui demander. Contrairement à moi qui n’avait aucune dextérité, Jean-Luc se maquillait tout le temps, ce qui facilitait les choses ! Nous étions dans une communauté d’esprits ce qui a rendu la collaboration très naturelle. En parallèle, j’ai réalisé quelques castings sauvages en demandant à des personnes rencontrées dans la rue ou dans des clubs s’ils voulaient jouer pour moi. C’est un exercice particulier car contrairement à un casting classique où les gens viennent car ils souhaitent tourner pour toi, il faut là aller vers eux, se présenter et les convaincre. Aujourd’hui, je choisis des personnes qui sont déjà professionnellement engagées, mais je continue parfois de me mettre en scène, car je pense qu’il est toujours bien de revenir aux sources. » Il est pertinent également de s’attarder sur le titre même de la série de Dellsperger. Body Double est un thriller érotique de Brian de Palma sorti en 1984 dont l’intrigue, se déroulant à Hollywood, repose sur l’utilisation d’une doublure, ces acteurs anonymes employés lors de cascades ou autres scènes de nu. Si le vidéaste devient la doublure des personnages qu’il incarne, alors les autres interprètes avec lesquels il collabore sont quant à eux les doublures de l’artiste. Certains Body Double (le 8, d’après Return of the Jedi (1983) de Richard Marquant, ou encore les 9, 10 et 12, de nouveau consacrés au cinéma de Brian de Palma) se présentent sous la forme de triptyque. Les vidéos sont diffusées simultanément et on y voit trois interprètes différents rejouer la même scène. C’est dans cette substitution que se révèlent les singularités de ces acteurs – leur physique, leur gestuelle,mais aussi le caractère commun des personnages qu’ils incarnent, à travers les histoires archétypales qu’offre le cinéma. À propos de cet effet d’écho, Brice Dellsperger commente :
« Je pense que mon travail parle effectivement de cette universalité. Elle est difficile à accepter car elle n’est finalement qu’une banalité. Mais il s’agit aussi de la question de l’identification au cinéma. De quelle manière l’inconscient travaille lorsque l’on s’identifie à un personnage ? Comment se met en place cette possibilité de se reconnaître sans pour autant connaître ? Cependant je ne cherche pas vraiment à livrer une interprétation psychologique de mon travail. J’y vois plutôt une formule mathématique que j’applique et qui produit des effets variables en fonction des individus. Moi-même je ne peux pas voir mes films comme les autres les découvrent. »
Le cinéma célèbre l’artifice, que ce soit par son utilisation du maquillage – le plus rudimentaire des effets spéciaux – ou le principe même de mise en scène. En se travestissant, l’artiste utilise donc l’un des principaux fondamentaux du 7e art. Si la philosophe américaine Judith Butler questionne l’identité à travers le genre depuis les années 1990, la démocratisation et la vulgarisation de sa réflexion, digérée par la culture pop, est plus récente. Lorsqu’on demande à Dellsperger si son travail est politique, il répond : « Mes œuvres n’ont pas cette forme de radicalité qui était caractéristique de l’art politique tel qu’on le concevait lorsque j’ai débuté ma carrière. Ma pratique veut passer pour quelque chose qu’elle n’est pas, elle veut se faire accepter. C’est l’idée d’un rapprochement, de la séduction. Mais puisque cela fait un moment que je développe cette approche, et que tout est politique aujourd’hui, alors je pense que l’on peut dire que mon travail l’est également. Ma manière d’être politique se situe peut-être ailleurs et dépasse la question du genre. Isoler au sein d’un film un élément plutôt qu’un autre me permet d’apporter un éclairage nouveau. »
À travers la série des Body Double, on ressent la passion cinéphile du plasticien. Nous vient forcément l’envie de lui demander quels sont les derniers longs-métrages qu’il a vu. « J’ai apprécié After Blue (2022) de Bertrand Mandico, c’est un objet totalement incroyable. J’ai compris que je l’avais aimé car j’ai envie de le revoir. Dans un autre registre, j’ai revu Buffet Froid (1979) et Tenue de soirée (1986) de Bertrand Blier qui sont extraordinaires. Je ne sais même pas si on pourrait refaire des films comme ça aujourd’hui. Je reste très attaché à la période 1970-80 mais je continue à explorer et à chercher des films qui pourraient faire de nouveaux Body Double. » Les pronostics sont donc ouverts quant à l’inspiration de la 38ème doublure…

Brice Dellsperger, Body Double 12, 1997, 2’18. Acteurs : Alexia, Joy Falquet & Jean-Luc Verna. Images : Brice Dellsperger. Montage & effets spéciaux : Béatrice Marianni. Production : FIACRE. Avec l’aimable autorisation de l’artiste et des galeries Air de Paris (Paris) & Team Gallery (New York).
entretien avec muriel stevenson
De terre et d’or
Daniel Kruger
La sculpture de Daniel Kruger se développe autour de deux pratiques qui peuvent sembler éloignées : la céramique, plus particulièrement l’art de la table, et la joaillerie. Toutes deux fonctionnelles, elles questionnent le rapport à l’ornement et au décoratif. Si les expérimentations menées depuis plus de quarante ans par l’artiste Sud-Africain, aujourd’hui installé à Munich, ont donné naissance à un corpus d’œuvres extrêmement variées, elles témoignent d’un goût prononcé pour l’humour et d’une sensibilité « camp ». En conversation avec Florian Champagne, Daniel Kruger discute de ses idéaux de beauté, et de son rapport aux corps – ceux évoqués, représentés, parfois même moulés dans la céramique, mais aussi les corps de ceux qui entrent en relation avec ses créations.
Florian Champagne
Sur vos céramiques comme sur vos bijoux, on retrouve le corps humain et certaines de ses parties. Considérez-vous que le corps vous sert de simple « motif », ou tient-il aussi un autre rôle ? Certaines formes que vous utilisez dans votre travail font-elles aussi consciemment référence au corps ?
Daniel Kruger
Je fais référence au pénis de manière indirecte, par exemple avec des pommes de pin et d’autres images dans lesquelles on peut voir une référence aux organes génitaux masculins – si on veut les voir de cette manière. Mais j’utilise aussi des moulages de pénis. Les formes phalliques se retrouvent aussi souvent dans mes bijoux, de manière implicite. Les bijoux sont manipulés et flexibles, ce qui leur confère une dimension supplémentaire de sensualité. Il y a aussi une différence entre avoir un objet phallique posé, détaché de soi, sur une table, ou le porter sur soi.
Les ossements font référence à un memento mori. Il s’agit de moulages d’os d’animaux provenant d’articulations prélevées sur de la viande déjà cuite et consommée. Il y a une série d’assiettes qui contiennent, ou présentent, des pierres, des brindilles et des os, comme des collections. Ces objets sont également attachés à des vases de la même forme que ceux présentant des images de garçons, de sportifs enlacés, de produits de la nature ou de la civilisation.
Florian Champagne
Les parties du corps que nous voyons sur votre céramique racontent-elles une histoire particulière ?
Daniel Kruger
Les moulages sont bien sûr réalisés sur des personnes, mais les céramiques ne racontent pas l’expérience vécue avec les modèles ou celle de la réalisation des moulages.

Daniel Kruger, Vase Sponges, 2005. Biscuit de porcelaine et dorure, 30 × 21 × 21 cm. Collection D.K. Photographie d’Udo W. Beier. Avec l’aimable autorisation de la galerie Caroline Van Hoek.
J’utilise les moulages de façon très littérale : quand c’est un pénis, c’est un pénis et quand c’est une pomme de pin, c’est une pomme de pin. Si vous voulez voir un pénis dans la pomme de pin, je le comprends parfaitement parce que je le fais aussi.
Ils racontent une histoire intemporelle, si ce n’est que de nos jours nous attachons moins d’importance à la fertilité et davantage au plaisir, à la séduction et aux prouesses. Exhiber ses organes génitaux est considéré comme un acte obscène : ça ne se fait pas. C’est donc aussi une provocation.
Florian Champagne
Il y a parfois quelque chose de presque répugnant dans votre façon de faire référence au corps – avec la série d’assiettes Manneken Pis, ou la table d’appoint d’où jaillissent des pénis bleus… Ces pièces contrastent beaucoup avec celles à l’imagerie plus classique. Voulez-vous montrer comment le corps peut être à la fois charmant et dégoûtant ou s’agit-il d’humour ?
Daniel Kruger
Un dicton veut que lorsque quelque chose a très bon goût, c’est comme si un ange vous pissait sur la langue. Le Manneken est un petit garçon dans lequel on pourrait voir un ange, mais aussi un vilain petit garçon qui pisse dans la soupe. Pour moi, ces assiettes relèvent de l’humour et de la provocation. Elles sont destinées à être utilisées, par les moins impressionnables d’entre nous.
Florian Champagne
En regardant des photos de votre atelier, on remarque quelques statues d’hommes, classiques de l’époque gréco-romaine. Les objets en céramique – l’un des deux principaux médiums avec lesquels vous travaillez – font partie des productions artistiques antiques les plus célèbres. Votre travail fait-il référence à ces normes de beauté antique, ou s’agit-il d’inspirations plus abstraites ?
Daniel Kruger
Pour un de mes services de table, j’ai peint un athlète au corps magnifique dans des poses qui rappellent des sculptures gréco-romaines disposées dans un paysage. C’est une référence à l’Arcadie, avec un personnage idéalisé se déplaçant dans une nature idéalisée. Les nuages dorés et le ruban bleu sous-tendent une idée de beauté et de sérénité.

Daniel Kruger, Desserte, 1992. Argile et vernis, 30 × 30 × 32 cm. Collection D.K. Photographie d’Udo W. Beier.
J’utilise également des représentations d’hommes à l’apparence très banale qui ne reflètent en aucun cas un idéal mais plutôt l’« homme ordinaire ». Il y a une série de vases avec des motifs de garçons, un maigrichon ou un gros, un joli garçon etc. qui expriment le charme et la fragilité de la jeunesse.
Florian Champagne
Les motifs figuratifs dans vos céramiques semblent apparaître dans les années 1990. Les avez-vous intégrés dans vos créations pour une raison particulière ?
Daniel Kruger
Quand j’ai commencé à travailler la céramique, j’ai expérimenté des formes décoratives. Je cherchais des formes qui me fourniraient des surfaces sur lesquelles dessiner et peindre. J’ai décidé de travailler sur de la porcelaine produite en Europe : la porcelaine de Dresde. Ce qui m’a attiré et inspiré dans cette première période, c’est la recherche d’une interaction avec des formes et des décors asiatiques, la manière dont ils ont été réinterprétés dans un style européen et le défi technique quand on explore un nouveau support aussi indocile que la porcelaine. C’est ce que je faisais aussi : créer des formes et des décors et, comme dans les exemples historiques que je regarde, utiliser des motifs figuratifs. Dans la phase ultérieure de mon travail avec la céramique, les motifs figuratifs sont des photos ou des moulages d’objets réels.
Florian Champagne
La dimension homoérotique des sculptures et des céramiques antiques est, la plupart du temps, invisible pour le spectateur contemporain ; alors que je dirais qu’on la retrouve souvent lorsque l’on regarde des céramiques plus contemporaines représentant des hommes – qu’il s’agisse de joueurs de football ou de jeunes hommes dénudés. Jouez-vous avec cette idée consciemment ?
Daniel Kruger
L’aspect homoérotique est très présent dans mes céramiques. C’est délibéré. Je suis cependant certain que les hommes et les femmes hétérosexuels peuvent également apprécier la sensualité des corps masculins et apprécier l’humour.
Florian Champagne
Quelle est votre relation avec la masculinité représentée dans vos céramiques ? Est-ce un idéal personnel, ou y voyez-vous l’idéal de la société dans laquelle vous vivez ? Ou bien cela ne se rapporte-il pas à un idéal, mais tente d’aborder un autre aspect ?
Daniel Kruger
Il y a le « féminin », il y a le « masculin » et j’étudie un aspect de cette question de mon point de vue d’homme gay. C’est un point de vue personnel, mais je pense que d’autres le partagent et qu’il reflète des attitudes présentes dans notre société actuelle.
Le contact physique entre hommes est naturel dans certaines sociétés et tabou dans d’autres. Les images de sportifs qui s’étreignent sont de simples instantanés qui s’inscrivent dans un contexte particulier et n’impliquent pas une relation érotique entre eux. C’est là où je veux en venir : représenter le contact physique désinhibé entre hommes en tant qu’expression d’une certaine intimité et de l’amitié, leur sexualité réelle étant secondaire et pas nécessairement figée.
Florian Champagne
Le transfert d’images sur de la céramique pose la question de la mémoire. ces images sont-elles en quelque sorte élevées au rang d’icônes de notre époque ou sont-elles simplement des moments fugaces de la vie de ces hommes, qui cherchent à être préservés et honorés ?
Daniel Kruger
Les figures masculines sont utilisées comme des icônes, certaines héroïques, d’autres non.

Daniel Kruger, Vase Jet Fighters, 2000. Porcelaine, vernis et dorure, 30 × 19 × 19 cm. Collection D.K. Photographie d’Udo W. Beier. Avec l’aimable autorisation de la galerie Caroline Van Hoek.
Les sportifs sont des icônes, les héros de notre temps. Ils sont agiles et rapides, rusés et ingénieux, admirés et enviés pour leur corps, mais aussi pour leur intelligence. On reconnaît certains de ces sportifs, mais ce n’est pas de cela qu’il s’agit. Il s’agit d’une idéalisation de l’époque, mais aussi d’une évocation et d’une réinterprétation du passé.
Puis il y a les photos d’hommes anonymes au physique ordinaire. Elles racontent elles aussi des histoires, ou bien on peut y trouver des échos de sa propre histoire.
Florian Champagne
Bien que peu de vos bijoux soient anthropomorphes, il existe une relation évidente entre un bijou et le corps de celui qui le porte. Cet aspect vous intéresse-t-il et le prenez-vous en compte dans vos créations ?
Daniel Kruger
Je créé principalement des bijoux, mais la céramique me donne l’occasion de travailler à plus grande échelle, d’exprimer des idées différentes, de dessiner et de peindre. Comme pour les bijoux, il est important que les pièces soient utilisées, dans le sens où elles font partie de notre vie et de notre environnement, des choses avec lesquelles on vit et interagit régulièrement : les bijoux portés sur soi, les assiettes dans lesquelles on mange et les vases dans lesquels on peut mettre des fleurs.
Florian Champagne
Même question pour les pièces en céramique : les avez-vous toujours considérées avant tout comme des objets destinés à être utilisés et touchés, ou y a-t-il dès le départ autre chose en jeu lorsque vous les créez ?
Daniel Kruger
Je m’inspire d’idées du passé que l’on observe sur des objets et des images et je les repense en les adaptant au présent.
Je souhaite exprimer la vénération, l’ironie, l’humour, l’enthousiasme, l’amusement, l’envie, le désir. C’est ce qui est sérieux dans tout cela.
Florian Champagne
Votre travail balaie un large spectre de la création. Y a-t-il des artistes dont vous vous sentez proche, qui seraient de la même « famille artistique » que vous ?
Daniel Kruger
Je ne me sens proche d’aucun artiste en particulier, contemporain ou ancien. Mais j’ai beaucoup de petites sources d’inspiration, des œuvres que j’admire et qui m’inspirent. Il m’arrive aussi de voir une œuvre d’art et de l’ « utiliser » à des fins personnelles. Mais ensuite, en réfléchissant à l’objet que je veux créer, puis en le créant, elle change du tout au tout. C’est notamment le cas des pièces qui font référence aux premières porcelaines de Meissen. Je visite le passé et je les repense dans le présent, telles que je les comprends – je me les approprie.
Florian Champagne
Vos céramiques peuvent avoir un côté humoristique, voire irrévérencieux. Avez-vous des anecdotes à ce sujet, des réactions qui vous ont surpris ou amusé ?
Daniel Kruger
Je trouve le côté humoristique très important. Je ne parlerais cependant pas d’irrévérence, à moins qu’il s’agisse d’irrévérence ludique. On peut se moquer de quelqu’un ou de quelque chose tout en lui portant de l’admiration et de l’estime. Je ne méprise ni ne ridiculise rien. Si l’on rit, c’est que l’on prend du plaisir et que l’on s’amuse.
Intérieur jour
Justin Morin
Une chaise à l’acier froid et chromé pour une salle d’interrogatoire. Un papier peint psychédélique comme métaphore des névroses d’un personnage. Un luminaire réduit à une forme minimale pour préfigurer le futur. Les éléments de mobiliers sont autant d’indices narratifs, précieux éléments muets qui dévoilent l’histoire qui se joue dans les films. Qu’il s’agisse de récits d’anticipation, de drames contemporains ou de long-métrages d’horreurs, chaque genre a développé ses propres codes en matière de design d’intérieur. Et il arrive que le décor devienne un acteur à part entière, renouvelant ainsi les règles d’usage. Retour sur sept films à l’approche singulière.
Mon oncle
Jacques Tati
1958
Troisième film du réalisateur français Jacques Tati, et premier essai en couleur, Mon oncle est une satire sociale qui met en parallèle Monsieur Hulot (interprété par le réalisateur), aussi doux rêveur que gaffeur, et la famille de sa sœur. Cette dernière vit en compagnie de son mari, industriel ayant fait fortune dans le plastique, dans une somptueuse villa moderniste qui fait leur fierté. « Toutes les pièces communiquent », lance-t-elle fièrement à tous les visiteurs. La maison, remplie de gadgets technologiques, semble pourtant peu attirer le petit Gérard, 9 ans, et son chien, qui préfèrent tous deux faire les quatre cents coups dans le terrain vague de la ville. Au générique de Mon oncle sont crédités Henri Schmitt et Eugène Roman pour les décors, mais aussi Jacques Lagrange, peintre et proche collaborateur du réalisateur.
Hautement chorégraphié, le film fait se succéder les trouvailles visuelles. L’action passe de l’usine et de sa logique fordiste à la place animée du village, de l’immeuble foutraque de Monsieur Hulot à la maison cubique de sa sœur. Et le jugement de Tati sur l’architecture moderniste est sans appel : cette dernière manque cruellement d’âme. Et pourtant, en voyant aujourd’hui cette comédie, on ne peut que sourire en constatant que certaines de ses formes, qu’il s’agisse du plan de la villa Arpel – du nom de ses habitants – ou de son mobilier, sont aujourd’hui célébrées, voire reprises par certains designers. Ultime ironie, trois pièces iconiques de ce décor ont été reproduites et réalisées par la Maison Domeau & Pérès. On retrouve donc le sofa de Madame Arpel, composé de deux cylindres de mousse, l’un pour l’assise, l’autre pour le dossier. Tapissés d’un vert sapin graphique, ils reposent sur des pieds métalliques noirs. Dans la même couleur, le banc de M. Hulot amuse par ses proportions et sa forme de haricot. Enfin, une chaise à bascule jaune aux piètements métalliques blancs revisite ce classique du mobilier à la sauce moderniste. Dévoilées en 2007 à Paris dans un décor récréant la Villa Arpel, exposé au Pavillon français de la Biennale d’architecture de Venise en 2014, ces pièces au statut hybride, entre sculpture et design, font aujourd’hui partie de collections publiques et privées, témoignant à la fois de l’histoire du cinéma et du design.

Mon oncle, Jacques Tati, 1958
Dolor y gloria
Pedro Almodovar
2019
Si l’on doit résumer les décors des films qui jalonnent la carrière de Pedro Almodovar, on pensera certainement à des bibelots accumulés dans des intérieurs aux couleurs criardes. Après tout, le réalisateur fut le fer de lance de la Movida, courant culturel et artistique célébrant l’exubérance et la joie de vivre dans l’Espagne des années 1980, tout juste sortie du régime dictatorial de Franco. Si son cinéma s’est assagi esthétiquement, il n’en reste pas moins inventif et fort en rebondissements. Son vingt-et-unième film, Douleur et gloire, met en scène Antonio Banderas dans le rôle de Salvador Mallo, réalisateur empêtré dans ses douleurs physiques et morales. Difficile de ne pas y voir une dimension autobiographique tant les similitudes entre Almodovar et Mallo sont nombreuses. Bien évidemment, on pense à la métamorphose physique de Banderas. Mais d’autres détails, bien moins explicites, sont présents. L’appartement de Mallo est une copie de celui d’Almodovar – il en reprend du moins les éléments de mobilier les plus singuliers. Signé Antxón Gómez, collaborateur de longue date, ce décor est un mélange de quotidienneté et d’exceptionnalité. Ainsi, les yeux aguerris des amateurs de design pourront reconnaître la lampe Eclisse créée en 1967 par Vico Magistretti. Un cabinet signé Piero Fornasetti, reconnaissable par son motif de papillons multicolores, est posé dans le salon, non loin d’un ensemble de chaises 637 Utrecht de Gerrit Rietveld, elles-mêmes à proximité de la lampe Pipistrello de Gae Aulenti. À quelques pas d’une fausse affiche d’un film de Salvador Mallo, un poster sérigraphié signé Enzo Mari, célèbre designer italien dont le travail a infusé tout un pan de la culture populaire, ajoute une touche colorée et graphique. Les clins d’œil se succèdent et pour autant, nul effet de showroom. Ici, le décor n’est pas là pour être ostentatoire mais pour raconter l’intime. Dans sa banalité, il est un témoin d’une histoire personnelle qui s’est construit dans le temps, au fil des objets et du mobilier glanés ici ou là.

Dolor y gloria, Pedro Almodovar, 2019
Evangelion : 3.0 + 1.0
Thrice Upon a Time
Hideaki Anno
2021
Légende de l’animation japonaise, la franchise Neon Genesis Evangelion déchaîne les passions depuis 1995, année de diffusion des 26 épisodes de la série originelle, déclinée par la suite en deux long-métrages, puis revisitée avec la tétralogie cinématographique Rebuild of Evangelion. Débutant comme une série d’action classique mettant en scène des adolescents pilotant des robots en charge de repousser une invasion extraterrestre, l’anime surprend par la place qu’il accorde à l’introspection de ses personnages, abordant frontalement le thème de la dépression. Au fil des formats – le titre est passé d’épisodes de 25 minutes réalisés sur celluloïds peints à la main à des long-métrages exploitant les possibilités offertes par les nouvelles technologies –, Evangelion impressionne par ses qualités techniques en termes de réalisation. Initialement prévu pour 2008, le film final Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time sort finalement en 2021, surmontant ainsi la dépression de son réalisateur, les embrouilles juridiques autour de la licence, une pandémie mondiale et l’impossibilité de conclure une œuvre devenue prisonnière de sa propre histoire. Les décors, à l’image de la complexité de l’œuvre, sont magistraux. Ils oscillent entre abstraction graphique et hyper-réalisme architectural. Le film s’ouvre sur une séquence épique de dix minutes se passant à Paris, montrant l’étonnante transformation de la ville lumière, où les immeubles Haussmanniens se surélèvent pour abriter du matériel de combat. Un peu plus tard, les protagonistes se retrouvent dans la campagne japonaise, dans un village de fortune qui abrite une société en pleine reconstruction. Dans le documentaire Hideaki Anno: The Final Challenge of Evangelion, sorti en parallèle du film, on découvre qu’une immense maquette a été réalisée afin de reconstituer cette ville. On y voit le réalisateur déplacer et replacer minutieusement les habitations, poteaux électriques et autres containers afin de leur trouver leur juste place. On pense évidemment à l’art de la maquette, grand classique du cinéma d’anticipation, notamment brillamment exploité dans le Metropolis de Fritz Lang. Avec cette même démarche avant-gardiste, Anno injecte dans son film d’animation des scènes réalisées à partir de motion capture pour trouver le cadrage le plus innovant. Le réalisateur multiplie les expérimentations graphiques sans pour autant renoncer à son récit. En vingt-cinq ans, Evangelion a mis en place un univers d’une créativité folle tout en témoignant de l’évolution de l’animation japonaise. Une saga méta à la richesse inouïe.

Evangelion : 3.0 + 1.0 Thrice Upon a Time, Hideaki Anno, 2021
Suspiria
Dario Argento
1977
Thriller surnaturel, Suspiria raconte l’histoire de Suzy Banyon, jeune ballerine américaine qui s’installe en Allemagne, à Fribourg, afin d’intégrer l’une des meilleures écoles de danse au monde. Très vite, l’héroïne va comprendre que celle-ci abrite des secrets plus terrifiants les uns que les autres. Avec ce récit aux allures de conte, Dario Argento, maître du giallo – ce genre cinématographique italien à la frontière du policier, de l’horreur et de l’érotisme, particulièrement en vogue dans les années 1960 à 1980 –, a mis en place un univers visuel détonnant. L’école est un personnage à part entière. Ici, la photographie saturée signée Luciano Tovoli se met au service de décors d’une gamme chromatique affirmée. Argento le dira à plusieurs reprises : l’une des inspirations esthétiques est le Blanche Neige (1937) de Walt Disney aux couleurs si particulières dues au procédé Technicolor. Suspiria est d’ailleurs l’un des derniers films tournés selon cette technique, perçue comme dépassée et contraignante, mais qui permet de réaliser un travail minutieux sur les couleurs primaires. Celles-ci viennent donc souligner les styles des différentes pièces de l’école : motifs géométriques qui habillent les sols et murs, vitraux et portes façon Art nouveau et peinture murale inspirée par les énigmes graphiques de Maurits Cornelis Escher. Ce mélange bigarré produit un effet saisissant. D’autres détails, moins évidents, sont à noter. Argento souhaitait initialement faire se dérouler son récit dans un pensionnat pour enfants, mais a renoncé à cette idée au vu des complications commerciales. Pour conserver cet aspect enfantin, il décide de faire surélever les poignées de portes du décor, afin d’amener les actrices de Suspiria à recréer la gestuelle si spécifique d’un corps confronté à un obstacle trop grand. Quarante et un ans plus tard, en 2018, Luca Guadagnino réalise un remake de ce classique de l’horreur. Grand amateur de décoration d’intérieur, ayant réalisé plusieurs projets de rénovation et d’aménagement sous cette casquette, son Suspiria se révèle également une somptueuse proposition en termes de décors. Mais là où Argento joue sur la saturation des couleurs, Guadagnino va à l’opposé et développe une palette muette révélant l’architecture même de l’école, suggérant la lecture du bâtiment comme celle d’un corps. Deux visions opposées, hallucinées et complémentaires.

Suspiria, Dario Argento, 1977
Speed Racer
Lana & Lilly Wachowski
2008
Des Wachowski, les amateurs de cinéma retiennent principalement la saga Matrix, désormais totem de la culture pop. Moins connu et pourtant tout aussi inspirant, leur cinquième film derrière la caméra est l’adaptation d’un dessin animé japonais datant des années 1960. De courses en courses, Speed Racer, jeune prodige de la course automobile, va déjouer les plans de la Royalton Industrie et restaurer l’honneur de sa famille. Si Matrix repose sur un univers visuel fait de nuances de gris et de touches vertes, alors Speed Racer est une bombe colorée survitaminée, assumant la saturation de ses images. Au générique, pour les décors, on retrouve Owen Paterson déjà à l’œuvre sur les précédents films du duo. Mais Speed Racer est un film qui révolutionne le genre – une affirmation simple mais qui pourrait résumer la philosophie globale des Wachowski – et propose donc une approche inédite. Entièrement filmées sur fond vert, les images que l’on voit à l’écran sont factices. Si la technique n’est pas nouvelle, l’application est ici différente. En répliquant les effets de plan inhérents aux techniques d’animation traditionnelles (un décor peint sur lequel sont apposées des feuilles de celluloid figurant les personnages), Speed Racer joue avec les superpositions. Ici, la question du focus est totalement éludée, ce qui crée des « incohérences visuelles » qui font le style du film. Générés par ordinateur, les décors proviennent de photographies prises aux quatre coins de la planète par l’équipe du film. Pour ce faire, les ingénieurs ayant travaillé sur Speed Racer ont développé une technique baptisée « Quicktime Virtual Reality Sphere ». Celle-ci permet de photographier un environnement sous forme de bulle, à 360 degrés, et de plaquer les images sur n’importe quel volume, recréant ainsi des espaces de manière précise tout en permettant des axes de caméra impossibles dans le réel. Autre point notable de Speed Racer, le décor devient un élément de montage à part entière. Puisque les images qui composent l’arrière-plan sont en constante transformation, elles peuvent également faciliter le découpage de l’action. Ainsi un personnage pourra séparer l’écran en deux et créer deux fonds différents, sans aucune cohérence, de part et d’autre. Les possibilités offertes par ce procédé, là aussi héritées du dessin animé, sont infinies. D’ailleurs, malgré son scénario simpliste destiné aux enfants, Speed Racer est un film visuellement complexe, presque éreintant. Échec au box-office international, il est de ces ovnis visionnaires qui méritent une seconde chance.

Speed Racer, Lana & Lilly Wachowski, 2008
Mishima: A Life
in Four Chapters
Paul Schrader
1985
Cinquième film de Paul Schrader en tant que réalisateur, Mishima : Une vie en quatre chapitres est un joyau de sophistication. Sur une bande originale signée Philip Glass, on découvre la vie de l’écrivain japonais Yukio Mishima, géant de la littérature et figure controversée. Plutôt que de suivre un déroulé chronologique linéaire, Schrader décide de faire le portrait de l’auteur en adaptant trois de ses nouvelles, comme autant de facettes autobiographiques. Pour donner forme à ce parti pris original, il collabore avec Eiko Ishioka. De sa formation de graphiste, cette dernière a gardé un sens des couleurs et des formes. Très rapidement, elle œuvre pour le grand magasin nippon Parco dont l’avant-gardisme publicitaire n’est plus à prouver. Pour Schrader, elle réalise costumes et décors. Elle imagine des environnements stylisés proches de scénographies pour le théâtre ou l’opéra. Elle attribue à chaque roman une gamme chromatique précise : Le Pavillon d’or se distingue par son utilisation de l’or et du vert, La Maison de Kyoko se pare d’un rose acide, Chevaux échappés ponctue le noir et le blanc de notes rouges. Fort de cette direction artistique singulière, le film sera récompensé au Festival de Cannes en 1985 par le prix de la meilleure contribution artistique (tant pour sa photographie, sa musique que ses décors et costumes). Par la suite, Eiko Ishioka sera notamment créditée en tant que costumière, même si son influence sera souvent plus large. Citons notamment Bram Stoker’s Dracula (1992) de Francis Ford Coppola, chef d’œuvre gothique qui modernise le mythe du célèbre comte. Impossible également de ne pas souligner la fructueuse collaboration qui la lie au réalisateur Tarsem Singh : The Cell (2000), thriller horrifique offrant un rôle à contre-emploi à Jennifer Lopez, The Fall (2006), fresque onirique à la démesure inégalée, Immortals (2011), péplum mythologique et enfin Mirror Mirror (2012), exubérante relecture de Blanche Neige pour laquelle Ishioka décrochera une nomination aux Oscars. Décédée en 2012, Eiko Ishioka laisse derrière elle un passionnant corpus d’œuvres, récemment présenté au MOT Museum de Tokyo lors de l’exposition monographique Blood, Sweat, and Tears – A Life of Design.

Mishima: A Life in Four Chapters, Paul Schrader, 1985
Cleopatra
Joseph L. Mankiewicz
1963
Film de toutes les démesures, Cléopâtre est un monument à plus d’un titre. D’une durée de quatre heures (alors que Mankiewicz, son réalisateur, souhaitait sortir deux long-métrages de trois heures chacun !), le récit retrace la vie tumultueuse de la célèbre reine d’Égypte. Difficile de ne pas faire de parallèle avec son tournage étalé sur deux longues années, interrompu à cause d’importants soucis de santé d’Elizabeth Taylor, son actrice principale, ou encore suite à la relocalisation de son décor ! Les jeux Olympiques d’été de 1960 se passent alors à Rome, obligeant la production à changer son projet initial et à s’installer en Angleterre. Mais le climat britannique est bien différent de celui du bassin méditerranéen, et la pluie et le brouillard peinent à simuler la ville d’Alexandrie. Le décor et les palmiers importés supportent mal les intempéries. La Twentieth Century Fox prend alors la décision de démonter les plateaux et de les reconstruire dans les studios italiens de Cinecittà. C’est ainsi que le forum romain reprend des couleurs ! Mankiewicz demande à John de Cuir, en charge des décors, de construire la fameuse place en gonflant ses proportions de deux à trois fois par rapport à l’originale, afin de la rendre plus impressionnante. Lors de l’arrivée de Cléopâtre à Rome, la reine arrive sur un trône d’or porté par des serviteurs, suivi d’une réplique de Sphynx de dix mètres de haut sur vingt mètres de long. Quant aux intérieurs, ils ne manquent pas non plus de panache. La chambre de la protagoniste principale est synonyme d’opulence, avec ses palmiers dorés, ses colonnes, ses drapés et sa vaisselle sertie de (fausses) pierres précieuses. Souvent cité par Andy Warhol comme l’un de ses films favoris, Cleopatra raflera quatre Oscars lors de la cérémonie de 1964, récompensant son esthétisme (meilleure photographie, meilleure direction artistique, meilleure création de costumes, meilleurs effets visuels), laissant bredouille les acteurs et Mankiewicz. Longtemps considéré comme le film le plus cher d’Hollywood, éreinté par la presse à scandale en raison de la liaison des deux acteurs principaux (tous deux mariés par ailleurs, offrant à Taylor son quatrième divorce), l’histoire rocambolesque de Cléopâtre est généreusement commentée dans le documentaire Cleopatra: The Film That Changed Hollywood (2001), parfait complément à cette fresque épique.

Cleopatra, Joseph L. Mankiewicz, 1963
Texte de Justin Morin
EXPLORER REVUE
Cultivons
notre jardin
Justin Morin
À la direction artistique de Loewe depuis 2013, Jonathan Anderson a mis en place, saison après saison, une identité forte pour l’historique maison espagnole. Subtile mélange d’expérimentation stylistique et de savoir-faire artisanal, les collections dessinées par Anderson cultivent leur singularité et ne cessent de surprendre. Si, du fait de ses références artistiques, certains classent le designer dans la catégorie des intellectuels, il faut souligner son sens du décalage, glissant ici ou là quelques notes d’humour qui parfont sa signature. Ainsi, il est intéressant de voir comment le créateur anglais s’empare du parfum, domaine généralement régi par de nombreuses règles commerciales. Entre identités visuelles radicales, audaces olfactives et goût pour l’objet, les parfums Loewe ne font aucune concession. Analyse.
Fondée en 1846, la maison Loewe a bâti sa réputation sur la qualité de ses articles en cuir, avant de se lancer dans le prêt-à-porter féminin dans les années 1970. Suivant cette politique de diversification, le premier parfum, sobrement intitulé L Loewe, verra le jour en 1972. En 2013, Jonathan Anderson est nommé directeur artistique de l’institution espagnole acquise par le groupe LVMH en 1996. Si la marque est respectée pour son histoire, son style n’est pas clairement défini. Le créateur anglais devra donc mettre en place une vision globale, des collections de prêt-à-porter à l’identité visuelle des produits et des espaces de vente. Déjà à la tête de sa propre marque, Jonathan Anderson a débuté en tant que visual merchandiser, en travaillant notamment sur les vitrines de Prada. Un exercice de mise en scène régi par des contraintes d’espace, de lisibilité et de créativité. Assurément, cet apprentissage aura été bénéfique au reste de sa carrière. C’est en 2016, trois ans après son arrivée à Loewe, qu’Anderson lance sa première fragrance. Son nom est explicite. Bien loin du champ lexical des fleurs et autres synonymes de féminité si appréciés par l’industrie du parfum, 001 joue la sobriété et annonce un programme. Ici c’est le jus qui prime, et non le décorum qui l’entoure.
Réalisé en collaboration avec Emilio Valero, qui fut le nez de la maison pendant plus de deux décennies, 001 combine notes de jasmin, lin et musc. Sa composition résume les intentions du britannique : sophistiquée mais facile à porter, légère mais jouant les contrastes. Quant à son écrin, il sera la matrice du projet visuel pensé par Anderson. Là où la stratégie la plus répandue consiste à développer un flacon pour chaque parfum, afin de l’identifier, de le différencier et de le rendre désirable, Jonathan Anderson décide de réunir les créations de Loewe Parfums sous la forme d’une collection reprenant le même flacon. Sa forme est celle d’un rectangle debout. En verre transparent, il est décoré d’un autocollant blanc qui reprend le nom de la fragrance. Chaque flasque est fermée par un bouchon de bois cylindrique. Seul signe distinctif visuel : la couleur des flacons, allant du transparent neutre au rouge, déclinant le spectre chromatique avec quelques surprises comme l’effet « coup de pinceau » métallisé pour Aura Floral et Aura Pink Magnolia. Classiques de la maison et nouvelles créations se retrouvent donc dans cette gamme joliment baptisée Botanical Rainbow.

Placés côte à côte, ces blocs de verre forment une palette de couleurs à l’irrésistible simplicité. Ils séduisent le regard avant d’intriguer l’odorat. On retrouve dans ce kaléidoscope chromatique toute la sensibilité d’Anderson, grand amateur d’art. Cet arc en ciel botanique évoque les sculptures en résine de Roni Horn. L’expérience visuelle ne s’arrête pas là. Ou plutôt, elle débute en amont, dès le packaging. Avant de révéler leur couleur, les flacons reposent dans des boîtes au design sobre. Chacune d’entre elles reproduit une nature morte signée Karl Blossfeldt, figure majeure de la photographie, célébré depuis plus d’un siècle pour son inventaire des formes et structures végétales fondamentales.
Tout en affirmant les références artistiques du créateur anglais, ces images rendent hommage à la richesse de la nature.
Dans la continuité de cette démarche, Jonathan Anderson a imaginé une collection destinée à l’espace domestique. Celle-ci décline les fragrances en bougies, savons, parfums d’intérieur en spray ou sous forme de bâtonnets diffuseurs. Si les parfums sont communément des créations qui mettent en avant des combinaisons d’odeurs complexes, cherchant à brasser les univers à travers une formule unique (magique ?), ici le parti pris est à l’exact opposé. Plutôt que de mélanger les senteurs, chaque création met à l’honneur une plante. Ainsi la gamme se compose de Beetroot [betterave], Oregano [origan], Tomato Leaves [feuilles de tomate], Ivy [lierre], Honeysuckle [chèvrefeuille], Luscious Pea [pois de senteur], Liquorice [réglisse], Juniper Berry [baie de genévrier], Scents of Marihuana [senteur de marijuana], Coriander [coriandre] et Cypress Balls [cônes de cyprès]. Réalisés par Nuria Cruelles, actuel nez de la maison Loewe depuis 2018, ces parfums font le pari de l’ingrédient unique :
« Nous n’avons jamais été tentés de combiner ces senteurs avec d’autres fragrances. De la même manière que Blossfeldt a montré la beauté des fleurs et des plantes à travers leurs structures apparemment simples, mais étonnantes, nous avons voulu recréer le plus fidèlement possible les parfums des plantes dont nous nous sommes inspirés. C’était d’ailleurs l’idée de Jonathan Anderson pour cette collection de parfums d’ambiance d’éviter toute fioriture lors du mélange des essences. Alors que nous traversons un moment où nous avons besoin de nous sentir proches de la nature, nous nous en sommes inspirés et l’avons apportée à l’intérieur de chaque maison avec l’idée que ces parfums puissent transporter à la campagne ou dans une serre. »
Les flacons reprennent la forme rectangulaire de la gamme Botanical Rainbow, en y ajoutant des bouchons cylindriques en céramique vernie au toucher propre d’un cuir. Les visuels des packagings, signés Erwan Frotin, sont des natures mortes mettant en avant la beauté de chacune des plantes sélectionnées, dans un chatoyant jeu de couleurs. Simples, par l’unicité de leur senteur, mais sophistiqués, par leurconception globale – de l’image qui décore les boîtes au design de leur flacon, en passant par le vocabulaire employé pour les décrire – ces parfums jouissent d’un double statut : à la fois senteur intangible et objet aux qualités hybridant artisanat et industrie. Ce rapport à l’objet, on le retrouve très clairement dans les bougies parfumées de la collection de parfums d’intérieur. S’il existe des bougies présentées, assez classiquement, dans des pots de terre cuite émaillée, une version tautologique complète la collection. Moulée sous la forme d’un chandelier d’inspiration Louis XIV, la sculpture de cire est à la fois support et matière. Dès lors qu’il se consume, le bougeoir disparaît progressivement en laissant un effluve parfumé. On pense aux œuvres en cire d’Urs Fischer, commentaire doux-amer du temps qui passe inexorablement. À noter que Loewe propose également un coffret d’échantillons de cire de ces senteurs végétales. La proposition est si atypique qu’elle a, elle aussi, tout le potentiel pour devenir un objet de collection. Présentées sous forme de disque de cire coloré, frappées du logo de la maison, ces galettes servent à identifier les onze fragrances existantes. Blocs de couleurs pures, n’ayant aucune autre fonction hormis celle de présenter une odeur, elles rappellent le travail pop de Damien Hirst et ses Spot Paintings.
Bien évidemment ces interprétations et ces parallèles avec l’histoire de l’art ne sont pas au centre du discours des parfums Loewe, mais il est certain que les intérêts et la curiosité de Jonathan Anderson infusent ses propositions. À ce sujet, nous avons demandé à Nuria Cruelles comment naissaient les nouvelles fragrances qu’elle mettait au point. « Nous commençons à travailler à partir d’un briefing de ce que Jonathan souhaite créer pour chaque projet. Ensuite, j’essaie de recueillir des essences qui pourraient s’inscrire dans ce cadre tout en enrichissant la palette d’ingrédients lors de promenades ou de recherches approfondies. En parallèle, je collecte des senteurs de ma mémoire olfactive et j’expérimente en laboratoire pour voir si elles conviennent. Ce sont généralement des ingrédients utilisés en parfumerie que j’aime amener dans le contemporain en proposant de nouvelles structures. C’est le cas du galbanum que l’on retrouve dans la composition de Paula’s Ibiza. » Car au-delà de ces collections à l’approche sérielle, les parfums Loewe continuent de proposer de nouvelles fragrances comme autant d’histoires individuelles et satellitaires. C’est le cas de Paula’s Ibiza, lancé en 2020. Nuria Cruelles commente : « Nous avons fait beaucoup de fragrances depuis mon arrivée, mais Paula’s Ibiza a été particulièrement importante en raison de la dimension du projet : c’est la première dédiée à une collection de mode. Pour celle-ci, le briefing était de traduire l’île d’Ibiza en senteur : son côté bohème, l’odeur de ses côtes et son aspect irrévérencieux. Jonathan m’a montré l’histoire de Paula’s Ibiza, boutique de l’île, ainsi que la collection Loewe qu’il a imaginée en hommage à ce magasin historique. » Le flacon cylindrique en verre affichant un dégradé façon coucher de soleil, coiffé d’un bouchon bleu ciel, se loge dans un écrin reprenant l’imprimé de sirènes crée dans les années 1970 par Amin Heinemman et Stuart Rudnick, les fondateurs de Paula’s Ibiza. Unisexe, la fragrance mise donc sur une interprétation moderne du galbanum, sur laquelle se superposent eau de coco, huile de mandarine malgache, bois flotté, lys des sables et fleurs de frangipanier. Alors que Cruelles et Anderson développent actuellement de nouvelles créations qui devraient voir le jour en 2023, leur collaboration témoigne d’une richesse sensorielle – de l’odorat à la vue en passant par le toucher – galvanisante. Un parti pris qui démontre que l’industrie du parfum peut faire le pari de la singularité tout en restant accessible et désirable.

C.Q.F.D. du cinéma
à l’ère des séries
Luca MarchettiThibaut de Saint-Maurice
Cinéma et séries télévisuelles, on pourrait croire qu’il s’agit plus ou moins de la même chose. L’un se regarde en salle, les autres se consomment potentiellement partout. Le film est compact, tandis que la série nous entraîne dans une narration itinérante. Mais il est toujours question d’images en mouvement, d’histoires, d’acteurs… et de gros budgets. J’en ai discuté avec Thibaut de Saint-Maurice, philosophe, afin de comprendre pourquoi, d’après lui, ces deux spécimens culturels n’ont rien à voir l’un avec l’autre.
Luca Marchetti
Depuis maintenant deux décennies on ne cesse de questionner le futur du cinéma, mis à mal par l’engouement global pour les séries. Comment un genre si proche du cinéma a pu s’imposer comme forme narrative incontournable dans notre présent ?
Thibaut de Saint-Maurice
Avant de s’incarner en un produit télévisé de grande consommation, le « mode sériel » est depuis la nuit des temps une façon pour les humains de « raconter la vie » et d’en transmettre la mémoire. La généalogie des séries remonte aux histoires orales et aux contes populaires anciens. Puis il y a eu le feuilleton… La période qui va de la fin des années 1970 aux années 2020 n’est, pour les spécialistes, que le troisième âge (d’or !) de la série. On pourrait l’appeler le « tournant ethnographique » ; lorsque les séries ont commencé à documenter la vie ordinaire en se penchant sur des univers professionnels singuliers qui génèrent des formes de pouvoir sur la vie réelle des gens, comme le commissariat, l’hôpital… Et d’autres milieux peu accessibles au regard des gens communs.
Luca Marchetti
Pourtant ces milieux ont aussi été l’objet de nombreux films. D’où vient donc la spécificité des séries vis-à-vis du langage cinématographique ?
Thibaut de Saint-Maurice
Comme le cinéma, la série a fourni un traitement critique, ou alors une célébration de ces lieux de pouvoir. Mais pour le faire de manière percutante et efficace elle a de son côté le « long terme » et la possibilité de raconter des situations complexes en les découpant en épisodes successifs, ce qui permet aussi une incroyable flexibilité scénaristique… tout peut évoluer, voire s’inverser au fil du temps. Ce sont des aspects essentiels pour investir les coulisses de réalités peu accessibles au plus grand nombre.
Un autre facteur de réussite, d’ordre stratégique, tient au fait que la plupart des séries a été portée par des chaînes du câble qui ont incessamment besoin de nouveauté et de pousser de plus en plus loin le curseur des intrigues, de la caractérisation des personnages et des formats.
Luca Marchetti
Le cinéma a depuis sa naissance essayé de donner une interprétation du réel et, dans certain cas, il a carrément souhaité proposer une version alternative de certains faits historiques. Peut-on s’attendre à ce que la série en fasse de même ?
Thibaut de Saint-Maurice
Absolument. La « grammaire communicationnelle » de la série décrite plus haut s’insère toujours dans un contexte social spécifique. Aujourd’hui on a le sentiment que les mécanismes qui font tourner le monde ne cessent de se complexifier. Et la compréhension de ses rouages demande souvent des compétences que nous n’avons pas. Il suffit de penser à la crise de confiance politique au sein des grandes démocraties analysée par le sociologue Anthony Giddens.
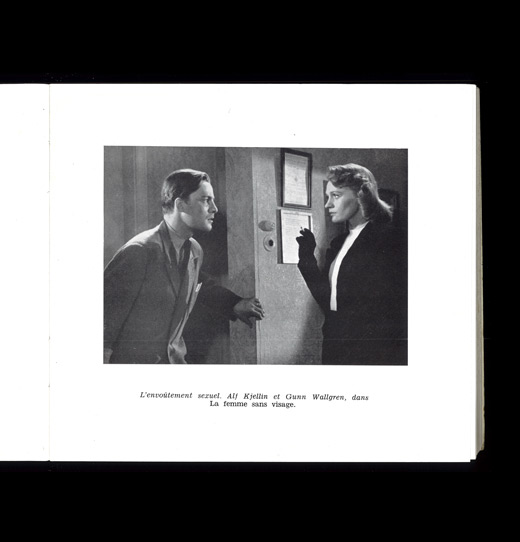
La Femme sans visage (Kvinna utan ansikte), film de Gustaf Molander, scénario d’Ingmar Bergman, 1947.
Extrait du livre Ingmar Bergman et ses films de Jean Béranger, édité par Le Terrain Vague, Paris, 1959.
Bibliothèque Alexandru Balgiu
En mettant en scène les coulisses du système, la série a une fonction pédagogique et même sans le vouloir, elle aide à réparer la confiance en l’institution. Elle transforme le spectateur en expert !
Luca Marchetti
Il y a une dizaine d’années, en constatant l’impact des grands blockbusters chinois sur le marché cinématographique international, certains se demandaient si le cinéma était en passe de devenir le « nouvel opium du peuple ». Est-ce que ce ne sont pas les séries qui auraient dû être pointées du doigt ?
Thibaut de Saint-Maurice
Pas du tout. Les séries, quoi qu’on en dise, développent chez le spectateur des compétences et des points de vue très divers, et inclut une expertise d’ordre démocratique et citoyen. Elles peuvent également stimuler un certain sens critique et une pensée individuelle qui n’est pas sans impact sur les questionnements existentiels et métaphysiques de chacun.
Luca Marchetti
Peut-on voir des emprunts linguistiques entre série et cinéma ?
Thibaut de Saint-Maurice
Pas beaucoup en fait. La série télé s’est construite indépendamment du cinéma : des éléments comme le générique, des pauses dans la narration censées accueillir les coupes publicitaires, le résumé des épisodes précédents qui suggère toujours une interprétation des événements racontés, mais aussi la technique de réalisation qui se fait souvent en présence d’un public face à deux-trois plateaux de tournage en intérieur qui se succèdent, les cadrages serrés… Tout ça confère à la série un langage tout à fait original. J’ajouterais aussi la présence cruciale de la figure du showrunner. Ce n’est pas un scénariste, ni un réalisateur, mais plutôt le « directeur artistique » de la série. Au cinéma cela n’existe pas. Le profil le plus proche est l’auteur-réalisateur dans le domaine des films d’essai. Dans le showbusiness contemporain, le showrunner a une légitimité et une « autorialité » que le réalisateur n’a pas…
Luca Marchetti
Il y a quand-même eu une filiation esthétique entre le cinéma et les séries, notamment au niveau de la photographie et de l’esthétique générale des images…
Thibaut de Saint-Maurice
Games of Thrones est souvent citée parmi les séries les plus proches de l’esthétique cinématographique, avec beaucoup de plans larges et beaucoup de tournages en extérieur. Ceux-ci restent quand-même limités en nombre et l’effet spectaculaire final tient surtout aux effets spéciaux numériques ajoutés en phase de post-production. Je citerais plutôt le jeu vidéo que le cinéma en tant que référence.
Dès les années 2010 on a vu arriver une génération de nouvelles séries avec une qualité esthétique remarquable, comme Mad Men. Ces séries qu’on rapproche le plus souvent du cinéma, visent la reconstitution historique ou la recréation « d’ambiances » typiques d’une époque ou d’un lieu… comme le néo-western Dead Wood. Mais il reste toujours une différence fondamentale entre les deux genres : la série est toujours portée par les dialogues, par la dynamique entre les personnages et non pas par la mise en image ou le récit, contrairement au cinéma. Ce qu’on valorise vraiment dans les séries c’est la vie ordinaire, la reconstitution des formes de vie d’une époque, d’un lieu, d’une famille comme dans Downtown Abbey, jusqu’au « normal de l’extraordinaire » quand il s’agit de dévoiler au monde le protocole royal dans The Crown.
Luca Marchetti
Et inversement alors ? Quels sont les apports de la série au cinéma contemporain, par exemple au niveau de la définition du film et du design des personnages ?
Thibaut de Saint-Maurice
Sur le plan de la conception même du film, le format de la série a systématisé au cinéma la logique des franchises « à thème » telles que les réactualisations de Superman ou Batman en y incluant le principe peu orthodoxe de sequels et de prequels bien que ceux-ci ne soient pas toujours justifiés par les sources originales de ces histoires (livres, bandes dessinées etc.). En deuxième lieu, la série a familiarisé le public avec des personnages aux vies complexes et des intrigues à rallonge même pour des blockbusters très populaires. Le personnage idéal de la série, à la fin du récit, a peu en commun avec ce qu’il était au début. De même, en ce qui concerne les intrigues, la série raconte des histoires de transformation, de révolution et de mutation. C’est essentiellement l’inverse de ce sur quoi le cinéma s’est construit, à savoir la définition d’un type humain,d’un état d’esprit, d’un caractère, d’un moment singulier de l’histoire. Le cinéma « fige » et définit un mode narratif statique, dans la série tout est mobile.
Luca Marchetti
Peut-on imaginer que le « grand saut » du cinéma dans le futur se produira lorsque le film se détachera du contexte de sa diffusion, notamment la salle : à l’image des séries qui vivent aussi bien à télé – pour laquelle elles sont nées – que sur un smartphone, sur un écran home cinéma 4K, ou encore dans une salle…
Thibaut de Saint-Maurice
Oui probablement. Mais le pas à franchir n’est pas anodin car le cinéma est le résultat d’un médium (le dispositif que vous décrivez), alors que la série est le résultat d’un nouveau « regard », notamment celui qui a été porté sur l’ordinaire, sur l’intime.
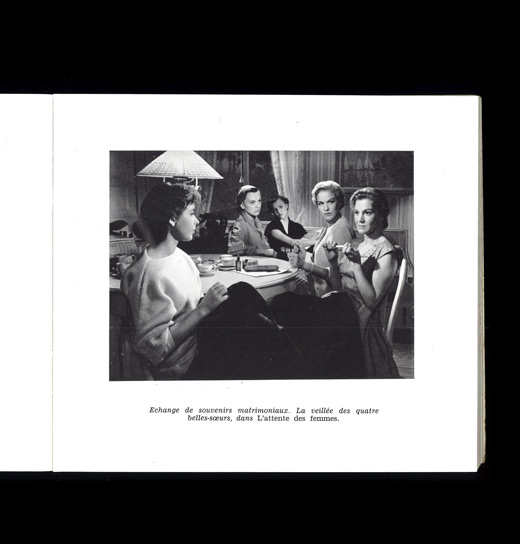
Carolien Niebling, The Sausage of the Future, 2017. Projet soutenu par l’ECAL et publié par Lars Müller Publishers.
Un autre obstacle à cela est le fait que le cinéma est né comme un art de l’image tandis que la série est un art de la conversation et du dialogue. Paradoxalement elle est plus proche de la radio que du cinéma !
Quand les talons
pour hommes
s’ensanglantent
Antoine Bucher
Si aujourd’hui un homme en perruque, talons et maquillage a de grandes chances d’appartenir à un programme télévisé de RuPaul, au XVIIe et XVIIIe siècles, ce type de description correspond facilement à un membre masculin de l’aristocratie européenne.
Au XVIIe siècle, les nobles prennent notamment de la hauteur grâce à leurs chaussures et c’est d’abord aux pieds des hommes que les talons hauts s’installent dans les cours royales. La fréquentation diplomatique des ambassadeurs de Perse au début du XVIIe siècle cultive la curiosité pour ce qu’on appelle alors l’Orient et la mode des souliers à talons gagne progressivement les courtisans inspirés par ceux des cavaliers perses qui leur permettent de caler les pieds dans les étriers. Alors que sous Louis XIV, les représentations de mode masculine abondent avec le développement de la gravure de mode sous l’impulsion notamment des éditeurs d’estampes Jean Dieu de Saint-Jean et la famille Bonnart, de nombreuses eaux-fortes représentant les tenues en vogue n’oublient pas de représenter ces souliers qui rajoutent de la hauteur aux grands du monde sur les centaines d’images qui sortent des presses de la rue Saint-Jacques, haut lieu de l’estampe française (cf. illustration). Si ces gravures de mode imposent à partir de 1670 un format vertical standardisé présentant un personnage en pied dont la parure est détaillée avec soin, mais au visage indifférencié, la paternité des tendances de mode peut être attribuée à certains personnages de la cour. Ainsi, le duc d’Orléans, le frère du roi, qu’on appelle alors Monsieur est croqué par Saint-Simon dans ses Mémoires en 1701 comme un amateur portant à ses pieds les modèles de talons les plus importants : « C’était un petit homme ventru, monté sur des échasses tant ses souliers étaient hauts, toujours paré comme une femme, plein de bagues, de bracelets et de pierreries partout, avec une longue perruque tout étalée devant, noire et poudrée et des rubans partout où il pouvait mettre, plein de sortes de parfums, et, en toutes choses, la propreté même. »
Monsieur, alors l’un des personnages les plus important du royaume, mais aussi un expert en débauche, ajoute une touche de couleur aux talons de l’aristocratie. Lors d’une nuit de fête de 1662, le frère du roi finit avec son entourage sa soirée dans l’anonymat des tavernes du cœur de Paris et traverse notamment le quartier de la Grande Boucherie près du Châtelet. Le sang des animaux colore les talons du fêtard et le roi s’en inspire en commandant à son cordonnier des talons rouges. Ils deviennent alors une mode à Versailles puis à la cour d’Angleterre par l’entremise du cousin de Louis XIV, le roi Charles II. Un rare exemplaire d’une version habillée d’une estampe des années 1690 représentant le souverain français met l’accent sur cette nouvelle tendance. Publiée par l’éditeur Antoine Trouvain, la gravure finement découpée comporte des parties ajourées habillées de morceaux de textile. Ce type d’objet réservé aux collectionneurs les plus fortunés de la fin du XVIIe siècle voit ici les talons royaux laisser apparaître un morceau de tissu rouge. Ce montage réalisé dans ce cas à l’époque diffère de la version originale de l’eau-forte qui ne différencie pas le talon et le corps de la chaussure. Pour les clients de ce type d’œuvres, plus chères encore que les versions rehaussées en couleurs à la main, il semble alors important de mettre l’accent sur les pieds du roi. Quelques années plus tard, le peintre Hyacinthe Rigaud ne manque pas de souligner de rouge les talons du roi dans son magistral portrait de Louis XIV en costume du sacre qu’il réalise en 1702. La tendance dure et ouvre la voie à l’utilisation aux XVIIIe et XIXe siècles de l’expression « les talons rouges » pour décrire les nobles et notamment les courtisans. Le Dictionnaire Universel de 1896 décrit un talon rouge comme « un homme de la cour qui avait des talons rouges à ses souliers ce qui était une marque d’élégance et de distinction », mais la synecdoque sous-entend également de grandes manières et une affectation certaine, à l’image des plus importants courtisans du royaume. En 2019, le Metropolitan Museum associe d’ailleurs Monsieur, l’inventeur de ces talons colorés, au développement du « camp » lors de l’exposition Camp Notes. La mode des semelles rouges couplées à des talons aiguilles est, elle, une histoire d’un autre genre…

Jean dieu de Saint-Jean, Homme de Qualité en Surtout, 1683. Librairie Diktats
La voyageuse
contemplant
une mer de nuages
Simone Rocha
La collection Printemps 2022 de Simone Rocha a conduit le public dans l’église médiévale de St Bartholomew-the-Great à Londres dont l’atmosphère lugubre et sinistre, mais également sublime et sacrée, offrait une ambiance parfaite pour les silhouettes de la créatrice. Pendant que les mannequins défilaient sur le podium, le spectateur avait l’impression d’assister à un baptême allégorique, les vêtements évoquant les tenues revêtues pour une cérémonie chrétienne qui semble devenir, d’une certaine manière, troublante et poignante. En jouant avec la thématique de l’enfance, de la naissance, mais aussi de la maternité, Simone Rocha parvient à célébrer le corps féminin dans l’expérience de l’accouchement et de l’adaptation au rôle de mère. Nous avons rencontré la créatrice pour parler de ses inspirations pour la collection et de sa méthodologie de travail.
Lorsqu’on lui a demandé s’il existait un lien entre ses expériences personnelles et ses créations – au moment de la présentation de la collection, elle venait d’avoir son second enfant – Simone Rocha a répondu :
« Je trouve difficile de concilier les deux, donc je suppose que ma situation authentique de maternité s’est naturellement infiltrée dans mon travail. »
Cette « infiltration naturelle » n’est donc pas simplement une inspiration fugace, mais doit être considérée davantage comme une évolution organique de la vie de la créatrice et de son approche des créations.
Le printemps 2022 marque en effet le 10e anniversaire de sa première collection griffée Simone Rocha. Tout au long de la décennie, elle est parvenue à développer certaines caractéristiques clés qui sont restées des constantes dans chaque collection. Parmi les détails qui définissent l’identité de la marque on retrouve l’exagération des dimensions de certains éléments tels que les cols et les manches, l’utilisation impulsive de volumes démesurés sur des silhouettes classiques et enfantines et celle de symboles irlandais et catholiques comme ornements. Après avoir obtenu une licence en mode au National College of Art and Design de Dublin, Simone a suivi le Master de mode du Central Saint Martin’s College de Londres, dont elle est sortie diplômée en 2010. C’est là qu’elle a pu travailler sur différents textiles et découvrir les possibilités qu’ils offrent pour créer un vêtement :
« Je me suis toujours intéressée aux silhouettes et aux volumes, j’ai toujours aimé les déplacer, jouer avec les proportions, exagérer les détails et travailler avec les tissus dans les mains. Il faut être mis au défi et bousculé, l’expérimentation est donc cruciale. Mais les créations en elles-mêmes résultent toujours de la collaboration avec mon équipe et nous avons maintenant une signature qui résonne dans chaque collection. »
Le jeu avec les possibilités offertes par le studio de mode fait partie de l’ADN de la créatrice. En effet, son père, John Rocha, est un créateur installé à Dublin qui travaille dans l’industrie de la mode depuis les années 1980. En grandissant, elle a baigné dans le design de mode en accompagnant son père au studio et en l’aidant à développer ses collections. Sa mère, Odette, travaille également aux côtés de son mari depuis ses débuts à Dublin et accompagne aujourd’hui Simone dans ses prises de décisions pour sa marque solo. Rocha reconnaît cette dynamique quand elle affirme :
« La plus grande chance que j’ai eue en grandissant dans un environnement aussi créatif, c’est que ma créativité n’a jamais été remise en question, elle a toujours été acceptée. »
Par conséquent, sa famille et ses racines irlandaises ont toujours joué un rôle central dans sa vie de créatrice, d’abord avec ses parents à Dublin, puis aujourd’hui avec la famille qu’elle a fondée à Londres. D’une certaine manière, ses collections sont un moyen de réinterpréter et d’analyser ses expériences personnelles, par exemple la maternité lors du défilé du printemps 2022. Il est difficile de concilier ces deux activités, et elles se déroulent donc, biologiquement, en parallèle. À ce sujet, Simone ajoute :
« Avec chaque collection, je peux mettre le doigt sur ma vie, le contexte et les événements à ce moment précis. Mes collections naissent d’abord de mes émotions et, avec elles, j’explore de nouvelles idées, des récits multiples et des sensations diverses. »
Ces sensations ne doivent pas nécessairement être toujours brillantes et éblouissantes. Ce qui ressort de l’expérience dans la collection est souvent un fil conducteur, en partie sombre, troublant :
« Je pense qu’il y a toujours un contraste, et un élément sous-jacent. »
La maternité, par exemple, apporte aussi avec elle le dérèglement du sommeil, l’insomnie, et est indissociable du corps qui a dû se transformer, presque se disloquer, pour accueillir un autre être humain. Les vêtements de Simone Rocha parviennent à célébrer avec brio cette transformation primitive et nécessaire dans laquelle de nombreuses femmes peuvent se retrouver. En ce sens, sa vision de la féminité est précise. Il était donc presque naturel de lui demander si, après une décennie, elle pourrait transposer cette vision en parfum. La créatrice pense qu’un éventuel parfum Simone Rocha sentirait « le bois brûlé et la tubéreuse. »
Sa vision personnelle s’inscrit également dans le contexte plus large de ses collections. Le cinéma, par exemple, joue un rôle important dans leur élaboration. Pour la collection Automne-Hiver 2020, par exemple, Simone a travaillé en collaboration avec le réalisateur Hugh Mulhern. Elle a utilisé le support du clip pour contextualiser davantage les silhouettes en se concentrant sur les mouvements, les effets textiles et des détails particuliers.

« J’adore travailler avec les réalisateurs de films, surtout lorsqu’ils sont comme Hugh et qu’ils ont une vision personnelle si forte. J’aime amener mes pièces dans un nouveau monde. Un peu comme lorsque j’ai fait un film avec Petra Collins et que mon travail est presque devenu un personnage du récit. »
Les réalisateurs sont capables de ré-imaginer ses vêtements et de les recontextualiser, en analogie ou en contraste avec l’idée originale. L’ensemble du processus devient un échange fertile entre les deux créateurs.
D’une manière générale, les films que Simone a cités comme sources d’inspiration alternatives sont en adéquation avec sa personnalité. En tête de liste, le grand classique Chambre avec vue, de James Ivory, un drame romantique complexe qui se déroule à Florence au début du XXe siècle. Vient ensuite In the Mood for Love de Wong Kar-Wai, une histoire d’amour située dans les années 1960 à Hong Kong, d’où le père de Simone est originaire. Elle ajoute ensuite deux films dans lesquels on peut voir des symboles internationaux du cinéma irlandais : Le Cheval venu de la mer et The Field. Plus tard, son intérêt se portera vers Londres, avec Les Chaussons rouges, une histoire d’amour tragique racontant les péripéties d’une ballerine dans les années 1940. Enfin, elle ajoute à sa liste Fish Tank, un film de la réalisatrice britannique Andrea Arnold, l’histoire de l’enfance troublée d’une jeune fille tiraillée entre famille et amants.
On est également surpris de constater que lorsqu’on lui demande si sa dernière collection – automne 2022 – pourrait être traduite en film, elle choisit précisément Andrea Arnold comme scénariste pour adapter ses vêtements en récit cinématographique. Une collaboration entièrement féminine pour repenser dans un contexte plus large les femmes Simone Rocha, personnages principaux de son récit. Elle précise qu’elle y verrait une adaptation de la légende irlandaise des Enfants de Lir. Ce mythe, qui a inspiré Le Lac des cygnes, raconte l’histoire de quatre frères et sœurs condamnés par leur belle-mère, jalouse de l’amour et de l’attention que leur accorde leur père, à passer 900 ans sous la forme de cygnes. Ainsi transformés, les enfants ne parviennent à conserver leur voix humaine que pour chanter des mélopées susceptibles d’attirer l’attention de leur père qui découvrirait enfin la vérité sur sa nouvelle épouse. Le charme n’est rompu que lorsqu’il entend sonner une cloche, la première cloche chrétienne à sonner en Irlande. À partir de là, ils peuvent mourir sous leur apparence humaine tandis que leur mémoire sera conservée grâce à ce mythe. Quand on écoute cette histoire ancienne, on remarque bien sûr la métaphore entre les élégantes créatures blanches des quatre cygnes, fascinantes à première vue mais au destin tragique,
TEXTE D'ILARIA TRAME
Ed cetera
Ed Atkins
Présentées sous forme d’installation déployée dans l’espace, les vidéos d’Ed Atkins sont immédiatement identifiables. On y retrouve le plus souvent un avatar dont l’aspect joue avec les limites de l’hyper-réalisme des images générées par ordinateur. Les errances de ses personnages sont l’occasion pour l’auteur de questionner le sens de la vie, et plus particulièrement de l’inévitable déclin. Ses monologues révèlent un sens du rythme singulier, à la fois à travers l’écriture textuelle – Ed Atkins a publié deux recueils de textes, A Primer for Cadavers (2016) et Old Food (2018) – et cinématographique. Cadrages et montages montrent une maîtrise du langage du cinéma et de ses effets. L’artiste britannique, né en 1982, développe donc depuis plusieurs années une œuvre complexe et fascinante, alternant entre ombre et lumière. En discussion avec le critique Piero Bisello, il revient sur les interprétations de son travail et ses productions les plus récentes.
Piero Bisello
Une de vos œuvres de 2017 (en collaboration avec Contemporary Art Writing Daily), du bois découpé au laser, indique : « Le terme de nourriture périmée [Old food] est bien sûr impropre. Il n’y a pas de périmé dans le numérique. Pas de négligence de réfrigération. On décide de lui donner cette apparence. » Old food est aussi le titre d’un de vos poèmes en prose, « un rien épique » selon vos mots. On peut y lire : « … un tas de mouches l’ont dégradé avec leurs vomissures répétées et il s’est presque liquéfié sur son support. Même s’il était devenu marron et avait fait des flaques de latex dans les poubelles, nous l’aurions sans doute quand même mangé… » Ces deux passages me rappellent que quand on y réfléchit bien la nourriture est dégoûtante, peu importe à quel point on la rend attrayante. Même le pain n’est qu’une chose morte transformée, sans parler des saucisses et du caviar. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre intérêt récurrent pour la nourriture périmée ? Y a-t-il une volonté de repousser le lecteur/spectateur avec un produit censé être désirable ?
Ed Atkins
Une grande partie de mon travail est liée aux limites de la représentation du médium ; une grande partie de mon travail traite plus ou moins de lui-même – même et surtout si ce qu’il pourrait hypothétiquement comprendre de lui-même est en conflit assez évident avec sa vraie nature. Il s’agit souvent d’un type particulier d’anthropomorphisme délirant, qui suppose, d’une manière ou d’une autre – et cela demande d’opérer un raccourci – que l’œuvre d’art est une personne qui s’inquiète de son identité. Ou s’inquiète de savoir si elle est convaincante en tant que personne. Pour les autres et pour elle-même. Ce qui constitue un autre type de spécificité du médium, je suppose. Tout ceci n’est qu’une expérience imaginative, mais elle engendre un type particulier de relation avec le média, qui détermine la capacité à approcher un niveau élevé de fidélité dans sa représentation, quel qu’il soit. La nourriture a sûrement quelque chose de grotesque, mais en réalité, il s’agit là des processus de la vie et du numérique, de la vie et de la mort ou de la non-mort, de la rémanence et de la mortalité ; de l’aspect immortel du numérique, par opposition à sa réalité physique et à ses conséquences, ainsi qu’à l’existence mortelle et sensationnelle des individus. La nourriture est fondamentale. Il n’est pas vraiment question de désir et de répulsion, mais dans la mesure où je ne m’intéresse ni à l’apparence lisse des images ni à la cohérence lisse des phrases et de la grammaire – ou à la perte facile de toute sorte de certitude – les approches du grotesque, de l’immonde et de l’abject en tout genre font partie intégrante de mon travail.
Piero Bisello
Dans une interview de 2014, une table ronde sur l’art et le cinéma organisée par le magazine Mousse, vous avez déclaré que vous adhérez à « l’idée d’un anti-illusionnisme structurel/matérialiste, jusqu’à ce que nous ne puissions plus distinguer l’illusion de la réalité. » Pendant de nombreuses années, j’ai vu dans cette déclaration un résumé de votre philosophie de l’art, notamment celle appliquée dans vos vidéos et vos textes. Cependant, vos dessins les plus récents, que je reçois chaque jour par e-mail, semblent moins rigoureux quant à cette velléité anti-illusionniste. Pour moi, il s’agit davantage de dessins en tant que tels plutôt que de dessins sur le dessin. Pour moi, ils invoquent plus directement les émotions. Par leur biais, avez-vous tempéré votre « appel à révéler le médium », comme l’écrit Hal Foster dans son récent essai sur votre travail ?
Ed Atkins
Tout d’abord, je clarifierais cette première citation et je soulignerais le fait que mon intérêt pour le cinéma structurel/matérialiste s’oppose assez clairement à celui que je vois dans le fait de ne plus pouvoir distinguer l’illusion de la réalité. J’entends par là que le cinéma anti-illusionniste part du postulat que l’illusion est politique et éthique. Ainsi, bannir l’illusion reviendrait à bannir la possibilité de voir la vérité au-delà de l’illusion. Je pense que ce que je voulais dire, c’est que les aspirations de la technologie, et de ceux qui propagent son avenir, semblent tendre vers un point de convergence entre l’illusion et la réalité. Ce qui est intéressant en soi. Cependant, ce qui m’intéresse en premier lieu, c’est d’exposer le médium. Ce qui implique souvent d’utiliser délibérément des médias contemporains qui manifestent ouvertement leur volonté d’aboutir à une sorte de transcendance technologique, et de leur demander d’accomplir des prouesses qu’ils ne peuvent évidemment réaliser qu’imparfaitement, divulguant ainsi leur essence – ou du moins leurs aspirations. Les dessins sont une toute autre chose. Je trouve important de souligner que mes théories sur les médias et autres ne sont qu’un pan de ce que j’essaie de créer.
Piero Bisello
Vous participez à la gestion du site Web Contemporary Art Writing Daily, qui vient de publier un ouvrage intitulé Anti-Ligature Rooms. C’est une plongée dans la critique. Par exemple, le chapitre consacré au surréalisme débute par un commentaire sur une installation de Chris Burden, et se poursuit par des commentaires sur le surréalisme, le capitalisme, la société, la peinture, l’image, etc. Pouvez-vous préciser les conditions de votre participation au site Web et au livre ? J’ai entendu dire que vous écriviez plus que vous ne lisiez. Comment avez-vous abordé l’écriture d’Anti-Ligature Rooms par rapport à d’autres projets d’écriture ?
Ed Atkins
En fait, je n’ai rien à voir avec les créateurs de CAWD. J’ai travaillé avec eux à plusieurs reprises et j’ai également publié leur livre, Anti-Ligature Rooms. Mais je ne sais pas qui ils sont, et je ne suis l’auteur de rien de ce qu’ils publient. Je partage des informations et des idées avec eux, à peu près en toute impunité, et ils écrivent ce qu’ils veulent, plus ou moins. Je vous recommande cependant de les contacter. Ils sont bien meilleurs correspondants que moi.
Piero Bisello
Deux de vos projets récents ont pour sujet la famille. Dans la vidéo The Worm une femme converse avec son fils, ou disons plutôt qu’il l’écoute. Elle y parle de son passé, de sa mère en particulier. Le second projet est un ouvrage réunissant vos dessins pour enfants, dédié à votre fille – vous y mentionnez que vous avez réalisé des dessins chaque matin et les avez cachés dans sa lunch box. Comment avez-vous commencé à intégrer le thème de la famille dans votre travail ? N’est-il pas parfois gênant d’inclure des sujets personnels dans une œuvre destinée à un large public ? La fiction permet-elle de surmonter cette gêne, le cas échéant ? Dans The Worm, le fils déclare à un moment donné que « la réalité ou le réalisme est triste ».
Ed Atkins
Dans ce passage – à moitié retenu –, ce dont parle le fils c’est de la tendance de sa mère à affirmer que la réalité est triste. Que la vie est triste, que l’expérience est par essence déjà appauvrie. Et qu’il a hérité de cette tendance, mais qu’il se rebelle contre elle. L’œuvre aborde les questions d’hérédité, les traumatismes, la façon dont on se perçoit ou dont on imagine que les autres nous perçoivent, et des dégâts que cela peut causer. J’ai toujours inclus ma famille dans mon travail. De manière moins ostensible, mais elle est présente depuis le début. Tout comme l’effet de la présomption familiale, la répulsion de l’intimité, la distance, la perte, le détachement, tout cela. Il n’y a donc là rien de nouveau. Le livre de dessins rend compte d’un processus entamé sans aucune aspiration artistique, si ce n’est le processus en lui-même, et de l’existence d’un public aimant. J’ai la quasi-certitude que je ne ferai jamais mieux que les dessins. Il y a une idée d’excès, sans doute. Une intimité détournée ? Une impression de se conformer à une définition indisponible ? Une sorte de machine qui se construit chaque jour ? Imaginez-en des dizaines de milliers ; il y en a déjà quelques milliers.
Piero Bisello
Pour des raisons familiales, je n’ai pas pu assister à votre performance, Mutes, à Knokke, il y a quelques mois, mais j’ai appris que vous aviez tenté de proposer une lecture pertinente du poème The Morning Roundup de Gilbert Sorrentino. Je suppose que votre but n’était pas de parvenir à le lire correctement. Qu’est-ce qui vous a attiré vers ce poème?
Ed Atkins
Le fait est qu’il n’y a aucun moyen de l’appréhender correctement : le poème en lui-même traduit son incapacité à évoquer quoi que ce soit de vaguement réparateur qui pourrait exprimer « correctement » les sujets qu’il aborde. Quelque chose dans le langage, le ton exclamatif et la mention de la parole et des radios, m’a évoqué un mantra pour la fragilité qui s’extériorise après le deuil. J’ai utilisé le poème comme refrain d’une vidéo que j’ai réalisée il y a longtemps, Warm, Warm, Warm Spring Mouths.
Piero Bisello
Vous avez récemment écrit et mis en scène une pièce de théâtre (en collaboration avec Steven Zultanski). Elle s’intitule Sorcerer, et traite de l’amitié. Le rapport entre l’amitié et la sorcellerie me laisse perplexe. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur la pièce et cette étrange juxtaposition qui apparaît dans son sujet et son titre ? Dans votre ouvrage A Seer Reader, « un recueil de prophéties écrites au futur » comme vous l’avez défini dans une interview pour Frieze, vous mettez également en scène un personnage magique et surnaturel. Dans quelle mesure le Seer Reader est-il un précurseur du Sorcerer ?
Ed Atkins
Il ne l’est pas encore. Le Sorcerer, je veux dire. Il n’y a pas de mystère à résoudre dans le titre en tant que descripteur. Je ne pense pas avoir jamais créé une œuvre qui soit une énigme à résoudre. Il n’y a pas de sujet, non plus. Il y a de la magie, mais aussi du réalisme, de l’onanisme spécifique au médium et bien d’autres choses encore. En ce qui concerne A Seer Reader, il exprime une sorte de fascination de longue date pour l’aspect magique du langage. Ou pour la magie en tant que langage. Crowley a dit : « La magie est une maladie du langage. » Mais peu importe.

Ed Atkins, Refuse.exe, (still), 2019-2020.
Simulation 3D en temps réel sur 2 écrans avec son — boucle de 15 minutes.
Avec l’aimable autorisation de l’artiste, de Galerie Isabella Bortolozzi (Berlin),de Cabinet Gallery (Londres), de dépendance (Bruxelles) et de Gladstone Gallery (New York).

Ed Atkins, Refuse.exe, (still), 2019-2020.
Simulation 3D en temps réel sur 2 écrans avec son — boucle de 15 minutes.
Avec l’aimable autorisation de l’artiste, de Galerie Isabella Bortolozzi (Berlin),de Cabinet Gallery (Londres), de dépendance (Bruxelles) et de Gladstone Gallery (New York).

Ed Atkins, Untitled, (still), 2018.
Vidéo avec son, boucle de 5 minutes et 30 secondes.
Avec l’aimable autorisation de l’artiste, de Galerie Isabella Bortolozzi (Berlin),de Cabinet Gallery (Londres), de dépendance (Bruxelles) et de Gladstone Gallery (New York).

Ed Atkins, Good smoke, (still), 2017.
Vidéo avec son surround, boucle de 16 minutes et 40 secondes.
Avec l’aimable autorisation de l’artiste, de Galerie Isabella Bortolozzi (Berlin),de Cabinet Gallery (Londres), de dépendance (Bruxelles) et de Gladstone Gallery (New York).

Ed Atkins, The worm, (still), 2021.
Vidéo avec son, boucle de 12 minutes et 40 secondes.
Avec l’aimable autorisation de l’artiste, de Galerie Isabella Bortolozzi (Berlin),de Cabinet Gallery (Londres), de dépendance (Bruxelles) et de Gladstone Gallery (New York).
Je voulais écrire quelque chose qui pointe directement vers le futur. Donc tout a été rédigé au futur simple. Tout y est une promesse inébranlable. Sorcerer aurait pu s’intituler autrement. Mais ce n’est pas le cas. Il s’intitule Sorcerer, et si vous avez besoin d’une baguette magique, c’est d’une baguette fantastique à tenir en regardant la pièce.
Les goûts et les couleurs
Carolien Niebling
En utilisant la nourriture et la nature pour proposer des perspectives alternatives dans le domaine du design, Carolien Niebling élargit notre approche des pratiques alimentaires en faisant de la saucisse une métaphore de la nécessité de repenser notre attitude vis-à-vis de l’alimentation quotidienne. La saucisse est abordée comme un véritable objet de design, à réimaginer et à conceptualiser. La particularité du travail de Carolien Niebling réside dans l’échange constant entre les domaines de l’alimentation et de la recherche scientifique, équilibrant élégamment innovation et imagerie délicate pour incarner son concept. Grâce à l’utilisation astucieuse de la photographie et des images en mouvement, la nourriture peut être décontextualisée et se présenter comme un produit évocateur dans son essence pure. En étudiant ses apparences et ses formes diverses, Carolien Niebling évoque des perspectives visionnaires pour l’avenir de l’alimentation et du design de produits.
Ilaria Trame
Sur votre site web vous vous définissez comme une « Food Futurist ». Pouvez-vous nous expliquer ce que vous entendez par là ?
Carolien Niebling
« Food Futurist » est simplement une formule pour manifester mon intention de travailler sur l’alimentation sans perdre de vue l’avenir. J’ai une formation en design de produits et, à ce titre, je réfléchis aussi en tant que designeuse de produits. C’est une sorte de jeu de mots sur le lien entre les deux identités.
Ilaria Trame
Votre ouvrage The Sausage of the Future [la saucisse du futur] est votre œuvre la plus connue. La saucisse y est considérée comme une métaphore de la multitude de possibilités qui s’offrent à nous en matière de nutrition si nous voulons réduire notre consommation de viande. J’aimerais connaître votre méthodologie de travail lors de l’étape de réflexion et lorsque vous envisagez les différents ingrédients qui pourraient se présenter et nourrir votre concept. Avez-vous voyagé, vous êtes-vous inspirée de différents lieux et cultures, avez-vous expérimenté différentes alternatives alimentaires ?
Carolien Niebling
Pour être tout à fait honnête, lorsque j’ai commencé le projet, je n’étais pas une mangeuse incroyablement « téméraire ». J’aimais simplement essayer de nouveaux plats par curiosité. Avec ce projet j’ai vraiment réussi à réunir ma passion pour le design et mon intérêt pour la nourriture.
J’ai commencé à faire des recherches sur la saucisse parce que j’ai toujours pensé qu’elle était, en un sens, un aliment incompris. Les gens disent souvent : « Je n’en mange pas parce que je ne sais pas ce qu’il y a dedans. » Mais cette crainte est injuste car les bouchers ne cherchent pas à cacher les ingrédients qu’ils utilisent. Il s’agit simplement d’utiliser les restes de viande et d’en faire quelque chose de bon. Si vous avez peur de la saucisse, vous devriez avoir peur de son producteur et de tous les autres aliments qu’il confectionne. En menant des recherches, j’ai acquis un grand respect pour cet aliment.

Carolien Niebling, The Sausage of the Future, 2017. Projet soutenu par l’ECAL et publié par Lars Müller Publishers. Collage d’Emile Barret.
La saucisse a en fait été créée il y a 5 000 ans grâce à une maîtrise efficace de la boucherie, à une époque où il ne fallait gaspiller aucun aliment. On mettait dans une peau les restes de la production de viande et on les assaisonnait de sel pour qu’ils se conservent mieux. Par conséquent, elle a réussi à changer un mode de vie, car à l’époque, elle permettait d’emballer les sources de nourriture, de voyager plus loin et de rester à l’étranger beaucoup plus longtemps, pour l’exploration.
Au départ, j’ai commencé par m’intéresser à différentes saucisses venues du monde entier. Chaque région du monde a la sienne ; cela me fascine et m’inspire. En même temps, je me suis promis d’essayer tous les types de saucisses que je trouverais au cours de mes voyages ; le résultat a été très surprenant. La forme est la même, mais l’expérience est à chaque fois complètement différente. En ce sens, elle s’apparente pour moi à un élément de design ; elle est fabriquée comme une chaise ou une lampe. Il faut qu’elle ait un look, qu’elle soit constituée d’éléments qui répondent à une certaine logique et qu’elle ait une durée de vie, tout comme un produit.
Ilaria Trame
Comment le public a-t-il réagi à votre projet ? A-t-il compris les différentes possibilités que peut offrir la saucisse ?
Carolien Niebling
Les réactions ont été très différentes selon les publics. À New York, par exemple, l’accueil a été incroyablement impressionnant, pour ne pas dire hostile. D’un côté, il y avait des gens qui venaient directement me parler pour remettre en question ma théorie, comme si je leur proposais une réponse unique à un problème. D’autres, en revanche, étaient beaucoup plus enthousiastes à l’idée de voir le projet évoluer. En Europe, c’était assez différent. En Allemagne et aux Pays-Bas, au départ, le public était un peu méfiant, il ne comprenait pas l’intérêt de ma recherche. En revanche, en Italie, en Suisse, en France, en Espagne et au Royaume-Uni, il s’est montré très enthousiaste. En Nouvelle-Zélande, il a vu en moi une visionnaire. Je ne sais pas pourquoi mon travail a suscité des réactions aussi diverses. Pour moi, c’est presque naturel, puisque de toute façon il existe des saucisses différentes de par le monde. J’ajoute simplement davantage de légumes et je propose des modifications de la recette.
Ilaria Trame
Je suis également curieuse de savoir, compte tenu de votre formation de designer de produits, comment votre langage visuel a évolué du design de produits à l’alimentation.
Carolien Niebling
J’ai réalisé à quel point il est important de présenter une alternative aux aliments existants. Lorsque vous concevez un produit, vous effectuez d’abord quelques tests, puis vous présentez les différentes étapes de réalisation. En revanche, lorsque vous concevez des aliments, vos tests se perdent. Une fois qu’ils ont disparu, il vous reste seulement des images ou des recettes. C’est pourquoi dans l’ouvrage sur les saucisses j’ai tenté de prendre la partie visuelle très au sérieux. J’ai apporté une grande attention à ce sur quoi je voulais que le public se concentre, dans la photographie comme dans le dessin.
Mais à l’origine, c’est par la saucisse que s’est opéré le passage du design de produit à l’alimentation. Dès le début de mes études à l’ECAL, mes projets ont tous été liés à l’alimentation, malgré moi. C’est seulement lorsque j’ai conçu mon portfolio que je me suis aperçue que tous mes projets étaient d’une manière ou d’une autre liés à la nourriture. J’ai mis au point des ustensiles pour manger des insectes, une machine à fumer les aliments et une boîte à lunch. C’est seulement quand j’ai obtenu mon diplôme que j’ai réalisé que je voulais créer des objets plus explicites. C’est à ce moment-là que j’ai envisagé d’inclure la nourriture dans le processus de création. Et mon approche a également changé. J’envisageais de concevoir des systèmes et des nouvelles façons de penser plutôt que des objets.

Carolien Niebling, The Sausage of the Future, 2017. Projet soutenu par l’ECAL et publié par Lars Müller Publishers.
Pour cela, j’ai travaillé avec un boucher et un chef spécialisé en cuisine moléculaire. Le premier m’a aidée dans le processus de fabrication des saucisses, qui a pris la forme d’un échange constant d’idées et d’expériences multiples. Le second m’a plutôt aidée à comprendre les processus chimiques à l’œuvre dans la transformation de la viande et m’a montré par quoi la remplacer en l’absence de protéines animales.
Ilaria Trame
Aviez-vous des connaissances en biologie avant de vous pencher sur votre sujet ou les avez-vous développées au fil de votre travail ?
Carolien Niebling
Aussi stupide que cela puisse paraître, j’ai toujours voulu étudier les sciences au lycée, mais je pense que j’aurais été trop jeune pour cela à l’époque. Je ne les comprenais pas encore. Mais maintenant, j’adore ça. Apprendre ce qu’est une protéine, par exemple, la raison pour laquelle nous en avons besoin et en quelle quantité, et pourquoi il existe des protéines qui permettent de remplacer la viande (et d’autres qui ne le permettent pas). Je voulais étudier le sujet et être capable de l’expliquer en une seule page, car les explications scientifiques sont souvent très longues et le lecteur se déconcentre facilement. Il est important de rendre le sujet accessible à un large public, c’est le plus pertinent selon moi.
Ilaria Trame
Ce qui est fascinant dans votre travail, c’est qu’il ne propose pas seulement un produit, mais aussi une vision alternative et un mode de pensée innovant. Avec The Sausage of the Future, vous faites la lumière sur une solution à la surproduction de viande. Mais ce faisant, vous présentez aussi votre projet sous une forme incroyablement esthétique, en accord avec l’expression créative d’un designer.
Carolien Niebling
J’aime les livres, même si cela peut sembler démodé de nos jours. En créant le mien, je me suis rendu compte de ce qui me plaît tant chez eux : le fait que, dans leurs pages, un concept est saisi dans un cadre temporel spécifique. Lorsque vous lisez des articles en ligne sur le sujet auquel je m’intéresse – par exemple l’avenir de l’industrie alimentaire – vous ne pouvez jamais savoir à quel moment ils ont été écrits, les choses ont pu évoluer depuis. En revanche, dans les livres, un concept est formulé à un moment précis, et les photos sont éternelles. Ce sont des images que vous pouvez saisir. Et en faisant cela, vous créez un autre objet de design.
Ilaria Trame
Beaucoup de vos œuvres s’intitulent « The Beauty of… » – par exemple le film The Beauty of Edible Things et les vases que vous avez conçus pour The Beauty of Water Plants – comme si votre travail de designer ne consistait pas à produire des objets nouveaux, mais essentiellement à mettre en valeur et à accentuer la beauté naturelle de vos sujets. Quel rôle la nature a-t-elle joué dans votre processus de création ?
Carolien Niebling
Elle a été déterminante. Avec The Beauty of Water Plants, j’avais pour objectif d’exposer un problème réel en conservant une note positive.

Carolien Niebling, The Sausage of the Future, 2017. Projet soutenu par l’ECAL et publié par Lars Müller Publishers. Collage d’Emile Barret.
Par exemple, la culture des plantes et des fleurs est aussi peu naturelle que certaines productions alimentaires. Nous ne nous rendons pas compte que les fleurs que nous achetons viennent de loin alors qu’elles pourraient être cultivées localement. Ou que les fleurs ne fleurissent que pendant de courtes périodes et ne devraient pas être disponibles toute l’année. C’est devenu un commerce, tout tourne autour de l’industrie, puisque de nos jours on assiste à une surproduction et à une surconsommation des produits de la nature.
Pour le projet The Beauty of Edible Seaweeds, j’ai réfléchi à l’importance des algues dans l’avenir de l’industrie alimentaire et je me suis demandé pourquoi on ne généralisait pas leur utilisation. Pour moi, les algues sont des plantes incroyables qui poussent de manière improbable sans substrat et flottent généralement dans l’eau, tout en étant robustes et résistantes pour pouvoir supporter les courants forts et les marées. Pour moi, c’est ce qui les rend vraiment fascinantes. Mais comment se fait-il que cette beauté ne se traduise pas dans l’assiette ? J’ai eu l’idée de sonder la beauté de ces plantes comestibles en me concentrant sur des algues disponibles en supermarché. Je les ai réhydratées, puis je les ai projetées sur une assiette de manière à ce qu’elles ressemblent exactement à ce qu’on pourrait manger. Le concept sous-jacent consistait vraiment à prendre un moment pour observer les aliments qu’on pourrait manger et s’émerveiller de leur beauté.
Ilaria Trame
Comment pensez-vous que votre vision du design, bien plus axée sur le lien qui existe entre la nature et la beauté, pourrait s’appliquer aux secteurs de la mode et des cosmétiques ?
Carolien Niebling
C’est une question à laquelle il est difficile de répondre. Lorsqu’on s’inspire directement de la nature, par exemple de la façon dont les végétaux ont poussé, et qu’on crée des structures à partir de là, que ce soit dans le domaine du design, de l’architecture ou de la mode, j’ai l’impression que c’est un peu forcé. On peut assurément s’en inspirer, mais je préfère la prendre simplement telle qu’elle est. Les plus belles choses sont aussi simples que cela. Je préfère prendre de bonnes photos et zoomer, sortir la nourriture du contexte de la cuisine ou du supermarché et la placer dans un univers où l’on peut apprécier la beauté essentielle du sujet, sans essayer de le reproduire. En la décontextualisant, nous pouvons la contempler.
EXPLORER REVUE
Héros
Camille Moulin-Dupré
Auteur du Voleur d’Estampes, manga en deux volumes publié chez Glénat, Camille Moulin-Dupré est un passionné de cinéma. À travers ces illustrations et ce texte qui retrace son histoire, entre souvenirs intimes et plaisirs cinéphiles, il revient sur les films et personnages qui ont façonné son identité d’auteur.
Je suis auteur de manga. Avec un père peintre et une mère qui fut bibliothécaire, on pourrait voir une certaine logique à ce que je sois auteur de bande dessinée : le mélange entre le texte et les images.
Pourtant faire du manga n’était pas une évidence. Si j’en suis venu là, c’est que je voulais faire des films. Aussi loin que je me souvienne, je suis toujours allé en salle. Dès l’âge de trois ans, j’y ai accompagné ma mère durant les week-ends et les vacances. Adolescente, elle séchait les cours pour aller au ciné. Elle était passionnée par Truffaut et avait une fascination sans borne pour Christopher Walken. Assez naturellement, elle m’a emmené avec elle. Petit, j’ai pu voir toutes les daubes que je voulais (j’ai vu toutes les adaptations des Tortues Ninja). On pouvait aller en salle deux fois par jour, voir cinq à sept films par semaine. Du cinéma Hollywoodien. Du cinéma d’auteur. Du cinéma asiatique. Bref tout. Sans compter les cassettes vidéo.
Avec mon père, qui peignait avec la télévision en fond sonore, j’ai découvert les polars, la science-fiction et les films d’action, que l’on voyait sur Canal + ou en magnétoscope. J’ai une très grosse culture vidéoclub. Pourtant le cinéma n’était qu’un divertissement… Ce que je voulais, c’était faire les Beaux-Arts.
À cette époque, fin 90, début 2000, le Graal pour les étudiants était de posséder une caméra DV. Un caméscope numérique, une Sony de préférence, avec un Mac pour faire du montage. Tout le monde voulait faire des installations vidéo… Moi j’avais tout claqué dans un PC. Ni mes parents ni moi ne pouvions m’offrir de caméra.
Pourtant je sentais que je voulais faire de la narration en vidéo. Et peu importe si c’était en basse résolution. Pendant un temps, j’ai utilisé une webcam avec un dictaphone couplé à un micro de PC. On ne peut pas faire plus cheap. Tout le monde me le rappelait sauf mon professeur de vidéo qui m’encourageait. De l’image et du son: c’est tout ce qui compte sur un écran quand on a les bonnes intentions.
Mais très vite, je me suis heurté à deux réalités. Le cinéma est un art collectif et moi j’étais seul. Et j’ai compris que lorsque l’on ne sait pas cadrer avec un caméscope, comme c’était mon cas, alors il était compliqué de faire un film. Pourtant deux ou trois ans plus tard, un producteur me signait pour réaliser un premier court-métrage, avant même que j’obtienne mon diplôme. Et ça, c’est en grande partie grâce à Satoshi Kon.
Satoshi Kon le réalisateur qui m’a donné envie de faire du cinéma
Les amateurs de cinéma d’animation connaissent tous Satoshi Kon. Pourtant, le jour où j’ai découvert son premier film, j’étais seul dans la salle. Tout juste bachelier, avec un appétit délirant autour du Japon, Perfect Blue m’a mis une grande claque. En voyant ce thriller psychologique où une ancienne chanteuse de girls band sombre peu à peu dans la schizophrénie, je comprends que les films d’animation peuvent être pour adultes. Je suis fasciné par la façon dont Kon mêle le réel, l’imaginaire, l’onirisme, les cauchemars ou les visions délirantes. Et si j’utilise le fantastique et les cauchemars dans mon œuvre, c’est probablement du fait de son influence. Quelques années plus tard, je découvre sa série Paronaïa agent (2004), que je considère comme son chef d’œuvre. Il y a notamment un épisode qui se passe lors de la création d’un dessin animé. L’occasion pour le réalisateur de décrire tous les métiers : animateur, réalisateur, décorateur, coloriste. Cet épisode, c’est le déclic. À partir de là, c’est décidé, je peux faire de l’animation chez moi, seul, en autodidacte. Il me suffit juste d’enfiler toutes les casquettes. Je ne sais pas animer ? Pas grave, je filmerai au caméscope et je décalquerai plan par plan à la palette graphique. Je ne sais pas cadrer ? Là, désormais avec un ordinateur, j’ai tout le temps de peaufiner mon plan. Je réalise alors en autodidacte sept minutes d’animation, avec mon petit frère de sept ans comme interprète principal. L’animation vaut ce qu’elle vaut, par contre je soigne le découpage, le montage, le jeu avec la musique, et surtout le style graphique.
Quand Bruno Collet, un réalisateur de films d’animation passe à mon école des Beaux-Arts, je lui montre mon film, histoire d’avoir un avis. Une semaine plus tard, son producteur me laisse un message sur mon répondeur. Ils seraient très heureux que je réalise un court métrage pour eux.

Camille Moulin-Dupré, Mima, l’héroïne angoissée et son double maléfique du film Perfect Blue de Satoshi Kon.
Jean-Paul Belmondo, l’acteur pour lequel j’ai réalisé un film
Quand Jean-François le Corre, le producteur du studio Vivement Lundi! me propose de faire un film sur Belmondo, j’ai du mal à être enthousiaste. Bébel a beau être une icône du cinéma, pour moi c’est un vieil acteur qui n’est pas de ma génération. Mais faire un film n’est pas une occasion qui se refuse.
J’ai alors en tête un autre chef d’œuvre de Satoshi Kon : Millennium Actress (2001). La vie fictive d’une actrice qui a traversé tout le cinéma japonais. Avec Belmondo, je mesure bien que je peux faire la même chose avec le cinéma français. En regardant cinq films de Jean-Luc Godard et de De Broca, je me rends compte que l’acteur français a joué tous les genres : polar, aventure, comédie, drame, action… Et aussi, qu’il court toujours après une fille : Anna Karina, Jean Seberg, Ursulla Andress, Françoise d’Orléac… L’idée du film Allons-y! Alonzo! (2009) me vient instantanément : Bébel qui part à la poursuite d’une jeune femme, en explorant sa filmographie, le tout dessiné comme le journal de Tintin.

Camille Moulin-Dupré, Jean-Paul Belmondo en Pierrot le fou, extrait de mon film ALLONS-Y ! ALONZO !
Wes Anderson, le réalisateur par lequel je suis arrivé au manga
C’est en voyant Fantastic Mister Fox (2009) que m’est venue l’idée du Voleur d’estampes. En sortant de la salle, je me suis mis à raconter ma propre histoire de cambrioleur. Mais je voulais la transposer dans le Japon du XIXe siècle, avec une esthétique fidèle aux maîtres de l’ukiyo-e : Harunobu et Hiroshige.
Et voici comment m’est apparu mon nouveau film d’animation ! Un projet hybride que je voulais aussi transposer en livre. Au final le film ne s’est jamais fait.Il est devenu un manga en deux tomes édités chez Glénat. Aucun regret, bien au contraire : en quatre cents pages on peut raconter bien plus de choses qu’en quinze minutes d’un court-métrage.
Pourtant ce projet je l’ai vraiment pensé comme un film d’animation. Chaque case est un plan, chaque chapitre est une scène. Je compose mes doubles pages comme si elles étaient un cadre de cinéma. Le cinéma, c’est avant tout raconter en image plutôt qu’en mot. Aussi pour chaque tome, je dessine d’abord toutes les planches et ce n’est qu’une fois les images terminées que j’y ajoute les dialogues. Si une image se suffit à elle-même, pas la peine de rajouter du texte.
Le premier tome a été un succès inattendu, en grande partie par son style visuel, et aussi grâce à la passion grandissante du public envers le Japon. Cela allait faire un an jour pour jour que le livre était sorti. La veille, j’ai dit à ma fiancée à quel point j’étais heureux de fêter l’anniversaire du Voleur d’estampes, mais que le plus beau des cadeaux serait un coup de téléphone pour du travail. Et ç’a été le cas. Octavia Peissel, la co-productrice de Wes Anderson m’appelle pour me dire qu’il avait lu et aimé mon manga, et qu’il souhaiterait que je travaille sur son prochain film qui se déroule au Japon : Isle of Dogs (2018). Moi qui était autodidacte, j’allais travailler pour un grand cinéaste ! Comble de la chance, je me suis retrouvé dès le départ à travailler sous les ordres directs de Wes Anderson, avec Octavia comme relais entre nous deux. Wes est la personne la plus intelligente que j’ai rencontrée. Il a un regard terriblement affûté, il voit tout, la moindre erreur, instantanément. Avec lui, il n’y a pas de place pour l’imperfection. Il faut aussi accepter qu’on est là pour nourrir son imagination. Une imagination que je pressens comme perpétuellement en mouvement, et derrière laquelle on court toujours. Produire pour lui est long et exigeant mais il y a une véritable satisfaction à passer autant de temps sur une simple image. À la perfectionner. Surtout quand le résultat est là.

Camille Moulin-Dupré, Mon Voleur d’estampes, face au loup de Fantastic Mister Fox, de Wes Anderson. Le Voleur d’estampes, tomes 1 & 2 édité chez Glénat manga.
Mad Max Fury Road, mon film préféré
Immortan Joe, Furiosa. Un univers qui me transporte instantanément. Pourtant esthétiquement, c’est assez éloigné de mes goûts. Mais la fascination est bel et bien là. Mad Max Fury Road (2015) est tout ce que j’aime dans le cinéma. La première fois que je l’ai vu, c’était en après-midi. J’ai enchaîné ensuite avec une soirée spéciale qui projetait les deux premiers Mad Max, pour finir à nouveau sur Fury Road.
La nuit qui a suivi, j’ai rêvé en boucle des visages d’Immortan Joe et Furiosa. Puis j’ai été incapable de faire quoi que ce soit pendant une semaine. Même chose, toutes les fois où je l’ai revu. En réalisant cette illustration, j’ai de nouveau commencé à rêver du film…

Camille Moulin-Dupré, Immortan Joe et Furiosa, les héros de Mad Max Fury Road
Baby Rock
and Doll
Nicolas di FeliceCaroline PoggiJonathan Vinel
Après de nombreuses années à travailler dans l’équipe du designer Nicolas Ghesquière, et un rapide passage dans le Dior de Raf Simons, Nicolas di Felice a tout récemment été nommé directeur artistique de la maison française Courrèges. Enfance dans un petit village belge, non loin de néons de maisons closes, puis études à la Cambre à Bruxelles, qu’il ne termine pas pour rejoindre Paris, et Balenciaga.
Jonathan Vinel et Caroline Poggi font des films, le plus souvent ensemble, parfois séparément. L’un est né dans une banlieue proche de Toulouse, l’autre dans une des grandes villes de Corse. On peut notamment citer Bébé Colère, court-métrage sorti en 2020, commandé par la Fondation Prada ; Martin Pleure, réalisé intégralement sur le jeu vidéo Grand Theft Auto V, ou encore à leur premier long-métrage Jessica Forever.
Décrire les travaux des uns comme des autres en quelques mots serait réducteur, tant les mondes qu’ils proposent sont denses. Leur échange, une fin d’après-midi, en face du parc des Buttes-Chaumont, dessine les contours de leurs univers.
Nicolas di Felice
Je suis encore en train de prendre le rythme chez Courrèges. J’ai commencé il y a un an et demi. C’est la première fois que j’ai ce rôle de directeur artistique. J’ai tendance à être assez control freak : le rapport que j’ai aux vêtements est extrêmement précis. Je pense que jusqu’à présent, je donnais des directions très précises à mon équipe. Pour la collection qui défile en mars, je me suis forcé à lancer un genre de brief, et ne faire qu’un seul dessin. Je suis parti une semaine, et puis j’ai vu ce que mon équipe proposait. C’était très enthousiasmant de voir ce qu’ils comprenaient. Un certain nombre de pièces sont des propositions, des dialogues avec certains des stylistes – j’apprends à travailler avec cette nouvelle équipe.
Caroline Poggi
Après avoir travaillé avec Prada sur notre court-métrage Bébé Colère, Jonathan et moi avions pu assister au développement d’une collection : elle n’était prête que deux ou trois jours avant le défilé.
Jonathan Vinel
C’est tellement différent du cinéma, cette temporalité.
Caroline Poggi
En tout cas, c’est différent de notre façon de faire du cinéma. On est dans quelque chose de très préparé. Nos envies de scènes demandent beaucoup d’acteurs, de la lumière… On ne peut pas arriver et dire : on verra sur le moment. En assistant à ça, je ne comprenais pas.
Nicolas di Felice
Je connais vraiment ce genre de choses… Quand j’ai commencé chez Balenciaga en 2008, c’était encore très petit. Dans les vieilles collections, les vêtements sont parfaits – aussi parfaits que ce dont ils avaient l’air. On croirait qu’ils sont photoshoppés, mais non. On avait une équipe pour le défilé, et puis une équipe pour la pré-collection. Des stylistes travaillaient six mois sur cinq pièces. On les refaisait, encore et encore, jusqu’à ce qu’elles soient parfaites. Si la surpiqûre était un peu trop large, on recommençait tout le vêtement. De nos jours, on peut lancer un vêtement en patchwork de cuirs colorés cinq jours avant un défilé, alors qu’on n’avait pas commandé ces matières encore trois mois avant. Il faut alors, en un temps record, trouver le motif du patchwork, les cuirs, il faut lancer la pièce, la faire fabriquer… C’est un peu fou.
Revue
Vous pensez que les méthodes de travail ont changé entre 2008 et aujourd’hui ? Ou c’est quelque chose d’autre ?
Nicolas di Felice
Je pense que c’est une question de moyens… Aussi, je ne trouve pas ça confortable de faire les choses dans la précipitation. Même si j’ai déjà fait un certain nombre de choses, je me sens – peut-être comme Caroline et Jonathan – toujours en construction. On a envie d’être fier de ce qu’on fait, d’être sûr.
Caroline Poggi
Il y a un temps qu’on est obligé d’avoir, de mûrissement, pour laisser les idées grandir, avoir du relief. Même quand on cherche des pages d’illustration, que l’on pense à la façon dont on va les montrer à des gens, on pèse quelle image arrive en premier, en deuxième…
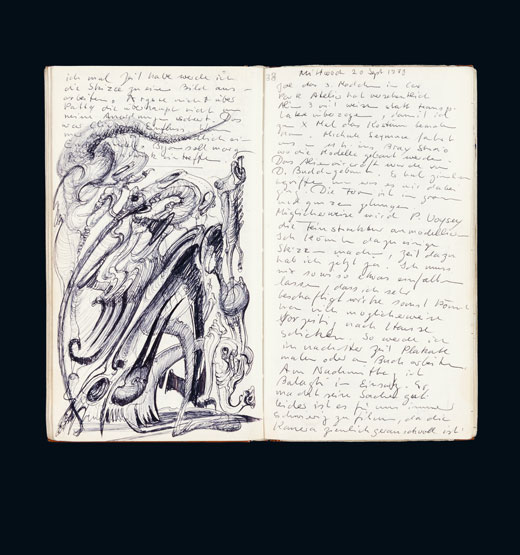

Extrait du livre d’H.R. Giger, Alien Diaries / Alien Tagebücher, Edition Patrick Frey, 2013 (première édition). Avec l’aimable autorisation des éditions Patrick Frey.
Tout ça a un équilibre, que tu ne peux pas trouver en deux jours. C’est dur d’arriver à quelque chose qui a du relief, une profondeur, une histoire, quand tu es dans la pression. Tu as tendance à marcher plus à l’instinct – même si ça peut être bien.
Nicolas di Felice
Ça peut être beau aussi… Une pièce à laquelle tu n’avais pas pensé, une scène que tu n’avais pas voulue…
Caroline Poggi
Je pense qu’il faut les deux. On peut garder cette notion d’instinct sur un temps plus long. C’est quand tu retravailles trop quelque chose que tu perds le désir.
Jonathan Vinel
Nicolas, est-ce que tu as une histoire de marque à respecter, ou est-ce que tu es totalement libre ? Est-ce que tu peux tout changer ?
Nicolas di Felice
J’ai hérité de la maison dans l’état dans lequel elle était, il y a un an et demi. Je n’ai eu aucune exigence de qui que ce soit. La famille Pinault, à qui Courrèges appartient, ne savait pas ce que j’allais présenter : je n’ai fait aucun dossier d’images, de croquis… J’ai été engagé sur une lettre, où je racontais ma vie. Ils ont parié sur moi, ne sachant absolument pas ce que j’allais faire. Je n’ai jamais rêvé d’avoir ma marque, avec mon nom. Ce qui me plaisait dans le projet, c’est de faire revivre une maison que j’affectionne beaucoup, et qui m’a toujours inspiré.
Jonathan Vinel
Mais qui a aussi un héritage.Nicolas di Felice C’est pour ça que, dès le début, j’ai voulu que l’on fasse des rééditions. Personne au marketing ne m’a rien demandé.
Quand j’ai repris la maison, il me semblait primordial de réfléchir à ce que je voulais proposer, et produire. On parle tout le temps d’écologie... Je voulais réfléchir à ce qui allait être produit, pour ne pas gaspiller. Formellement, mais aussi dans mes idées. Faire un hommage à la maison, ne pas arriver en détruisant tout à grands coups de massue. De manière générale, je n’aime pas trop ce genre d’entrée.
Je trouvais cette marque super belle, comme un petit symbole de quelque chose que je ne retrouvais plus autour de moi. Même le fait que ce soient des vêtements très géométriques, des à-plats de couleurs, des matières absorbantes, très nettes… Dans le flot d’images que je voyais, les images de Courrèges : tout à coup, juste une forme colorée. C’était une respiration très inspirante pour moi, que j’avais envie d’honorer.
Jonathan Vinel
Je me dis que parfois tu dois avoir des idées qui te plaisent, qui te semblent justes, mais qui ne le sont pas par rapport à Courrèges…
Nicolas di Felice
Oui, bien sûr… Mais ça ne me brise jamais le cœur de faire un choix.
Jonathan Vinel
Où vont tous ces trucs que tu ne peux pas faire ?
Nicolas di Felice
Je les transforme pour que ce soit Courrèges, je ne laisse pas tomber l’idée.
Caroline Poggi
Ç’a à voir avec la réception de ton travail : comment ça va être reçu, qui regarde… Comment tu montres un film, c’est pareil.
Jonathan Vinel
Quand on a une commande, on se positionne toujours par rapport à comment ça va être perçu, et comment on dialogue avec ça. Quand tu arrives dans une maison qui a une certaine histoire, j’ai l’impression qu’il y a forcément cette question de comment tu vas te positionner par rapport à elle : parfois, le fait que ça ne corresponde pas à la maison, ça peut aussi créer d’autres envies…
Nicolas di Felice
Les idées rentrent toutes, d’une manière ou d’une autre. Même si c’est seulement du point de vue de l’idée, ce que racontait la pièce… On lui fera raconter la même chose, mais différemment. Il y a ce truc d’opposés qui se rencontrent. Mes inspirations ne sont pas du tout des petites dames des années soixante : je suis inspiré par des choses qui sont sans doute similaires aux vôtres. C’est comme si ça passait très naturellement par un filtre, et que je les remélangeais.
Jonathan Vinel
À chaque collection, tu as une idée un peu globale ou tu la trouves au fur et à mesure ?
Nicolas di Felice
Je me dis tout en une seconde. La musique, le défilé, le lieu, le style… Ça vient comme un flash. Je vois les choses très vite. Le reste du temps, c’est pour tout traduire.
Jonathan Vinel
Pour moi, j’ai l’impression que c’est l’inverse. Au début, c’est plein de petites envies ; et il faut travailler pour qu’elles sortent de quelque chose de purement fétichiste, qui ne veuille pas dire grand-chose… Trouver l’histoire de ces envies en les montant ensemble.
Caroline Poggi
Il y a des images dont tu sais au fond de toi que ce sont des premières images.
Jonathan Vinel
Le totem, un peu.
Caroline Poggi
Ce ne sont pas forcément des images qui restent, au final. Mais c’est l’origine, le battement de cœur… Si tu as l’impression de te perdre, tu reviens à cette image et bon, c’est bon, tu peux repartir. Après, forcément, tu creuses, tu donnes des formes, du relief… Ça part de quelque chose d’intuitif, qui le devient de moins en moins. Tu es obligé de formuler tes idées en permanence, encore plus en étant deux : on passe notre temps à parler, à verbaliser. Petit à petit, il y a des codes, des genres, des ambiances, des sons, des musiques qui viennent héberger ces images initiales.
Nicolas di Felice
Quand je m’emballe dans les belles surprises que je rencontre dans le processus, j’essaie de me rappeler, me remettre dans ces images du début. Ou bien, quand on n’a pas le lieu que l’on veut pour faire un défilé, il s’agit quand même de trouver la manière de raconter l’histoire que l’on avait en tête. Heureusement, il y a une évolution au cours du processus : tout ce qui en fait partie est intéressant, même parfois certains incidents.
Jonathan Vinel
Est-ce que tu te racontes une histoire quand tu crées une collection ? Ou bien est-ce que ce sont des choses visuelles, sensorielles ?
Nicolas di Felice
Je ne me raconte que des histoires. À la Cambre, c’était assez troublant, parce qu’ils tenaient quand même à l’art en général. Tu découvres des artistes, des expositions qui résonnent un peu en toi. Mais j’avais du mal à venir avec des documents d’inspiration. Caroline, je t’avais entendu parler de votre court métrage After School Knife Fight, et je me reconnais dans cette idée de tenter de représenter un sentiment – c’est la fin de l’adolescence, ce film. Je n’étais inspiré que par ce genre de choses. Une fille que j’avais croisée à un festival de musique, qui dansait devant un mur de speakers… Mais va trouver cette image !
Caroline Poggi
Et même si tu en avais une image, elle ne représenterait pas le moment.
Nicolas di Felice
Pas vraiment.
Caroline Poggi
C’est un état.
Nicolas di Felice
Ce sont des moments, des sentiments, des rencontres. Après, heureusement, à trente-huit ans, j’ai eu la chance de trouver des artistes…
La première fois que j’ai vu des photos de John Divola, je me suis dit mais c’est exactement tout ce que j’aime. J’avais l’impression de comprendre totalement ce qu’il faisait, mais aussi d’être compris. Il y a aussi des photos de Mapplethorpe...
Maintenant, je peux faire des moodboards, mais pendant mes années d’école c’était problématique… Jonathan, Caroline, est-ce que vous fonctionnez avec des moodboards ?
Caroline Poggi
Je n’aime pas ce mot.
Nicolas di Felice
C’est vrai, moi non plus
Caroline Poggi
Mais je vois évidemment ce que tu veux dire. Moi aussi je dis comme ça, parce que c’est difficile d’appeler ça autrement. Et puis, nous en faisons.
Jonathan Vinel
Énormément. Le problème, c’est que souvent, dans les images, je cherche à montrer le sentiment qu’elles m’évoquent. Quand tu les montres, les gens vont voir des formes, des couleurs… Alors que c’est quelque chose d’intime qui te rattache à cette image. Souvent, ce n’est pas dans l’image elle-même.
Caroline Poggi
On a beaucoup de retours, en commission – alors que moi j’adorais nos moodboards, que j’étais contente de l’effet que ça produisait sur moi, que ça me donnait envie de faire le film – « C’est dommage, car les images ne correspondent pas trop à l’imaginaire qu’on s’en fait. » Et c’est vrai que ce n’est pas collé, ce n’est pas illustratif. C’est un état, quelque chose d’un peu plus large. C’est tellement dur à transmettre.
Jonathan Vinel
C’est déjà du montage. Les images ne sont pas là pour aiguiller une fabrication précise, mais pour donner un sentiment global de ce que l’on veut dans le film – de l’ordre de la sensation. C’est dur à capter. Souvent, les gens s’arrêtent précisément à ce que l’on voit dans l’image.
Caroline Poggi
« Mais il n’y avait pas cette scène dans le moodboard ? »
Jonathan Vinel
Parfois, on n’en fait pas, comme ça chacun projette ce qu’il veut.
Caroline Poggi
C’est dur de trouver la balance, surtout lorsque l’on fait un travail qui n’est pas naturaliste : arriver à transmettre l’atmosphère, l’univers, de tes plans, de tes scènes. Le problème c’est que ceux à qui s’adressent nos moodboards, qui souvent doivent financer le film, en voient tellement que c’est difficile de leur demander de faire un effort. Il faut que les choses soient simples, faciles à prendre.

Image extraite du livre d’H.R. Giger, Alien Diaries / Alien Tagebücher, Edition Patrick Frey, 2013 (première édition).
Avec l’aimable autorisation des éditions Patrick Frey.
Nicolas di Felice
Je vois très bien. Ce qui motive une collection, c’est souvent quelque chose que j’aurais du mal à exprimer par une image. Quand je fais les premiers briefs de collection, je parle à mon équipe, je leur raconte des histoires. J’ai l’impression – et c’est ce que je ressens aussi dans votre travail – que mes projets demandent beaucoup d’énergie, donc j’ai besoin d’être motivé par quelque chose qui me touche.
Jonathan Vinel
S’il n’y a pas déjà une image qui résume parfaitement, c’est peut-être là aussi que ça vaut le coup de le faire.
Caroline Poggi
Ce qui est difficile pour moi, c’est que je suis la dernière spectatrice de mes films. Je fais un film que j’aimerais voir au cinéma, que j’aime profondément, mais je suis tellement dans le process que je suis incapable de le voir. Jessica Forever, sorti en 2018, on l’a seulement revu dernièrement – quatre ans plus tard. Et encore, on le voit avec du recul – c’est notre film. Je trouve ça quand même fou comme métier.
Nicolas di Felice
Ce sont des films que vous faites avant tout pour vous ?
Caroline Poggi
Non, je les fais pour partager quelque chose que je n’arrive pas à retransmettre autrement.
Jonathan Vinel
Je les fais quand même pour moi, à la base. Quand j’ai commencé, c’était dans l’idée de m’amuser. Il y avait quelque chose de puéril à se dire cette image, avec cette musique, je n’ai jamais vu, j’ai envie de voir ce que ça fait. C’était de l’ordre du test : se dire que quelque chose n’a pas l’air possible, le faire, en être content, et voilà, c’est ça le film. J’ai toujours gardé ce rapport instinctif, de désir, de joie. Au début, j’arrive à les revoir ; mais après, avec toutes les critiques… Tout abîme ton film. Quand j’en fabrique un nouveau, je n’arrive plus à voir celui d’avant.
Nicolas di Felice
Tu as peut-être aussi des regrets, liés aux compromis nécessaires sur le tournage…
Jonathan Vinel
Oui. Parfois je me dis : comment j’ai pu faire ça ? J’ai envie de me couper la tête. Mais je suis toujours content de l’énergie dans laquelle on a travaillé. On a l’impression, quand même, d’être allé au bout de l’idée de ce qu’on voulait raconter.
Caroline Poggi
Mais alors toi, Nicolas, c’est quoi qui t’a fait commencer ? Tu savais que tu voulais faire des vêtements ?
Nicolas di Felice
Je n’étais pas prédestiné à faire ça. J’ai fait des études générales, les jésuites… Vient le moment où tu as 17 ans, et il faut choisir ce que tu fais. J’ai dit : la mode. On me demande tout le temps quels sont mes premiers souvenirs de mode. Je viens de la Belgique profonde, il n’y avait pas vraiment de magazines de mode. Mes parents n’achetaient pas Vogue. J’ai compris ce qu’était la mode par la musique, les clips : pouvoir être qui tu veux par le vêtement, la coiffure… Construire une image. Ensuite, quand j’ai découvert ce que c’était, j’ai vite été happé par le côté manuel de la chose. J’adore fabriquer des vêtements. Je prenais beaucoup de temps, à la Cambre, pour faire les vêtements.
Jonathan Vinel
Tu faisais tes vêtements, jeune ?
Nicolas di Felice
Dès que je suis arrivé à Bruxelles, oui. Je customisais tout.
Jonathan Vinel
Mais plus jeune ?
Nicolas di Felice
Non, je n’avais pas de machine à coudre. Mais je me déguisais tout le temps. Mes parents n’ont qu’une seule photo de moi habillé comme ils m’avaient habillé le matin. Sinon, il n’y a que des photos de moi déguisé.
Caroline Poggi
Moi aussi j’avais la malle aux déguisements, que je sortais le weekend. C’était un panier à linge blanc. On avait une petite caméra. Avec mes copines, on la posait, en mettant le petit écran devant nous pour voir le retour, et on se déguisait, on racontait des histoires.
Nicolas di Felice
Tu faisais déjà des films… Toi, Jonathan, tu faisais aussi des images, petit ?
Jonathan Vinel
Non, j’ai commencé assez tard. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire. J’aimais bien les films, mais je n’en regardais pas trop quand j’étais petit. À un moment, j’avais un pote qui voulait faire des films : j’étais chaud, j’ai acheté une caméra. J’y ai pris goût en faisant. C’est comme ça aussi que j’ai pris goût au montage : essayer de fabriquer des films en chopant des images sur Internet, et en voyant ce que ça racontait en les mettant ensemble. J’aurais voulu faire un BTS montage, mais je n’ai pas été pris. Alors je suis allé à la fac de cinéma. J’avais le sentiment d’être en retard, d’avoir zoné. J’avais redoublé ma seconde, puis j’avais arrêté un IUT qui me soûlait, donc je travaillais à l’usine à côté… Je me disais que si je choisissais le cinéma, il fallait que je travaille dur, que je me lance. C’est pour ça qu’on a commencé tôt à faire des films, même en étant à l’école. C’est quelque chose que j’ai vraiment appris. Je n’étais pas prédestiné à ça. Je pense aussi qu’on m’a montré les bons films aux bons moments, qui m’ont fait des chocs assez forts.
Nicolas di Felice
Quels films ?
Jonathan Vinel
Le premier c’était Elephant de Gus van Sant, que mon oncle m’avait emmené voir. J’ai pris un énorme kick. Deux mois après, j’ai vu Mulholland Drive de David Lynch. Ces deux films ont été très fondateurs : je me suis dit que c’était ce que je voulais faire. C’était aussi lié à la musique. À la base, j’étais bassiste dans un groupe de métal, et je voulais faire ça. Mon premier choc esthétique, c’était Slipknot et Korn. Caroline et moi, on parlait récemment du micro du chanteur de Korn, qui a été fait par HR Giger, celui qui a créé la créature et le vaisseau dans Alien.
Nicolas di Felice
Cette idée de musique est toujours importante dans vos films : vos choix de soundtrack…
Caroline Poggi
On travaille tout le temps avec la musique.
Jonathan Vinel
C’est même sans doute une des choses qui nous a donné envie de faire des films…
Caroline Poggi
… écouter certaines musiques au cinéma.
Jonathan Vinel
Ce sont des musiques liées à un univers, un sentiment.
Il y a ce truc ado, emo : je ne suis pas bien dans ce monde-là. On choisit des musiques agressives, un peu extrêmes. Des musiques qui essaient de tout casser.
After School Knife Fight, c’est le film qui en parle le plus. Pourtant, c’est le plus doux qu’on ait fait. On était en train d’essayer d’avoir les financements de Jessica Forever, un film avec beaucoup d’armes, qui traite de la violence. On a aussi fait Martin Pleure en attendant, celui qui a été fait dans Grand Theft Auto.
Nicolas di Felice
Habituellement, les jeux vidéo ne me touchent pas du tout esthétiquement. J’aime y jouer, mais en terme d’esthétique, j’aime plutôt les choses avec du grain, délavées, les VHS… Quand c’est trop en HD, ça me tend. Pourtant, je trouve que Martin Pleure est très beau. C’est ce contraste entre ce truc complètement froid de la super technologie, et Martin qui dit des choses touchantes.
Jonathan Vinel
C’est un film qui s’est fait très simplement, qui n’était pas écrit. Ce n’est même pas en le faisant que c’est devenu un film. Ça le devient parce que, à force, tu en as envie. Sur le moment, on ne savait pas.
Caroline Poggi
Tu attendais, on attendait, tu me disais : je ne sais pas ce que je vais faire, donc je vais filmer GTA, faire un avatar… De fil en aiguille, tu as écrit un texte. Comme Bébé Colère, notre dernier film : il y a eu les images, l’idée du Bébé, puis la commande de la fondation Prada. On a inclu le film dans leur commande.
Jonathan Vinel
Pendant le confinement, Prada est venu nous voir. Nous avions déjà commencé le film, mais leur commande y correspondait.
Caroline Poggi
Le début de l’idée de ce film, c’est de partir exclusivement d’images d’archives. Nous nous sommes dit que ces archives, nous les avions déjà – sauf que c’était nous qui les avions tournées. On est arrivés avec des images de la Corse, de Toulouse… Et après on a créé le Bébé, qui est un peu une archive aussi : c’est un asset qu’on a acheté, pimpé et animé.
Jonathan Vinel
Il existait déjà.
Caroline Poggi
Et c’était chouette que le film se retrouve sur YouTube. Il parlait avec le moment, avec les un an et demi que l’on venait de vivre, enfermés chez nous à se demander à quoi bon, et il y avait ce bébé qui se demandait exactement la même chose.
Revue
Et vous Nicolas, comment avez-vous envisagé ce moment des confinements, et notamment la production de défilé sous forme de vidéos ?
Nicolas di Felice
Une vidéo d’un défilé de mode, je trouve ça très compliqué. Le premier film, on l’a tourné en une seule prise, comme un vrai défilé. Et c’était diffusé une heure et demie après. J’ai l’impression que cette énergie se voit. Il manquait juste le public.
Jonathan Vinel
Même si un projet ne se passe pas exactement comme on aurait pu l’espérer, on garde toujours des choses des idées que l’on a eues.
Nicolas di Felice
J’ai l’impression que toutes les discussions que l’on a, les rêves que l’on s’échange, même si ça ne se fait pas, ça laisse toujours quelque chose que l’on peut ressortir le lendemain. Les grosses looses aussi, d’ailleurs.
Caroline Poggi
Il y a des personnages que l’on fait sauter de projet en projet. On se dit toujours : la prochaine fois, ce sera la bonne !
Nicolas di Felice
J’ai une robe, aussi, qui est là depuis le premier défilé. Et qui a un peu changé, mais finalement je l’ai trop changée… J’ai revu sa première version, et je me suis rendu compte qu’il fallait que je m’en rapproche à nouveau. Je pense que ça va être son moment, là.
Jonathan Vinel
Pour chaque collection, tu repars de zéro ? Ou il y a des idées, des fils que tu tires de collection en collection ?
Nicolas di Felice
Je tire des fils non-stop. Je ne repartirai jamais de zéro.
C’est une histoire que j’écris petit à petit. Qui a commencé depuis que l’on m’a donné l’opportunité de parler en mon nom. Je pense que je fais ça pour que ça ait un sens pour moi. Tout ce que je fais a été une évolution.
Le premier défilé, c’était la boîte blanche. Puis, le suivant, on était uniquement dans la nature, mais le carré blanc était peint sur l’herbe. Et la dernière campagne, ce sont les mêmes personnes qui étaient dans le carré blanc, endormies dans le métro. Et ensuite, le défilé de mars arrive.
Jonathan Vinel
Ça se déploie, comme des échos.
Nicolas di Felice
J’essaie de laisser quelques surprises, mais la trame est écrite. Je ne peux pas recommencer à zéro. Je fais un métier où on ne sait jamais quand ça va se terminer, et j’en ai conscience. Si ça se termine demain, j’ai envie de regarder ce que j’ai fait, et me dire que j’ai écrit une histoire qui a un sens pour moi.
Caroline Poggi
Quand je vois que nous on travaille sur un scénario pendant quatre ans… Ça correspond à ce que tu dis. Tu pars avec tes totems, tes images de cœur, et puis tu les fais grandir. Mais tu grandis aussi avec…
Rose poussière
Karla Black
Décrire les sculptures de Karla Black est un exercice proche de la poésie, tant leurs qualités s’épanouissent dans les contrastes. Délicates et pourtant brutes, matérielles et néanmoins évanescentes, puisant dans l’intime autant que dans l’abstrait, elles se lisent comme de sublimes énigmes. Couleurs pures, formes froissées et transparences composent le vocabulaire esthétique de l’artiste écossaise, nominée en 2011 au Turner Prize et à l’honneur de son pavillon national lors de la Biennale de Venise cette même année. Son universchromatique se décline dans de douces gammes pastel. Pour ce faire, elle utilise divers éléments : matériaux de construction – comme l’enduit ou le plâtre – ou produits de beauté – talc et autres fards à paupières –, sans pour autant les hiérarchiser ou les conceptualiser. Début 2022, lors de sa quatrième exposition personnelle à la galerie londonienne Modern Art, Karla Black a présenté un ensemble de nouvelles pièces. Sculptures de papiers imbibées d’encres, elles signent un retour vers une forme d’absolu, témoignage de ses deux dernières décennies de pratique, mais aussi conséquence de la pandémie. En discussion avec Justin Morin, l’artiste évoque ici les coulisses de son travail, sa relation avec le monde de la cosmétologie et les limites du marché de l’art.
Justin Morin
Ma première question porte sur l’aspect matériel de votre travail. Vos pièces dépendent du monde physique, du poids ou de la légèreté des matériaux que vous utilisez et de la lumière qui va révéler toutes les nuances de leurs couleurs. Je n’ai jamais assisté à la réalisation de vos pièces, mais je suppose qu’elle est liée à votre corps, comme pour une chorégraphie. J’imagine que vous devez vous rapprocher du sol ou tourner autour des pièces suspendues. Je me demandais si cet aspect de performance, bien que non documenté, vous intéresse.
Karla Black
C’est une bonne question, car mon travail est aux antipodes de la performance. Ce qui m’intéresse, c’est la forme finie que je donne à regarder. J’ai le sentiment que si je savais que quelqu’un m’observe ou me photographie pendant que je réalise une pièce, je serais paralysée et incapable de travailler, ou du moins de bien travailler. En fait, cela s’est déjà produit et j’ai eu l’impression d’être complètement paralysée. J’aime tout simplement travailler, bouger, créer et utiliser les matériaux, je n’aime pas réfléchir pendant que je réalise une pièce car ça gâche le moment de la création.
Justin Morin
Votre gamme de couleurs s’inspire des cosmétiques au sens large, du maquillage aux articles pour bébés… Mais beaucoup de couleurs sont absentes de vos sculptures. Par exemple, le bleu Klein, un ton très séduisant, mais référencé… Au cours des dix dernières années, l’industrie du maquillage a créé de nombreux produits aux couleurs vives et pop. Êtes-vous attirée par ces teintes et leurs vibrations ? Ou ne sont-elles pas appropriées à votre travail ?
Karla Black
J’utilise la couleur comme j’utilise la forme. D’une certaine manière, je la considère comme un matériau. C’est vraiment la teinte qui m’importe.

Karla Black, Apart From Itself, 2022. Papier à dessin, encre d’aquarelle, 47 × 56 × 29 cm. Avec l’aimable autorisation de Modern Art, London & Capitain Petzel, Berlin. Photo : Tom Carter.
Tout comme les sculptures ne sont presque que des objets ou seulement des objets, la couleur n’est que de la couleur. Je n’utilise jamais de couleurs primaires parce que j’essaie avant tout de ne me rapprocher de rien d’existant, ou de tendre vers le blanc.
Justin Morin
J’ai découvert avec plaisir votre installation à Dhondt-Dhaenens en 2017. Pourriez-vous partager avec nous votre processus de création pour ce type d’exposition destinée à un site spécifique ? Travaillez-vous à partir d’une maquette de la galerie ? Ou employez-vous un vocabulaire préexistant une fois sur place ? Combien de jours consacrez-vous à l’installation d’une exposition comme celle-ci ?
Karla Black
Une grande partie de la préparation sedéroule dans l’atelier, mais l’œuvre est seulement « terminée » sur place. J’adapte les sculptures, certaines plus que d’autres – parfois elles sont même réalisées in situ – pendant que je travaille dans la galerie. De nombreux paramètres physiques participent à leur création : ma réalité physique, mes limites, mon énergie, etc., les matériaux et l’environnement – l’action de la gravité, en particulier – et enfin la taille, la forme, l’accès et les différents points de vue possibles dans la galerie. Je travaille généralement entre quatre et sept jours pour réaliser ce genre d’exposition.
Justin Morin
Une autre question très pragmatique concerne les coulisses de votre travail. Vous avez parfois utilisé de grandes quantités d’un même produit. Lorsqu’un produit vous intéresse, qu’il s’agisse d’un type de revêtement particulier ou d’un papier toilette pastel, l’achetez-vous en grande quantité en prévision des travaux à venir ?
Karla Black
J’achète juste la quantité de matériel nécessaire à la réalisation de l’exposition sur laquelle je travaille, je ne fais pas de stock à l’avance. Souvent, l’institution ou la galerie finance les matériaux et fait en sorte qu’ils soient expédiés directement sur place, car cela peut représenter un budget conséquent et s’avérer compliqué sur le plan logistique.
Justin Morin
Je sais que cet aspect ne fait pas partie de vos priorités, mais je suis curieux de connaître les instructions que vous fournissez aux acquéreurs de vos pièces. Ce protocole est bien connu quand il concerne des artistes de performance, mais il est moins courant pour la sculpture (bien que vos créations se situent quelque part entre sculpture, performance et peinture). Je voulais vous demander si vous aviez senti une certaine réticence dans le monde de l’art (qu’il s’agisse de collectionneurs, de conservateurs ou de galeristes) concernant l’aspect « vivant » de votre travail ?
Karla Black
Oh oui, bien sûr. La sculpture est plus excitante pour moi lorsqu’elle reste proche de la réalité physique qui fait de l’objet une illusion. J’aime penser à la façon dont tout dans le monde physique s’assemble ou se sépare, comme si la masse devenait de l’énergie, puis redevenait masse avant de redevenir énergie. Notre perception limitée du temps ne nous permet pas de voir ce qui se passe, mais cela ne change rien au fait que les choses se passent. J’aime que le matériau conserve le plus longtemps possible son énergie et sa capacité de transformation.
Plus précisément, cela signifie qu’il faut en quelque sorte permettre aux matériaux de conserver leur capacité de transformation à une très grande échelle. C’est l’ambition que j’ai pour mon travail en général : forcer l’institution à présenter la fonction première de l’art : donner à voir l’aspect difficile, désordonné, chaotique du comportement humain, qu’il faut absolument permettre et préserver. J’espère atteindre cet objectif avec mon travail – il oblige cette fonction première de l’art à apparaître dans l’arène de l’institution et dans les canons historiques, car c’est quelque chose qui a beaucoup manqué ces derniers temps, avec les foires d’art et les galeries, qui proposent des objets transférables.

Karla Black, Turner Prize, Baltic Centre for Contemporary Art, 21 octobre 2011 — 8 janvier 2012. Avec l’aimable autorisation de Modern Art, London & Capitain Petzel, Berlin. Photo : Colin Davison.
Le public devrait être confronté à des objets réels. Je veux créer un objet réel, pas seulement une sorte d’objet historique, mort et immuable.
Justin Morin
Vous est-il facile de donner un titre à vos œuvres ?
Karla Black
Une fois l’œuvre terminée, j’y réfléchis davantage et je lui donne un titre. Je la considère d’un point de vue psychanalytique et le processus de création est un peu comme un « jeu » de passage à l’acte, comme lorsqu’on agit et qu’on se demande ensuite « Qu’est-ce que j’ai fait ? ». J’agis, puis j’y pense après coup et j’essaie de traduire en titre mon comportement.
Justin Morin
Pour finir, j’aimerais conclure avec quelque chose que j’ai lu dans votre entretien avec Veronica Simpson pour le site de Studio International. Vous avez expliqué qu’à un moment de votre vie, les cosmétiques vous ont apporté un sentiment de paix (je fais référence à votre anecdote concernant les produits Clinique que vous aligniez chez vous). Il est assez rare que des artistes soient à l’aise avec quelque chose qui est considéré comme superficiel. C’est ce qui me plaît vraiment dans votre travail. Dans son minimalisme, il comporte une couche complexe de références à l’histoire de l’art, à la sensorialité, à l’expérimentation, aux questions de hiérarchie et aux interprétations personnelles. Aussi vaste soit-elle, quelle serait votre définition de la beauté ?
Karla Black
Je n’ai jamais considéré que les cosmétiques, les produits de toilette ou les « produits de beauté » étaient superficiels. On peut aspirer à les utiliser, ils peuvent représenter un signe de réussite sociale, tant pour soi qu’aux yeux des autres.Pour moi, il n’y a pas de hiérarchie de matériaux. Dans un magasin, des pigments en poudre sont vendus en tant que « matériel d’art » et dans un autre, des pigments en poudre sont vendus pour être étalés sur la peau. Tout vient de la terre. Tout ce que je peux dire, c’est que je fais ce que je veux faire. C’est le plus important pour moi. Pour moi, créer est une question de liberté. J’ai décidé très tôt de m’autoriser à être libre quand je crée. En pratique, cela signifie que si une couleur me plaît, je l’utilise, et que si j’ai envie de travailler avec un matériau particulier, je le fais. Créer est déjà assez difficile, alors autant m’amuser le plus possible en faisant ce que j’aime. Quand je travaille, je ne réfléchis pas trop au processus de création, sinon je me paralyserais. Si je me focalisais dessus, ça me tuerait, surtout au début.
Malheureusement, je ne peux pas vous donner ma définition de la beauté, je n’ai pas les mots pour cela. Je crois que tout ce que je peux dire, c’est que pour savoir comment j’essaie de la définir, il faut regarder mes sculptures.

Karla Black, Museum Dhondt-Dhaenens Deurle, Belgique, 23 avril — 18 juin 2017. Avec l’aimable autorisation de Modern Art, London & Capitain Petzel, Berlin. Photo : Rik Vannevel.
EXPLORER REVUE














