La science des odeurs
Sissel TolaasPhilippa Nesbitt
Le travail de Sissel Tolaas trouve sa source dans la recherche et l’enseignement et chevauche l’art et la science pour repenser notre manière de concevoir les odeurs. Elle a enregistré et reproduit l’odeur des villes, des océans, des individus — en d’autres termes de la vie du niveau micro au niveau macro. Ses installations ont été exposées partout dans le monde dans de multiples institutions tels que le Musée d’art moderne de Tokyo, le MoMA, la Galerie nationale de Singapour, le Centre Pompidou, la Biennale de Kochi-Muziris et la biennale de Venise. À travers ses différents projets, elle cherche à bousculer les préjugés qui dictent nos réactions aux odeurs. Sa recherche, d’une complexité délibérée, met en œuvre des méthodes inspirées de ses diverses expériences. Pour Sissel Tolaas, aucun thème ne reste inexploré, aucune odeur n’est interdite.
Philippa Nesbitt Votre travail porte sur l’intangible, il est donc assez difficile de le dépeindre avec des mots. Comment le définiriez-vous ?
Sissel Tolaas Toute ma vie j’ai été animée par une curiosité infinie et irrésistible pour l’invisible. Comment comprendre l’invisible ? Comment potentiellement rendre visible l’invisible ? Mener différentes opérations entre le possible et l’impossible, les entre-deux, est devenu mon quotidien. Je me définis comme une professionnelle de l’entre-deux. Je viens de la chimie organique, de la linguistique et des arts visuels. Au départ, je ne savais ni où j’allais ni dans quelle réalité je me retrouverais.
Tout ce que je savais c’est que j’avais besoin d’air pour rester en vie.
L’air est devenu le centre de mes préoccupations et, puisque chaque nano partie de l’atmosphère contient des molécules odorantes, j’ai fait de l’odeur mon sujet de recherche. Entre 1990 et 1997, j’ai constitué un répertoire considérable à partir d’odeurs réelles. Il consiste en 6730 sources et traite divers thèmes tels que « Odeur et préjugés », « Odeur et souvenir », « Odeur et langage » ou « Odeur et tolérance ».
La présence sur les lieux représente la moitié de mon travail — le travail sur le terrain est essentiel. Je recueille et j’enregistre les odeurs qui m’intéressent. Chaque matin, je me réveille en me disant : « Je respire ! Ça veut dire que je peux travailler. » À chaque inspiration, j’inhale des molécules d’odeur. J’inspire jusqu’à 24000 fois par jour et je déplace 12,7 mètres cubes d’air. Tant qu’il y a une planète à sentir et des habitants à qui apprendre à sentir, je ne m’arrêterai pas.
Depuis 2004, mon Smell Re_searchLab est financé par l’IFF [L’International Flavors & Fragrances Inc]. Grâce à cette aide, j’ai accès à une grande partie des recherches en chimie et en technologie des odeurs. Je possède des outils qui me permettent de recueillir les molécules émises par les sources odorantes. Au moyen de l’analyse chimique, les chimistes en laboratoire décomposent les échantillons recueillis pour en tirer des molécules individuelles identifiables. À partir de ces données, je suis en mesure de reproduire chimiquement l’odeur à l’infini pour atteindre divers objectifs. Chaque échantillon rejoindra ensuite une base de données de molécules dans de vastes archives qui englobent différents thèmes centraux : City SmellScape ; Body SmellScape; Ocean SmellScape (paysage d’odeur de ville, paysage d’odeur de corps, paysage d’odeur d’océan). Ces catégories principales se subdivisent ensuite en sous-catégories : ségrégation, tolérance, pollution, peur, biodiversité, navigation, éducation etc.
La plupart de mes projets s’intéressent au reboot sensoriel, invitant le public à sortir de sa zone de confort et à mettre sa perception à l’épreuve.
Philippa Nesbitt Pouvez-vous m’en dire davantage sur vos archives de données linguistiques ?
Sissel Tolaas Le plus souvent, nous parlons d’odeurs en termes métaphoriques : ça sent comme ci, ça sent comme ça. La majorité des articles scientifiques qui traitent des odeurs et du langage sont rédigés par des hommes, blancs. Rares sont ceux qui se sont rendus sur le terrain pour travailler à partir de langues possédant moins de locuteurs et là où l’odeur est inhérente à la vie quotidienne. Non seulement j’enregistre, reproduis et amplifie les odeurs réelles, mais au fil des ans, j’essaie de trouver des moyens de les communiquer et d’exprimer dans différentes langues leur processus d’inhalation.
J’ai mis au point une méthodologie qui me permet de générer un langage en fonction de la situation que je rencontre. L’odeur est immédiate — on sent quelque chose puis une réaction dans le cerveau provoque des émotions et fait ressurgir des souvenirs — la réflexivité de ce processus sous forme de mots semble complexe. Les odeurs enregistrées et reproduites sont ensuite présentées au public dont on enregistre, analyse et évalue les réactions verbales. Les divers enregistrements d’un même échantillon sont ensuite comparés et servent de base à un mot construit ou à des termes abstraits. Nommer les couleurs est également abstrait. Que signifient vert, jaune et rouge ? Différents phénomènes, émotions et teintes sont codés dans le langage. J’espère qu’un jour nous coderons les odeurs de la même façon.
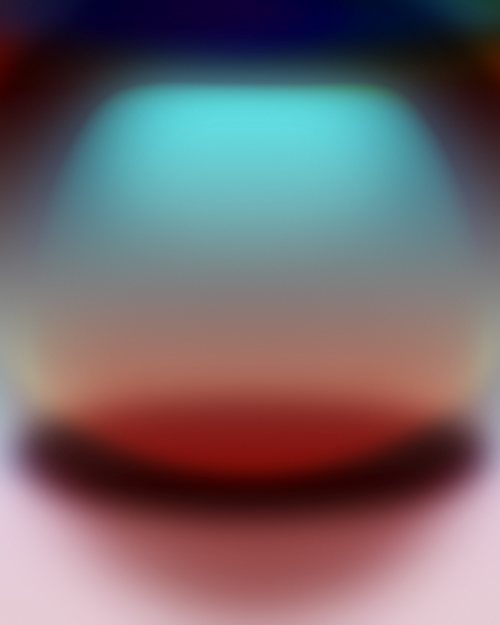
Image de Mathilde Roussel & Matthieu Raffard.
J’ai inventé le Nasalo Lexicon (lexique nasal) comme système de codification pour les besoins de la communication au moyen de molécules d’odeur et de structures odorantes complexes. La recherche est un projet en cours. J’enregistre des gens décrivant une même odeur en un mot ou en un son. Ces expressions abstraites sont ensuite analysées et comparées. Puis chaque terme vient enrichir le Nasalo Lexicon. Cette base de données comporte sa propre logique et ses propres règles linguistiques. Chaque terme a sa propre racine non-dérivée, non-métaphorique, non-métonymique avec des fonctions attributives et prédicatives. En 2019, le Nasalo Lexicon compte 3710 mots et termes.
Philippa Nesbitt Comment les utilisez-vous par la suite ?
Sissel Tolaas J’utilise le lexique au quotidien. J’anime beaucoup d’ateliers pédagogiques et je travaille très souvent avec des enfants. Ils n’ont pas de préjugés et sont souvent très créatifs ; leur capacité à rationaliser n’est pas encore entièrement développée, ils tendent à être beaucoup plus spontanés dans leurs réactions aux odeurs et les résultats sont incroyables ! J’applique ensuite la même méthodologie aux adultes.
Philippa Nesbitt J’ai l’impression qu’on n’associe pas souvent les odeurs au langage, que nos cinq sens ne sont peut-être pas vraiment connectés les uns aux autres.
Sissel Tolaas Notre société et notre culture sont traditionnellement dominées par le visuel. Cependant, la vue nous tient à distance des objets. Nous cadrons des « vues » pour les photos avec les objectifs des appareils photo ; la probabilité d’une réaction intellectuelle est considérable. Par contraste, nous sommes entourés d’odeurs ; elles pénètrent le corps et imprègnent l’environnement immédiat. Nos réactions sont donc bien plus susceptibles de faire intervenir de fortes émotions et d’être retenues plus longtemps.
Nous utilisons les odeurs constamment, consciemment ou inconsciemment, pour communiquer au milieu des plantes, des animaux et des êtres humains.
Philippa Nesbitt À partie de cette idée d’éducation, d’entraînement aux odeurs ou d’enseignement, comment travaillez-vous pour vous détacher des préjugés que nous avons envers des senteurs particulières ?
Sissel Tolaas Nous naissons neutres. Les êtres humains, les cafards et les rats sont les plus grands érudits de la planète. Le nez était, et demeure, un moyen de trouver de la nourriture et des partenaires. Cela semble simple, mais la réalité est différente. Les systèmes sanitaires et les surfaces aseptisées et brillantes sont devenus la norme, en concordance avec notre manière de juger le monde. Il n’existe pas de gène pour nous dire ce qui est bon ou mauvais. On se déodorise et on désinfecte nos environnements à tel point que ça n’en devient bon ni pour nos corps ni pour la planète, et bien au-delà.
J’étais moi aussi pleine de préjugés et j’étais très curieuse de voir si je pouvais m’en débarrasser. La première fois que nous sentons quelque chose, nous créons une référence que nous conservons jusqu’à la fin de notre vie. Cette expérience, chargée d’émotions positives ou négatives influencera notre relation à cette odeur. C’est à ce niveau-là que nous avons besoin d’aide, d’une « détox d’odeurs » et d’une « rééducation aux odeurs ». On rééduque d’autres déficits alors pourquoi pas l’odorat ? J’ai donc utilisé les données scientifiques auxquelles j’ai pu avoir accès, j’ai réalisé le test sur moi-même, puis nous avons pu développer une méthodologie qui fonctionne : je me suis libérée des préjugés et je crois pouvoir dire que suis l’une des « senteuses » les plus tolérantes au monde.
Philippa Nesbitt On retrouve souvent dans vos travaux l’idée que nous considérons notre contexte, tant moral qu’éthique, en termes d’odeur. Selon moi, c’est très important, parce qu’au quotidien nous ne pensons pas l’odeur comme nous percevons nos autres sens.

Image de Mathilde Roussel & Matthieu Raffard.
Sissel Tolaas Exactement. L’un de mes premiers critères, c’est d’aller au-delà de la hiérarchie des odeurs. J’ai par exemple réalisé une étude de terrain dans un bidonville de New Delhi où les odeurs vous pénètrent avant que vous ne pénétriez l’environnement où elles se trouvent. Certains auraient pu faire demi-tour, mais pour moi, c’était le début de l’expérience. C’est incroyable de découvrir à quel point nous pouvons gagner en tolérance et agir par la suite pour permettre aux autres d’évoluer.
Aujourd’hui la politique des odeurs est plus forte que jamais.
Philippa Nesbitt Dans les paysages urbains que vous avez recréés, vous avez évité les clichés des odeurs qu’une ville peut évoquer et vous vous êtes au contraire intéressée à ce que vous appelez les réalités invisibles de la ville. Quels espaces ou quels aspects approchez-vous pour capturer les odeurs urbaines et comment développez-vous le concept d’odeur d’une ville ?
Sissel Tolaas Cela dépend vraiment des thèmes étudiés. Ils peuvent aller de la pollution ou de la ségrégation à l’identité et à la justice. En ce qui concerne la recherche, je sélectionne des zones ou des quartiers et je décide quelles odeurs représentent quel contenu.
Je marche le matin, à la mi-journée, la nuit, sans arrêt, parfois à plusieurs reprises et à différentes saisons. Au cours de cette phase de pré-recherche, je décide si j’ai besoin de mes appareils d’enregistrement ou si je peux simplement rapporter la source odorante au laboratoire pour l’analyser. Je pratique ensuite des analyses et je décompose chaque source en molécules individuelles. Elles sont répliquées et reconstruites au plus proche de l’original. Les odeurs imitées sont ensuite proposées dans divers dispositifs interactifs. Le rapport au site de départ est toujours inclus, il agit comme une extension du dispositif. Il est toujours très important de faire l’expérience du réel.
Philippa Nesbitt J’aime beaucoup cette idée d’abject si présente dans vos travaux. L’idée de ne pas considérer l’abject seulement en termes de matière corporelle comme la sueur, mais aussi dans son rapport à certains environnements. Qu’est-ce qui vous donne envie d’enquêter sur ce sujet et de cette manière-là ?
Sissel Tolaas Tout est question d’honnêteté, rien n’est plus honnête qu’une odeur ; comme je l’ai dit plus tôt, les odeurs viennent à moi et sont si prégnantes que je n’ai pas le choix. Je suis lassée des surfaces. Quand on creuse, on rencontre des obstacles mais les obstacles me stimulent. Ce qui me motive, c’est d’aller au-delà de mes compétences et de ma force. J’ai les outils, les connaissances, j’ai montré au monde que j’ose faire les choses autrement, alors on m’engage souvent pour me rendre dans des zones extrêmes, explorer de nouveaux territoires et étudier des sujets complexes. Je refuse rarement. Quand on veut on peut. Si je ne peux pas être présente sur le terrain, je ne le fais pas. Si quelqu’un me disait : « Sissel, peux-tu reproduire l’odeur de Mars ? », je dirais non. Ce serait trop spéculer. J’en ai assez de la spéculation. Aujourd’hui, je m’intéresse à de nombreux sujets qui traitent de la réalité. Nous devons le faire avant de spéculer, sinon nous allons nous retrouver prisonniers d’une esthétique utopique de zombies dépourvus d’émotions.
Philippa Nesbitt Vous vous intéressez souvent au rapport entre odeur et identité. Qu’avez-vous découvert de la manière dont nous sommes enclins à apprécier une odeur, même si nous ne la penserions pas agréable, à cause de nos préjugés sociaux ?
Sissel Tolaas Je décontextualise de multiples réalités invisibles. Le caractère abstrait d’une odeur in situ est essentiel dans tous mes travaux parce que c’est la seule manière dont le « senteur » est ouvert et accessible à l’information qu’elle fournit. Le défi, c’est de sortir de notre zone de confort qui consiste à en avoir trop pour traiter une odeur seule. Nous vivons dans un monde d’hyperstimulation sensorielle et nos sens sont tristes, et complètement confus.

Image de Mathilde Roussel & Matthieu Raffard.
Les odeurs sont exposées dans un environnement « sûr » — une galerie, un musée, une université — loin de leurs contextes d’origine. Disons que le thème est le corps et la peur : les odeurs reproduites des hommes anxieux sont logées dans la surface des murs. Les murs deviennent une métaphore de la peau. La seule façon d’activer l’odorat est de toucher le mur.
Les odeurs sont une composante essentielle qui permet à chacun de se comprendre et de comprendre l’environnement. Je mets le public au défi d’utiliser son nez et je lui apporte de nouvelles méthodes et de nouveaux moyens de comprendre et d’approcher divers thèmes importants qui le concernent. Il y a un côté ludique dans la découverte du monde à l’aide des odeurs. L’expérience et l’apprentissage dans un contexte joyeux a presque disparu du monde sérieux aux problèmes sérieux dans lequel nous vivons. Apprendre dans un contexte d’émotion est essentiel pour que l’apprentissage soit efficace et modifie nos comportements. Rien n’empeste, mais notre intellect nous pousse à le penser.